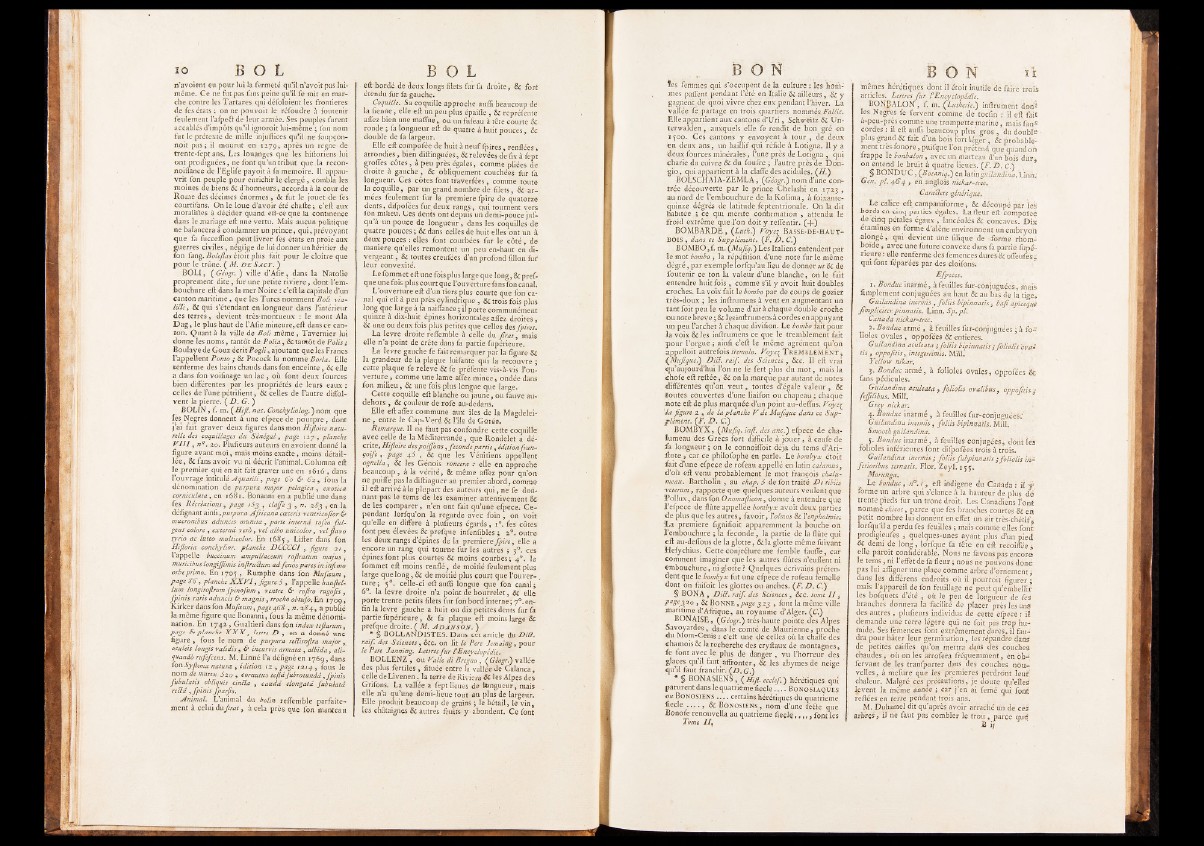
n’avoient eu pour lui la fermeté qu’il n’avoit pas lui-
même. Ce ne fut pas fans peine qu’il fe mit en marche
contre les Tartares qui défoloient les frontières
de fes états ; on ne pouvoit le réfoudre à foutenir
feulement l’afped de leur armée. Ses peuples furent
accablés d’impôts qu’il ignoroit lui7même ; Ion nom
fut le prétexte de mille injuftices qu’il ne foupçon-
noit pas; il mourut en 1279, aPr^s un régne de
trente-fept ans. Les louanges que les hiftoriens lui
ont prodiguées, ne font qu’un tribut que ,1a recon-
noiffance de l’Eglife payoit à fa mémoire. Il appauvrit
fon peuple pour enrichir le clergé , combla les
moines de biens & d’honneurs, accorda à la cour de
Rome des décimes énormes , & fut le jouet de fes
çourtifans. On le loue d’avoir été chatte ; c ’eft aux
moraliftes à décider quand ett-cè que la continence
dans le mariage eft une vertu. Mais aucun politique
ne balancera à condamner un prince, qui,prévoyant
que fa fucceflion peut livrer fes états en proie aux
guerres civiles, néglige de lui donner un héritier de
fon fang. Bolejlas étoit plus fait pour le cloître que
pour le trône. ( M. de Sacy. )
BO L I, Géogr. ) ville d’Afie, dans la Natolie
proprement dite , fur une petite riviere, dont l’embouchure
eft dans la mer Noire : c’eft la capitale d’un
canton maritime, que les Turcs nomment Boli via-
licli, & qui s’étendant en longueur dans l’intérieur
des terres, devient très-montueux : le mont Ala
D a g , le plus haut de l’Afie mineure, eft dans ce canton.
Quant à la ville de Boli même, Tavernier lui
donne les noms, tantôt de Polia, & tantôt de Polis ;
Boulaye de Gouz écrit Pogli, ajoutant que les Francs
l’appellent Ponto ; & Pocock la nomme Borla. Elle
renferme des bains chauds dans fon enceinte, & elle
a dans fon voifinage un lac , où font deux fources
bien différentes par les propriétés de leurs eaux :
celles de l’une pétrifient, & celles de l’autre diffol-
vent la pierre. ( D . G. )
BOLIN, f. m. ( Hifi. nat. Conchyliolog. ) nom que
lès Negres donnent à une efpece de pourpre, dont
j’ai fait graver deux figures dans mon Hifioire naturelle
des coquillages du Sénégal, page 12 7, planche
V I I I , n<?. 20. Plufieurs auteurs en avoient donné la
figure avant moi, mais moins e x a â e , moins détaillée,
& fans avoir vu ni décrit l’animal. Columna eft
le premier qui en ait fait graver une en 1616 , dans
l’ouvrage intitulé Aquatiü, page 6 0 6 - 6 2 , fous la
dénomination de purpura major pelagica , exotica
corniculata, en j68i . Bonanni en a publié une dans
fes Récréations, page i5g , clajj'e 3 , n, 282 , en la
défignant ainfi,purpura Africana coeteris ventricoJior &
mucronibus aduncis munita, parte interna rofeo ful-
gens colore , externâ ver b , vel albo unicolor,' veljlavo
tyrio ac luteo multicolor. En 1685, Lifter dans fon
Hifioria conchylior. planche DCCCCI , figure 2/ ,
l’appelle buccinum ampullaceum rofiratum mdjus,
muricibus longijfimis inftructum ad fenos pàres in infimo
orbe primo. En 1705 , Rumphe dans fon Mufceum ,
page 8G, planche X X F I , figure 5 , l’appelle haufiel-
lum longiroflrum fpinofum, ventre & rofiro rugofis ,
fpinis rafis aduncis & magnis , trocho obtufo. En 1709,
Kirker dans fon Mufieum, page 4G8 , n. 284, a publié
la même figure que Bonanni, fous la même dénomination.
En 1742 , Gualtieri dans fon index tefiarum9
page & planche X X X , lettre D , en a donné une
figure , fous le nom de purpura reclirofira major
aculeis longis validis , & incurvis armata , albida, ali-
quandb rufefcens. M. Linné l’a défignéen 1769, dans
fon Syjlema naturce , édition 12 , page 1214 , fous le
nom de murex S 20 , cornutus te fia J'ubrotundâ , fpinis
fubulatis ^ obliquis cincla , caudd elongatd fubulatâ
reclâ, fpinis fparfis.
Animal. L’animal du bolin reffemble parfaitement
à.celui dufirat 9 à cela près que fon manteau
eft bordé de deux longs filets fur fa droite| & fort
étendu ftir fa gauche.
Coquille. Sa coquille approche auffi beaucoup de
la fienne, elle eft un peu plus épaiffe , & repréfente
affez bien une maffue, ou un fufeau à tête courte &
ronde ; fa longueur eft de quatre à huit pouces, Ô£
double de fa largeur»
Elle eft compofée de huit à neuf fpires, renflées *
arrondies , bien diftinguées, & relevées de fix à fept
groffes côtes, à peu près égales, comme pliées de
droite à gauche , & obliquement couchées fur fa
longueur. Ces côtes font traverfées , comme toute
la coquille, par un grand nombre de filets, & armées
feulement fur la première fpire de quatorze
dents, difpofees fur deux rangs, qui tournent vers
fon milieu. Ces dents ont depuis un demi-pouce juf-
qu a un pouce de longueur , dans les coquilles de
quatre pouces ; & dans celles dë huit elles ont un à
deux pouces : elles font courbées fur le côté , de
maniéré qu’elles remontent un peu en-haut en divergeant
, & toutes creufées d’un profond fillon fur
leur convexité.
Le fommet eft une fois plus large que long, & pref-
que une fois plus court que l’ouverture fâns fon canaL
L ouverture eft d’un tiers plus courte que fon ca-*
nal qui eft à peu près cylindrique , & trois fois plus
long que large à fa naiffance ; il porte communément
quinze à dix-huit épines horizontales affez droites ,
& une ou deux fois plus petites que celles des fpires.
La levre droite reffemble à celle du firat, mais
elle n’a point de crête dans fa partie fupérieure.
La levre gauche fe fait remarquer par la figure &:
la grandeur de la plaque luifante qui la recouvre ;
cètte plaque fe releve & fe préfente vis-à-vis l’ouverture,
comme une lame affez mince , ondée dans
fon milieu, & une fois plus longue que large.
Cette coquille eft blanche ou jaune, oit fauve au-
dehors , & couleur de rofe au-dedans.
Elle eft affez commune aux îles de la Magdeleine
, entre le Cap-Verd & 111e de Gorée.
Remarque. Il ne faut pas confondre cette coquille
avec celle de la Méditerranée, que Rondelet a décrite,
Hifioire despoijfons, fécondé partie, éditionfran-
çoife , page 46 , & que les Vénitiens appellent
ognella, & les Génois roncera : elle en approche
beaucoup, à la vérité, & même affez pour qu’on
ne puiffe pas la diftinguer au premier abord, comme
il eft arrivé à la plupart des* auteurs qui, ne fe donnant
pas le tems de les examiner attentivement &
de les'comparer, n’en ont fait qu’unë efpece» Cependant
lorfqu’on la regarde avec foin , on voit
qu’elle en diffère à plufieurs égards, i° . fes côtés
font peu élevées & prefqlie infenfibles ; 20. outre
les deux rangs d’épines de la première fpire, elle a
encore un rang qui tourne fur les autres ; 30. ces
épines font plus courtes & moins courbes ; 40. le
fommet eft moins renflé, de moitié feulement plus
large que long, & de moitié plus court que l’ouver- v
ture; 50. celle-ci eft auffi longue que fon canal;
6°. >la levre droite n’a point de bourrelet, & elle
porte trente petits filets fur fon bord interne ; 70. enfin
la levre gauche a huit ou dix petites dents fur fa
partie fupérieure, Sz; fa plaque eft moins large &
prefque droite. ( M. A d an so n . )
* § BOLLAND1STES. Dans cet article du Dicl.
raif. des Sciences, &c. on lit le Pere Jemaing, pour
le Pere Janning. Lettres fur tEncyclopédie.- ;
BOLLENZ , ou Fzlle di Bregno , (Géogr.) vallée
des plus.fertiles, fituée entre là vallée de Calanca,
celle deLivenen, la terre de Riviera & les Alpes des
Grifons. La vallée a fept lieues de longueur, mais
elle n’a qu’une demi-lieue tout âu plus de largeur.
Elle produit beaucoup de grains ; le bétail, le vin,
les châtaignes & autres fruits y abondent. Ce font
tes femmes qui s’occupent de la culture : les hommes
paffent pendant l’été en Italie & ailleurs, & y
gagnent de quoi vivre chez eux pendant l ’hiver. La
vallée fe partage en trois quartiers nommés
Elle appartient aux cantons d’U r i, Schwèitz & Un-
terwaîden, auxquels elle fe rendit de bon gré en
1500. Ces cantons y envoyent à tour , de deux
ten deux ans, un baillif qui réfide à Lotigna. Il y a
deux fources minérales, l’une près de Lotigna , qui
charie du cuivre & du foufre ; l’autre près de Don-
igio, qui appartient à la claffe des acidulés. (ZT.)
BOLSCHAIA-ZEMLA, (Géogr.) nom d’une contrée
découverte par le prince Chelashi en 1723 ,
au nord de l’embouchure de la K olima, à foixante-
quinze dégrés de latitude feptentrionale. On la dit
habitée ; ce qui mérite confirmation , attendu le
froid extrême que Ton doit y reffentir. (+ )
BOMBARDE , (Luth.) Foye^ Bassè-de-HAUT-
BOIS , dans ce Supplément, (F. D . C.)
BOMBO;f. m. (.Mufiq.) Les Italiens entendent pair
le mot bombo ; la répétition d’une note fur le même
dégré, par exemple îorfqu’au lieu de donner ut & de
foutenjr ce ton la valeur d’une blanche, on le fait
entendre huit fois , comme s’il y avoit huit doubles
croches. La voix fait le bombo par de coups de gozier
très-doux ; les inftrumens à vent en augmentant un
tant foit peu le volume d’air à chaque double croche
ou note breve ; & les inftrumens à cordes en appuyant
un peu l’archet à chaque divifion. Le bombo fait pour
la voix &Ies inftrumens ce que le tremblement fait
pour l’orguè ; ainfi c’eft le même agrément qu’on
appelloit autrefois trémolo. Foye[ Tremblement,
(JAufiquej JD ici. raif. des Sciences , Sic. Il eft vrai
qu’aujourd’hui l’on ne fe fert plus du mot, mais la
chofe eft reliée, Si on la marque par autant de notes
différentes qu’on v eu t , toutes d’égale valeur , Si
toutes couvertes d’une liaifon ou chapeau ; chaque
note eft de plus marquée d’un point au-deflùs. Foye^
la figure 2 , de la planche F de Mufique dans ce Supplément.
(Z’. D . C.')
BOMBYX, (Mufiq. ih/l. des anci) efpece de chalumeau
des Grecs fort difficile à jou er, à caufe de
fa longueur ; on le connoiffoit déjà du tems d’Ari-
ftote , car ce philofophe en parle. Le bombyx étoit
fait d’une efpece de rofeau appellé en latin calamus,
d’où eft venu probablement le mot françois chalumeau.
Bartholin , au chap. 5 de fon traité De tibiis
•veterum, rapporte que quelques auteurs veulent que
Pollux, dans fon Unomafiicon9 donne à entendre que
l ’efpece de flûte appellée bombyx avoit deux parties
de plus que les autres, fa voir, Yolmos Si Yenpholmiei
•La première fignifioit apparemment la bouche ott
l ’embouchure ; la fécondé, la partie de la flûte qui
eft au-deffous de la glotte, Si la glotte même fuivant
Hefychius. Cette conjeélure me femble fauffe, car
comment imaginer que les autres flûtes n’euffent ni
embouchure, ni glotte ? Quelques écrivains prétendent
que le bombyx fut une efpece de rofeau femelle
dont on fâifoit les glottes ou anches. (F. D . Ci)
§ BON A , DiU. raif. des Sciences, Sic. tome I I ,
page$2.0 , Si Bonne , page 323 , font la même ville
maritime d’Afrique, au royaume d’Alger. (Ci)
BON AISE, (Géogr.) très-haute pointe des Alpes
Savoyardes, dans le comté de Maurienne, proche
du Mont-Cenis : c’eft une de celles où la chaffe des
chamois Si la recherche des cryftaux de montagnes,
fe font avec le plus de danger , vu l’horreur des
glaces qu’il faut affronter, Si les abymes de neige 1
qu’il faut franchir. (Z). G.)
* § BONASIENS, (Hifi. ecclef.) hérétique's qui
parurent dans le quatrième fiecle. . . . Bonosiaques
ou Bonosiens . . . . certains hérétiques du quatrième
fiecle . . . . , Si Bonosiens, nom d’une fêéle que
Bonofe renouvella au quatrième fiecle'. . , font les
Tome JL
memes hérétiques dont il etoit inutile de faire trois
articles. Lettres fu r F Encyclopédie.
BONBÂLON, f. m. .(Lutherie.) infiniment don*
lés Negres fe fervent comme de tocfin : il eft fait
à-peu-près comme une trompette mariné, mais fan S
cordes : il eft auffi beaucoup plus gros , du double
plus grand Si fait d’un bois fort léger , Si probablement
très-fonore, puifque l’on prétend que quand oh
frappe le bonbalon, avec un marteau d’un bois dur
on entend le bruit à quatre lieues. (F. D . C.) 9
§ BO N DU C, (Botaniq.) en htmguilandina. Linrr;
Gen.- pl. 4 6 4 y eh anglôis nickar-tree.
Car allere générique.
Le calice eft campaniforme, Si découpé par les
bords en cinq parties égales. La fleur eft compofée
de cinq pétales égaux , lancéolés Si concaves. Dix
etamines en forme d’alêne environnent un embryon
alôngé, qui devient une filique de -forme rhomboïde
, avec une future convexe dans fa partie fupérieure
: elle renfermé des femences dures Si offeufes 1'
qui font féparées par des cloifons:
Efpece^
1. Boriduc inarmé, à feuilles fur-conjuguées, fnais
Amplement conjuguées au haut Si au bas de la tige.
Guilandina iriermis , fôtiis bïpinnatis ; baji apiceque
fimpliciter. pinnatis. Linn. Sp.pl.
Canada nickar-tree.
. 2* Bonduc armé, à feuilles fur-cOnjuguééS ; à fo~
fioles ovales, oppoféës Si entières.
Guilandina acüleàlà ; foliis bipinnatîs / fôliolis ova»
lis » oppofitis, integerrimis. Mill.
Yellow nikàr.
3. Bonduc armé, à folioles ovales, Oppoféës Si
fans pédicules.
Guilandina aculeata, foliolis ovalïbüs. oppofitis t
fcjjïlibus. Mill. 1 *
Grey nickàr.
4. Bonduc in armé , à feuilles fur-conjuguées;'
Gidlandina inermis, foliis bipinnatîs. Mill;
S mooth gùilandiiid.
5. Bonduc inarmé, à feuilles conjiigées, dont léâ
folioles inférieures font difpofées trois à trois.
Guilandina inermis ; foliis fubpinnatis ; foliolis in*
ferioribus ternatis. Flor. Zey l. 15 j.
Morunga.
Le bonduc, n°. i , eft indigène du Canada : il y
forme un arbre qui s’élance à la hauteur de plus de
trente pieds fur un tronc droit. Les Canadiens fönt
nommé chicot, parte que fes branches Courtes Si en
petit nombre lui donnent en effet un air très-chétif-
iorfqu’il a perdu fes feuilles ; mais comme elles font
prodigieufes , quelques-ünes ayant plus d’un pied
Si demi de long, lörfque fa tête en eft recoiffée £
elle paroît confidérable. Nous ne favons pas encore
le tem$, ni l’effet de fa fleur ; nous ne pouvons donc
pas lui affignerune place comme arbre d’ornement i
dans les différens endroits où ii pourroit figurer ;
mais ^appareil de fon feuillage ne peut qu’embellir
les bofqùets d’été , où le peu de longueur de fes
branches donnera la facilite de placer près les tins
des autres , plufieurs individus de cette èfpéce : il
demande une terre légère qui ne foït pas trop humide.
Ses iemences font extrêmement dures, il fau-»'
dra pour hâter leur germination, les répandre dans
de petitës càiffes qu’on mettra dçns des couches
chaudes, où on les arrofera fréquemment, ën ob-s
fervant de les tranfportef dans des couches nouvelles
, à mefùre que les premierés perdront leur
chaleur. Malgré ces précautions,, je doute qu’elleS
^event la même année ; car j’en ai femé qui font
reliées en terre pendant trois ans.
M. Duhamel dit qu’après avoir arraché un de céS
arbfçs, il ne faut pas combler le trou , parce que
. B ij