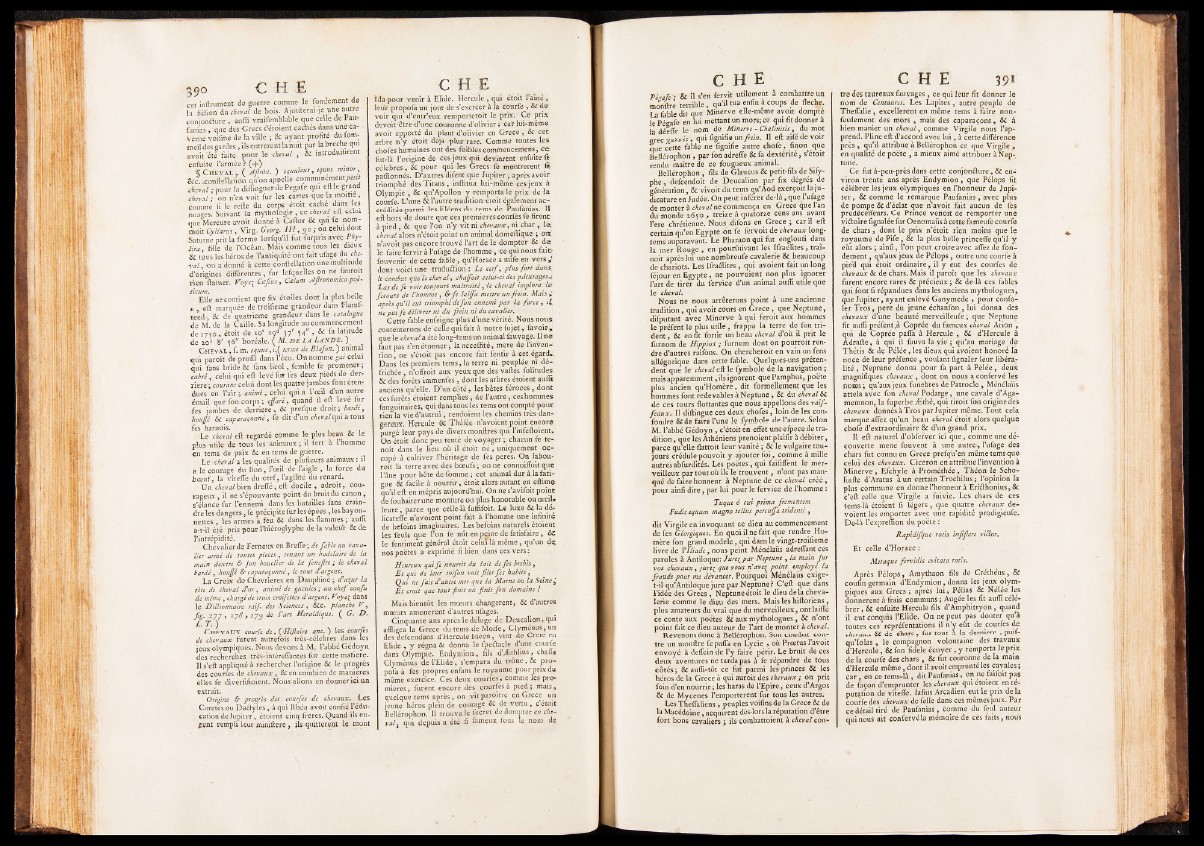
cet infiniment de guerre comme le fondement de
la fiSiôn Su cheval de bois. t— I M autte
conionfture , auffi vraifemblable que celle de Paufanias,
que des 'Grecs s’étoient caches dansuneba- -
Verne Voifine de la ville ; 8c ayant profité du fô®:
meil des gardes , ils entrèrent b nuit-par labrecbe qui
.avoit'été faite .pour le cheval , 8c introduifîrent
enfuite l’armée ? (+ ) .
’« C h e v a i , ( A p ita . ) iqunlcus, cijuus minor,
Sic. .conflellafioii qû’on appelle communément
cheval'; pour la diftinguer de Pegafe qui eft le grand
cheval ; on n'en voit fur les cartes que -la moitié»} .. .
tomme fi le refle du corps étoit cache dans -les
images. Suivant la mythologie , ce cheval eü. celui
que Mercure avoit donné à Caftor 8c qui te nom-
a l , — W / « , .9 0 1 ou cehu dont
-Saturne prit la forme lorfqu’il fut furprrs avec chylira,
fille de l’Océan. M fc comme tous-les dieux
6c tous les héros de Tantiquité-ont fait-ufage du due-
-val, -on a donné à c e t t e conffellation tme multitude
d’origines différentes , fur lefquelles ôn ne fauroit
rien ftarnet. Voye^ Coefms, Galum -Afironomico-poe-
•Elle ne contient que fix'étoiles dont la pli« belle
* , eft marquée de troifieme grandeur dans Flami-
teed- & de quatrième grandeur dâns lé catalogue
de M. de la Caille. Sa longitude au commencement
de 1750, étoit de ios i9d 37' 54" » & lat“ ud€
de 2bd 8' boréale. ( M. d e l a La n d e . )
Oheval , f. m. equus, i f terme de Blafon. ) animal
cui paroît de profil dans l’écu. On nomme gai celui
qui fans bride Ôc fans lico l, femble fe promener;
xabre, celui qui eft levé fur fes deux pieds de derrière
; courant celui dont les quatre jambes font étendues
en l’air ; anime , celui qui a 1 oeil d un autre
émail que fon corps ; effaré, quand il eft levé fur
fes jambes de derrière, & prefque droit; barde,
bouffé & caparaçonné, fe dit d ’un cheval qui a tous
fes harnois. .
Le cheval eft regardé comme le plus beau & le
plus utile de -tous les animaux ; il fert à l’homme
■ en tems de paix & en tems de guerre.
Le cheval a ies qualités de plufieufs animaux : il
a le courage du lion, l’oeil de 1 aigle , la force du
boeuf, la vîteffe du-cerf, l’agilité du renard.
Un cheval bien dreffé,eft docile , adroit, courageux
, il ne s’épouvante point du bruit du canon,
s’élance fur l’ennemi dans les batailles fans craindre
les dangers ,-fe précipite fur les épées , les bay on-
nettes , les armes à feu & dans les flammes ; aufli
a-t-il é,té pris pour ^hiéroglyphe de la valeur & de
l’intrépidité.
Chevalier de Ferneux^en Breffe; de fable au cavalier
armé de toutes pièces , tenant un badelaire de la
main dextre & Jon bouclier-de la fenefire ; le cheval
bardé, .houjfé & caparaçonné, le tout d!argent.
La Croix de Chevrieres en Dauphiné ; d'azur la
tête de cheval d’or, animé de gueules ; nu chef coufu
de même , ckargéde trois croifettes d'argent. Voye^ dans
le Dictionnaire raif des Sciences , &C. planche V y
fig. x y j , £78,2 79 de V-art Héraldique. ( G. D .
C h ev au x courfe de ,QHifioire anc.') les courfes
de chevaux furent autrefois très-célebres dans les
jeux olympiques. Nous devons à M. l’abbé Gédoyn
des recherches très-intéreffantes fur cette matière.
Il s’eft appliqué à rechercher l’origine & le progrès
des courfes de chevaux, & en combien de maniérés
elles fe diverfifioient. Nous allons en donner ici un
extrait.
Origine & progrès des courfes de chevaux. Les
.Curetes ou Da&yles, à qui Rhéa avoit confié l’éducation
de Jupiter, étoient cinq freres. Quand ils eurent
rempli leur miniftere, ils quittèrent le mont
Ida pour venir à Elide. Hercule , qui étoit l’aîné
leur propofa un jour de s’exercer à la eburfe , & dé
voir qui d’entr’ eux remporteroit le prix. Ce prix
devoir 'être d ’une couronne d’olivier ; caî lui-même
avoit apporté du plant d’olivier en G re ce, & cet
arbre n’y étoit déjà plus-rare. Comme toutes les
chofes humaines ont des foibles commencemens, cb
futdà l’origine de ces jeux qui devinrent'enfuite ft
célébrés, & pour qui les Grecs fe montrèrent f i
pafîionnés. D’autresdifent que Jupiter, après avoir,
triomphé des T itans, inftitua lui-même ces jeux à
Olympie -, & qu*Apollon y remporta le prix de la
courfe. L’une & l’autre tradition étoit également accréditée
parmi les Eléens du tems de Paufanias. Il
eft hors de doute que ces premières courfes fe-firent
à-pied, & que l’on n’y vit ni chevaux, ni char , le;
cheval alors n’étoit point un -animal domeftique ; 01*
n?svoit pas encore trouvé l’art de le dompter & de;
le faire fervir à l’ufage de l ’homme -, ce qui nous fâiCr
fouvenir de cette fable-, qu’Horace amife en vers,*
dont voici une traduction : Le cerf , plus fort dans,
k combat ‘ftie ‘le cheval-, chaffoit celui-ci des pâturages4
Las de fe voir toujours maltraité, ‘le cheval implora ie>
fecours de l'homme , & fe laiffa mettre un frein. Mais »
après qu'il eut triomphé de fon ennemi par la force ,
ne put fe délivrer ni du frein ni du cavalier.
Cette fable enfeigne plus d’une vérité. Nous nous;
contenterons de celle qui fait à notre fu je t , fa v o ir ,
: que le cheval a été long-tems un animal fauyage. Il ne
faut pas s’en étonner ; la néceffité, mere de l’invention
, ne s’étoit pas encore fait fentir à eet égards
Dans les premiers tems, la terre ni peuplée ni défrichée,
n’offroit aux yeux que des vaftes foUtudes
& des forêts immenfes, dont les arbres étoient aufli
anciens qu’elle. D’un cô té, les bêtes féroces, dont
ces forêts étoient remplies, de l’autre > ces hommes
fanguinaires, qui dans tous les tems ont compté pour,
rien la vie d’autrui, rendoiènt les chemins très-dangereux.
Hercule & Théfée n’avoient point encore
purgé leur pays de divers monftres qui l’infeftoient»
On étoit donc peu tenté de voyager ; chacun fe te-
noit dans le lieu où il étoit n é , uniquement occupé
à cultiver l’héritage de fes peres. On labou-
roit la terre avec des boeufs ; on ne connoiffoit que
l ’âne pour bête de fomme ; cet animal dur à la fatigue
& facile à nourrir , étoit alors autant en eftime
qu’il eft en mépris aujourd’hui. On ne s’avifoit point
de fouhaiter une monture ou plus honorable ou meil»
leure, parce que celle-là fufflfoit. Le luxe & la dé-
licateffe n’avoient point fait à l’homme une infinité
de befoins imaginaires. Lesbefoins naturels étoient
les feuls que l’on fe mît en pejne de fatisfaire, &
le fentiment général étoit celui-là même, qu’un d$
nos poètes a exprimé fi bien dans ces vers ç
Heureux quife nourrit du lait de fes brebis
Et qui de leur toifon voit filer fes habits,
Qui ne fait d?autre mer que la Marne Ou la Seine y
E t croit que tout finit où finit fon domaine j
Mais bientôt les moeurs changèrent, & d’autres
moeurs amenèrent d’autres ufages.
Cinquante ans après le déluge de Deucalion, qui
affligea la Grece du tems de Moïfe, Clyménus, un
des defeendans d’Hercule Idéen, vint de Crete en
Elide , y régna & donna le fpeûaçle d’une courfe
dans Olympie. Endymion., fils d’Æthlius, chafla
Ciyménus, de l’Elide, s’empara du trône, & propofa
à fes propres enfans le royaume pour prix du
même exercice. Ces deux courfes, comme les premières
, furent encore des courfes à pied ; mais,
quelque tems après, on vit paroitre en Grece^ un
jeune héros plein de courage & de vertu, c étoit
Bellérophon. Il trouva le fecret de dompter ce che±
valx qui depuis a été -fi fameux fous le nom de
p h a h " & il s’en fervit utilement à combattre ütî
monftre terrible, qu’il tua enfin h coups de fléché.
La fable dit que Minerve elle-meme avoit dompte
le Pégafe en lui mettant un mors; ce qui fit donner à
la déefle le nom de Minerve - Chalinids, du mot ;
grec %ahnéc, qui lignifie un frein. Il eft aifé de voir
que cette fable ne lignifie autre chofe, linon que
Bellérophon , par fon adreffe & fa dextérité, s’étoit
rendu maître de ce fougueux animal.
Bellérophon , fils de Glaucus & petit-fils de Sify-
phe, defeendoit de Deucalion par fix degrés de
génération, & vivoit du tems qu’Aod exerçoit la ju-
dioature en Judée. On peut inférer de-là, que l’ufage -
de monter à cheval ne commença en Grece que l’an
du monde 1650 , treize à quatorze cens ans avant
l’ere chrétienne. Nous/difons en Grece ; car il eft
certain qu’en Egypte/ôn fe fervoit de chevaux long-
tems auparavant. Lé Pharaon qui fut englouti dans
la mer Rouge , en pourfuivant les Ifraélites, traî-
noit après lui une nombreufe cavalerie & beaucoup
de chariots. Les Ifraélites, qui avoient fait un long
féjour en Egypte, ne pouvoient non plus ignorer
l’art de tirer du fervice d’un animal aufli utile que
le cheval.
Nous ne nous arrêterons point à une ancienne
tradition, qui avoit cours en G re ce, que Neptune,
difputant avec Minerve à qui feroit aux hommes
le préfent le plus utile, frappa la terre de fon trident
, & en fit fortir un beau cheval d’où il prit le
furnom de Hippius j furnom dont on pourroit rendre
d’autres ràifons. On chercheroit en vain un fens
allégorique dans cette fable. Quelques-uns prétendent
que le cheval eft le fymbole de la navigation ;
mais apparemment, ils ignorent quePamphus, poète
plus ancien qu’Homère, dit formellement que les
hommes font redevables à Neptune, & du cheval &
de ces tours flottantes que nous appelions des vaif-
feaux. Il diftingue ces deux chofes, loin de les confondre
& d e faire l’une le fymbole de l’autre. Selon
M. l’abbé G édoyn , c’étoiten effet une efpece de tradition
, que les Athéniens prenoient plaifir à débiter,
parce qu’elle flattoit leur vanité ; & le vulgaire toujours
crédule pouvoit y ajouter fo i, comme à mille
autresabfurdités. Les poètes, qui faififfent le m e r veilleux
par tout où ils le trouvent, n’ont pas manqué
de faire honneur à Neptune de ce cheval c ré é,
pour ainfi dire, par lui pour le fervice de l’homme :
Tuque ô cui prima frementem
Fudit equum magno tellus pereuffa tridenti ,
dit Virgile en invoquant ce dieu au commencement
de fes Géorgiques. En quoi il ne fait que rendre Homère
fon grand modèle, qui dans le vingt-troifieme
livre de l'Iliade, nous peint Ménélaïis adreffant ces
paroles à Antiloque: Jure^ par Neptune , la main Jur
vos chevaux, jure^ que vous n ave^ point employé^ la
fraude pour me devancer. Pourquoi Menelaiis exige-
t-il qu’Antiloque jure par Neptune? C ’eft que dans
l ’idée des Grecs , Neptune étoit le dieu delà chevalerie
comme le dieu des mers. Mais les hiftoriens ,
plus amateurs du vrai que du merveilleux, ont laifle
ce conte aux poètes & aux m ythologues, & n’ont
point fait ce dieu auteur de l’art de monter à cheval.
Revenons donc à Bellérophon. Son combat contre
un monftre fe pafla en Lycie > où Proetus l’avoit
envoyé à deffein de l’y faire périr. Le bruit de ces
deux aventures ne tarda pas à fe répandre de tous
côtés ; & aufli-tôt ce fut parmi les princes & les
héros de la Grece à qui auroit des chevaux ; on prit
foin d’en nourrir ; les haras de l’Epire, ceux d’Argos
& de Mycenes l’emportèrent fur tous les autres.
Les Theffaliens , peuples voifins de la Grece & de
la Macédoine, acquirent dès-lors la réputation d’être
fort bons cavaliers ; ils combattoient à cheval çontre
des taureaux fauvages , ce qui leur fit donner le
nom de Centaures. Les Lapites ,• autre peuple de
Theflalie, excellèrent en même tems à faire non-
feulement des mors , mais des caparaçons, & à
bien manier un cheval, comme Virgile nous l’apprend.
Pline eft d’accord avec lu i, à cette différence
près , qu’il attribue à Bellérophon ce que Virgile >
en qualité de poète , a mieux aimé attribuer à Neptune.
Ce fut à-peu-près dans cette conjoncture, & environ
trente ans après Endymion, que Pélops fit
célébrer les jeux olympiques en l’honneur de Jupiter
, & comme le remarque Paufanias, avec plus
de pompe & d’éclat que n’avoit fait aucun de fes
prédéceffeurs. Ce Prince venoit de remporter une
victoire fignalée fur Oenomaiis à cette fameitfe courfe
de chars, dont le prix n’étoit rien moins que le
royaume de Pife, & la plus belle princefle qu’il y
eût alors ; ainfi, l’on peut croire avec aflezde fondement
, qu’aux jeux de Pélops, outre une courfe à
pied qui étoit ordinaire, il y eut des courfes de
chevaux & de chars. Mais il paroît que les chevaux
furent encore rares & précieux ; & de là ces fables
qui font fi répandues dans les anciens mythologues,
que Jupiter, ayant enlevé Ganymede , pour confor
1er T ro s , pere du jeune échanfon , lui donna des
chevaux d’une beauté merveilleufe ; que Neptune
fit aufli préfent .à Coprée du fameux cheval Arion
qui de Coprée pafla à Hercule , & d’Hercule à
Adrafte, à qui il fauva la vie ; qu’au mariage de
Thétis & de Pelée, les dieux qui avoient honoré la
noce de leur préfence , voulant fignaler leur libéralité
, Neptune donna pour fa part à Pélée, deux
magnifiques chevaux , dont on nous aconfervé les
noms; qu’aux jeux funèbres dePatrocle , Ménélaiis
attela avec fon cheval Podarge, une cavale d’Aga-
memnon, la fuperbe Æthé, qui droit fon origine des
chevaux donnés à Tros par Jupiter même. Tout cela
marque aflez qu’un beau cheval étoit alors quelquè
chofe d’extraordinaire & d’un grand prix.
Il eft naturel d’obferver ici que, comme une découverte
mene fouvent à une autre», l’ufage des
chars fut connu en Grece prefqu’en même tems que
celui des chevaux. Cicéron en attribue l’invention à
Minerve, Efchyle à Prométhée, Théen le Scho-
liafte d’Aratus à un certain Trochilüs; l’opinion la
plus commune en donne l’honneur à Eriûhonius, &
c’eft celle que Virgile a fuivie. Les chars de ces
tems là étoient fi légers , que quatre chevaux dévoient
les emporter avec une rapidité prodigieufe.
De-là l’expreflion du poète :
Rapidifque rôtis injîjlere viclor.
Et celle d’Horace :
Metaque fervidis evitata rôtis.
Après Pélops, Amythaon fils de Créthéus, &
coufin germain d’Endymion, donna les jeux olympiques
aux Grecs; après lui, Pélias & Nélée les
donnèrent à frais communs ; Augée les fit aufli célébrer
, & enfuite Hercule fils d’Amphitryon, quand
il eut conquis l’Elide. On ne peut pas douter qu’à
toutes ces' repréfentations il n’y eût de courfes de
chevaux &C de chars, fur-tout à la derniere , puif-
qu’Iolas , le compagnon volontaine des travaux
d’Hercule, & fon fidele écuyer , y remporta le prix
de la courfe des chars , & fut couronné de la main
d’Hercule même, dont il avoit emprunté les cavales;
c a r , en ce tems-là, dit Paufanias, on ne faifoit pas
de façon d’emprunter lés chiraux qui étoient en réputation
de vîteffe. Iafius Arcadien eut le prix delà
courfe des chevaux de felle dans ces mêmçs jeux. Par
ce détail tiré de Paufanias , comme du feul auteur
qui nous ait confervéla mémoire de cès faits, nous