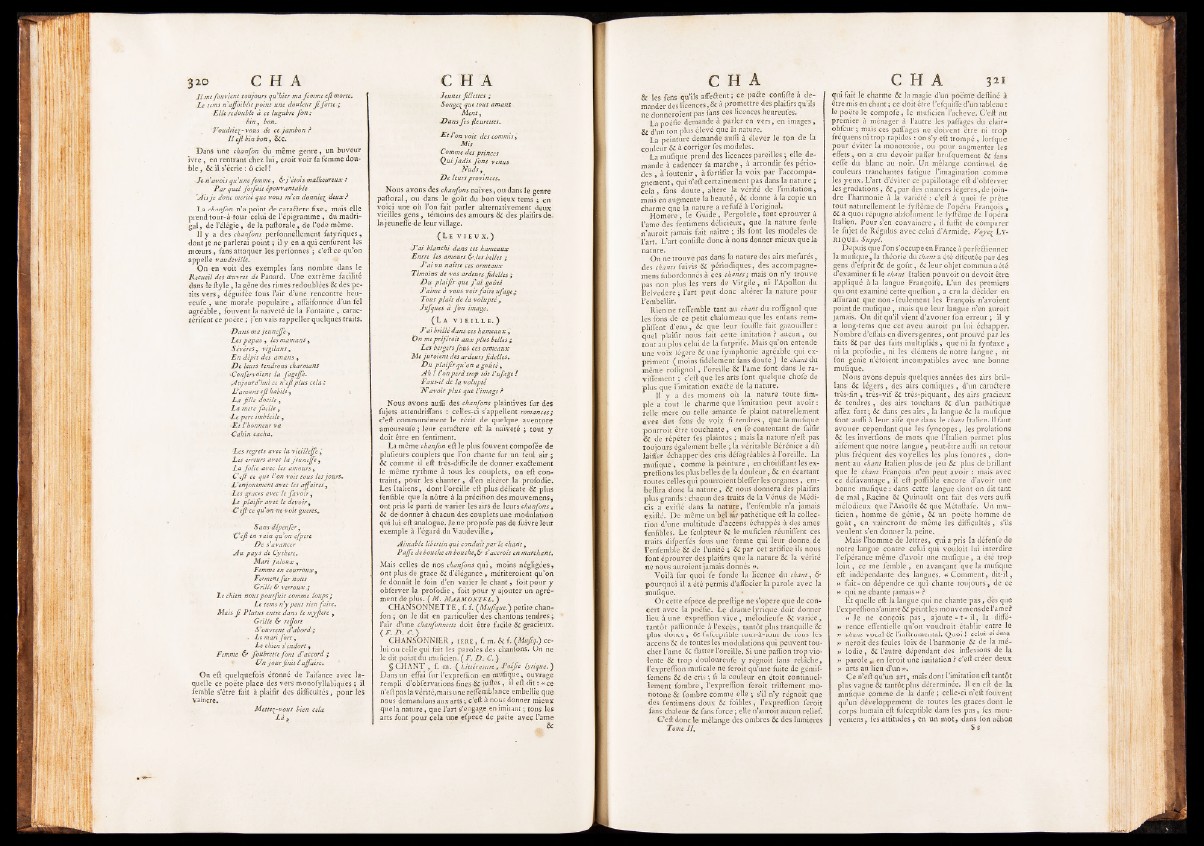
IL me fouvient toujours qu'hier ma femme ejl morte. '
Le tems naffoibht point une douleur Ji forte ;
Elle redouble à ce lugubre fon :
bin, bon.
"Voudriez-vous de ce.jambon ?
I l ejl bin bon, &c.
Dans une chanfon du même genre, un bUVéu'r
iv r e , en rentrant chez lui, croit voir fa femme double
, & il s’écrie : ô ciel ]
Je n av ois qu'une femme, 6‘j'étois malheureux :
Par quel forfait épouvantable
'Àisje donc mérité que vous m'en donniez deux ?
La chanfon n’a point de cara&ere fixe, mais elle
prend tour-à>tour celui de l’épigramme , du madrigal
, de l’élégie, de la paftorale, de l’ode même.
Il y a des chànfons perfonnellement fatyriques,
dont je ne parlerai point ; il y en a qui cenfurent les
moeurs , fans attaquer lesperfonnes ; c’eft ce qu^on
appelle vaudeville.
On en voit des exemples fans nombre dans le
Recueil des oeuvres de Panard. Une extrême facilité
dans-le fty le , la gêne des rimes redoublées & des p etits
vers, déguifée fous l’air d’une rencontre beu-
reufe , une morale populaire , affaifonnée d’un fel
agréable, fouvent la naïveté de la Fontaine , carac-
térifent ce poëte ; j’en vais rappeller quelques traits.
■ Dans ma jeuneffe-y
Les papas , les mamans ,
Sévéres, vigilans,
En dépit des amans ,
De leurs tendrons charmans
-•Confervoient la fageffe.
Aujourd'hui et n'ejl plus cela :
Damant ejl habile 7
La fille docile,
La mere facile ,
De pere imbécile ,
■ Et l'honneur va
Gahin cacha.
'Les regrets avec la vieilleffeÿ
Les erreurs avec la jeuneffe ,
La folie avec les amours $
C'efi ce que l'on voit tous les jours.
L'enjouement avec les affaires ,
Les grâces avec le f avoir ,
Le plaifir avec le devoir,
LJ ejl ce quon-ne voit gueres.
S ans'dépênfer,
"C'efi en vain qu'on efpere
De s'avancer
Au pays de Cythere.
-Mari ja lou x ,
Femme en courroux ,
Ferment fur notis
Grille & ver roux
Le chien nous pour fuit pomme loups
Le tems n'y petit rien faire.
Mais f i Plutus entre dans le myfiere ,
Grille & reffort
S'ouvrent d'abord^
Le mari fort,
Le chien s'endort,
Femme & foubrette font d'accord ;
Un jour finit l'affaire.
On eft quelquefois étonné de l’aifance avec laquelle
ce poëte place des vers monofyllabiques ; il
.femble s’être fait à plaifir des difficultés, pour les
vaincre.
Mettez-vous bien cela
La ,
Jeunes fillettes ;
Songez que tout amant
Ment,
Dans fes fleurettes.
E t l'on voit des commis y
Mis
Commedes princes
Qui jadis font venus
NudSy
De leurs provinces.
Nous avons des chànfons naïves, ou dans le genre
pafioral, ou dans le goût du bon vieux tems ; en
voici une oii l’on fait parler alternativement deux
vieilles gens, témoins des amours & des plaifirs de.
la jeuneffe de leur village.
( L e v i e u x . )
■ J'ai blanchi dans ces hameaux
Entre les amours &.les belles ;
J'ai vu naître ces ormeaux
Témoins de vos ardeurs fidelles ;
D u plaifir que j'ai goûté
J'aime a vous voir faire ufage,;
Tout plaît de la volupté ,
Jufques à fon image.
( L a v i e i l l e . )
J'ai brillé dans ces hameaux j
On me préféroit aux plus belles ,•
Les bergers fous ces ormeaux
Me juraient des ardeurs fidelles.
Du plaifir qu'on a goûté,
Ah ! l'on perd trop tôt Tuf âge !
Faut-il de la volupté
‘N ’avoir plus que T image?
Nous avons auffi des chànfons plaintives fur des
fujets attendriffans : celles-ci s’appellent romances
c’eft communément le récit de quelque aventure
amoureufe ; leur caraûere eft la naïveté ; tout y
doit être en fentiment.
La même chanfon eft le plus fouvent compofée de
plufieurs couplets que l’on chante fur un feul air .;
& comme il eft tres^difficile de donner exaftement
le même rythme à tous les couplets, on eft contraint,
pour les chanter, d’en altérer.la profodie.
Les Italiens, dont l’oreille eft plus délicate & plus
fenfible que la nôtre à la précifion des mouvemens;
ont pris le parti de varier les airs de leurs chànfons+
& de donner à chacun des couplets une modulation
qui lui eft analogue. Je ne propofe pas de fuivre leur
exemple à l’égard du Vaudeville.,
Aimable libertin qui conduit par le chartt 9
Paffe de bouche en bouche fit s'accroît en marchant.
Mais celles de nos chànfons qui, moins négligées ^
ont plus de grâce & d’élégance, mériteroient qu’on
fe donnât le foin d’en varier je chant, foitpour y
obferver la profodie, foit pour.y ajouter un agrément
de plus. ( M. Ma rm o n te l . )
CHANSONNETTE, f. f. (Mufique.) petite chanr
fon ; on le dit en particulier des chantons tendres ;
l’air d’une chanfonnette doit être facile & gracieux.
( F. D . C. )
CHANSONNIER, iere , f. m. & f. (Mufiq) celui
ou Celle qui fait les paroles des chànfons. On ne
le dit point du iriuficien. ( F. D. C. )
§ CHANT , f. m. ( Littérature, Poéfie lyrique. )
Dans un effai fur l’expreffion en mufique, ouvrage
rempli d’obfervations fines & juftes, il eft dit : « ce
n’eft pas la vérité,mais une reffemblance embellie que
nous demandons aux arts ; c’eft à nous donner mieux
que la nature, que l’art s’engage en imitant ; tous les
arts font pour cela une efpece de paâe avec l’ame
& les fens qu’ils affeaent; ce pade confifte à demander
des licences, & à promettre des plaifirs qu’ils
ne donneraientpas'fans ces licencés.heureules,,
La poéfie demande à parler en vers, en images ,
& d’un ton plus élevé que la nature.
La peinture demande auffi à élever le ton de la
couleur & à corriger fes modèles;
La mufique prend des licences pareilles ; elle demande
à cadencer fa marche, à arrondir fes périodes
, à foutenir, à fortifier la voix par l’accompagnement
, qui n’eft certainement pas dans la nature ;
Cela, fans doute, altéré la vérité de l’imitation,
mais en augmente la beaute, & donne à la copie un
charme que la nature a refufé à l’originaL
Ho mere, le Guide, Pergolefe, font éprouver à
l’amé dès fentimens délicieux, que la nature feule
n’auroit jamais fait naître ; ils font les modèles de
' l’art. L’art confifte donc à nous donner mieux que la
On ne trouve pas dans la nature des airs mefurés,
des chants fuivis & périodiques, des accompagne-
mens fubordonnés à ces chants; mais on n’y trouve
pas non plus les vers de Virgile, ni l’Apollon du
Belvedere ; l’art peut donc altérer la nature pour
l’embellir.
Rien ne reffemble tant au chant du roffignol que
les fons de ce petit chalumeau que les enfans rem-
pliffent d’eau, & que leur fouffle fait gazouiller:
quel plaifir nous fait cette imitation } aucun, ou
tout au plus celui de la furprife. Mais qu’on entende
une voix légère & une fymphonie agréable qui expriment
(moins fidèlement fans doute ) le chant du
même roffignol, l’oreille & l’ame font dans le ra-
viffement ; c’eft que les arts font quelque chofe de
plus que l’imitation exatte de la nature.
Il y a des momens oîi la nature toute Ample
a tout le charme que l’imitation peut avoir :
telle mere ou telle amante fe plaint naturellement
avec des fons de voix fi tendres, que la mufique
pourroit être touchante, en fe contentant de faifir
& de répéter fes plaintes ; mais la nature n’eft pas
toujours également belle ; la véritable Bérénice a dû
laiffer échapper des cris défagréables à l’oreille. La
mufique , comme la peinture , en choififfant les ex-
preffions les plus belles de la douleur, & en écartant
toutes celles qui pourroient bleffer les organes , embellira
donc la nature, & nous donnera des plaifirs
plus grands : chacun des traits de la Vénus de Médi-
cis a exifté dans la nature, l’enfemble n’a jamais
exiftë. De même un bel air pathétique eft la collection
d’une multitude d’accens échappés à des âmes
fenfibles. Le fculpteur & le muficien réunifient ces
traits difperfés fous une'forme qui leur donne.de
l ’enfemble & de l’unité ; & par cet artifice ils nous
font éprouver des plaifirs que la nature & la vérité
ne nous auroient jamais donnés ».
Voilà fur quoi Te fonde la licence du chant, &
pourquoi il a été permis d’affocier la parole avec la
mufique.
Or cette efpëce de preftige ne s’opère que de concert
avec la poéfie. Le drame lyrique doit donner
lieu à une expreflion v iv e , mélodieufe & variée,
tantôt paffionnée à l’excès, tantôt plus tranquille &
plus douce, & fufceptible tour-à-tour de tous les
accens & de toutes les modulations qui peuvent toucher
l’ame & flatter l’oreille. Si une paffion trop violente
& trop douloureufe y régnoit fans relâche,
l’expreffion muficale ne feroit qu’une fuite de gémif-
femens & de cris ; fi la couleur en étoit continuellement
fombre, l’expreffion feroit triftement monotone
& fombre comme elle ; s’il n’y régnoit que
des fentimens doux & foibles, l’expreffion feroit
fans chaleur & fans force ; elle n’auroit aucun relief.
C’eft donc le mélange des ombres ôc des lumières
Tome II.
qui fait le charme & la magie d’un pôë’me deftiné à
être mis en chant ; ce doit être l’efquifle d’un tableau î
le poëte le compofe, le muficien l’acheve, C ’eft ail
premier à ménager à l’autre les paflàges du claire
obfcur ; mais ces paffages ne doivent être ni trop
fréquens ni trop rapides : on s’y eft trompé , lorfque
pour éviter la monotonie, ou pour augmenter les
effets, on a cru devoir paffer brufquement & fans
ceffe du blanc au noir. Un mélange continuel de
couleurs tranchantes fatigue l’imagination comme
les yeux. L’art d’éviter ce papillotage eft d’obferver
les gradations, & , par des nuances légères,de joindre
l’harmonie à la variété : c’eft à quoi fe prête
tout naturellement le fyftême de l’opéra François ,
& à quoi répugne abfolument le fyftênje de l’opéra
Italien. Pour s’en convaincre, il fuffit de comparer
le fujet de Régulus avec celui d’Armide. Voyez L yriq
u e. Suppl.
Depuis que l’on s’occupe en France à perfeélionner
la mufique, la théorie du chant a été difeutée par des
gens d’efprit& de goût, & leur objet commun a été
d’examiner fi le chant Italien pouvoit ou devoit être
appliqué à la langue Françoife. L’un des premiers
qui ont examiné cette queftion, a cru la décider en
affurant que non-feulement les François n’avoient
point de mufique , mais que leur langue n’en auroit
jamais. On dit qu’il vient d’avouer fon erreur ; il y
a long-tems que cet aveu auroit pu lui échapper.
Nombre d’effais en divers genres, ont prouvé par les
faits & par des faits multipliés , que ni la fyntaxe ,
ni la profodie, ni les élémens de notre langue , ni
fon génie n’étoient incompatibles avec une bonne
mufique.
Nous avons depuis quelques années des airs bril-
lans & légers, des airs comiques , d’un câraftere
très-fin , très-vif & très-piquant, des airs gracieux
& tendres , des airs touchans & d’un pathétique
affez fort ; & dans çes airs, la langue & la mufique
font auffi à leur aife que dans le chant Italien. 11 faut
avouer cependant que les fyncopes, les prolations
& les inverfions de mots que ritalien permet plus
aifément que notre langue, peut-être auffi un retour
plus fréquent des voyelles les plus fonores , donnent
au chant Italien plus de jeu & plus de brillant
que le chant François n’en peut avoir : mais avec
ce défavanrage, il eft poffible encore d’avoir une
bonne mufique : dans cette langue dont on dit tant
d e mal, Racine & Quinault ont fait des vers auffi
mélodieux que l’Ariofte & que Métaftafe. Un muficien
, homme de génie, & un poëte homme de
g o û t, en vaincront de même les difficultés, s’ils
veulent s’en donner la peine.
Mais l’homme de lettres, qui a pris la défenfe de
notre langue contre celui qui vouloit lui interdire
l’efpérance même d’avoir une mufique, a été trop
lo in , ce me femble , en avançant que la mufique
eft indépendante des langues. «Comment, dit-il,
» fait-on dépendre ce qui chante toujours, de ce
» qui ne chante jamais » ?
Et quelle eft la langue qui ne chante pas, dès que
l’expreffion s’anime & peint les mouvemens de l’ame }
« Je ne conçois pas, a j o u t e - t - i l , la diffé-
» rence effentielle qu’on voudroit établir entre le
» chant vocal & l’inllrumental. Quoi! celui-ciéma-
» neroit des feules loix de l ’harmonie & de la mé-
» lodie, ÔC l’autre dépendant des inflexions de la
» parole ^ en feroit une imitation ? c’eft creer deux
» arts au lieu d’un ».
Ce n’eft qu’un art, mais dont l ’imitation eft tantôt
plus vague & tantôt plus déterminée. Il en eft de la
mufique comme de la danfe ; celle-ci n’eft fouvent
qu’un développement de toutes les grâces dont le
corps humain eft fufceptible dans fes pas, fes mouvemens,
fes attitudes, en un tnot, dans fon aétion