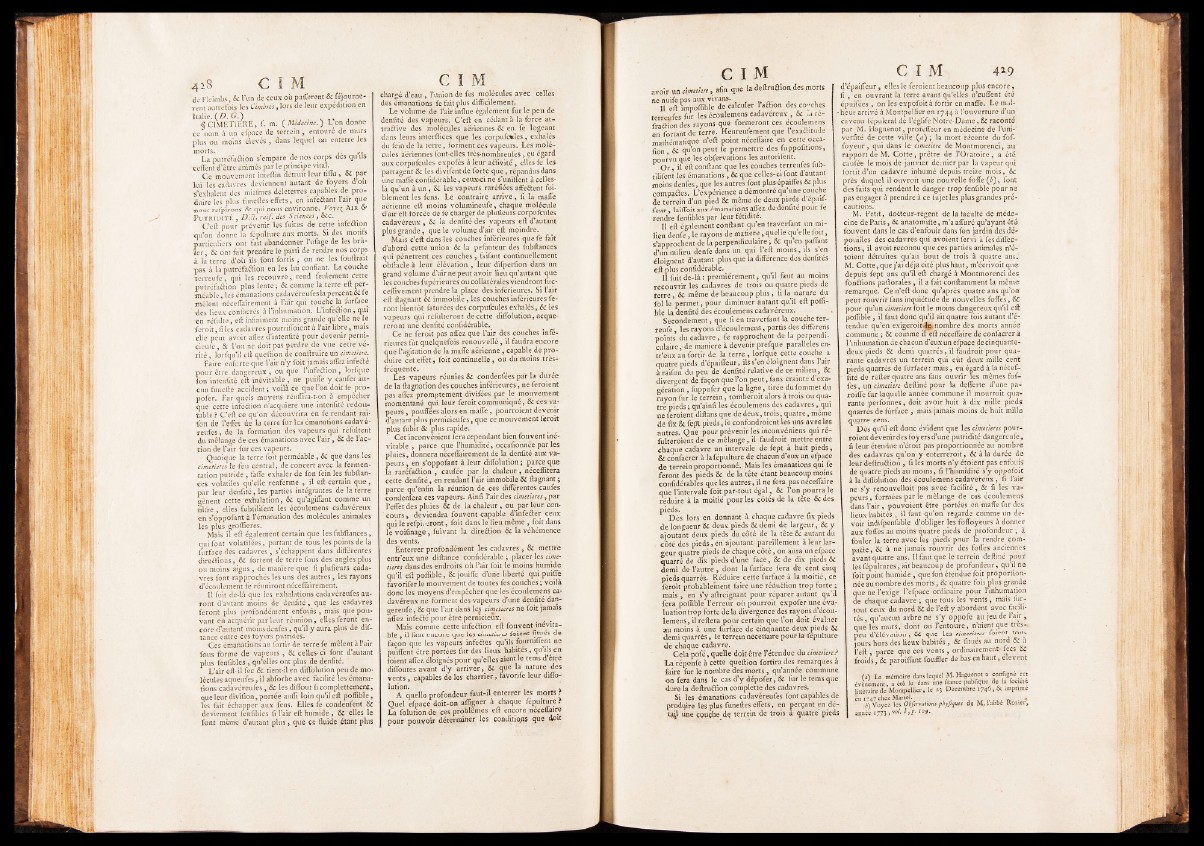
m C I M
de Fleimbs, & l’un de ceux où pafferent-& féjourne-
rent autrefois les Cimbrés, lors de leur expédition en
'Italie. (Z>. G .) , . v T, ,
§ CIMETIERE, f. m. ( Médecine. ) L on donne
ce nom à un efpace de terrein , entouré de murs
plus ou moins élevés , dans lequel qn enterre les
morts. • . , •
La putréfa&ion s’empare de nos corps des quils
ceffent d’être animëspar le principe vital.
Ce mouvement inteftin détruit leur tiflii, & par
lui les cadavres deviennent autant de foyers d’où
•s’exhalent des miafmes déleterres capables de produire
les plus funeftes effets, en irifeftant l’ air que
nous refpirons & qui nous environne. Voye{ AiR &
Putridité , Dicl. raif. des Sciences , &c.
C’eft pour prévenir les fuites de cette infettion
'qu’on donne la fépulture aux morts. Si des motifs
particuliers ont fait abandonner l’ufage de les brûl
e r , & ont fait prendre le parti de rendre nos corps
à la terre d’où ils font fortis , on ne les fouftrait
pas à la putréfa&ion en les lui confiant. La couche
terreu fe, qui les recouvre, rend feulement cette
putréfaction plus lente ; & comme la terre eft perméable,
les émanations cadavéreufes la percentj&fe
mêlent néceffairement à l’air qui touche la furface
-des lieux confacrés à l’inhumation. L’infeélion, qui
-en réfulte, eft infiniment moins grande qu’elle ne le
feroit, u les cadavres pourrilToient à l’air libre, mais
elle peut avoir afl'ez d’intenfité pour devenir perni-
cieufe, & l’on ne doit pas perdre de vue cette vérité
, lorfqu’il eft queftion de conftruire un cimetière.
Faire enferte que l’air n’y foit jamais afl'ez infeété
pour être dangereux , ou que l’infeâion, lorfque
ion intenlité eft inévitable , ne puifle y caufer aucun
funefte accident ; voilà ce que l’on doit fe pro-
pofer. Par quels moyens réuflira-t-on à empecher
que cette infeCtion n’acquiere une intenfité redoutable
? C’eft ce qu’on découvrira en fe rendant rai-
Ton de l’effet de la terre fur les émanations cadavé-
reufes, de la formation des vapeurs qui réfultent
du mélange de ces émanations avec l’air, & de l’action
de l’air fur ces vapeurs. i
Quoique la terre foit perméable , & que dans les
cimetières le feu central, de concert avec la fermentation
putride , fafle exhaler de fon fein les fubftances
volatiles qu’elle renferme , il eft certain que,
par leur denfité, les parties intégrantes de la terre
gênent cette exhalation, & qu’agiflant comme un
S ltre , elles fubtilifent les écoulemens cadavéreux
en s’oppofant à l’émanation des molécules animales
les plus groflieres.
Mais il eft également certain que les fubftances,
qui font volatiféès, partant de tous les points de la
furface des cadavres , s’échappent dans différentes
directions, & fortent de terre fous des angles plus
ou moins aigus , de maniéré que fi plufieurs cadavres
font rapprochés les uns des autres, lés rayons
d’écoulement fe réuniront néceffairement.
Il fuit de-la que les exhalations cadavéreufes auront
d’autant moins de denfité, que les cadavres
feront plus profondément enfouis , mais que pouvant
en acquérir par leur réunion, elles feront encore
d’autant moins denfes , qu’il y aura plus de dif-
tance entre ces foyers putrides.
Ces émanations au fortir de terre fe mêlent à l’air
fous forme de vapeurs , & celles-ci font d’autant
plus fenfibles , qu’elles ont plus de denfité.
L’air eft-il fec & tient-il en diffolution peu de molécules
aqueufes, îl abforbe avec facilité les émanations
cadavéreufes , & les diffout iicqmplettement,
que leur divifion, portée aufli loin qu’il eft poflible,
les fait échapper aux fens. Elles fe condenfent &
deviennent fenfibles fi l’air eft humide , & elles le
font même d’autant plus, que cé fluide étant plus
C I M
chargé d’eau , l’union de fies molécules avec celles
des émanations fe fait plus difficilement.
Le volume de l’air influe également fur le peu de
denfité des vapeurs. C ’eft en cédant à la force at-
tra&ive des molécules aeriennes & en fe logeant
■ dans leurs interfiiees que les corpufcwles, exhalés
du fein de la terre, forment ces vapeurs. Les molécules
aeriennes font-elles très-nombreufes , eu égard
aux corpufeules expofés à leur aûivité', elles fe les
partagent & les divifentde forte que, répandus dans
une maffe confidérable, ceux«ci ne s’unifient à celles-
là qu’un à un, & les vapeurs raréfiées affe&ent foi-
blement les fens. Le contraire arrive, fi la mafle
aérienne eft moins volumineufe, chaque molécule
d’air eft forcée de fe charger de plufieurs corpufeules
cadavéreux , & la denfité des vapeurs eft d’autant
plus grande, que le volume d’air eft moindre.
Mais c’eft dans les couches inférieures que fe fait
d’abord cette union &c la pefanteur des fubftances
qui pénètrent ces couches , faifant continuellement
obftacle à leur élévation , leur difperfion dans un
grand vôlume d’air ne peut avoir lieu qu’autant que
les couches fupérieures ou collatérales viendront fuc-
ceflivement prendre la place des inférieures. Si l’air
eft ftagnant ÔC immobile, les couches inférieures feront
bientôt faturées des corpufeules exhalés, & les
vapeurs qui réfulteront de cette diffolution, acque-
reront une denfité confidérable.
Ce ne feroit pas afl'ez que l’air des couches inférieures
fut quelquefois renouvellé, il faudra encore
que l’agitation de la mafle aérienne , capable de produire
cet effet, foit continuelle, ou du moins très-
fréquente.
Les -vapeurs réunies & condenfées par la durée
de la ftagnation des couches inférieures, ne feroient
pas afl'ez promptement divifées par le mouvement
momentané qui leur feroit communiqué, & ces va-
i peurs, pouffées alors en mafle, pourroient devenir
d’autant plus pernicieufes, que ce mouvement feroit
plus fubit & plus rapide.
Cet inconvénient fera cependant bien fouvent inévitable
, parce que l’humidité, occafionnée parles
pluies, donnera néceffairement de la denfité aux vapeurs
, en s’oppofant à leur diffolution ; parce que
la raréfaftion , caufée par la chaleur, néceffitera
cette denfité, en rendant l’air immobile & ftagnant ;
parce qu’enfin la réunion de ces différentes caufes
condenfera ces vapeurs. Ainfi l’air des cimetières, par
l’effet des pluies & de la chaleur, ou par leur con-
' cours, deviendra fouvent capable d’infe&er ceux
qui le refpi^ront, foit dans le lieu même 1 foit dans
le voifinage, fuivant la direction & la véhémence
des vents.
Enterrer profondément les cadavres , & mettre
entr’euxune diftance confidérable; placer les cimetières
dans des endroits où l’air foit le moins humide
qu’il eft poflible, & jouiffe d’une liberté qui puiffe
favorifer le mouvement de toutes fes couches ; voilà
donc les moyens d’empêcher que les écoulemens cadavéreux
ne forment des vapeurs d’une denfité dan-
gereufe, & que l’air dans les cimetières ne foit jamais
afl'ez infeCté pour être pernicieux.
Mais comme cette infeCtion eft fouvent inévitable
, il faut encore que les cimetières foient fitues de
façon que les vapeurs infeCles qu’ils fourniffent ne
puiffent être portées fur des lieux habités, qu’ils en
foient afl'ez éloignés pour qu’elles aient le teins d’etre
diffoutes avant d’y arriver, & q«e « nature des
vents „ capables de les charrier, favorife leur diffo-
lution. . , , 1
A quelle profondeur faut-U enterrer les morts ?
Quel efpace doit-on afligner à chaque fépulture ?
La folutionde ces problèmes eft encore néceflaire
pour pouvoir déterminer les conditions que doit
C I M
avoir un ciptçtlm, afin que la deftmQion des morts
ne nuife pas aux vivan?- t , ,
Il eft impoflible de calculer 1 a&on des couches
terreufes fur les écoulemens cadavéreux , & réfraction
des rayons que formeront ces écoulemens
en fortant de terre. Heureufement que l’exaftitude
mathématique n’eft point néceflaire en cette occa-
fion & qu’on peut fe permettre des fuppofitions,
pourvu que les observations les autorifent. ^
O r , il éft confiant que les couches terreufes fu'o-
tilifent les émanations , & que celles-ci font d autant
moins denfes, que les autres font plus épaiffes & plus
compares. L’expérience a démontré qu’une couche
de terrein d’un pied & même de deux pieds d’epaif-
feur, laiffoit aux émanations allez de denfite pour fe
rendre fenfibles par leur fétidité.
Il eft également confiant qu’en traverfant un milieu
denfe, le rayons de matière , quelle qu’elle foit,
s’approchent de la perpendiculaire ; & qu’en paflant
d’un milieu denfe dans un qui .l’eft moins, ils s’en
éloignent d’autant plus que la différence des denfités
eft plus confidérable.
Il fuitde-là: premièrement, qu’il faut au moins
recouvrir les cadavres de trois ou quatre pieds de
ferre, & même de beaucoup plus, fi la nature du
fol le permet, pour diminuer autant qu’il eft poflible
la denfité des écoulemens cadavéreux.
Secondement, que fi en traverfant la couche tèr-
reufe, les rayons d’écoulemens, partis des differens
points du cadavre, fe rapprochent de la perpendiculaire
,- de maniéré à devenir prefque parallèles en-
tr’eux au fortir de la terre , lorfque cette couche a
quatre pieds d’épaiffeur, ils s’en eloignent dans l’air
à raifon du peu de denfité relative de ce milieu, &
divergent de façon que l’on peut, fans crainte d’exagération
, fuppofer que la ligne, tirée dufommet du
rayon fur le terrein, tomberoit alors à trois ou quatre
pieds ; qu’ainfi les écoulemens des cadavres, qui
ne feroient diftans que de deux, trois, quatre, même
de fix & fefTt pieds, fe confondroient les uns avec les
autres. Que pour prévenir les inconvéniens qui ré-
fulteroient de ce mélange, il faudroit mettre entre
chaque cadavre un intervale de fept à huit pieds,
& confacrer à la fépulture de chacun d’eux un efpace
de terrein proportionné. JMais les émanations qui fe
feront des pieds & de la tête étant beaucoup moins
confidérables que les autres, il ne fera pas néceflaire
que l’intervale foit par-tout égal, & l’on pourra le
réduire à la moitié pour les côtés de la tête & des
pieds.
Dès lors en donnant à chaque cadavre fix pieds
de longueur & deux pieds & demi de largeur, & y
ajoutant deux pieds dii côté de la tête & autant du
côté des pieds, en ajoutant pareillement à leur largeur
quatre pieds de chaque côté, on aura un efface
quarré de dix pieds d’une face, & de dix pieds &
demi de l’autre, dont la furface fera de cent cinq
pieds quarrés. Réduire cette furface à la moitié, ce
feroit probablement faire une réduction trop forte ;
mais , en s’y aftreignant pour réparer autant qu’il
fera poflible l’erreur où pourroit expofer une évaluation
trop forte de là divergence des rayons d’écoulemens,
il reliera pour certain que l’on doit évaluer
au moins à une furface de cinquante-deux pieds &
demi quarrés, le terrein néceflaire pour la fépulture
de chaque cadavre.
Cela pofé, quelle doit être l’étendue du cimetiere?
La réponfe à cette queftion fortira des remarques à
faire fur le nombre des morts, qu’année commune
on fera dans le cas d’y dépofer, & fur le tems que
dure la deftruélion complette des cadavres.
Si les émanations cadavéreufes font capables de
prodqire les plus funeftes effets, en perçant en dé-
uql Une couche d§ terrein de trois à quatre'pieds
C I M 419
d’épaijTeur, elles le feroient beaucoup plus encore,
fi , en ouvrant la terre avant qu’elles n’euflent été
épuifées , on les expofoit à fortir en mafle. Le mal-
•tieur arrivé à Montpellier en 1744 à l’ouverture d’un
caveau féptilcràl de l’eglife Notre-Dame, & raconté
par M. Haguenot, profefleur en médecine de l’uni-‘
Verfité de cette ville (æ) ; la mort récente du fof-
foÿ eu r, qui dans le cimetiere de Montmorenci, au
rapport de M. C o tte , prêtre de l’Oratoire , a été
cauféè le mois de janvier dernier par la vapeur qui
fortit d’un cadavre inhumé depuis treize mois, &c
près duquel il ouvroit une nouvelle foflfe ( f ) , font
des faits qui rendent le danger trop fenfible pour ne
pas engager à prendre à ce lujet les plus grandes précautions.
M. Petit, doéleur-régent de la faculté de médecine
de Paris, & anatomifte, m’a alluré qu’ayant été
fouvent dans le cas d’enfouir dans fon jardin des dépouilles
des cadavres qui avoient fervi à fesdiflec-*
tions, il a voit reconnu que ces parties animales n’é-
toient détruites qu’au bout de trois à quatre ans.'
M. Cotte, que j’ai déjà cité plus haut, m’écrivoit que
depuis fept ans qu’il eft chargé à Montmorenci des
fondions paftorales, il a fait cortftamment la mêm&
remarqué. Ce n’eft donc qu’après quatre ans qu’ort
peut rouvrir fans inquiétude de nouvelles fofles, &C
pour qu’un cimetiere foit le moins dangereux qu’il eft:
poflible , il faut donc qu’il ait quatre fois autant d’étendue
qu’en exigeroitdjg» nombre des morts année
commune ; & comme il eft néceflaire de confacrer à
l ’inhumation de chacun d’eux un efpace de cinquante-
deux pieds & demi quarrés, il faudroit pour quarante
cadavres un terrein qui eût deux mille cent
pieds quarrés de furface : mais, eu égard à la nécef-'
lité de relier quatre ans fans ouvrir les mêmes fof-
fe s, un cimetiere deftiné pour la deflerte d’une pa-
roifle fur laquelle année commune il mourroit quarante
perfonnes, doit avoir huit à dix mille pieds
quarrés de furface , mais jamais moins de huit mille
quatre cens.
Dès qu’il eft donc évident que les cimetières pourroient
devenir des foyers d’une putridité dangereufe ,
fi leur étendue n’étoit pas proportionnée au nombre
des cadavres qu’on y enterreroit, & à la durée de
leur dèllruélion , fi les morts n’y étoient pas enfouis
de quatre pieds au moins, fi l’humidité ’s’y oppolbit
à la dilfolution des écoulemens cadavéreux, fi l’ait
ne s’y renouvelloit pas avec facilité, & fi les vapeurs
, formées par le mélange de ces écoulemens
dans l’air, pouvoient être portées en mafle fur des
lieux habités , il faut qu’on regarde comme un devoir
indifpenfable d’obliger les foffoyeurs à donner
aux fofles au moins quatre pieds de profondeur , à
fôuler la terre avec les pieds pour la rendre compacte
, & à ne jamais rouvrir des fofles anciennes
avant quatre ans. Il faut que le terrein deftiné pour
les fépultures, ait beaucoup de profondeur , qu’il rte
foit point humide , que fon étendue foit proportionnée
au nombre des morts, & quatre fois plus grande
que ne l’exige l’efpace ordinaire pour l’inhumatiort
de chaque cadavre ; que tous les vents , mais fur-
tout Ceux du nord & de l’eft y abordent avec facilités
, qu’aucun arbre ne s’y oppofe au jeu de l’air ,
que les murS, dont on l’entoure, n’aient que très-,
peu d’élévation V;‘& que les cimetières foient tou jours
hors des lieux habités, & fitués au nord & a
l’eft , parce que ces vents, ordinairement* fecs
froids, & paroiffant fouffler de bas en haut, élevent
(d) Le mémoire dans lequel M. Haguenot a configné cet
événement , a été lu dans une féance publique de la focieté
littéraire de Montpellier, lé 23 Décembre 1746» & imprime
en 1 ” 47 chez Martel. _ «
^ y) Vo y ez les Obfervations phyfiques de M. l’abbé Rozier,
année 1773 ? ?>P‘ 109'