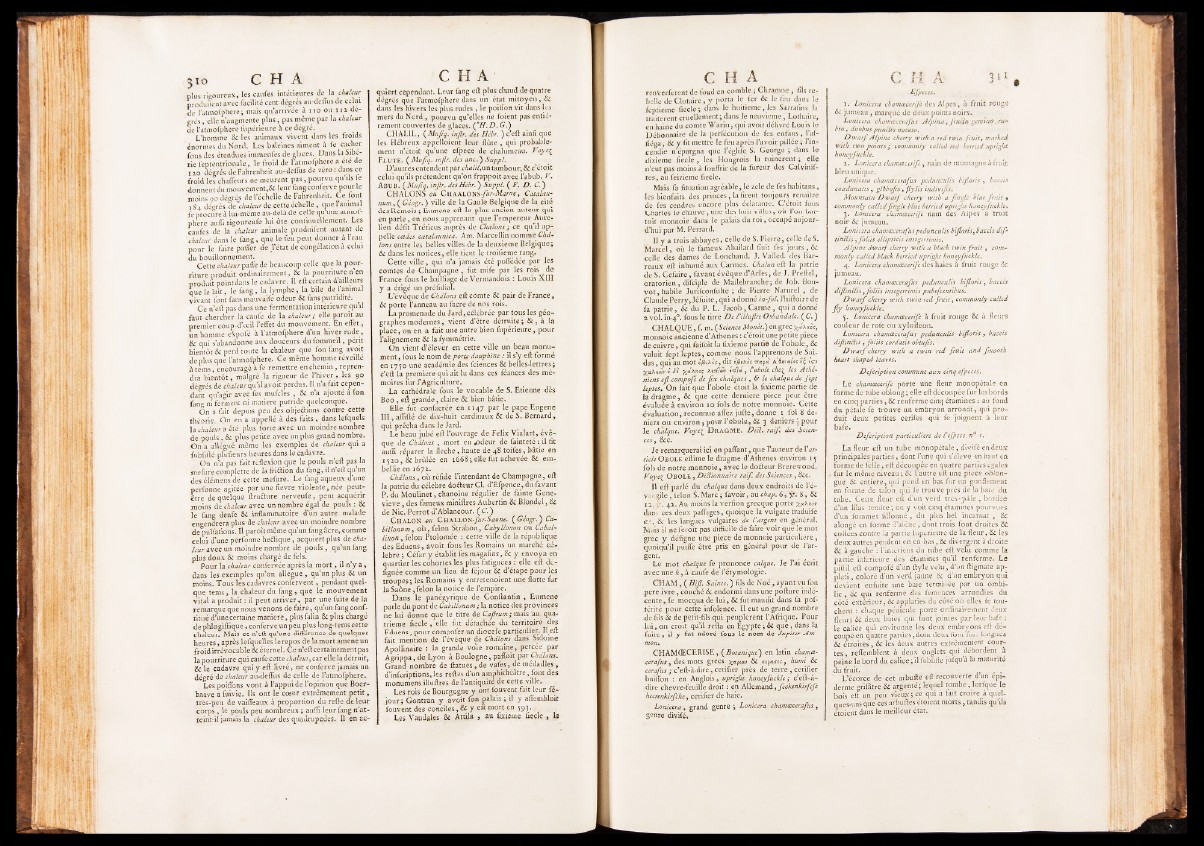
plus vigoureux, les caufes intérieures de la chtltur
produifentavec facilité cent degrés au-deflusde celui
de Tatmofphere; mais qu’arrivée à i io ou m degrés
, elle n’augmente plus, pas même par la chaleur
de Tatmofphere fupérieure à ce dégré.
L’homme 6c les animaux vivent dans les froids
énormes du Nord. Les baleines aiment à fe cacher
fous des étendues immenfes de glaces. Dans la> Sibérie
l'eptentrionale, le froid de 1 atmofphere a été de
110 dégrés de Fahrenheit aurdeflus de zéro: dans ce
froid les chaffeurs ne meurent pas, pourvu qu’ils le
donnent du mouvement,& leur (angconferve pour le
moins 90 degrés de l’échelle de Fahrenheit. Ce font
184 dégrés de~chaleur de cette échelle, que l’animal
fe procure à lui-même au-delà de celle qu une atmofphere
aulîi rigoureufe lui ôte continuellement. Les
caufes de la chaleur animale produifent autant de
chaleur dans le fang, que le feu peut donner à l’eau
pour le faire paffçr de Tétât de congélation à celui
du bouillonnement.
Cette chaleur pafle de beaucoup celle que la pourriture
produit ordinairement, 6c la pourriture n en
produit pointdans le cadavre. Il eft certain d’ailleurs
que le lait, le fang, la lymphe, la bile de l’animal
vivant font fans mauvaife odeur & ians putridité.
Ce n’eft pas dans une fermentation intérieure qu’il
faut chercher la caufe de la chaleur; elle paroît au
premier coup-d’oeil l’effet du mouvement. En effet,
un homme eXpofé à l’atmofphere d’un hiver rude,
& qui s’abandonne aux douceurs du fommeil, périt
bientôt 6c perd toute la chaleur que fon fang avoit
déplus que Tatmofphere. Ce même homme réveille
à tems, encouragé à fe remettre en chemin, reprendra
bientôt, malgré la rigueur de l’hiver, les 90
dégrés d e chaleur qu’il avoit perdus. Il n’a fait cependant
qu’agir avec fes mufcles , 6c n’a ajouté à fon
fang ni ferment ni matière putride quelconque.
On a fait depuis peu des obje&ions contre cette
théorie. On en a appellé à des faits, dans lefquels
la chaleur a été plus forte avec un moindre nombre
de pouls, 6c plus petite avec un plus grand nombre.
On a allégué même les exemples de chaleur qui a
fubfifté plufieurs heures dans le cadavre.
On n’a pas fait réflexion que le pouls n’eft pas la
mefure complette de la fri&ion du fang, il n’eft qu’un
des élémens de cette mefure. Le fang aqueux d’une
perfonne agitée par une fievre violente, née peut-
être de quelque ftrutture nerveufe, peut acquérir
moins de chaleur avec un nombre égal de pouls : 6c
le fang denfe Si inflammatoire d’un autre malade
engendrera plus de chaleur avec un moindre nombre
de pulfations. 11 paroît même qu’un fang âcre, comme
celui d’une perfonne heélique, acquiert plus de chaleur
avec un moindre nombre de pouls , qu’un fang
plus doux & moins chargé de fels.
Pour la chaleur confervée après la mort, il n’y a ,
dans les exemples qu’on allégué , qu’un plus & un
moins. Tous les cadavres confervent, pendant quelque
tems , la chaleur du fang, que le mouvement
vital a produit : il peut arriver, par une fuite de la
remarque que nous venons de faire, qu’un fang conf-
titué d’une certaine maniéré, plusfalin 6c plus charge
de phlogiftique, conferve un peu plus long-tems cette
chaleur. Mais ce n’eft qu’une différence de quelques
heures, après lefquelles le repos de la mort amene un
froid irrévocable & éternel. Ce n’ eft certainement pas
la pourriture qui caufe cette chaleur, car elle la détruit,
& le cadavre qui y eft livré, ne conferve jamais un
degré de chaleur au-deffus de celle de Tatmofphere.
Les poiffons vont à l’appui de l’opinion que Boer-
haave a fuivie. Ils ont le coeur extrêmement petit,
très-peu de vaiffeaux à proportion du refte de leur
corps , le pouls peu nombreux ; aufli leur fang n’atteint
il jamais la chaleur des quadrupèdes. Il en acquïert
cependant. Leur fang eft plus chaud de quatre
dégrés que Tatmofphere dans un état mitoyen, 6c
dans les hivers les plus rudes , le poiflon vit dans les
mers du Nord, pourvu qu’elles né foient pas entièrement
couvertes de glaces. (*H .D . G.)
CHALIL, (Mujîq. injlr. des Hèbr. ) c’eft ainft que
les Hébreux appelloient leur flûte , qui probablement
n’etoit qu’une efpece de chalumeau. Voyc^
FLUTE. ( Mufiq. injlr. des anc.) Suppl.
D’autres entendent par chalil,un tambour; & c’étoit
celui qu’ils prétendent qu’on frappoit avec l’abub. V .
ABUB. ( Mùfiq. injlr. des Hèbr. ) Suppl. ( F. D . C. )
CHALONS ou CüAALOUS-fur-Mame, Catalau-
num, ( Géogr.) ville de la Gaule Belgique de la cité
des Remois; Eumene eft le plus ancien auteur qui
en parle, en nous apprenant que l’empereur Aure-
lien défit Tréticus auprès de Châlons ; ce qu’il appelle
coedes catalaunica. Am. Marcellin nomme Châlons
entre les belles villes de la deuxieme Belgique;
6c dans les notices, elle tient le troifieme rang.
Cette ville, qui n’a jamais été pofledée par les
comtes de Champagne , fut mife par les rois de
France fous le bailliage de Vermandois : Louis XIII
y a érigé un préfidial.
L’éveque de Châlons eft comte & pair de France ,
& porte l’anneau au facre de nos rois.
La promenade du Jard, célébrée par tous les géographes
modernes, vient d’être détruite ; & , à la
place, on en a fait une autre bien fupérieure, pour
l’alignement 6c la fymmétrie.
On vient d’élever en cette ville un beau monument
, fous le nom de porte-dauphine : il s’y eft formé
en 1750 une académie des fciences 6c belles-lettres;
c’eft la première qui ait lu dans ces féances des mémoires
lur l’Agriculture.
La cathédrale fous le vocable de S. Etienne dès
B o o , eft grande, claire 6c bien bâtie.
Elle fut confacrée en 1147 par le pape Engene
I II, aflifté de dix-huit cardinaux & de S. Bernard,
qui prêcha dans le Jard.
Le beau jubé eft l’ouvrage de Félix Vialart, évêque
de Châlons , mort en codeur de fainteté : il fit
aufli réparer la fléché, haute de 48 toifes, bâtie en
1520, & brûlée en 1668; elle fut achevée 6c embellie
en 1671.
Châlons, oit réfide l’intendant de Champagne, eft
la patrie du célébré doâeur Cl. d’Efpence, du favant
P. du Moulinet, chanoine régulier de fainte Geneviève
, des fameux miniftres A libertin 6c Blondel, 6c
de Nie. Perrot d’Ablancour. ( C. )
CHALON ou ChallON-fur-Saone. ( Géogr. ) Ca-
billonum, o ii, félon Strabon, Cabyllonon ou Cabal-
linon, félon Ptolomée : cette ville de la république
des Eduens, avoit fous les Romains un marché célébré
; Céfar y établit fes magafins, 6c y envoya en
quartier les cohortes les plus fatiguées : elle eft dc-
ftgnée comme un lieu de féjour 6c d’étape pour les
troupes; les Romains y entretenoient une flotte fur
la Saône, félon la notice de l’empire.
Dans le panégyrique de Conftantin , Eumene
parle du pont de Cabillonum; la notice des provinces
ne lui donne que le titre de Cajlrum; mais /au quatrième
fiecle, elle fut détachée du territoire des
Eduens, pour compofer un diocefe particulier. Il eft
fait mention de Tévêque de Châlons dans Sidoine
Apollinaire : la grande Voie romaine, percee par
Agrippa, de Lyon à Boulogne, paffoit par Châlons.
Grand nombre de ftatues,de vafes, de médailles,
d’inferiptions, les reftes d’un amphithéâtre, font des
monumens illuftres de l’antiquité de cette ville.
Les rois de Bourgogne y ont fouvent fait leur fe-
jour; Gontran y avoit fon palais ; il y affembloif
fouvent des conciles, & y eft mort en 593.
Les Vandales 8c Attila , au ftxieine fiecle , la
renVerferent de fond en comble ; Chramne, fils rebelle
de Clotaire, y porta le fer 6c le feu dans le
feptieme fiecle ; dans le huitième, les Sarrafins la
traitèrent cruellement; dans le neuvième, Lothairc,
en haine du comte W arin, qui avoit délivré Louis le
Débonnaire de la perfécution de fes enfans, Taf-
fiéga, 6c y fit mettre le feu après l’avoir pillée ; l’incendie
n’épargna que l’églife, S. George ; dans le
dixième fiecle , les Hongrois la ruinèrent ; elle
n’eut pas moins à fouffrir de la fureur des Calvinif-
le s , au feizieme fiecle.
Mais fa fituation agréable, le zele de fes habitans,
les bienfaits des princes ; la firent toujours renaître
de fes cendres encore plus éclatante, C ’étoit fous
Charles le chauve, une des huit villes, oii Ton bat-
toit monnoie dans le palais du ro i, occupé aujourd’hui
par M. Perrard.
Il y a trois abbayes, celle de S. Pierre, celle de S.
Marcel, oii le fameux Abailard finit fes jours, 6c
celle des dames de Lonchand. J. Valled. des Barreaux
eft inhumé aux Carmes. Chalon eft la patrie
de S. Cefaire, favant évêque d’Arles, de J. Preftel,
oratorien, difciple de Mallebranche; de Job. Bou-
v o t , habile Jurifconfulte ; de Pierre Naturel , de
Claude Perry, Jéfuite, qui a donné in-fol. Thiftoire de
fa patrie, 6c du P. L. Jacob, Carme, qui a donné
2 vol. in-40. fous le titre De l'illujlre Osbandale. ( C. )
CHALQUE, f. m. (Science Monèt.) en grec
monnoie ancienne d’Athenes : c’étoit une petite piece
de cuivre, qui faifoit la fixieme partie de l’obole, 6c
valoit fept leptes, comme nous l’apprenons de Suidas
, qui au mot o/3oXoc, dit ofiçAoç Traça A ônvatoi tÇ iç-t
XaXnuv à «Te x*Kkoç Mn\uv injcl, lobole chc{ les Athéniens
ejl compofé de Jix chalques , & le chalque de fept
leptes. On fait que l’obole étoit la fixieme partie de
la dragme, 6c que cette derniere piece peut être
évaluée à environ 10 fols de notre monnoie. Cette
.évaluation, reconnue affez jufte, donne 1 fol 8 deniers
ou environ, pour l’obole, 6c 3 deniers ÿ pour
le chalque. Voye1 DRAGME. D i cl. raif. des Sciences,
6cc.
Je remarquerai ici en paffant, que l’auteur de Varticle
Obole eftime le dragme d’Athenes environ 15
fols de notre monnoie, avec le do&eur Brerewood.
Voye£ OBOLE , Dictionnaire raif. des Sciences, 6cc.
Il eft parlé du chalque dans deux endroits de l'évangile
, félon $. Marc ; favoir, au chap. 6 , ■ jîr. 8, 6c
12,y . 42. Au moins la verfion grecque porte
dans ces deux paffages, quoique la vulgate traduife
ces, 6c les langues vulgaires de l'argent en général.
^Mais il ne feroit pas difficile de faire voir que le mot
grec y défigne une piece de monnoie particulière ,
quoiqu’il puiffe être pris en général pour de l’argent
m u
Le mot chalque fe prononce calque. Je 1 ai écrit
avec une h , à caufe de l’étymologie.
CHAM, ( Hifi. Sainte. ) fils de Noé, ayant vu fon
pere iv re , couché 6c endormi dans une pofture indécente,
fe mocqua de lui, 6c fut maudit dans fa pof-
.térité pour cette infolence. Il eut un grand nombre
de fils & de petit-fils qui peuplèrent l’Afrique. Pour
lui, on croit qu’il refta en Egypte ; & que, dans la
fuite, il y fut adoré fous le nom de Jupiter Am-
mon.
CHAMGECERISE, (Botanique) en latin chamte-
cerafus, des mots grecs x*!**-1 & ntpaeoç, humi 6c
cerafus ; c’eft-à-dire, cerifier près de terre, cerifier
buiflbn : en Anglois, upright honeyfuckle; c’eft-à-
dire chevre-feuille droit : en Allemand, feckenkirfcfe
hecrenkirfche , cerifier de haies
Lonicera, grand genre ; Lonicera chamcecerafus,
• genre diyifé.
Efpeces.
ï. Lonicera charnoeccrife des Alpes, à fruit rouge
6c jumeau, marqué de deux points noirs.
Lonicera chamcecerafus Alpina, Jntclu.gemino. ru-
bro, duobus punchs notato.
Dwarf Alpine cherry with a red twin fruit, marked
with two points ; commonly called red berried upright
honeyfuckle.
1. Lonicera chamotcerife, nain de montagne à fruit
bleu unique.
Lonicera chamcecerafus pedunculis bifloris , baccis
coadunatis, glbbofis, (lylis indivifis.
Mountain Dwarf cherry with a Jingle blue fruit t
commonly calledfingle blue berried upright honeyfuckle.
3. Lonicera chamcccerife nain des Alpes à fruit
noir 6c jumeau.
Lonicera chamcecerafus pedunculis bifloris, baccis d if
tinclis , folds ellipticis iniegerrimis.
Alpine dwarf cherry with a black twin fruit, commonly
called black berried upright honeyf uckle.
4. Lonicera chamotcerife des haies à fruit rouge 6c
jumeau.
Lonicera chamcecerafus pedunculis bifloris, baccis
diflinclis , folds integerrirnis pubefcentibus.
Dwarf cherry with twin red fruit, commônly called
fly honeyfuckle.
j . Lonicera chamcecerifc à fruit rouge 6c à fleurs
couleur de rofe ou xylofteon.
Lonicera chamcecerafus pedunculis bifLoris, baccis
d if inctis , folds cordatis obtujîs.
Dwarf cherry with a twin red fruit and fnootk
heart shaped leaves.
Defcription Commune aux cinq efpeces.
Le chamoecerife porte une fleur monopétale en
forme de tube oblong ; elle eft découpée fur les bords
en cinq parties, & renferme cinq étamines : au fond
du pétale fe trouve un embryon arrondi, qui produit
deux petites cerifes qui fe joignent à leur
bafe.
Defcription particulière de Vefpece n° 1.
La fleur eft un tube monopétale, divifé en deux
principales parties, dont Tune qui s’élève en haut eii
forme de felle, eft découpée en quatre parties égales
. fur le même niveau ; & L’autre eft une piece oblon-
gue 6c entière, qui pend en bas fur un gonflement
en forme de talon ; qui ’fè trouve près de la baie du
tube. Cette fleur eft d’un verd très - pâle , bordée
d’un lilas tendre ; on y voit cinq étamines pourvues
d’un fommet lillonné , du plus bel incarnat , 6t
alongé en forme d’alêne, dont trois font droites
collées contre la partie fupérieure de la fleur, 6c les
deux autres pendent en en-bas, 6c divergent à droite
& à gauche : l’intérieur du tube eft velu comme la
partie inferieure des étamines qu’il renferme. Le
piltil eft compofé d’un ftyle velu, d’un ftigmate ap-
plati, coloré d’un verd jaune 6c d’un embryon qui
devient enfuite une baie terminée par un ombilic
, & qui renferme des femences arrondies du
côté extérieur, & applaties du côté où elles fe touchent
: chaque pédicule porté ordinairement deux
fleurs & deux baies qui font jointes par leur bafe :
le calice qui environne les deux embryons eft découpe
en quatre parties, dont deux font fort longues
6c étroites, & les deux autres extrêmement cour-
te s , reffemblent à deux onglets qui débordent à
peine le bord du calice;il lublifte jufqu’à la maturité
du fruit, , , i „ -, .
' L’écorce de cet arbufte eft recouverte d un epi-
derme griiâtre & argenté; lequel tombe, lorfque le
bois eft un peu viëujf ; eè qui a fait croire à quelques
uns què cès arbuftés étoient morts, tandis qu’ils
etoientdans le meilleur état.