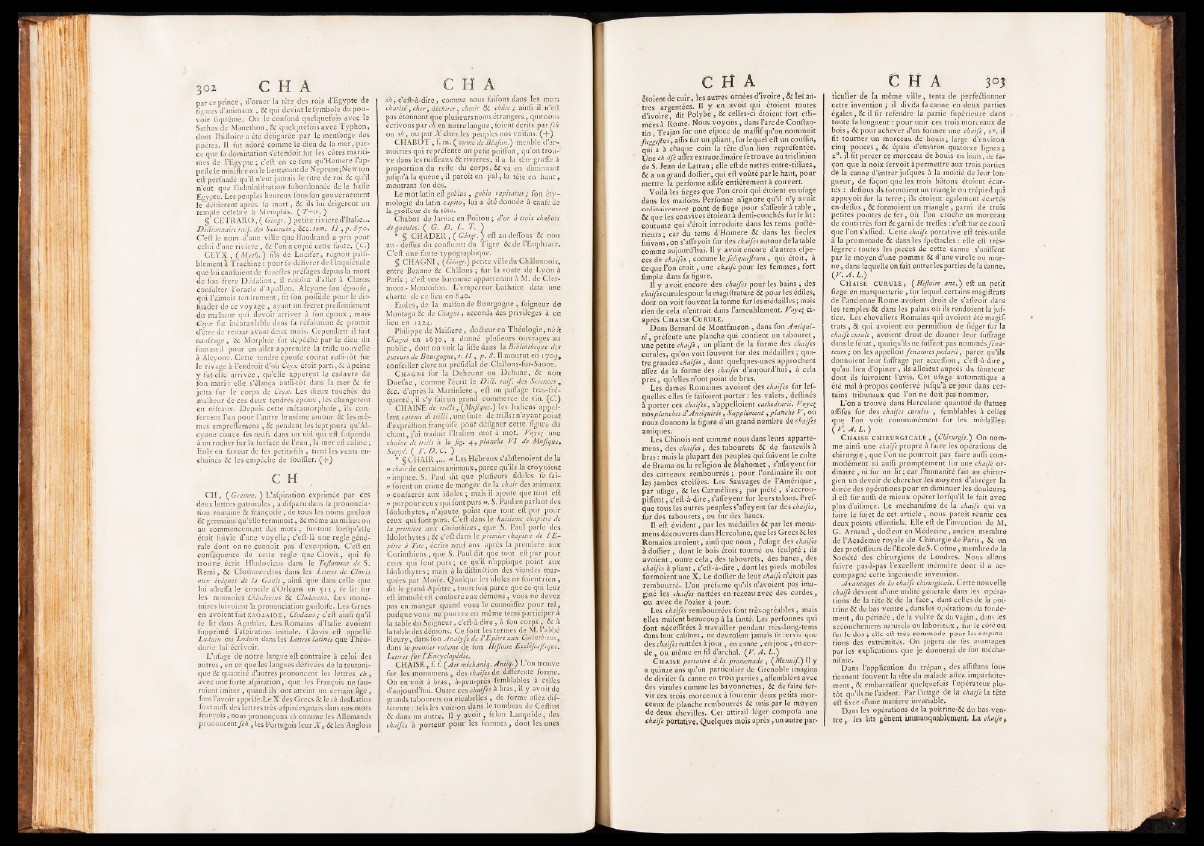
par ce prince , d’orner la tête des rois d’Egypte de
figures d’animaux , 6c qui devint le fymbole du pouvoir
fuprême. On le confond quelquefois avec le
Sethos de Manethon, 6c quelquefois avec Typhon,
dont l’hiftoire a été défigurée par le menfonge des
poètes. Il fut adoré comme le dieu de la mer,-parce
que fa domination s’étendoit fur les côtes maritimes
de l’ Egypte ; c’eft en ce fens qu’Homere 1 appelle
le miniftre ou le lieutenant de Neptune jNewton
eft perfuadé qu’il n’eut jamais le titre de roi 6c qu il
n’eut que l’adminiftratiçn fubordonnée de la baffe
Egypte. Les peuples heureux fousfon gouvernement
le déifièrent après fa mort, 6c ils lui érigerent un
temple célébré à Memphis. ( T—N. )
§ C E TR A R O ,( Géogr. ) petite riviered’Italie..»
Dictionnaire raif. des Sciences, &c. tom. I I , p. 8 jo .
C ’eft le nom d’une ville que Baudrand a pris pour
celui d’une riviere , 6c l’on a copié cette faute. (C\)
C E YX , ( Myth. ) fils de Lucifer, régnoit paifi-
blementà Trachine : pour fe délivrer de l’inquiétude
que luicaufoientde funeftes préfages depuis la mort
de fon frere Dédalion, il rélolut d’aller à Claros
confulter l’oracle d’Apollon. Alcyone fon époufe,
qui l’aimoit tendrement, fit fon poflible pour le di(-
liiader de ce voyage , ayant un l'ecret preflèntiment
du malheur qui devoit arriver à fon époux ; mais
Cevx fut inébranlable dans fa réfolution 6c promit
d’être de retour avant deux mois. Cependant il fait
naufrage, 6c Morphée fut dépêché par le dieu du
fommeil pour en aller apprendre la trifte nouvelle
à Alcyone. Cette tendre époufe courut aufti-tôt fur
le rivage à l’endroitd’oit -Ceyx étoit parti, & à peine
y fut-elle arrivée , qu’elle apperçut le cadavre de
Ion mari : elle s’élança aufli-tôt dans la. mer 6c fe
jetta fur le corps de Ceyx. Les dieux touchés du
malheur de ces deux tendres époux , les changèrent
en oifeaux. Depuis cette métamorphofe, ils conservent
l’un pour l’autre le même amour 6c les mêmes
empreffemens ,6c pendant les fept jours qu’Al-
cyone couve fes oeufs dans un nid qui eft fufpendu
à un rocher fur la Surface de l’eau, la mer eft calme ;
Eole en faveur de fes petits-fils , tient les vents enchaînés
6c les empêche de Souffler. (+ )
C H
CH , ( Gramtn. ) L’afpiration exprimée par ce$
deux lettres gutturales , a difparu dans la prononciation
romaine & françoife , de tous les noms gaulois
6c germains qu’elle terminoit, 6c même au milieu ou
au commencement des mots, fur-tout lorfqu’elle
étoit Suivie d’une voyelle; c’eft-là une réglé générale
dont on ne connoît pas d’exception.. C ’eft en
conféquence de cette réglé que Clovis, qui Se
trouve écrit Hludovicus dans le Tejlament de S.
Remi, & Clothowechits dans les Lettres de Clovis
aux évêques de la Gaule, ainfi que dans celle que
lui adreffa le concile d’Orléans en 5x1, Se lit fur
les monnoies Chlodevius 6c Clodeveus. Les monétaires
fuivoient la prononciation gauloife. Les Grecs
en avoient fait xao A a 102, Clodceus ; c’eft ainfi qu’il
fè lit dans Agathias. Les Romains d’ Italie avôient
Supprimé l’afpiration initiale. Clovis eft appellé
Liiduin ou Lodoin dans les Lettres latines que Théo-
doric lui écrivoit.
L’ ufage de notre langue eft contraire à celui des
autres, en ce que les langues dérivées de la teutoni-
que 6c quantité d’autres prononcent les lettres ch,
avec une forte afpiration, que les François ne fau-
roient imiter , quand ils ont atteint un certain âge,
fans l’avoir apprife.Le X des Grecs & le ch desLatins
font aufli des lettres très-afpirées;mais dans nos mots
Srançois, nous prononçons ck comme les Allemands
prononcent fck , les Portugais leur X , 6c les Anglois
5/2, c’eft-à-dire, comme nous faifons dans les mots
charité, cher, déchirer, cheoir 6c chute ; ainfi il n’eft
pas étonnant que plufieurs noms étrangers, que nous
écrivons par ch en notre langue, Soient écrits par fck
ou sh t ou par X chez les peuples nos voifins. (+ )
CHABOT , f. m. ( tende dcBlafoh.') meuble d’armoiries
qui repréfentè un petit poiffon, qu’on trou-'
ve dans les ruiffeaux &c rivières, il a la tête groffe à
proportion du refte du corps, 6c va en diminuant
jufqu’à la queue ; il paroît en pal, la tête en haut ,
montrant fon dos.
Le mot latin eft gobius , gobio capitatus ; fon étymologie
du latin capito, lui a été donnée à taufe de
la groflèur de fa tête.
Chabot de Jarnac en Poitou ; dlor à trois chabots
de gueules. ( G. D. L. T. )
* § CHADER, ( Géogr. ) eft au-deffous 6c non
au - deffus du confluent du Tigre 6c de l’Euphrate.
C ’eft une faute typographique.
§ CHAGNI, (Géogr.) petite ville du Châlonnois,
entre Beaune 6c Châlons ; Sur la route de Lyon à
Paris ; c’eft une baronnie appartenant à M. de Clermont
- Montoifon. L’empereur Lothaire data une
charte de ce lieu en 840.
Eudes, de la maifonde Bourgogne , Seigneur de
Montagu 6c de Chagni, accorda des privilèges à ce
lieu en 1224.
Philippe de Maifiere, do&eur en Théologie, né ;Y
Chagni en 1630, a donné plufieurs Ouvrages au
public , dont on voit la lifte dans la Bibliothèque des
auteurs de Bourgogne, t. I I , p. 8. Il mourut en 1709,
confeiiler clerc au préfidial de Ghâlons-fur-Saone.
C hagni fur la Debeune ou Dehune, &c non
Duefne , comme l’écrit le Dicl. raif. des Sciences ,
& c . d’après la Martiniere , eft un paflage très-fré-
quenté, il s’y fait un grand commerce de vin. (C.)
CHAINE E trills, (Mujîque.') les Italiens appellent
catena di trilli, une fuite de trills : n'ayant point
d’expréflion françoife pour défigner cette figure du
chant, j’ai traduit l’Italien mot à mot. Foye^ une
chaîne de trills à la fig. 4 , planche VI de Mujîque.
Suppl. ( F. D. C. )
* § CHAIR ,... « Les Hébreux s’abftenoient de la
» chair de certains animaux, parce qu’ils la croyoient
»impure. S. Paul dit que plufieurs fideles fe fai-
» Soient un crime de manger de la chair des animaux
» confacrés aux idoles ; mais il ajoute que tout eft
» pur pour ceux qui font purs ». S. Paul en parlant des
Idolothytes, n’ajoute point que tout eft pur pour
ceux qui font purs. C’eft dans le huitième chapitre de
la première aux Corinthiens, que S. Paul parle des
Idolothytes ; 6c c ’eft dans le premier chapitre de VE-
pitre à Tite, écrite neuf ans après la première aux
Corinthiens, que S. Paul dit que tout eft pur pour
ceux qui Sont purs ; ce qu’il n’applique point aux
Idolothytes; mais à la diftinttion des vian.des marquées
par Moïfe. Quoique les idoles ne Soient rien ,
dit le grand Apôtre , toutefois parc.e que ce qui leur
eft immolé eft confacré aux démons, vous ne devez
pas en manger quand vous le connoifl'ez pour te l,
puifque vous ne pouvez en même tems participer à
la table du Seigneur, c’eft-à-dire, à fon corps 6c à
la table des démons. Ce font les termes de M. l ’abbé
Fleury, dans fon Analyfe de VEpure aux Corinthiens,
dans le premier volume de fon Hifoire Ecclejîajlique.
Lettres fur C Encyclopédie.
CHAISE, S. f. ( Àrt mechaniq. Antiq.) L’On trouve
fur les monumens , des chaijes de differente forme.
On en voit à bras, à^peu-près femblables à celles
d’aujourd’hui. Outre ces chaifes à bras, il y avoit de
grands tabourets ou efcabelles , de forme affez différente
: tels les voit-on dans le tombeau de Ceftius
6c dans un a'utre. Il y avoir, félon Lampride, des
chaifes à porteur pour les femmes, dont les unes
etoientde cuir* tes autres ôrriéèsd’ivoire, & ïei ail-
ires argentées. Il y en .avoit qui étoient toutes
d’ivoirè° dit Polybe , 6c celles-ci étoient fort efti-
méesà Rome. Nous voyons, dans l’arc de Conftan-
tin Trajan fur une efpece de maflîf qu’on nOmmôit
fuggefltis, aflis fur un pliant, fur lequel eft un couffin,
qui^a à chaque coin la tête d’un ÜOn représentée;
Une chaife affez extraordinaire fe trouve âutriclinion
de S. Jean de Latran ; elle eft de nattes eritre-tiffues,
& a un grand doflier, qui eft voûté par le haut, pour
mettre la perfonne affife entièrement à couvert.
Voilà les fieges que l’on croit qui étoient en ufage
dans les maifons. Perfonne n’ignôre qu’il n’y avoit
ordinairement point de fiege pour s’affeôir à tablé,
& que les convives étoient à demi-couchés furie lit :
Coutume qui s’étoit introduite dans les tems pofté-
rieurs ; car du tems d’Homere & dans les necles
fui vans, on s’affeyoit fur des chaifes autour delà table
comme aujourd’hui. Il y avoit encore d’autres efpe-
ces de chaifes , Comme le feliquaftrum , qui étoit, à
Céque l’on croit, une chaife pour les femmes, fort
fimple dans fa figure.
Il y avoit encore des chaifes pouf les bains ; des
cfozi/itfcurulespour la triagiftraturé & pour les édiles,
dont on voit fouvent la forme fur les médailles; mais
rien de cela n’entroit dans l’ameublement. Foye{ ci-
après C haise C urule.
Dom Bernard de Montfaucort , dans fon Antiquité
, préfente une planche qui contient un tabouret,
une petite chaife, un pliant de la forme des chaifes
curules, qu’on voit fouvent fur des médailles ; quatre
grandes chaifes, dont quelques-unes approchent
affez de la forme des chaifes d’aujourd’hui, à cela
près, qu’elles n’ont point de bras.
Les dames Romaines avoient des chaifes fur lef-
quelles elles fe faifoient porter : les valets, deftinés
à porter ces chaijes, s’appelloient càthedrarii. Foye{
nos planches d’Antiquités, Supplément, planche F , oii
nous donnons la figure d’un grand nombre de chaifes
antiques.
Les Chinois ont comme nous dans leurs apparte-
mens, des chaifes ; des tabourets & de fauteuils à
bras : mais la plupart des peuples qui fuivent le culte
de Brama ou la religion de Mahomet, s’affeyent fur
des carreaux rembourrés ; pour l’ordinaire ils ont
les jambes cfoifées. Les Sauvages de l’Amérique,
par ufage , 6c les Carmélites ; par piété , s’accrou-
piffent, c’eft-à-dire, s’âffeyent lur leurs talons. Pref-
que tous les autres peuples s’affeyent fur des chaifes,
fur des tabourets, ou lur des bancs.
II eft évident, par les médailles & par les rtionu-
mens découverts dans Herculane, que les Grecs 6c les
Romains avoient, ainfi que nous , l’ufage des chaifes
à doflier, dont le bois etoit tourné ou fculpté ; ils
avoient, outre ce la , des tabourets, des bancs, des
chaifes à pliant, c’eft-à-dire , dont les pieds mobiles
formoient une X. Le doflier de leur chaife n’etoit pas
rembourré. L’on préfume qu’ils n’avoient pas imaginé
les chaifes nattées en rézeau avec des cordes ,
ou avec de l’ozier à jour.
Les chaifes rembourrées fortt très-agréables ^ mais
elles nuifent beaucoup à la fanté. Les perfonnès qui
font néceflitées à travailler pendant très-long-tems
dans leur cabinet, ne devroient jamais fe lervir que
des chaifes nattées à jou r, en canne , en jon c, en corde
, ou même en fil d’archal. (F . A . L.)
C haise portative a la promenade , ( Menuif.) Il y
a quinze ans qu’un particulier de Grenoble imagina
de divifer fa canne en trois parties, affemblées avec
des viroles comme les bayonnettes, 6c de faire fer-
vir Ces trois morceaux à foutenir deux petits morceaux
de planche rembourrés 6c unis par le moyen
de deux chevilles. Cet attirail léger compofa une
chaife portative, Quelques mois après, un autre particulier
de la mêmé v ille , tenta de peffe&iottner
cette invention ; il divifa fa canne en deux parties
égales , & il fit refendre la partie fupérieure dans
toute fa longueur : pour unir Ces trois morceaux dé
bois ; & pour achever d’en former une chaife, 1 °. il
fit tourner un morceau de bouis; large d’environ
cinq pouces, 6c épais d’environ quatorze lignes 5
2°; il fit percer ce morceau de bouis en biais, de façon
que la noix fer voit à permettre aux trois parties
dé la canne d’entrer jufqués à la môitié de leur Ion*
gueur, de façon que les trois bâtons étoient écartés
: deflbus ils formoient un triangle ou trépied qui
appuyoit fur la terre ; ils étoient également écartés
en-deffus , 6c formoient un triangle , garni de trois
petites pointes de fe r , bii l’on croche un morceau
de couti très fort 6c garni de treffes : e’eft fur ce couti
que l’on s’ aflied. Cette chaife portative eft très-utilé
à la promenade 6c dans les fpe&acles : elle eft très-
légere : toutes les pièces de cette canne s’unifient
par le moyen d’une pomme 6c d’une virole ou morne
, dans laquelle on fait entrer les parties de la canne*
M a l ■ ■
C haise cü ru e ê ; ( Hifloire ànc.) eft un petit
fiege en marquetterie , fur lequel certains magiftrats
de l’ancienne Rome avoient droit de s’afleoir dans
les temples 6c dans les palais oit ils rendoient la justice.
Les chevaliers Romains qui avoient été magiftrats
, & qui avoient eu permiflion de fiéger fur la
chaife curule, avoient droit de donner leur fuffragé
dans le fénat, quoiqu’ils ne fuffent pas nommés féna-
teurs ; on les appelloit ƒ ’.naturespedarii, parce qu’ils
donnoient leur fuffragé par accéflion, c’eft-à-dire,
qu’au lieu d’opiner , ils-alloient auprès du fénateur
dont ils fuivoient l’avis. Cet ufage automatique a
été mal à-propos conferVé jufqu’à ce jour dans certains
tribunaux que l’on ne doit pas nommer.
L’on a trouvé dans Herculane quantité de ftatues
aflifes fur des chaifes curules , femblables à celles
quq l’on voit communément fur les médaillesi
( K J . L . )
C haise c Riru rgicale , (Chirurgie.) On nomme
ainfi une chaife propre à faire les. opérations de
chirurgie , que l’on ne pourroit pas faire aufli commodément
ni aufli promptement fur une chaife ordinaire
, ni fur un lit ; car l’humanité fait au chirurgien
un devoir de chercher les moyens d’abréger la
durée des opérations pour en diminuer les douleurs;
il eft fur aüfli de mieux opérer lorfqu’il le fait avec
plus d’aifançe. Le méchanifme de la chaife qui va
faire le fujet de cet article , nous paroît réunir ces
deux points efîentiels. Elle eft de l’invention de M.
G. Arnaud , dofteur en Médecine, ancien membre
de l’Academie royale de Chirurgie de Paris, 6c un
des profefleurs de l’Ecole de S; Cofme, membre de la
Société des chirurgiens de Londres. Nous allons
fuivre pas-à-pas l’excellent mémoire dont il a accompagné
cette ingénieufe invention;
Avantages de la chaife chirurgicale. Cette nouvelle
chaife dévient d’une utilité générale dans les opérations
de la tête & de la face , dans celles de la poitrine
6c du bas ventre , dans les opérations du fondement
, du périnée , de la vulve 6c du Vagin , dans les
accouchémens naturels ou laborieux, fur le côté ou
fur le dos ; elle eft très-commode pour les amputations
des extrémités. On jugera de fes avantages
par les explications que je donnerai de fon méchanifme.
Dans l’application du trépan, des àflmans foù*
tiennent fouvent la tête du malade aflez imparfaite1
ment, & embarraffent quelquefois l’opérateur plu1
tôt qu’ils ne l’aident. Par Pillage de la chaife \a tête
eft fixée d’une maniéré invariable.
Dans les opérations de la poitrine-& du bas-veri**
t re , les lits gênent immanquablement» La chaife >