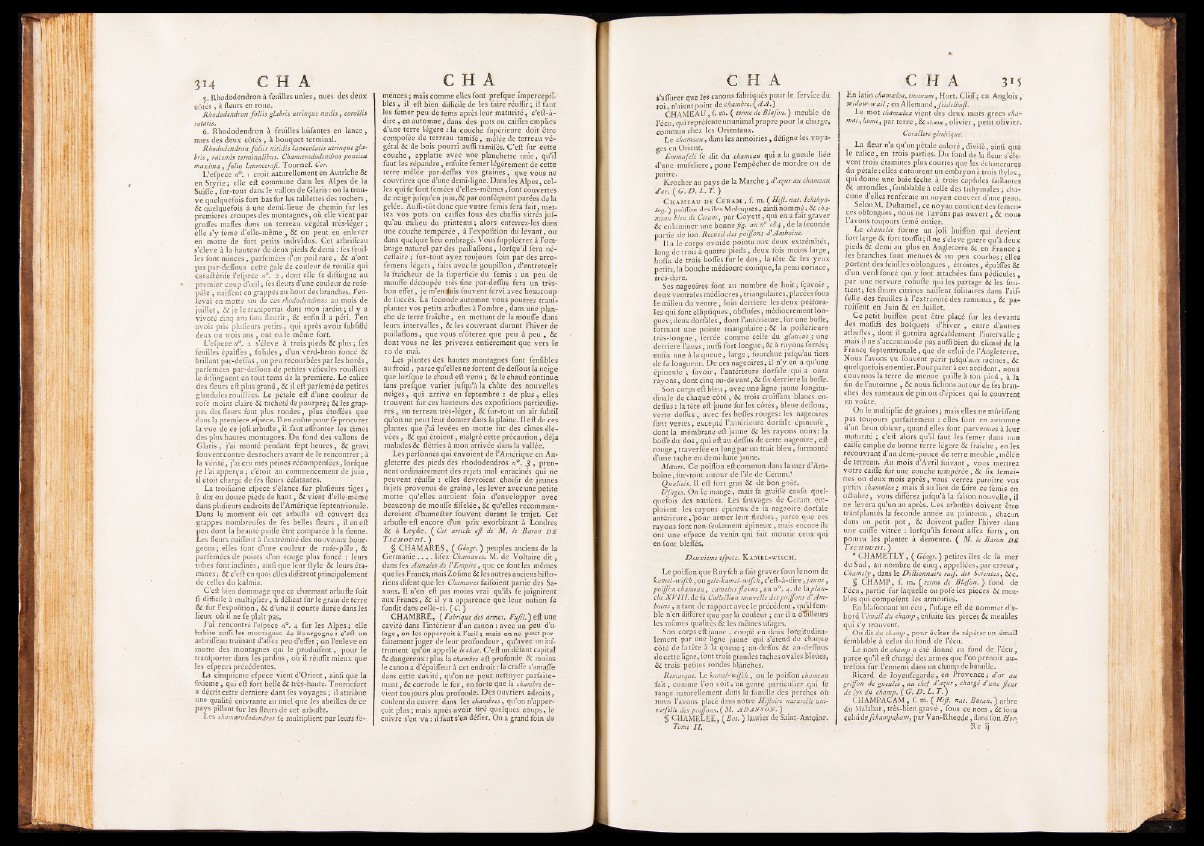
e. Rhododendron à feuilles unies, nues des deux
côtés , à fleurs en roue.
Rhododendron foliis glabris utrinque nudis, corollis
rotatis.
6. Rhododendron à feuilles luifantes en lance,
nues des deux côtés , à bouquet terminal.
Rhododendron foliis nitidis lanceolatis utrinque glu-
bris t ra'cemis terminulibus. Chamoerododendros ponticu
maxitna, folio laurocerajî. Tournef. Cor.
L ’efpece n°. / croît naturellement en Autriche &
en Styrie ; elle eft commune dans les Alpes de la
Suifle, fur-tout dans le vallon de Glaris : on la trouv
e quelquefois fort bas fur les tablettes des rochers,
& quelquefois à une demi-lieue de chemin fur les
premières croupes des montagnes, oit elle vient par
groffes maffes dans un terreau végétal très-léger ;
elle s’y feme d’elle-même , & on peut en enlever
en motte de fort petits individus. Cet arbriffeau
s’élève à la hauteur de deux pieds & demi : fes feuilles
font minces, parfemées d’un poil rare, & n’ont
pas par-deffous cette gale de couleur de rouille qui
caraftérife l’efpece n°. 2. , dont elle fe diftingue au
premier coup d’oeil ; fes fleurs d’une couleur de rofe-
pâle , naiflènt en grappes au bout des branches. J’enlevai
en motte un de ces rhododendrons au mois de
juillet, & je le tranfportai dans mon jardin ; il y a
vivoté cinq ans fans fleurir, & enfin il a péri. J’en
avois pris plufieurs petits, qui après avoir fubfifté
deux ou trois ans , ont eu le même fort.
L’efpece n°. 2. s’élève à trois pieds & plus ; fes
feuilles épaiffes , folides, d’un verd-brun foncé &
brillant par-deffus, un peu recourbées par les bords,
parfemées par-deffous de petites véficules rouillées
le diftinguent en tout tems de la première. Le calice
des fleurs eft plus grand, & il eft parfemé de petites
glandules rouillées. Le pétale eft d’une couleur de
rofe moins claire & tacheté de pourpre; & le s grappes
des fleurs font plus' rondes, plus étoffées que
dans la première efpece. Il en coûte pour fe procurer
la vue de ce joli arbufte, il faut affronter les cimes
des plus hautes montagnes. D u fond des vallons de
Glaris, j’ai monté pendant fept heures, & gravi
fouvent contre des rochers avant de le rencontrer; à
la vérité* j’ai cru mes peines récompenfées, lorfque
je l ’ai apperçu ; c’étoit au commencement de juin,
il étoit chargé de fes fleurs éclatantes.
La troifieme efpece s’élance fur plufieurs tiges,
à dix ou douze pieds de haut, & vient d’elle-même
dans plufieurs endroits de l’Amérique feptentrionale.
Dans le moment où cet arbufte eft couvert des
grappes nombreufes de fes belles fleurs , il en eft
peu dont la beauté puiffe être comparée à la fienne.
Les fleurs naiffent à l’extrémité des nouveaux bourgeons
; elles font d’une couleur de rofe-pâle, &
parfemées de points d’un rouge plus foncé : leurs
tubes font inclinés, ainfi que leur ftyle & leurs étamines
; & c’eft en quoi elles different principalement
de celles du kalmia.
C ’eft bien dommage que ce charmant arbufte foit
fi difficile à multiplier, fi délicat fur le grain de terre
& fur i’expofition, & d’une fi.courte durée dans les
lieux où il ne fe plaît pas.
J’ai rencontré l’efpece n°. 4 fur les Alpes ; elle
habite aufli les montagnes de Bourgogne : c’eft un
arbriffeau traînant d’affez peu d’effet ; on l’enleve en
motte des montagnes qui le produifent, pour le
tranfporter dans les jardins, où il réuflit mieux que
les eïpeces précédentes.
La cinquième efpece vient d’Orient, ainfi que la
fixieme, qui eft fort belle & très-haute. Tournefort
a décrit cette derniere dans fes voyages ; il attribue
une qualité enivrante au miel que les abeilles de ce
pays pillent fur les fleurs de cet arbufte.
Les chumarododendros fe multiplient par leurs fe-.
méncés ; mais comme elles font prefque imperceptibles
, il eft bien difficile de les faire réufiir ; il faut
les femer peu de tems après leur maturité, c’eft-à-
dire , en automne, dans des pots ou caiffes emplies
d’une terre légère : la couche fupérièure doit être
composée de terreau tamifé, mêlée de terreau végétal
& de bois pourri aufli tamifés. C ’eft fur cette
couche, applatie avec une planchette unie, qu’il
faut les répandre, enfuite femer légèrement de cette
terre mêlee par-deffus vos graines, que vous ne
couvrirez que d’une demi-ligne.Dans les Alpes, celles
qui fe font femées d’elles-mêmes, font couvertes
de neige jufqu’en juin,& par conféquent parées de la
gelée. Aufli-tôt donc que votre femis fera fait, mettez
vos pots ou caiffes fous des chaflis vitrés juf-
qu’au milieu du printems ; alors enterrez-les dans
une couche tempérée, à l’expofition du levant, ou
dans quelque lieu ombragé. Vous fuppléerez à l’ombrage
naturel par des paillaffons, lorfqu’il fera né-
ceflaire ; fur-tout ayez toujours foin par des arro-
femens légers, faits avec le goupillon, d’entretenir
la fraîcheur de la fuperficie du femis : un peu de
moufle découpée très-fine par-deffiis fera un très-
bon effet, je m’enffiuis fouvent fervi avec beaucoup
de fuccès. La fécondé automne vous pourrez tranf-
planter vos petits arbuftes à l’ombre, dans une planche
de terre fraîche, en mettant de la moufle dans
leurs intervalles, & les couvrant durant l’hiver de
paillaffons, que vous n’ôterez que peu à peu , &
dont vous ne les priverez entièrement que vers le
10 de mai.
Les plantes des hautes montagnes font fenfibles
au froid, parce qu’elles ne fortent de deffous la neige
que lorfque le chaud eft venu ; & le chaud continue
fans prefque varier jufqu’à la chute des nouvelles
neiges, qui arrive en feptembre : de plus, elles
trouvent fur ces hauteurs des expofitions particulières
, un terreau très-léger, & fur-tout un air fubtil
qu’on ne peut leur donner dans la plaine. Il eft de ces
plantes que j’ai levées en motte fur des cimes élevées
, & qui étoient, malgré cette précaution, déjà
malades & flétries à mon arrivée dans la vallée.
Les perfonnes qui envoient de l’Amérique en Angleterre
des pieds des rhododendros n°, J , prennent
ordinairement des rejets mal enracinés qui ne
peuvent réuflir : elles devroient choifir de jeunes
ïujets provenus de graine, les lever avec une petite
motte qu’elles auroient foin d’envelopper avec
beaucoup de moufle fiffelée, & qu’elles recomman-
deroient d’humeôer fouvent durant le trajet. Cet
arbufte eft encore d’un prix exorbitant à Londres
& à Leyde. .( Cet article ejl de M. le Baron DE
Ts c h o ü d i . )
§ CHAMARES, ( Géogr. ) peuples anciens de la
Germanie . . . . lifez Chamaves. M. de Voltaire, dit,
dans fes Annales de ÜEmpire, que ce font les mêmes
que les Francs; mais Zofime & les autres anciens hifto-
riens difent que les Chamaves faifoient partie des Saxons.
Il n’en eft pas moins vrai qu’ils fe joignirent
aux Francs, & il y a apparence que leur nation fe
fondit dans celle-ci. ( C. )
CHAMBRE, ( Fabrique des armes. Fujîl. ) eft une
cavité dans, l’intérieur d’un canon : avec un peu d’u-
fage, on les appèrçoit à l’oeil ; mais on ne peut parfaitement
juger de leur profondeur, qu’avec uninf-
trument qu’on appelle le chat. C’eft un défaut capital
& dangereux : plus la chambre eft profonde & moins
le canon a d’épaiffeur à cet endroit : la craffe s’amaffe
dans cette cavité, qu’on ne peut nettoyer parfaitement
, & corrode le fe r , en forte que la chambre devient
toujours plus profonde. Des ouvriers adroits,
coiilent du cuivre dans les chambres, qu’on n’apper-
çoit plus ; mais après avoir tiré quelques coups, le
cuivre s’en va : il faut s’en défier. On a grand foin .de
à’affurer que les carions fabriqués pour le fervice diï
ïo i, n’aient point de chambre-. ( AA.')
CHAMEAU, f. ni. ( terme de Blafon. ) meuble de
l ’é c u , q u i repréfente un animal propre pour la charge,
commun chez les Orientaux.
Le chameau, dans les armoiries, défigne les voyages
en Orient.
Emmufelé fe .dit du chameau qui a la gueule liee
d’une mufeliere, pour l’empêcher de mordre ou dé
paître*
. Krocher au pays de la Marche ; d a%_ur au chameau
'for. ( G. D . L. T, )
C hameau de C eram , f. m. ( Hiß. nat. îchthyà-
l°g, ) poiffon des îles Moluques, ainfi nommé * & chameau
bleu de Ceram, par C o y e tt, qui en a fait graver
& enluminer une bonne fig. au n° 184, de la fécondé
partie de fon Recueil des poiffons £ Amboine. ^
lia le corps ovoïde pointu aux deux extrémités,
long de trois à quatre pieds, deux fois moins large,
boffu de trois boffes fur le dos, la tête & les yeux
petits, la bouche médiocre conique, la peau coriace,
très-dure.
Ses nageoires font au nombre de huit ; fçâvoir ,
deux ventrales médiocres, triangulaires, placées fous
le milieu du ventre, loin derrière les deux peétora-
les qui font elliptiques, obftufes, médiocrement longues;
deux dorfales, dont l’antérieure, fur une boffe,
formant une pointe triangulaire ; & la poftefieure
très-longue, ferrée comme-celle du glaucus ; une
derrière l’a««*, aufli fort longue, & à rayons ferrés;
enfin une à la queue, large , fourchue jufqu’au tiers
de fa longueur. De ces nageoires, il n’y en a qu’une
épineufe ; favoir, l’antérieure dorfale qui a onze
rayons, dont cinq au-devant, & fix derrière la boffe.
Son corps eft bleu , avec une ligne jaune longitudinale
de chaque cô té, •& trois croiffans blancs en-
deffus : la tête eft jaune fur les côtés, bleue deffous,
verte deffus , avec fes boffes rouges: les nageoires
font vertes, excepté l’antérieure dorfale épineufe,
dont la membrane eft jaune ôf les rayons noirs: la
boffe du dos, qui eft au deffus de cette nageoire, eft
rouge, traverfée en long par un trait bleu, furmonté
d’une tache en demi-lune jaune.
Moeurs. Ce poiffon eft commun dans la mer d’Am-
boine, fur-tout autour de l’île de Ceram.!
Qualités. Il eft fort gras & de bon goût.
V f âges. On le mange, mais fa graiffe caufe quelquefois
des naufées. Les fauvages de Ceram emploient
les rayons épineux de la nageoire dorfale
antérieure,’pour armer leur fléchés, parce que ces
rayons font non-feulement épineux, mais encore ils
ont une efpece de venin qui fait mourir ceux qui
en font bielles.
Deuxieme efpece. K aMEL-wISCH.
Le poiffonque Ruyfch a fait graver fous le nom de
kamel-wifch, ou gele-kamel- wifch, C’eft-à-dire, jaune ,
poiffon chameau, camelus fiavus, au n°. 4. de la planche
X V I I I .fe fa Collection nouvelle des poiffons d'Amboine
, a tant de rapport avec le précédent, qu’il fem-
ble n’en différer que par la couleur ; car il a d’ailleurs
les mèmès qualités & les mêmes üfages.
Son corps eft jaune , coup*é en deux lorigitudina-
lement par une ligne .jaune qui s’étend de chaque
côté de la tête à la queue ; aü-deffUs & au-deffous
de cette ligne, font trois grandes taches ovales bleues,
& trois petites rondes blanches.
Remarque. Le kamel-wifch, ou le poiffon chanieàu
fait, comme l’on voit, un gehre particulier qui fe
range naturellement dans la famille des perches où
nous l’avons placé dans notre Hifioir: naturelle uni-
verfelle des poiffons. (M. A d ANSON. )
§ CHAMELÉE, {Bot. ) laurier de Saint-Antoine.
Tonie II.
En latin chamoeleay6ncorum9 Hort. Çliff ; en Anglois,’
widow-wail; en Allethand, feidelbaft. . •
Le mot chamoelea vient des deux mots grecs chaînai
, humiy par terre, & t'Kcua., olivier, petit olivier.
Caractère générique),
La fleur n’a qu’un pétale coloré, divifé, ainfi qué
le calice, en trois parties. Du fond de la fleur s’élèvent
trois étamines plus courtes que les échancrures
du pétale : elles entourent un embryon à trois ftyles,
qui donne une baie feche à trois capfules faillantes
& arrondies , femblable à celle des tithymâles ; chacune
d’elles renferme un noyau couvert d’une peau.
Selon M. Duhamel, ce noyau contient des femen*
ces oblongues, nous ne l’avons pas ouvert, & nous
l’avons toujours femé entier.
Le chamelée forme un joli buiflbn qui devient
fort large & fort touffu ; il ne s’élève guere qu’à deux
pieds & demi au plus en Angleterre & en France ;
fes branches font menues & un peu courbes; elles
portent des feuillesbblpngues , étroites, épaiffes &
d’un verd foncé qui y font attachées fans pédicules ,
par une nervure robufte qui les partage & les four
tient; fes fleurs citrines naiffent folitaires dans l’aif-
felle des feuilles à l’extrémité des rameaux, & pa-
roiffent eh Juin & en Juillet.
Ce petit buiflbn peut être placé fur les devants
des inàflîfs des bofquets d’hiver , entre d’autres
arbuftes, dont il garnira agréablement l’intervalle ;
mais il ne s’accommode pas aufli bien du climal de la
France feptentrionale, que de celui de l’Angleterre.
Nous l’avons vu fôiivent périr jufqu’aux racines, &
quelquefois en entier. Pour parer à cet accident, nous
couvrons la terre de menue paille à fon pied , à la
fin de l’automne , & nous fichons autour de fes branches
des rameaux de pin ou d’épices qui le couvrent
en voûte.
On le multiplie de graines; mais elles ne muriffent
pas toujours parfaitement : elles font en automne
d’un brun obfcur, quand elles font parvenues à leur
maturité ; c’eft alors qu’il faut les femer dans une
caiffe emplie de bonne terre légère & fraîche, en les
recouvrant d’un demi-pouce de terre meuble, mêlée
de terreau. Au mois d’Avril fiiivant, vous mettrez
votre caiffe fur une couche tempérée, & fix ïemai-
nes ou deux mois après, vous verrez paroître vos
petits chamoelea ; mais fi au lieu de faire ce femis ea
o&obre, vous différez jufqu’à la faifon nouvelle, il
ne lèvera qu’un an après. Ces ârbuftes doivent être
trànfplantés la fécondé année au printems, chacun
dans un petit p o t , & doivent paffer l’hiver dans
une caiffe vitrée : lorfqu’ils feront affez forts, on
pourra les planter à demeure. ( M. le Baron d e
Ts ch o ü d i . )
* GHAMETLŸ, ( Géogr. ) petites îles de la meï
du Sud, au nombre de cinq , appeljëes, par erreur,
Chamely, dans le Dictionnaire raif. des Sciences, & c .
§ CHAMP, f. m. ( terme de Blafon. ) fond de
l’écu, partie fur laquelle on pofe les pièces & meu«.
blés qui compofeht les armoiries.
En blafonnant uri écu , l’ufage eft de nommer d’abord
Xémail du champ, enfuite les pièces & meubles
qui s’y. trouvent.
On dit du champ, pour éviter de répéter un émail
femblablë à celui du fond de l’écü.J
• Le nom de champ a été donné au .fond de l’éeu,'
parce qu’il eft chargé des armés que l’ori prenoit autrefois
fur l’ennemi dans un champ de bataille.
Ricard de jôyeufegarde, en Provence; d'or au
griffon de gueules , au chef d'ajur , chargé d'une fleur
de lys du champ. ( G. D. L .T . )
CHAMPACAM, f. ni. ( Hijt. nat. Botah. ) arbre
du Malabar, très-bien gravé , fous ce nom , & fous
celui àe fehampaharn, par Yan-Rheede, dans fon Hor-
R r ij