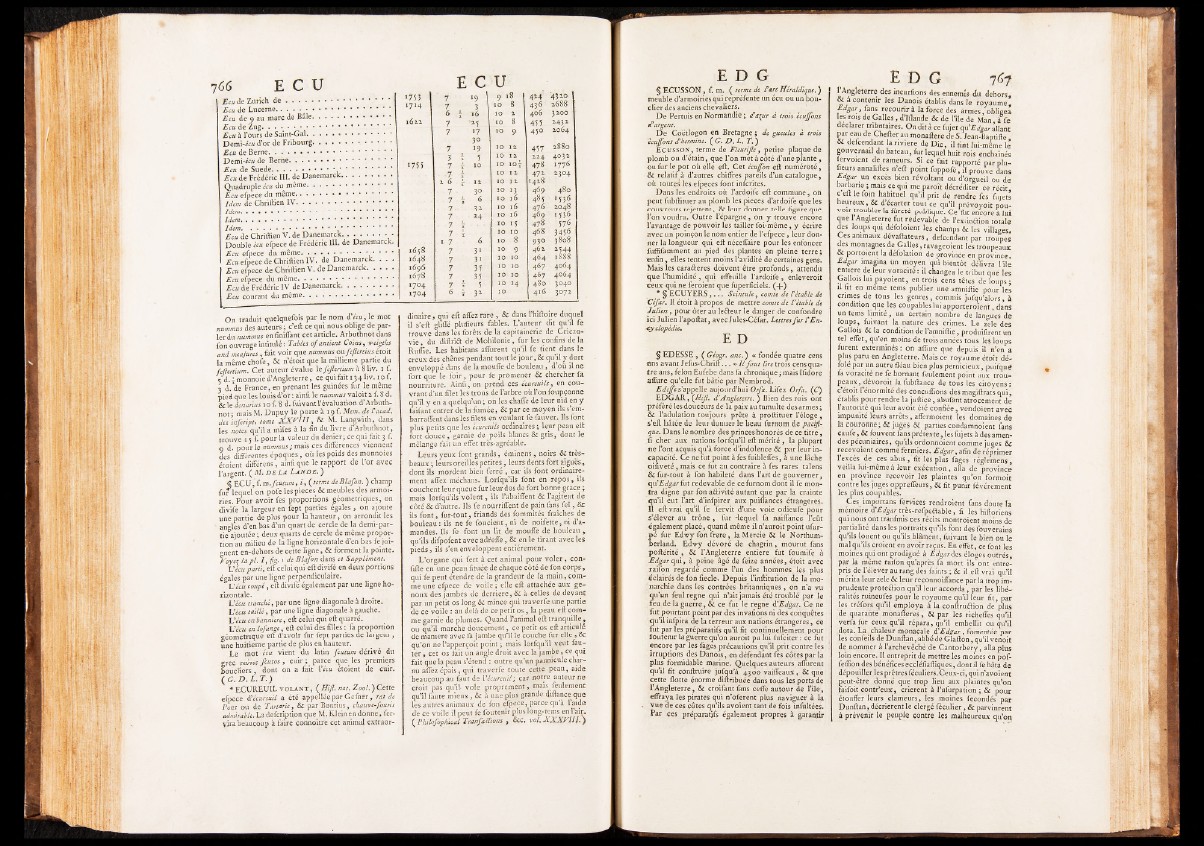
766 E C U E C U
*753
1714
7
7
6
| 1
i 16
0 o'-b
8 I
8
2 J
424
436
406
oj g £
0 000 '
Ecu de Zug. . . . • • • • .......................................*
Ecu à l’ours de Saint-Gai..............................................
Demi-éc« d’or de Fribourg. .........................
i6 z z 7
7
7
"H I
*7
3°
*9
'10
10
10
8
9
12
455
45°
457
2432
2064
2880
Demi-écade Berne.......................................................
1755
3
7
i 5
X 10
IÔ
10
12
107
224
478
4032
1776
WM Ecu 10 12 472 2304 de Frédéric III. de Danemarck........................
2 6 •f ’ 1 z 10 12 1428
Quadruple ecu du meme. . . . • • • •
7 . . 30. 10 13 469 480
Idem de Chniuen 1 v . . • • • • • - 7 M - 6 10 16 485 1536
. 7. 31 10 16 476 2048
j * nl............. .............. 7 24 . IO 16 469 1536 ...... . . . . 7 IO >5 478 576
Ecu de Chriftien V . de Danemarck. . ................. ...
Double écu efpece de Frédéric III. de Danemarck.
1658
1648
1696
. 1678
*7°4
1704
7
ï 7
7
6
31
10
10
1 10
10
8
9
468
•930
462
3456
3808
2544
Ecu efpece de Chriftien IV. de Danemarck. . . .
efpece de Chriftien V. de Danemarck. . . . .
77
7
3*
35
35
10
10
10
■ 10-/1
•vio
10 1
464
467
467
1888
4064
4064
7
6
t 5 10 *4 480 3° 4°
| 3* 10 416 3072
—
On traduit quelquefois par le nom d'écu, le mot
nummus des auteurs ; c’eft ce qui nous oblige de parler
du nummus enfiniffant cet article. Arbuthnot dans
fon ouvrage intitulé: Tables o f antient Coins, weiphs
and mtajures , fait voir que nummus oufeflertius étoit
la même chofe, 6c n’étoit que la millième partie du
feflertium. Cet auteur évalue le ffiertium à 8 liv. i f.
Y d. i monnoie d’Angleterre, ce qui fait 1 3 4 liv. 10 f.
3 d. de France, en prenant les guinées fur le même
pied que les louis d’or : ainfi le nummus valoit 2 f. 8 d.
& le denarius 10 f. 8 d. fuivant l’évaluation d’Arbùth-
not : mais M. Dupuy le porte à 19 f. Mem. de l'acad.
des infcript. tome X X V I I I , 6c M. Langwith, dans
les notes qu’il a mifes à la fin du livre d’Arbuthnot,
trouve 15 f. pour la valeur du denier; ce qui fait 3 f.
€) d. pour le nummus ; mais ces différences viennent
des différentes époques, où les poids des monnoies
étoient différens, ainfi que le rapport de l’or avec
l ’argent. ( M. d e l a L a n d e . )
§ E C U ,f . w.fcutum, i , ( terme deBlafon. ) champ
fur lequel on pofe les pièces 6c meubles des armoiries.
Pour avoir fes proportions géométriques, on
divife la largeur en fept parties égales , on ajoute
une partie de plus pour la hauteur, on arrondit les
angles d’en bas d’un quart de cercle de la demi-partie
ajoutée ; deux quarts de cercle de même proportion
au milieu de la ligne horizontale d’en bas fe joignent
en-dehors de cette ligne, 6c forment la pointe.
Voyei la p l. I , fig.1 de Blafon dans ce Supplément.
Vécu parti, eft celui qui eft divifé en deux portions
égales par une ligne perpendiculaire.
Vécu coupé, eft divifé également par une ligne horizontale.
.
Vécu tranché, par une ligne diagonale a droite.
Vécu taillé, par une ligne diagonale à gauche.
Vécu en bannière, eft celui qui eft quarre.
Vécu en lof ange, eft celui des filles : fa proportion
géométrique eft d’avoir fur fept parties de largeur,
une huitième partie de plus en hauteur.
Le mot écu vient du latin fcutum dérivé du
grec mvros fcutos , cuir ; parce que les premiers
boucliers, dont on a fait Vécu étoient de cuir.
( G .D .L .T . )
* ECUREUIL v o l a n t , ( Hifl. nat. Zool. ) Cette
efpece d’écureuil a été appelléepar G efner, rat de
Pont ou de Tartane, 6c par Bontius, chauve-fouris
admirable. La defcription que M. Klein en donne, fer-
yira beaucoup à faire connoître cet animal extraordinaire,
qui eft affezrare , & dans l’hiftoire duquel
il s’eft gliffé plufieurs fables. L’auteur dit qu’il fe
trouve dans les forêts de la capitainerie de Criczo-
vie du diftriâ de Mohilonie, fur les confins de la
Ruflie. Les habitans affurent qu’il fe tient dans le
creux des chênes pendant tout le jour, & qu’il y dort
enveloppé dans de la moufle de bouleau , d’où il ne
fort que le fo i r , pour fe promener & chercher fa
nourriture. Ainfi, on prend ces écureuils, en couvrant
d’un filet les trous de l’arbre où l’on foupçonne
qu’il y en a quelqu’un ; oh les chaffe de leur nid en y
fàifant entrer de la fumée, 6c par ce moyen ils s’ ein-
barraffent dans les filets eu voulant fe fauver. Ils font
plus petits que les écureuils ordinaires ; leur peau eft
fort douce, garnie de poils blancs 6c gris, dont le
mélange fait un effet très-agréable.
Leurs yeux font grands, éminens, noirs & très-
beaux ; leurs oreilles petites, leurs dents fort aiguës,
dont ils mordent bien ferré , car ils font ordinairement
affez médians.' Lorfqü’ils font en-repos, ils
couchent leur queue fur leur dos de fort bonne grâce ;
mais lorfqù’ils vôlèrit, ils l’abaiflent 6c l’agitent de
côté 6c d’autre. Ils fe noiirriflent de pain fans f e l , 6c
iis font, fur-tout, friands des fommités fraîches de
bouleau : ils ne fe foucient, ni de noifette, ni d’amandes.
Ils fe font un lit de moufle de bouleau ,
qu’ils difpofent avec adreffe, & en le tirant avec les
pieds, ils s’en envelOppènt entièrement.
L’organe qui fert à cet animal pour vo le r , con-
fifte en une peau fituée de chaque côté de fon corps ,
qui fe peut étendre de" la grandeur de la main, comme
une efpece de voile ; elle eft attachée aux genoux
des jambes de derrière, & à celles de devant
par un petit os long 6c mince qui traverfe une partie
de ce voile : au delà de ce petit o s , la peau eft comme
garnie de plumes. Quand l’animal eft tranquille ,
ou qu’il marche doucement, ce petit os eft articulé
de maniéré avec fa jambe qu’il le couche fur elle , 6c
qu’on ne l’apperçoit point ; mais lorfqu’il veut fauter
, cet os fait un angle droit avec la jambe, ce qui
fait que la peau s’étend : outre qu’un pannicule charnu
affez épais, qui traverfe toute cette peau, aide
beaucoup au faut de Vécureuil; car notre auteur ne
croit pas qu’i l vole proprement, mais feulement
qu’il faute mieux, & à une plus grande diftance que
les autres animaux de fon efpece, parce qu’à l’aide
de ce voile il peut fe foutenir plus long-tems en l’air.
( Philofophical Tranfallions , 6cq, vol, X X X V II1. )
E D G
§ ECUSSON, f. m. ( terme de fart Héraldique.}
meuble d’armoiries qui repréfente un écu ou un bouclier
des anciens chevaliers.
De Pertuis en Normandie ; d’azur à trois écujfons
d’argent.
De Coetlogon en Bretagne ; de gueules à trois
écujfons d hermine. ( G. D . L. T. )
E c u s s o n , terme de Fleurijle, petite plaque de
plomb ou d’étain, que l’on met à côté d’une plante ,
ou fur le pot où elle eft. Cet écuffon eft numéroté,
& relatif à d’autres chiffres pareils d’un catalogue,
où toutes les efpeces font infcrites.
Dans les endroits où l’ardoife eft commune, ofi
peut fubftituer au plomb les pièces d’ardoife que les
couvreurs rejettent, 6c leur donner telle figure que
l ’on voudra. Outre l’épargne, on y trouve encore
l’avantage de pouvoir les tailler foi-même, y écrire
avec un poinçon le nom entier de l’efpece, leur donner
la longueur qui eft néceflaire pour les enfoncer
fuffifamment au pied des plantes en pleine terre;
enfin, elles tentent moins l’avidité de certaines gens.
Mais les cara&eres doivent être profonds, attendu
que l’humidité , qui effeuille l’ardoife , enleveroit
ceux qui ne feroient que fuperficiels. (+ )
* § ECUYERS, . . . Scintule, comte de Üétable de
Cèfar. Il étoit à propos de mettre comte de l'étable de
Julien, pour ôter au lefteur le danger de confondre
ici Julien l’apoftat, avec Jules-Céfar. Lettres fur f Encyclopédie.
E D
§ ED ESSE , ( Géogr. ancf) « fondée quatre cens
ans avant Jefus-Chrift. . . » I l faut lire trois cens quatre
ans, félon Eufebe dans fa chronique ; mais Ifidore
aflùre qu’elle fut bâtie par Nembrod.
EdeJJes ’appelle aujourd’hui Orfa. Lifez Orfa. (C)
ED G A R , (Hifl. d.'Angleterre. ) Bien des rois ont
préféré les douceurs dé-la paix au tumulte des armes ;
& l’adulation toujours prête à proftituer l’éloge,
s’eft hâtée de leur donner le beau furnom de pacifique.
Dans le nombre des princes honorés de ce titre,
û cher aux nations lorfqu’il eft mérité , la plupart
ne l’ont acquis qu’à force d’indolence & par leur incapacité.
Ce ne fut point à fes foiblefles, à une lâche
oifiveté, mais ce fut au contraire à fes rares talens
& fur-tout à fon habileté dans l’art de gouverner,
qu’Edgar fut redevable de ce furnom dont il fe montra
digne par fon aâivité autant que par la crainte
qu’il eut l’art d’infpirer aux puiflances étrangères.
Il eft vrai qu’il fe fervit d’une voie odieufe pour
s’élever au trône , fur -lequel fa naiflance l’eût
également placé, quand même il n’auroit point ufur-
pé fur Edwy fon frere -, la Mercie & le Northum-
berland. Edwy dévoré de chagrin, mourut fans
poftérité , & l’Angleterre entière fut foumife à
Edgar qui, à peine âgé de feize années, étoit avec
raifon regardé comme l’un des hommes les plus
éclairés de fon fiecle. Depuis l’inftitution de la mo-
; narchie dans les contrées britanniques, on n’a vu
qu’un feul régné qui n’ait jamais été troublé par le
feu de la guerre, 6c ce fut le régné d'Edgar.. Ce ne
fut pourtant point par des in valions ni des conquêtes
qu’il infpira de la terreur aux nations étrangères, ce
fut par les préparatifs qu’il fit continuellement pour
foutenir la guerre qu’on auroit pu lui (ufeiter : ce fut
encore par les fages précautions qu’il prit contre les
irruptions des Danois, en défendant fes côtes par la
plus formidable marine. Quelques auteurs afîùrent
qu’il fit conftruire jufqu’à 43 00 vaiffeaux, & que
cette flotte énorme diftribuée dans tous les ports de
l’Angleterre, 6c croifant fans celle autour de l’île,
effraya les pirates qui n’oferent plus naviguer à la
vue de ces côtes qu’ils avoient tant de fois infultées.
Par ces préparatifs également propres à garantir
E D G §|f
ï Angleterre des incurfions des ennemis du dehors-
& à contenir les Danois établis dans le royaume,
Edgar , fans recourir à la force des armes, obligea
les rois de Galles , d’Iflande & de 111e de Man à fe
déclarer tributaires. On dit à ce fujet qu ’Edgar allant
par eau deChefter au monaftere de S. Jean-Baptifte *
6C defeendant la riviere de D ie, il tint lui-même le
gouvernail du bateau, fur lequel huit rois enchaînés
1er voient de rameurs. Si ce fait rapporté parplu-
iieurs annaliftes n’eft point fuppofé, il prouve dans
Edgar un excès bien révoltant ou d’orgueil ou dé
barbarie ; mais ce qui me paroît décréditer ce récit,
c’eft. le foin habituel qu’il prit de rendre fes fi.iets
heureux, 6c d ecarter tout ce qu’il prévoyoit pouvoir
troubler la fureté publique. Ge fut encore à lui
que 1 Angleterre fut redevable de l’exîinaion totale
des loups qui défoloient les champs 6c les villages*
Ces animaux dévaftateurs, defeendant par troupes
des montagnes de Galles, ravageoient les troupeaux
6c portoient la defolation de province en province.
Edgar imagina Un moyen qui bientôt délivra l ’île
entière de leur voracité: il changea le tribut quë les
Gallois lui payoient, en trois cens têtes de loups;
il fit en même tems publier une amniftie pour les
crimes de tous les genres , commis jufqu’alors, à
condition que les coupables lui apporteroient, dans
un tems limité, un certain nombre de langues de
; loups , fuivant la nature des crimes. Le zele des
Gallois 6c la condition de l’amnifti.e, produifirent un
tel effet, qu’en moins de trois années tous les loups
furent exterminés: on aflùre que depuis.il n’en a
plus paru en Angleterre. Mais ce royaume étoit dé-
fole par un autre fléau bien plus pernicieux, puifqué
fa voracité ne fe bornant feulement point aux trou^
peaux, devoroit la fubftance de tous les citoyens:
c’étoit l’énormité des concuflions des magiftràts qui,
établis pour rendre la juftice, abufant atrocement de
l’autorité qui leur avoit^été confiée, vendoient avec
impunité leurs arrêts , affermoient les domaines de
la couronne; & juges 6c parties condamnoient fans
caufe, & fouvent fa ns pré tex te, les fu jets à des amendes
pécuniaires, qu’ils ordonnoient comme juges 6c
recevoient comme fermiers. Edgar, afin de réprimer
l’excès de ces abus, fit les plus fages réglémens,
veilla lui-mêmçà leur exécution, alla de province
en province recevoir les plaintes qu’on formoit
contre les juges opprefleurs, 6c fit punir fé.vérement
les plus coupables.
Cês impôrtans fervices rendroient fans doute la
mémoire d’Edgar très-refpettable, fi les. hiftoriens
qui nous ont tranfmis ces récits montroient moins de
partialité dans les portraits qu’ils font des fouverains
qu’ils louent ou qu’ils blâment, fuivant le bien ou le
mal qu’ils croient en avoir reçus. En effet, ce font les
moines qui ont prodigué à Edgar des éloges outrés,
par la même raifon qu’après fa mort ils ont entrepris
de l’élever au rang des faints ; 6c il.eft vrai qu’il
mérita leur zele 6c leur reconnoiflance par la trop imprudente
prote&ion qu’il leur accorda, par les libéralités
ruineufes pour le royaume qu’il leur fit, par
les tréfors qu’il employa à la.conftru&ion de plus
de quarante monafferes, 6c par les richefles qu’il
verfa lùr ceux qu’il répara, qu’il embellit ou qu’il
.dotal La chaleur monacale d'Edgar, fomentée par
( les confeils de Dunftan, abbé de G lafton, qu’il venoit
de nommer à l’archevêché de Cantorbery, alla plus
loin encore. Il entreprit de mettre les moines en pof-
feflîon des bénéfices eccléfiafliques, dont il fe hâta de
dépouiller les prêtres féculiers.Ceux-ci, qui n’avoient
peut-être donné que trop lieu aux plaintes qu’on
faifoit contr’eux, crièrent à l’ufurpation ; 6c pour
étouffer leurs clameurs, les. moines fécondés par
Dunftan, décrièrent le clergé féculier, 6c parvinrent
à prévenir le peuple contre les malheureux qu’on.