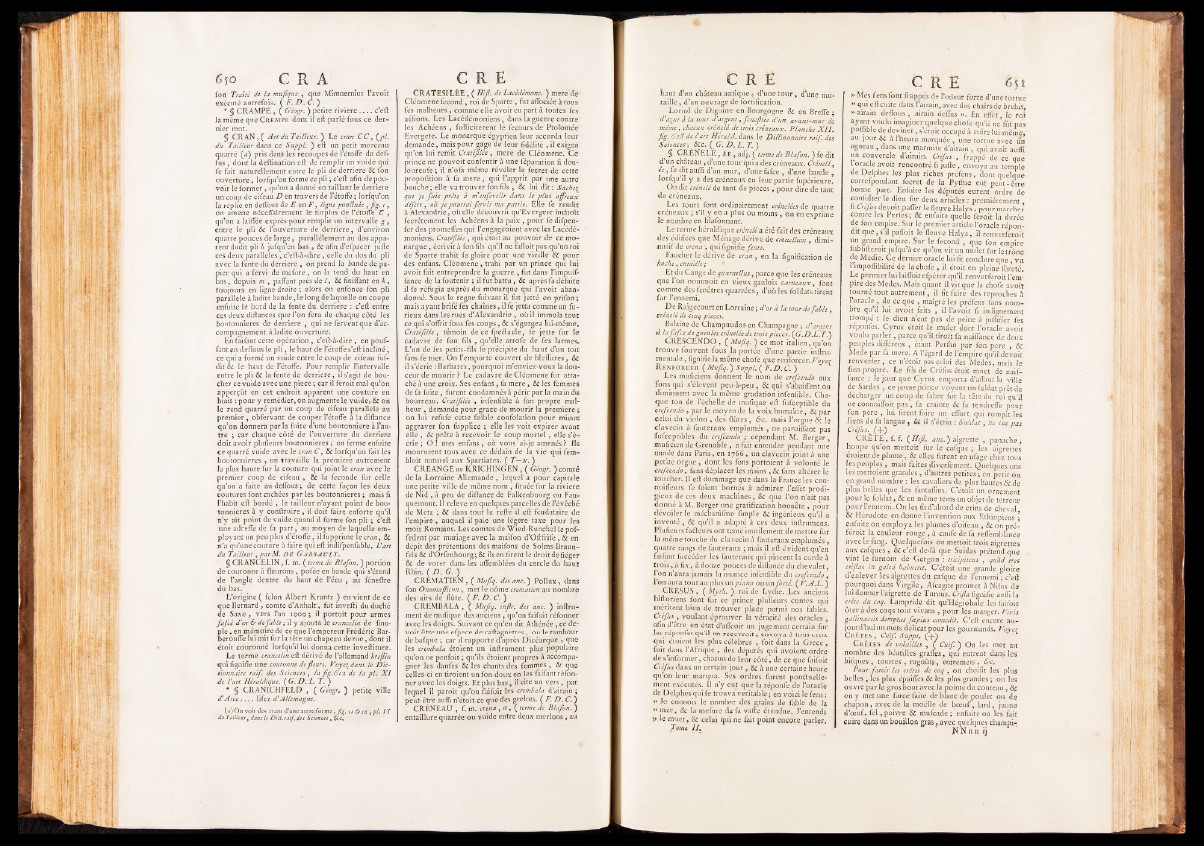
fon Traité de la mufique , que Mimnernius Ëavoit
exécuté autrefois. ( F . D . C .)
* § CRAMPE , ( Géogr. ) p e t i t e r i v i e r e . . . . c ’ e f t
Ja m ê m e q u e C r e m p e d o n t i l e f t p a r l é f o u s c e d e r n
i e r m o t .
§ C R A N ,( Art du Tailleur. ) Le cran C C , ( pl.
du Tailleur dans ce Suppl. ) eft un petit morceau
quarré (a) pris danis les recoupes de l’étoffe du def-
fus , dont la deftination eft de remplir un vuide qui
fe fait naturellement entre le pli de derrière & fon
ouverture, lorfqu’on forme ce pli ; c’eft afin de pouvoir
le former, qu’on a donné en taillant le derrière
un coup de cifeau D en travers de l’ étoffe ; lorfqu’on
la replie en deffous de E en F , ligne ponctuée , jig. i ,
on amene néceffairement le furplus de l’ étoffe E ,
qu’on a laiffée exprès pour remplir un intervalle g',
entre le pli 6c l’ouverture de derrière, d’environ
quatre pouces de large, parallèlement au dos apparent
dudit pli h jufqu’en bas , 6 c afin d’efpacer jufte
ces deux parallèles , c’eft-à-dire , celle du dos du pli
avec la fente du derrière , on prend la bande de papier
qui a fervi de mefure, on la tend du haut en
bas, depuis m , paffant près de /, 6c finiffant en k 9
toujours en ligne droite ; alors on enfonce fon pli
parallèle à ladite bande, le long de laquelle on coupe
enfuite le bord de la fente du derrière : c’eft entre
ces deux diftances que l’on fera de chaque côté les
boutonnières de derrière , qui ne fervent que d’accompagnement
à ladite ouverture.
En faifant cette opération , c’eft-à-dire , en pouffant
en deffous le p li, le haut de l’étoffe s’eft incliné,
ce qui a formé un vuide entre le coup de cifeau fuf-
dit 6c le haut de l'étoffe. Pour remplir l’intervalle
entre le pli & la fente de derrière, il s’agit de boucher
ce vuide avec une piece ; car il feroit mal qu’on
apperçût en cet endroit apparent une couture en
biais : pour y remédier, on augmente le vuide, 6c on
le rend quarré par un coup de cifeau parallèle au
premier, obfervant de couper l’étoffe à la diftance
qu’on donnera par la fuite d’une boutonnière à l’autre
; car chaque côté de l’ouverture du derrière
doit avoir plufieurs boutonnières ; on ferme enfuite
ce quarré vuide avec le cran C , & lorfqu’on fait les
boutonnières , on travaille la première autrement
la plus haute fur la couture qui joint le cran avec le
premier coup de cifeau , 6c la fécondé fur celle
qu’on a faite au-deffous; de cette façon les deux
coutures font cachées par les boutonnières ; mais fi
l’habit eft bordé , le tailleur n’ayant point de boutonnières
à y conftruire, il doit faire enforte qu’il
n’y ait point de vuide quand il forme fon pli ; c’eft
une adreffe de fa part, au moyen de laquelle employant
un peu plus d’étoffe, iifupprime le cran, 6c
n’a qu’une couture à faire qui eft indifpenfable. L’art
du Tailleur, par M. DE GARSAULT.
§ CRANCELIN, f. m. ( terme de Blafon. ) portion
de couronne à fleurons , pofée en bande qui s’étend
de l’angle dextre du haut de l’écu , au féneftre
du basr
L’origine ( félon Albert Krantz ) en vient de cè
que Bernard , comte d’Anhalt, fut inverti du duché
de S ax e, vers l’an 1000 ; il portoit pour armes
fafcé d’or G de fable ; il y ajouta le crancelin de lino-
p le , en mémoire de ce que l’empereur Frédéric Bar-
berouffe lui mit fur la tête un chapeau de rue, dont il
étoit couronné lorfqu’il lui donna cette inveftiture.
Le terme crancelin eft dérivé de l’allemand kreflm
qui lignifie une couronne de fleurs. Voye{ dans le Dictionnaire
raif. des Sciences , la flg.Gix de la pl. X I
de Part Héraldique. ( G. D . L. T. )
* § CRANICHFELD , (• Géogr. ) petite ville
£ Arce . . . . lifez d’Allemagne.
(<*) On voit des crans d’une autreforme, fig. ti & 12 , pl. VI
du Tailleur, dans le DiÜ. raif. des Sciences, & c.
CRATESILÊE, ( Hifl. de Lacédémone. *) mere dé
Cléomene fécond , roi de Sparte, fut affociée à'tous
fes malheurs, comme elle avoir eu part à toutes fea
a étions. Les Lacédémoniens, dans la guerre contre
les Achéens , folliciterënt le feeours de Ptolomée
Evergete. Le monarque égyptien leur accorda leur
demande, mais pour gage de leur fidélité , il exigea
qu’on lui remît Cratéfilée, mere de Cléomene. Ce
prince ne pouvoit confentir à une féparation fi dou->
loureufe ; il n’ofa même révéler le fecret de cette
propofition à fa mere, qui l’apprit par une autre
bouche; elle va trouver fon fils , 6c lui dit : Sachez
que je fuis prête à menfevelir dans le plus affreux
défert, où je pourrai fervir ma patrie. Elle fe rendit
à Alexandrie , oiielle découvrit qu’Evergete incitoit
fecrétement les Achéens à la paix, pour fe difpen-
fer des promeffeS qui l’engageoient avec les Lacédémoniens.
Cratéfilée , qui étoit au pouvoir de ce monarque
, écrivit à fon fils qu’il ne falloit pas qu’un roi
de Sparte trahît fa gloire pour une vieille 6c pour
des ènfans. Cléomene, trahi par un prince qui lui
avoit fait entreprendre la guerre , fut dans l’impuif-
fance de la foutenir ; il fut battu, 6c après fa défaite
il fe réfugia auprès du monarque qui l’avoit abandonné.
Sous le régné fuivantil fut jetté en prifon;
mais ayant brifé fes chaînes, il fe jetta comme un furieux
dans les rues d’Alexandrie , oîiil immola tout
ce qui s’offrit fous fes coups, 6c s’égorgea lui-mêjne.
Cratéfilée, témoin de ce fpeftacle, fe jette fur le
cadavre de fon fils , qu’elle arrofe de fes larmes.
L’un de fes petits-fils fe précipite du haut d’un toit
fans fe tuer. On l’emporte couvert de bleffures , 6c
il s’écrie : Barbares, pourquoi m’enviez-vous la douceur
de mourir ? Le cadavre de Cléomene fut attaché
à une croix. Ses enfans, fa mere, 6c les femmes
de fa fuite , furent condamnés à périr par la main du
bourreau. Cratéfilée , infenfible à fon propre malheur
, demande pour grâce de mourir la première
on lui refufe cette foible confolation pour mieux
aggraver fon fupplice ; elle les voit expirer avant
elle , 6c prête à recevoir le coup mortel , elle s’écrie
; O ! mes enfans, oii vous ai-je amenés ? Ils
moururent tous avec ce dédain de la vie qui fem-
bloit naturel aux Spartiates. ( T—n . )
CRÉANGE ou KRICHINGEN, ( Géogr. ) comté
de la Lorraine Allemande, lequel a pour capitale
une petite ville de même nom , fituée fur la riviere
de Nid , à peu de diftance de Falkenbourg ou Fau-
quemont. Il releve en quelques parcelles de l’évêché
de Metz ; 6c dans tout le refte il eft feudataire de
l’empire , auquel il paie une légère taxe pour les
mois Romains. Les comtes de Wied-Runckel le pof-
fedent par mariage avec la maifon d’Oftfrife , & en
dépit des prétentions des maifons de Solms-Bràun-
fels 6c d’Orfenbourg;& ils en tirent le droit de fiéger
6c de voter dans les affemblées du cercle du haut
Rhin. ( D . G. .)
CREMATIEN, ( Mufiq. des anc. ) Pollux, dans
fon Onomaflicon, met le nôme crematien au nombre
des airs de flûte. {F . D. C. )
CREMBALA , ( Mufiq.. inflr. des anc. ) infiniment
de mufique des anciens , qu’on faifoit réfonner
avec les doigts. Suivant ce qu’en dit Athénée, ce devoir
être une efpece de caftagnettes, ou le tambour
de bafque ; car il rapporte d’après Dicéarque , que
les crembala étoient un infiniment plus populaire
qu’on ne penfoit ; qu’ils étoient propres à accompagner
les danfes 6c les chants des femmes , & que
celles-ci en tiroient un fon doux en les faifant réfonner
avec les doigts. Et plus bas, il cite un vers, par
lequel il paroît qu’on faifoit les crembala d’airam ;
peut-être aufii n’étoit-ce que des grelots. (F . D. C .)
CRÉNEAU , f. m. crena , a , ( terme de Blafon. )
entaillure quarrée ou vuide entre deux merlons, au
haut d’un château antique * d’une tou r , d*itne muraille
, d’un ouvrage de fortification.
Loriol de Digoine en Bourgogne 6c en Breffe •
d’azur à la tour d’argent, feneflrée d’un avant-mur de
même , chacun crénelé de trois créneaux. Planche X I I .
flg. 6z8 de ,l’art Hérald. dans le Dictionnaire raif. des
Sciences6cc. ( G. D . L. T. )
S CRÉNELÉ , ée , adj. ( terme de Blafon. ) fe dit
d’un château, d’une tour qui a des créneaux. Crénelé,
ee , fe dit aufii d’un-mur, d’une fafee , d’une bande ,
lorfqu’il y a des créneaux en leur partie fupérieure.
On dit crénelé de tant de pièces , pour dire de tant
de créneaux.
Les tours font ordinairement, crénelées de quatre
créneaux ; s’il y en a plus ou moins , on en exprinie
le nombre en blafonnant.
Le terme héraldique crénelé a été fait des créneaux
des édifices que Ménage dérive de crenellum , diminutif
de crena -, quifignifie fente.
Fauchet le dérivé de cran , en la lignification de
hoche, entaille-}
Et du Cange de quarnellus, parce que les créneaux
que l’on nommoit en vieux gaulois carneaux, font'
icomme des fenêtres quarrées, d’oiiles fôldats tirent
fur l’ennemi.
De Raigecourt en Lorraine ; d'or à la tour de fable ,
trenele de cinq pièces.
Balaine de Champaudos en Champagne ; d'arpent
à la fafee de gueules crénelée de trois pièces. (G.D.L .T.')
CRESCENDO , ( Mufiq, ) ce mot italien, qu’on
trouve fouvent fous la portée d’une partie inftru-
mentale, fignifiela même chofe que renforcer. Voyez
^Renforcer ( Mufiq. ) Suppl. ( F. D . C. )
Les muficiens donnent l’e nom de crefcendo àiix
fons qui s’élèvent peu-à-peu , & qui s’abaiffent ou
diminuent avec la même gradation infenfible. Chaque
ton de l’échelle de mufique eft fufceptible du
crefcendo j par le moyen de la voix humaine, & par
celui du violon , des flûtes , &c. mais l’orgue & le
clavecin à fauteraux emplumés , ne paroiffent pas
fufceptibleis du crefcendo ; cependant M. Berger,
muficien de Grenoble , à fait ehrendre pendant une
année dans Paris, en 1766, un clavecin joint à une
petite orgue , dont les fons pbrtoient à volonté le
crefcendo, fans déplacer les mains , &c fans altérer le
toucher. Il eft dommage que dans la France les con-
noiffeurs fe foient bornés à admirer l’effet prodigieuse
de ces deux machines, & que l’on n’ait pas
donné à M. Berger une gratification honnête , pour
dévoiler le méçhanifme fimple & ingénieux qu’il a
inventé, & qu’il a adapté à ces deux inftrumens.
Plufieurs fadeurs ont tenté inutilement de mettre fur
la même touche du clavecin à fauteraux emplumés , .
quatre rangs de fauteraux ; mais il eft évident qu’en j
faifant fuccéder les fauteraux qui pincent la corde à
trois, à fix, à douze pouces de diftance du chevalet,
l’on n’aura jamais la nuance infenfible du crefcendo ,
l’on aura tout au plus un piano ou un forté. ( V.A.L. )
CRÉSUS, (Mjyth. ). roi de Lydie. Les anciens
hiftoriens font fur ce prince plufieurs contes qui
méritent bien de trouver place parmi nos fables.
Créfus , voulant éprouver la véracité des oracles ,
afin d’être en état d’affeoir un jugement certain fur
lesTéponfesqu’il en recevroit, envoya à tous ceux
qui étoient les plus célébrés , foit dans la Grece,
foit dans l’Afrique , des députés qui avoient ordre
de s’informer, chacun de leur côté, de ce que faifoit !
Créfus dans un certain jour , & à une certaine heure !
qu’on leur marqua. Ses ordres furent ponéhielle-
ment exécutés. Il n’y eut que la réponfe de l’oracle
de Delphes qui fe trouva véritable ; en voici le fens :
* Je connois le nombre des grains de fable de la
» mer, & la mefure d« fa vafte étendue. J’entends
le muet, & celui qui ne lait point encore parler.
Tçme I I ,
I » Mes fens font frappes de l’odeur forte d’uné tortue
>> qui eft cuite dans l’airain, avec des chairs de brebis,
»airain deffous, airain deffus ». En effet, le roi
ayant voulu imaginer quelque chofe qu’il ne fût pas
poflible de deviner, s’étoit occupé à cuire lui-même,
au jour 6c à l’heure marquée , une tortue avec un
agneau , dans une marmite d’airain , qui avoit aufli
un couvercle d'airain; Créfus , frappé de ce que
1 oracle avoit rencontré fi jufte, envoya au temple
de Delphes les plus riches préfens, dont quelque
correfpondant fecret de la Pythie eut peut-être
bonne part. Enfuite les députés eurent ordre de
confulter le dieu fur deux articles : premièrement,
fi Créfus dévoit paffer le fleuve Halys > pour marcher
contre les Perfes; & enfuite quelle feroit la durée
de fon empire. Sur le premier article l’oracle répondit
q u e ,s ’il paffoit le fleuve Halys, il renverferoit
un grand empire. Sur le fécond , que fon empire
fubfifteroit jufqu’à ce qu’on vît un mulet fur le trône
de Médie. Ce dernier oracle lui fit conclure que , vu
Pimpoffibilité de la chofe , il étoit en pleine fûreté.
Le premier lui laiffoit efpérer qu’il renverferoit l’empire
des Medes. Mais quant il vit que la chofe avoit
tourné tout autrement, il fit faire des reproches à
l’oracle , de ce que , malgré les préfens fans nombre
qu’il lui avoit faits , il l’avoit fi indignement
trompé : le dieu n’eut pas de peine à juftifier fes
.réponfes. Cyrus étoit le mulet dont l’oracle avoit
voulu parler , parce qu’iLtiroit fa naiffance de deux
peuples différens , étant/Perfan par fon pere , 6c
Mede par fa mere. A l’égard de l’empire qu’il devoit
renverfer, ce n’étoit pas celui des Medes, mais lé
fien propre. Lë fils de Créfus étoit muet de naiffance
: le jour que Cyrus emporta d’affaut la: ville
de Sardes , ce jeune prince voyant un foldat prêt dé
décharger un coup de fabre fur la tête du roi qu’il
ne connoiffoit pas , fa crainte & fa tendreffe pour
fon pere , lui firent faire un effort qui rompit les
liens de fa langue , & il s’écria : Soldat. ne tue pas
Créfus. (-f-)
CR Ê T E , f. f. (Hifl. ahç.) aigrette , panache;
houpe qu’on mettoit fur le cafque ; les aigrettes
étoient de plume, & elles furent en ufage chez tous
les peuples, mais faites jJiverfement. Quelques uns
les mettoient grandes , d’autres petites ; en petit ou
en grand nombre : les cavaliers de plus hautes & de
plus belles que les fantaffms. Ç’étoit un ornement
pour le foldat, & en même tems un objet de terreur
pour l’ennemi. On les fit d’abord de crins de cheval
& Hérodote en donne l’invention aux Ethiopiens •
enfuite on employa les plumes d’oifeau, 6c on pré-
féroit la couleur rouge, à caufe de fa reffemblance
àvec le fang. Quelquefois on mettoit trois aigrettes
aux cafques , 6c c’eft de-là que Suidas prétend que
vint le furnom de Gergon : tricipiteus , qubd très
criflas ih galea habucrit. C ’étoit une grande gloire
d’enlever les aigrettes du cafque de l’ennemi ; c’eft
pourquoi dans Virgile, Afcagne promet à Nifus de
lui donner l’aigrette de Turnus. Oz/fo fignifie auffi la
crête du coq. Lampride dit qu’Hégiobale les faifoit
ôter à des coqs tout v ivans, pour les manger. Fivis
gallinaceis demptas feepius comedit. C ’eft encore aujourd’hui
un mets délicat pour les gourmands. Voyez
C rêtes , Cuif. Suppl. (-}-)
C rêtes de volailles , ( Cuif. ) On les met au
nombre des béatilles grades, qui entrent dans les
bifques , tourtes , ragoûts, entremets , &c.
Pour farcir les crêtes de coq , on choifit les plus
belles-, les plus épaiffes & les plus grandes ; on les
ouvre par le gros bout avec la pointe du couteau, 6c
on y met une farce faite de blanc de poulet ou de
chapon, avec de la moelle de boe uf, lard, jaune
d’oe uf, f e l , poivre 6c mufeade ; enfuite on les fait
cuire dans un bouillon gras ? avec quelques champi-
^ N n n i;