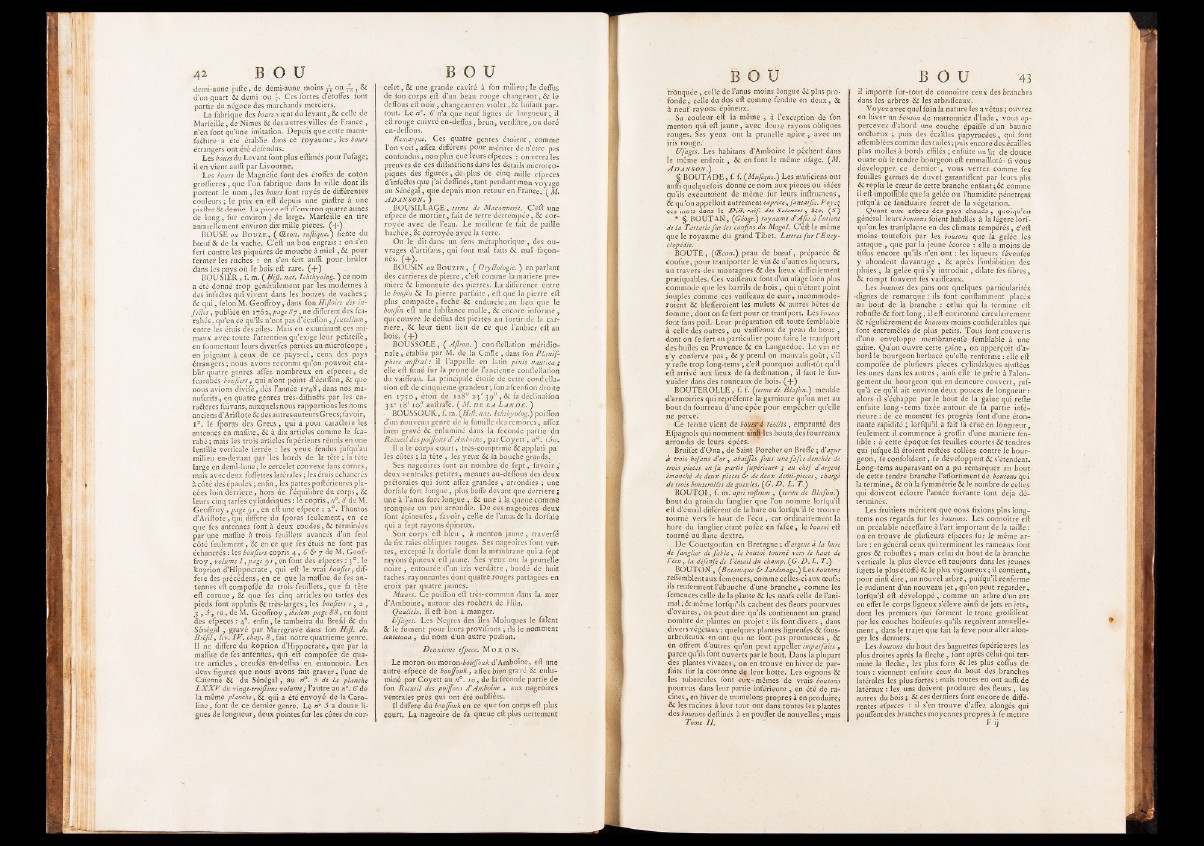
il il' « i lL i
i lilfei
•demi-aune jufte, de demi-aune moins rs ou &
d’un quart & demi ou £. Ces fortes d’étoffes font
partie du négoce des marchands merciers.
La fabrique des bouts vient du levant, & celle de
Marfeille, de Nîmes & des autres villes de France ,
n’en font qu’une imitation. Depuis que cette manufacture'
a été établie dans ce royaume, les bours
étrangers ont été défendus.
Les bours du Levant font plus eftiinés pour l’ufage;
il en vient aufli par Livourne.
Les bours de Magnéfie font des étoffes de coton
groflieres , que l’on fabrique dans la ville dont ils
portent le nom , les bours font rayés de différentes
couleurs ; le prix en eft depuis une piallre à une
piaftre & demie. La piece elf d’environ quatre aunes
de long, fur environ f de large. Marfeille en tire
annuellement environ dix mille pièces, ( - f )
BOUSE ou Bo ü z e , ( QLcon. rufiique-.) fiente du
boeuf & de la vache. C ’eft un bon engrais : on s’en
fert contre les piquûres de mouche à m ie l, & pour
fermer les niches : on s’en fert aufii pour brûler
■ dans les pays où le bois efl: rare. (+ )
BOU S1ER , f. m. ( Hiß. nat. Ichthyolog. ) ce nom
a été donné trop généralement par les modernes à
des infeCtes qui vivent dans les bouzes de vaches ;
& qui, félon M. Geoffroy, dans fon Hifioire des infectes
, publiée en 1762, page S y , ne different des fca-
rabés, qu’en ce qu’ils n’ont pas d’écuffon, fcutelLum,
entre les étuis des ailes. Mais en examinant ces animaux
avec toute l’attention qu’exige leur petiteffe,
en foumettant leurs diverfes parties au microfcope,
en joignant à ceux de ce pays-ci, ceux des pays
étrangers ; nous avons reconnu qu’on pouvoit établir
quatre genres affez nombreux en efpeces, de
fcarabés boufiers, qui n’ont point d’écuffon, & que
nous avions divifé, dès l’année 1748, dans nos ma-
nufcrits, en quatre genres très-diftin&s par les ca-
ra&eres fui vans, auxquels nous rapportions les noms
anciens d’Ariftote & des autresauteurs Grecs; favoir,
i ° . le fporas des Gre cs, qui a pour cara&ere les
antennes en maffue, & à dix articles comme le fca-
rabé ; mais les trois articles fupérieurs réunis en une
lentille verticale ferrée : les yeux fendus jufqu’au
milieu en-devant par ’ les bords de la tête ; la tête
large en demi-lune; le cercelet convexe fans cornes,
mais avec deux foffettes latérales ; les étuis échancrés
à côté des épaules ; enfin, les pattes poftérieures placées
loin derrière, hors de l’équilibre du corps, &
leurs cinq tarfes cylindriques : le copris, n°. 8 de M.
Geoffroy., page c) 1 , en efl une efpece : 20. l’hontos
d’Ariftote, qui différé du fporas feulement, en ce
que fes antennes font à déux coudes, & terminées
par une maffue à trois feuillets avancés d’un feul
côté feulement, & en ce que fes étuis ne font pas
échancrés : les boußers copris 4 , G & y de M. Geoff
ro y , volume I , page <) 1 , en font des efpeces : 3 °. le
koprion d’Hippocrate , qui efl le vrai boufier, différé
des précédens, en ce que la maffue de fes antennes
efl compofée de trois feuillets, que fa tête
efl: cornue, & que fes cinq articles ou tarfes des
pieds font applatis & très-larges ; les boußers 1 , 2 ,
3 , 3 , 10, de M. Geoffroy, ibidem page 88, en font
des efpeces : 40. enfin, le tambeira du Brefil & du
Sénégal , gravé par Marcgrave dans fon Hiß. du
Brefil, liv. IP . chap. #,fait notre quatrième genre.
Il ne différé du koprion d’Hippocrate, que par la
maffue' de fes antennes, qui efl: compofée de quatre
articles , creufés én-deffus ’ en entonnoir. Les
deux figures que nous avons fait graver, l’une de
Caïenne & du Sénégal , au n°. S de la planche
LX X V du vingt-troifiente volume; l’autre au n°. G de
la même planche, &: qui a été envoyé de la Caroline
, font de ce dernier genre. Le n° 5 a douze lignes
de longueur, deux pointes fur les côtes du corcelet,
& une grande cavité à fon milieu ; le deffus
de fon corps efl d’un beau rouge changeant, & le
deffous efl noir, changeant en violet ,& luifant partout.
Le n°. G n’a que neuf lignes de longueur;, il
efl rouge cuivré en-deffus, brun, verdâtre, ou doré
en-deffoùs.
Remarque. Ces quatre genres étoient, comme
l’on v o it , affez différens pour mériter de n’être pas
confondus, non plus que leurs efpeces : on verra les
preuves de ces diftinûions dans les détails mierofco-
piques des figures, de» plus de cinq mille efpeces
d’infettes que j’ai deflinés,tant pendant mon voyage
au Sénégal, que depuis mon retour en France. ( M.
A d a n s o n . )
BOUSILLAGE, terme de Maçonnerie. C ’eft une
efpece de mortier, fait de terre détrempée, & corroyée
avec de l’eau. Le meilleur fe fait de paille
hachée, & corroyée avec la terre.
On le dit dans un fens métaphorique, des ouvrages
d’artifans, qui font mal faits & mal façonnés.
(+ ) .
BOUSIN ou Bouzin , (- Oryclologie. ) en parlant
des carrières de pierre, c’eft comme la matière première
& limonéufe des pierres. La différence entre
le boufin & la pierre parfaite, efl que la pierre eft
plus compacte, feche & endurcie; au lieu que le
boufin eft une fubftance molle, & encore informe ,
qui couvre le deffus des piertës au fortir.de la carrière,
& leur tient lieu de ce que l ’aubier eft au
bois; (+ )
BOUSSOLE, ( Afiron. ) con ftellation méridionale
, établie par M. de la Caille , dans fon Planiß
phere auflral : il l ’appelle en latin pixis nautica ;
elle eft ntué fur la proue de l’ancienne conftellation
du vaiffeau. La principale étoile de cette conftellation
eft de cinquième grandeur ; fon afcenfion droite
en 1750, étoit de 1180 23'39" , & fa déclinaifon
320 18' io " auftrâîe. ( M. d e l a L a n d e . )
BOUSSOUK, f. m. (Hiß. nat. Ichthyolog.) p.oiffon
d’un nouveau genre de la famille des remores, affez
bien gravé & enluminé dans la fécondé partie du
Recueil despoißons d’Amboine, par C o y e tt , n°. iSô\
Il a le corps court, très-comprimé & applati pa
les côtés ; la tête , les yeux & la bouche grands.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir
deux ventrales petites, menues au-deffous des deux
peâorales qui font affez grandes , arrondies ; une
dorfale fort longue., plus baffe devant que derrière ;
une à l’anus fort longue , & une 3 la queue comme
tronquée ou peu arrondie. De ces nageoires deux
font épineufes, favoir, celle de l’anus & la dorfale
qui a fept rayons épineux.
Son corps, eft bleu , à menton jaune , traverfé
de fix raies obliques rouges. Ses nageoires font vertes,
excepté là dorfale dont la membrane qui a fept
rayons épineux eft jaune. Ses yeux ont la prunelle
noire , entourée d’un iris verdâtre, bordé de huit
taches rayonnantes dont quatre rouges partagées en
croix par quatre jaunes.
Moeurs. Ce poiffon eft très-commun dans la? mer
d’Amboine, autour des rochers de Hila.
Qualités. Il eft bon à manger.
Ufages. Les Negres des îles Moluques le faîent
& le fument pour leurs provifions ; ils le nomment
teutetoua , du nom d’un autre poiffon.
Deuxieme efpece. M O R O N.
Le moron ou moron-boußbuk d’Amboine, eft une
autre efpece de boußouk, affez bien gravé & enluminé
par Coyett aun°. 10, de la fécondé partie de
fon Recueil des poißons d'Amboine , aux nageoires
ventrales près qui ont été oubliées. ■.<
Il différé du boùffouk en ce que fon corps eft plus
court. La nageoire de fa queue eft plus nettement
trônqiiéè, celle de l’anus moins longue & plus profonde,
celle du dos eft comme fendue en deux, &
à neuf rayons épineux.
. Sa couleur eft la même , à l’exception de fon
menton qui eft jaune, avec douze rayons obliques
rouges. Ses yeux ont la prunelle npire , -avec un
iris rouge. ‘
Ufages. Les habitans d’Amboine le pêchent dans
le même endroit, & en font le même ufage. (Af.
A d a n s o n .)
§ BOUTADE, f. f. ( Mnfique.) Les muficiens ont
suffi quelquefois donné ce nom aux pièces ou idées
qu’ils exécutoient de même fur leurs inftrumens,
& qu’on appelloit autrement caprice, fantaifie. Voye{
ces mots dans le Dicl. raif. des Sciences, &c. (3 )
* § B O UT AN, (Géogr.) royaume d'Afie à torient
de la Tartarie fur les confins du Mogol. C ’éft le même
que le royaume du grand Tibet. Lettres fur l'Ency-
• çlopédie.
BOUTE , (OEcon.) peau de boeuf, préparée &
coufue, pour tranfporter le vin & d’autres liqueurs,
au travers des montagnes & des lieux difficilement
pratiquables. Ces vaiffeaux font d’un ufage bien plus
commode que les barrils de bois, qui n’étant point
fôuplés comme ces vaiffeaux de cuir, incommode-
roiênt & blefferoiènt les mulets & autres bêtes de
fomme, dont on fe fert pour ce tranfport. Les boutes
font fans poih Leur préparation eft toute femblable
à celle des outres, ou vaiffeaux de peau de bouc ,
dont on fe fert en particulier pour faire le tranfport
des huiles en Provence & en Languedoc. Le vin ne
s’y conferve pas, & y prend un mauvais goût, s’il
y refte trop long-tems ; c’eft pourquoi auffi-tôt qu’il
eft arrivé aux lieux de fa deftination, il faut le fur-
vuider dans des tonneaux de bois. (+ )
BOUTEROLLE, f. f. (terme de Blafon.) meuble
d’armoiries qui repréfente la garniture qu’on met au
bout du fourreau d’une épée pour empêcher qu’elle
rie perce.
Ce terme vient de bout&fig-rèolles, emprunté des
Efpagnols qui nomment ainfi les bouts des fourreaux
arrondis de leurs épées. ^
Bruifet d’On a, de Saint Porcher en Breffe ; à'açiir
à trois befans dor, abaiffés fous une fafce denchèe de
trois pièces en fa partie fupérieure ; au chef d'argent.
émanché de deux pièces & de deux deml-pieces, chargé
de trois bàuterolles de gueules. (G. D . L. T.)
• BOUTOI, f. m. apri rofirum , (terme de Blafon.)
bout du groin du fanglier que l’on nomme lorfqu’il
eft d’émail différent de la hure ou lorfqu’il fe trouve
tourné vers le haut de l’écu , car ordinairement la
hure du fanglier étant pofée en fafce, \e-boutoi eft
tourné au flanc dextre.
De Couetgoufan en Bretagne ; d'argent à la hure
de fanglier de fable, le boutoï tourné vers le haut de
Vécu, la défenfe de l'émail du champ. (G. D. L. T.)
BOUTON , (Botanique & Jardinage.') Les boutons
reffemblentaux femences, comme celles-ci aux oeufs:
ils renferment l’ébauche d’une branche, comme les
femences celle de la plante & les oeufs celle de l’animal
; & même lorfqu’ils cachent des fleurs pourvues
d’ovaires, on peut dire qu’ils contiennent un grand
nombre de plantes en projet : ils font divers , dans
divers végétaux: quelques plantes ligneufes &fous-
arbrifleaux en ont qui ne font pas prominens , &
en offrent d’autres qu’on peut appeller imparfaits ,
parce qu’ils font ouverts par le bout. Dans la plupart
des plantes vivaces, on en trouve en hiver de parfaits
fur la couronne ,d§ leur botte. Les oignons &
les tubercules font eux-mêmes de vrais boutons
pourvus dans leur partie inférieure , en été de racines
, en hiver de mamelons propres à en produire;
& les racines à leur tour ont dans toutes les plantes
déboutons deftinés à en pouffer de nouvelles ; mais
Tome II,
il importe fur-tout de connoître ceux des branches
dans les arbres & les arbriffeaux.
Voyez avec quel foin la nature les a vêtus ; ouvrez
en hiver un bouton de marronnier d’Inde, vous ap-
percevez d’abord une couche épaiffe d’un baume
onftuetix ; puis des écailles papyracées, qui font
affemblées comme des tuiles;puis encore des écailles
plus molles à bords effilés ; enfuite un lit de douce
ouate où le tendre bourgeon eft emmailloté : fi vous
développez ce dernier , vous verrez comme fes
feuilles garnies de duvet garantiffent par leurs plis
& replis le Coeur de cette branche enfant ; & comme
il eft impoflîblp que la gelée ou l’humidité pénètrent
jufqu’à ce fanftuaire fecret de la végétation.
Quant aux arbres des pays chauds , quoiqu’en
général leurs boutons foient habillés à la légère lorf-
qu’on les tranfplante en des climats tempérés, c’eft
moins toutefois par les boutons que la gelée les
attaque , que par la jeune écorce : elle a moins de
tiffus encore qu’ils n’en ont : les liqueurs féveufes
y abondent davantage , & après l’imbibition des
pluies , la gelée qui s’y introduit, dilate fes fibres,
& rompt fouvent fes vaiffeaux.
Les boutons des pins ont quelques particularités
'dignes de remarque : ils font conftamment placés
an bout de la branche : celui qui la termine eft
robnfte & fort long ; il eft environné circulairement
& régulièrement de boutons moins confidérables qui
font entremêlés de plus petits. Tous font couverts
d’une enveloppe membraneufe_ femblable . à une
gaine. Qu’on ouvre cette gaine , on apperçoit d’a-r
bord le bourgeon herbacé qu’elle renferme : elle eft
compofée de plufieurs pièces cylindriques ajuftées
les unes dans les autres ; ainfi elle fe prête à l’alon-
gement du bourgeon qui en demeure couvert, jufqu’à
ce qu’il ait environ deux pouces de longueur :
alors il s’échappe parle bout de la gaine qui refte
enfuite long-tems fixée autour de fa partie infé^-
rieure : de ce moment fes progrès font d’une étonnante
rapidité ; lorfqifil a fait fa crue en longueur,
feulement il commence à groflir d’une maniéré fen-
fible : à cette époque fes feuilles courtes & -tendres
qui jufque-là étoient reftées collées contre le bourgeon,
fe confolident, fe développent & s’étendent.
Long-tems auparavant on a pu remarquer au bout
de cette tendre branche Paffortiment de boutons qui
la termine, & où la fymmétrie & le nombre de celles
qui doivent éclorre l’année fuivante font déjà déterminés.
Les fruitiers méritent que nous fixions plus long-
tems nos regards fur les boutons. Les connoître eft
un préalable néceffaire à l’art important de la taille.:
on en trouve de plufieurs efpeces fur le même arbre
: en général ceux qui terminent les rameaux font
gros & robuftes ; mais celui du bout de la branche
verticale la plus élevée eft toujours dans les jeunes
fujets le plus étoffé & le plus vigoureux; il contient,
pour ainfi dire, un nouvel arbre, puifqu’il renferme
le rudiment d’un nouveau je t , qu’on peut regarder ,
lorfqu’il eft développé , comme un arbre d’un an:
en effet le corps ligneux s’élève ainfi de jets en jets.,
dont les premiers qui forment le tronc grofiîffent
par les couches boifeufes qu’ils reçoivènt annuellement
, dans le trajet que fait la feve pour aller alon-
ger les derniers.
Les boutons du bout des baguettes fupérieures les
plus droites après la fléché , font après celui qui termine
la fléché, les plus forts & les plus eoffus de
tous : viennent enfuite ceux du bout des branches
latérales les plus fortes ; mais toutes en ont aufli de
latéraux : les uns doivent produire des fleurs , les
autres du bois ; & ces derniers font encore de différentes
efpeces : il s’en trouve d’affez alongés qui
pouffent des branches moyennes propres à fe mettre