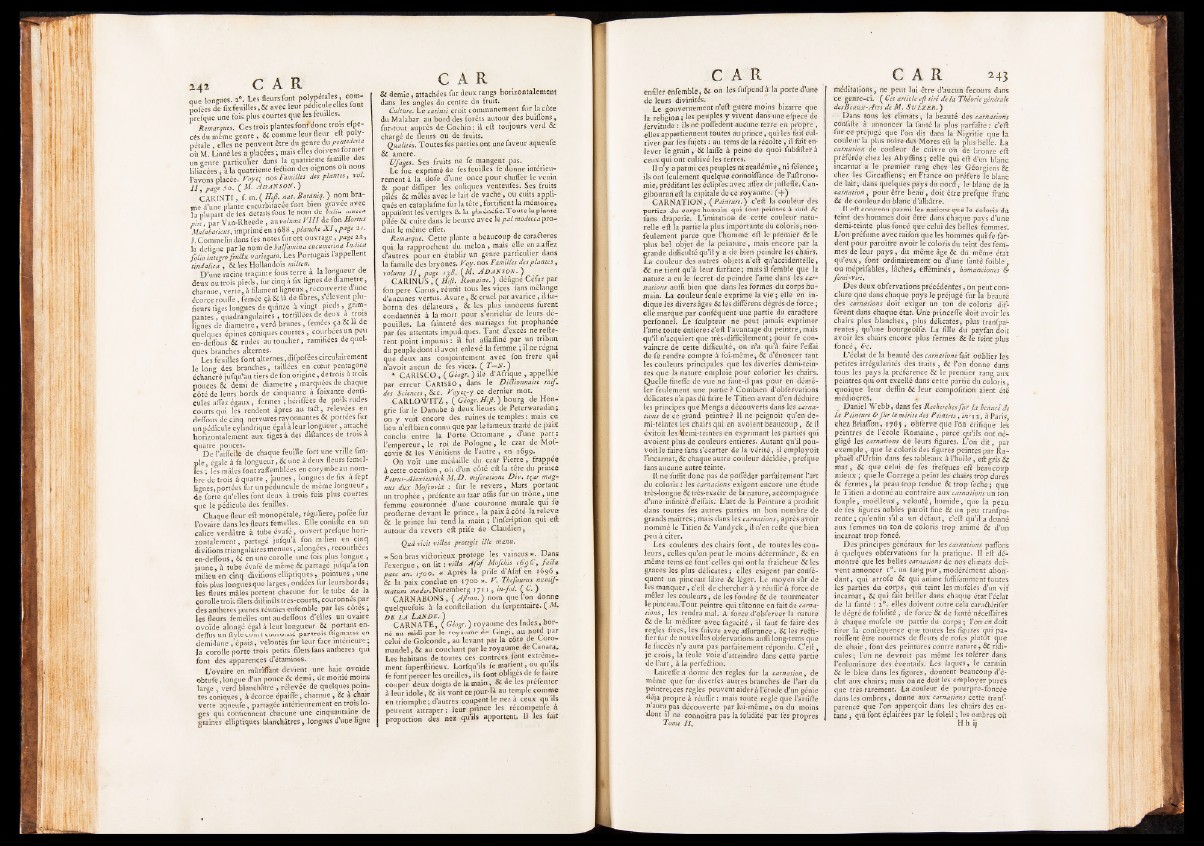
eue longues. i° . Les fleurs font polypétalès , com-
pofées de fixfeuilles,& avec leur pédicule elles font
prefque une fois plus courtes que les feuilles.
Remarques. Ces trois plantes forfdonc trois efpe-
cês du même genre , -& comme leur fleur eft poly-
pétale , elles ne peuvent être du genre du poniedena
oîi M. Linné les a placées ; mais elles doivent former
un genre particulier dans la quatrième famiüe des
liliacées, à la quatrième feftion des oignons ou nous
l’avons placée.' Voyez nos familles des plantes, vol.
I l , page s e . ( U. JD 4 *SO» . )
CAIUNTI, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) nom brame
d’une plante cucurbitacée fort bien gravée avec
la plupart defes détails fous le nom àe h aha mucca
p in , par Van-Rheede , mvotnnn V IU de for. Hortus
Malaharicus, imprimé en 1688 , planche X I , page ni.
J.Çommelin.dans fes notes fur cet ouvrage, page z z ,
là defigne par le nom de bdljàmina cucumenna Iri.ttea
filio imtgro fmäu variegato. Les Portugais rappellent
tindaiica, 8c les Hollandois milten.
D ’une racine traçante fous terré à la longueur de
deux où trois pieds, fur cinq à fix lignes de diamètreH
charnue, verte, à filament ligneux, recouverte d une
écorce touffe, femée çà de fibres, s’élèvent plu-
fieurs tiges longues de quinze à vingt pieds , grimpantes,
quadrangulaires , tortillées de deux a trois
lignes de diamètre, verd-brunes, femees çâ,tSclâ de
quelques épines .«iniques courtes , courbées un peu
én-déflbus & rudes au toucher, ramifiées de quel-
ques branches alternes. .
Les feuilles font alternes ,difpofees circulairement
le long des branches, taillées en coeur pentagone
échancré jufqu’au tiers de fon origine, de trois à trois
pouces 8c demi de diamètre , marquées de chaque
côté de leurs bords de cinquante a foixante denti-
cüles affez égaux, fermes ; heriffées de poils rudes
courts qui les rendent âpres au ta ô , relevees en
deffous de cinq nervures rayonnantes & portées lur
un pédicule cylindrique égal à leur longueur, attache
horizontalement aux tiges à des diftances de trois à
quatre pouces. ...
De Faiflellte de chaque feuille fort une vrille iim-
ple, ég^le à fa fongueur, 8c une à deux fleurs femelles
; les mâles font raffemblées en corymbe au nombre
de trois à quatre , jaunes, longues de fix à fept
lignes,portées fur unpéduncule de même longueur,
de forte qu’elles font deux à trois fois plus courtes
que le pédicule des feuilles.
Chaque fleur eft monopétale, régulière, pofée fur
l’ovaire dans les fleurs femelles. Elle confifte en un
calice verdâtre à tubeévafé, ouvert prefque horizontalement
, partagé jufqu’à fon milieu en cinq
divifions triangulaires menues, alongées, recourbées
en-deffous, ëc en une corolle une fois plus longue ,
jaune, à tube évafé de même 8c partage^ jufqu à fon
milieu en cinq divifions elliptiques, pointues , une
fois plus longues que larges, ondées fur leurs bords ;
les fleurs mâles portent chacune fur le tube de la
Corolle trois filets diftinéls très-courts, couronnées par
des anthères jaunes réunies enfemble par les côtes ;
les fleurs femelles ont au-deflous d’elles un ovaire
ovoïde alongé égal à leur longueur 8c portant en-
deflus un fty le court couronné par trois ftigmates en
demi-lune , épais, veloutés fur leur face intérieure ;
Ja corolle porté trois petits filets fans anthères qui
font des apparences d’étamines.
L’ovaire en mûriffant devient une baie ovoïde
obtufë, longue d’un pouce 8c demi, de moitié moins
large , verd blanchâtre , rélevée de quelques pointes
coniques, à écorce épaiffe , charnue , 8c à chair
verte aqueufe, partagée intérieurement en trois loges
qui contiennent chacune une cinquantaine de
graines elliptiques blanchâtres, longues d’uue ligne
& demie, attachées fur deux rangs horizontalement
dans les angles du centre du fruit. a
Culture. Le carinù croît communément fur la cote
du Malabar au bord des forêts autour des buiffons,
fur-tout auprès de Cochin : il eft toujours verd 8c
chargé de fleurs ou de fruits.
Qualités. Toutes fes parties ont une faveur aqueufe
8c amere.
U f âges. Ses fruits ne fe mangent pas.
Le lue exprimé de fes feuilles fe donne intérieurement
à la dofe d’une once pour chaffer le venin
& pour difliper les coliques venteufes. Ses fruits
pilés 8c mêlés avec le lait de vache, ou cuits appliqués
en cataplafme fur la tête, fortifiant la mémoire,
appaifent les vertiges 8c la phrenéfie.Toute la plante
pilée 8c cuite dans le beurre avec le pal modeccapro~
duit le même effet.
Remarque. Cette plante a beaucoup de carafteres
qui la rapprochent du melon, mais elle en a affez
d’autres pour en établir un genre particulier dans
la famille des bryones. Voy. nos Familles des plantes ,
volume I I , page 138. (AL A DAN SON. )
CARINUS , ( Hiß. Romaine. ) défigné Cefar par
fon pere Carus, réunit tou? les vices fans mélange
d’aucunes vertus. Avare, 8c cruel par avarice , illu-
borna des délateurs, 8c les plus inno.cens furent
condamnés à la mort pour s’enrichir de leurs dér
pouilles. La fainteté des mariages fut prophanee
par fes attentats impudiques. Tant dexces nerefte-
rent point impunis : il fut affafline par un tribun
du peuple dont il avoit enlevé la femme ; il ne régna
que deux ans conjointement avec fon frere qui
n’avoit aucun de fes vices. ( T—N. )
* CARISCO , ( Gèogr. ) île d’Afrique , appellee
par erreur C ariseo , dans le Dithonnaire raif»
des Sciences, &cc. Voye^-y ce dernier mot.
CARLO WITZ , ( Géogr. Hiß. ) bourg de Hongrie
fur le Danube à deux lieues de Peterwaradm ;
on y voit encore des ruines de temples : mais ce
lieu n’eftbien connu que par le fameux traite de paix
conclu entre la Porte Ottomane , d’une part :
l’empereur, le roi de Pologne, le czar de Mof-
covie 8c les Vénitiens de l’autre , en 1699.
On voit une médaille du czar Pierre , frappée
à cette occafion , oii d’un cote eft la tete du prince
Petrus-Alexieuvick M. D . miferatione Div. t[ar mag-
nus dux Mofcovia : fur le revers, Mars portant
un trophée , préfente au tzar aflis fur un trône, une
femme couronnée d’une couronne murale qui fe
profterne devant le prince, la paix a cote lareleve
8c le prince lui tend la main ; l’infcription qui eft
autour du revers eft prife de Claudien,
Quâ vieil viclos protegic ille manu.
« Son bras viâorieux protégé les vaincus ». Dans
l’ exergue, on lit : vicia A faf Mofchis 169C , facla
petee an. 1700. « Après la prife d’Afaf en 1696 ,
8c la paix conclue en 1700 ». V. Thefaurus numiJ-
matum moder. Nuremberg 1711 , in-fol. ( C. )
CARNABONS , ( Afiron. ) nom que l’on donne
quelquefois à la conftellation du ferpent£Ûre. ( AL
d e l a La n d e . )
C ARNATE, ( Géogr. ) royaume des Inde?., borné
au midi par le royaume de Gingi, au nord par
celui de Golconde, au levant par la côte de Coror.
mande!, 8c au couchant par le royaume de Canara,
Les habitans de toutes ces contrées font extrêmement
fuperftitieux. Lorfqu’ils fe marient, ou qu ils
fe font percer les oreilles, ils font obliges de fe faire
couper deux doigts de la main, & de les préfenter
à leur idole, & ils vont ce j©ùr-Ià au temple comme
en triomphes d’autres coupent le nez.à ceux qu’ils
peuvent attraper : leur prince les recompenle a
proportion des nez qu’ris apportent. U les fatt
enfiler ênfemblè, & on les fùfpcr.d à la porte d’une
de leurs divinités.
Le gouvernement n’eft gitêré fliouiS bizarre que
la religion ; les peuples y vivent dansHine efpëce de
jfervitude : ils ne poffedent aucune terre eft pfopfte ,
elles appartiennent toutes au prince, qui les fait euî-
tiver par fes fujets : au tems de la récolte, il fait enlever
le grain ,. 8c laiffe à peiné de quoi! fübfifter à
ceux qui ont cultivé les terresi
Il n’y a parmi ces peuples ni académie ,• ni feiéhée ;
ils ont feulement quelque coririôiffâneë <te l’aflrono-
mie, prédifànt les éclipfes aVé'c âfféz de juftéfféî Gan-
gibouran eft la capitale de cé royaume. (+ )
CARNATION, (Peinture.) c’éft la- ëôuleiir des
parties du corps humain qui font peintes à riiid 8c
fans draperie. L’imitation de cette couleur naturelle
eft la partie la plus importante du colbrls; non-
feulement parce que l’homme eft le'premier 8c lè
plus bel objet de la peinture, mais encore par la
grande difficulté qu’il y â de bien péindrë les chairs.
La couleur des autres objets n’eft qu’âccidéntélle,
& ne tient qu’à leur forfaGé; mais il femblé que la
nature a eu le fecret de peindre l’ame dans les car*-
nations attffi bien que dans les formés du corps humain.
La couleur feule exprime là vie ; elle en indique
les divers âges 8c lès différens degrés de force ;
elle marque par cônféqiient une partie du earâ&ere
perfonnel. Le fculpteur ne peut jamais exprimer
l’ame toute entière : c’eft l’avantage du peintre, mais
qu’il n’acquiert que très-difficilement ; pour fe convaincre
de Cette difficulté', on n’a qu’à faire l’effai
de fe rendre cdmpte à foi-même, 8c d’ënOneer tant
les couleurs principales que lés diverfes demi-teintes
que la nature emploie pouf colorier les chairs.
Quelle fineffe de vue ne faut-il pas pour en démêler
feulement une partie ? Combien d’obfèrvations
délicates n’a pas dû faire le Titien avant d’en déduire
les principes que Mengs a découverts dans lés carnations
de ce grand peintre? Il ne peignoif qü’én demi
teintes les chairs qui en avoient beaucoup, 8C il
évitoit les Me mi-teintes en exprimant les parties qui
avoient plus de couleurs entières. Autant qu’il pou-
voit le faire fans s’écarter de la vérité, il employôit
l’incarnat, 8c chaque autre couleur décidée, prel'que
fans aucune autre teinte.
Il ne fuffit donc pas de pofféder parfaitement l’art
du coloris : les carnations exigent encore une étude
très-longue 8c très-exafte de la nature, accompagnée
d’une infinité d’effais.' L’art dé la Peinture â produit
dans toutes fes autres parties un bon nombre de
grands maîtres ; mais dans les carnations, après avoir
nommé le Titien 8c Vandyek, il n’en reftë que bien
peu à citer.
Les couleurs des chairs font, de toutes les couleurs,
celles qu’on peut le moins déterminer, 8C en
même tems ce font" celles qui ont la fraîcheur 8c les
grâces les plus délicates ; elles exigent par conséquent
un pinceau' libre 8c léger. Le moyen sur de
les manquer, c’eft de chercher à y réuffir à force de
mêler les couleurs, de les fondre &C de tourmenter
lepinceau.Tout peintre qui tâtonne en fait de carnations
, les rendra mal, A force' d’ôbfervér la nature
& de la méditer avec- fagacité , il faut fe faire des
réglés fixes,, les fuivre avec affuranee, 8c les re£H-
fier fur de nouvelles ©bfervatio'ns auffilong-tems que
le fuccès n’y aura pas parfaitement répondu. C’e ft ,
je crois, la feule voie d’atteindre dans Cette partie
de l’art, à la perfection.
Laireffe a donné des réglés fur la carnation, de
même que fur diverfes autres branches de l’art du
peintre; ces réglés peuvent aider à l’étude d’un génie
déjà propre à réuffir : mais toute réglé que l’artifte
n aura pas découverte par lui-même, ou du moins
dont il ne connoîtra pas la folidité par les propres
Tome II.
méditations, rie peut lui être d’aucun fecours dans
ce genre-ci. ( Cét article ejl tiré de la Théorie générale
desBeàux-A'rts de M. SuLZER. )
- Dans fous les élintâts, la beauté des carnations
confifte a annoncer la fantéla plus parfaite : c’eft
lur cë préjugé que l’on dit dans la Nigritie que la
couleur la plus noîrê des Mores eft la plus belle. La
cathcttïoft de couleur de' cuivre où de bronze eft
préférée chez les Abyffiris ; celle qui eft d’un blanc
incâfriaf h lé pfemièlr rang ehéz 'lës Géorgiens 8t
clièz lés Cifdaffieris;- en Ffârice On préféré le blant
dé lait; dans quelques pays du nord,- le blanc de là
carnationpoiir être beàu, doit être prèfcjtte franc
8c de couleur du blarie d’âlbâtre.
Il eft convenu parmi lès nations qiie le Coloris dit
teinf des hommes doit être dans Chaque pays d’une
demi-teinte plus foncé' que celui dès béflés femmes’.
L’on préfume âvecraifon que les hommes qui fe fardent
pour paroître avoir lë!Coloris du teint des femmes
de leur p a y s , du même âgé 8c dit même état
qii’eux, font ordinairement ou d*urie fànté foible
Ou méprifabies, lâchés,- efféminés, hohiunciones &
femi-viri.
Des deux obfervatioris précédentes, on peut conclure
que dans chaque pays le préjugé fur la beauté
des carnations doit exiger un ton de coloris différent
dans chaque état. Une princèfle doit avoir les
chairs plus blanches, plus délicates, plus trânfpai-
rentes, qu’une boufgeoifé. La fille du payfan doit
avoir les chairs encore plus ferrites 8c le feint plus
foncéj &ct
L’éclat dé la beauté dès cdtnatlons fait oublier les
petites irrégularités des traits , 8c Fori donne dans
tous les pays la préférence 8c le premier rang, aux
peintres qui ont excellé darts cettë partie du coloris,
quoique leur deffin 8C leur eompofitiôri aient été
médiocres. *
Daniel Webb, dans fes Recherches fu i la Beauté de
la Peinture & für le mérité des Peintres, in - i i , à Paris
chez Briaffon* 176 5 , obfervé que Fon critiqué leS
peintfes de l’école Romaine, parce qu’ils Ont négligé
les carnations de leurs figures. L’on d it , par
exemple, que le coloris des figures pëirifêS par Raphaël
d’Urbin dans fes tableaux à l’huile, eft gris 8c
mat, & que celui dé fés frefques eft beaucoup
mieux ; que le Corrëge a peint lés chairs trop dures
8c fermes, la peau trop tendue 8c trop féche ; que
le Titien a donné aü contraire aüx carnations uiï toft
fouplè j moëlleux, velouté, humide, que là peau
de fes figures nobles parOît fine 8c un peu tranfpa'-
rente; qu’enfin s’il a un défaut, e’efii qu’ira donné
aux femmes un ton de coloris trop animé 8c d’un
incarnat trop foncé.
Des principes généraux fur les carnations paffons
à quelques ôbfervarions fur la pratique. II eft démontré
que les belles carnations de nos climats doivent
annoncer i° . un farig pur, modérément abondant,
qui arrofe 8c qui anime fuffifamment tontes
les parties du corps j qui teint les mufeles d’un v if
incarnat, 8c qui fait briller dans chaque état l’éclat
de la fanté : z°. elles doivent outré Gela caraâérifer
le degré de folidité , de force 8c de fanté néceffaires
à chaque mufcle Ou partie du corps ; l’on- en doit
tirer la Conféquenee que toutes les figures qui pa-
roiffent être nourries de fleurs de rofes plutôt que
de chair, font des peintures contre nature, 8c ridicules;
l’on ne devroit pas même les tolérer dans
l’enluminure des éventails. Les laqués, le carmin
8c le bleu dans les figures, donnent beaucoup d’éclat
aux chairs ; mais on né doit les employer pures
que très-rarement. La couleur de pourpre-foncée
dans les ombres, donne aux carnations cette tranf-
parence que Fon apperçoit dans les chairs des én-
fàns qui font éclairées par le folcil ; les ombres où
H h ij