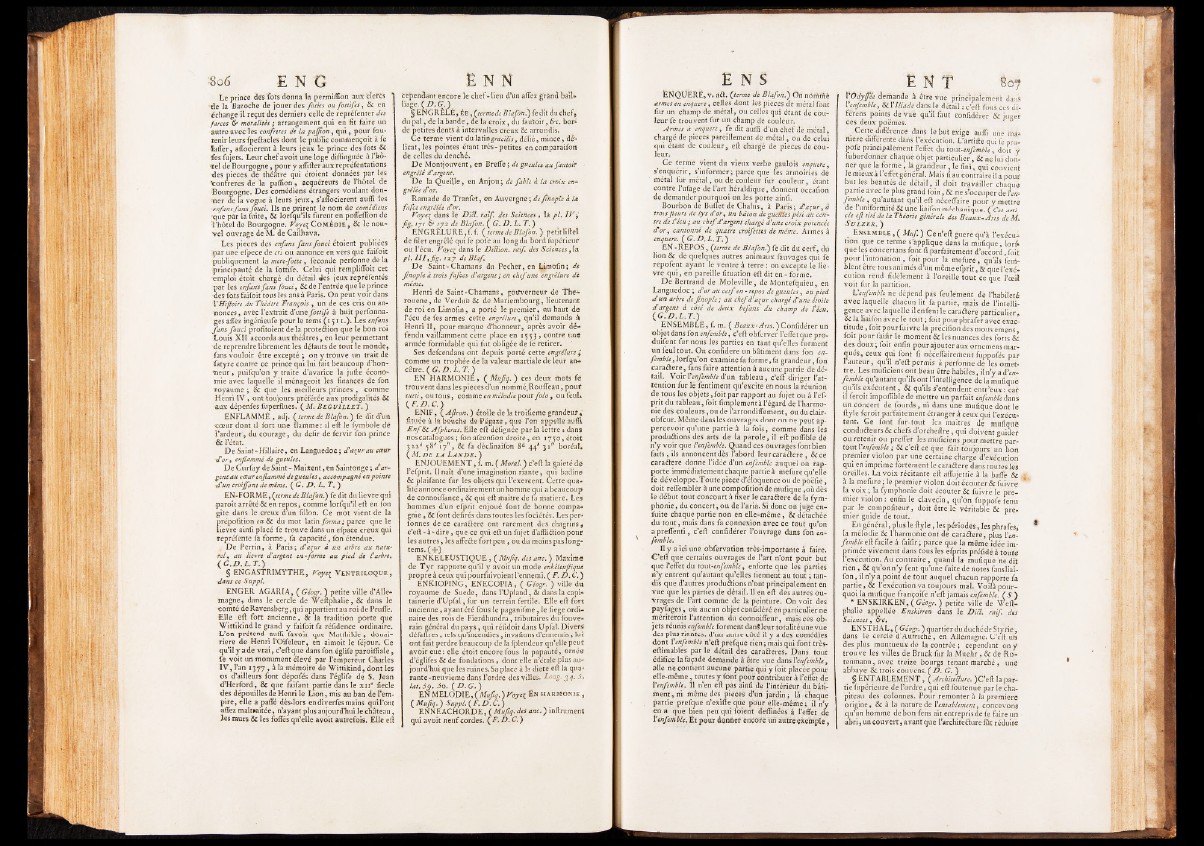
Le prince des Tôts donna la permiflioh aux clefCs
de la Bazoche de jôuer des foties ou fotùfes, Sc en '
échange il reçut des derniers celle de représenter des ■
farces & moralités ; arrangement qui en fit faire un
autre avec les confrères de la pajjion, qui, pour fbu-
tenir leurs fpeûacles dont le public comfhençoit à fe
laffer, affocierent à leurs jeux le prince des fots 8c
fes Sujets. Leur chef avoit une loge diftinguée à l’ho-
-tel de Bourgogne, pour y aflïfter aux représentations
-des pièces de théâtre qui étôient données par les
’Confrères de la palîion » acquéreurs de l’hôtel de
Bourgogne. Des comédiens etrangers voulant donn
e r de la vogue à leurs jeux-, s’auocierent aufli les
•enfans fans fouci. Ils ne prirent le nom de comédiens
•que par la fuite, 8c lorfqu’ils furent en poffeflïon de
l ’hôtel de Bourgogne. Voye{ C o m é d ie , & le nouvel
ouvrage de M. de Cailhava.
Les pièces des enfans fans fouci étoient publiées
par une efpece de cri ou annonce en vers que faifoit
publiquement la mere-fotte, fécondé perfonne de la
principauté de la fottife. Celui qui rempliffoit Cet
•emploi étoit chargé du détail des jeux représentés
par les enfans fans fouci, & de l’entrée que le prince
des fots faifoit tous les ans à Paris. On peut voir dans
l ’Hifloire du Théâtre François, un de ces Cris ou annonces,
avec l’extrait d’unz fottife à huit perfonna-
ges allez ingénieufe pour le tems ( t 511-). Les enfans
.fans fouci profitoient de la proteâion que le bon roi
Louis XII accorda aux théâtres, en leur permettant
'de reprendre librement les défauts de tout le monde,
fans vouloir être excepté ; on y trouve un trait de
fatyre contre ce prince qui lui fait beaucoup d’hon-
meur, puifqu’on y traite d’avance ia jufte économie
avec laquelle il ménageoit les finances de Son
royaume ; Sc que les meilleurs princes , comme
Henri I V , pnt toujours préférée aux prodigalités Sc
aux dépenfes Superflues. ( M. Be ù u il l e t . )
ENFLAMMÉ , adj. ( terme de Blafon. ) fe dit d’uil
■ coeur dont il fort une flamme: il eft le Symbole dé
l ’ardeur', du courage, du defir de Servir fon prince
Sc l’état.
De Saint-Hillaire, en Languedoc; <façurau coeur
f o r , enflammé de gueules.
De CurSay de Saint - Maixent, en Saintonge ; d argent
au coeur enflammé de gueules, accompagné en pointe
f un croiffant de même. ( G. D . L. T. )
EN-FORME,(terme de Blafon.) fedit du lievre qui
paroît arrêté 8c en repos, comme lorfqu’il eft en Son
gîte dans le creux d’un fillon. Ce mot vient de la
prépofition en Sc du mot latin forma; parce que le
lievre ainfi placé fe trouve dans un efpace creux qui
représente fa forme, fa capacité, Son étendue;
De Perrin, à Paris; dlaçur à un arbre au naturel,
au lievre tfareent en-forme au pied de Ü arbre.
( G .D .L .T .)
§ ENGASTRIMYTHE, Voye^ V en tr ilo q u e ,
■ dans ce Suppl.
ENGER AG ARIA, ( Gèogr. ) petite ville d’Alle»
magne, dans le cercle de ‘Weftphalie, Sc dans le
comté deRavensberg,qui appartient au roi de PrufTe.
Elle eft fort ancienne, & là tradition porte que
Vittikind le grand y faifoit fa réfidence ordinaire.
L’on prétend aufli Savoir que Matthilde, douairière
de Henri l’Oifeleur, en aimoit le Séjour. Ce
qu’il y a de vrai, c’eft que dans fôn églife paroifliale,
le voit un monument élevé par l’empereur Charles
IV , l’an 13 7 7 , à la mémoire de ‘Wittikind, dont les
os d’ailleurs font dépofés dans l’églife de S. Jean
d’Herford , & que faifant partie dans le x n e fiecle
des dépouilles de Henri le Lion, mis au ban de l’empire,
elle a paffé dès-lors endiverfesmains quil’ont
afTez maltraitée, n’ayant plus aujourd’hui le château,
Jes murs 6c les folles qu’elle avoit autrefois. Elle eft
cê'penâantëncore le chef- lieu d’ün afTez grârtcTbâiW
liage. (.D . S . )
§£NGRÊLÉ , ê e , f terme de Blafànï) fe dit du chef,
du pal I de la bande, de la croix, du Sautoir, &c. bot*
de petites dents à intervalles creux & arrondis.
Ce terme vient du la tin graciles, délié, mince, de*
licatjlès pointes étant très-petites en comparaiSort
de celles du denché.
D e Montjouvent, en Bf effe ; de gueules au farnoit
engrêlé <Pargent.
D e la Queille , en Anjou; de fable d la croix en*
grêlée T Or.
Ramade de Tranfet, en Auvergne; defihople à là
fafee engrêlé t d’or.
Voye{ dans le Dicl. ta f. des Sciehce's * là pi. Î V ,
fig. 17/ & 172. de Blafon. ( G. D . L. T. )
ENGRÊLURE, f .f. (termedeBlafon.) petirliftel
de filet engrêlé qui Se poSe au long du bord Supérieur'
ou l’écu. Foye^ dans le Diction, raif. des Sciences, la
pl. I II,fig . i z f deBlaf
De Saint-Chamans du Pechef, en Ijgmofin; dè
finople à trois fafees d’argent ; en chef une engrêlure dè
même-,
Henri de Saint-Châmahs, gOirvërneiir de îh e -
rouene, de Verdub 8c dé Mariembôurg, lieutenant
de roi en Limofin, a porté le premier, au haut de
Pécu de Ses armes cefte engrêlure, qu’il demanda à
Henri II, pour marque d’honnelit, après avoir défendu
vaillamment cette place en 1553 , contre unè
armée formidable qui fut obligée de fë retirer.
Ses defeenaans ont depuis porté cette engrêlure *
Comme un trophée de la valeur martiale de leur ancêtre.
( G. D. L. T. )
EN HARMONIE, ( Mufiq. ) ces deux mots fe
trouvent dans les pièces d’un nommé„Roufleau, pouC
tutti, ou tous, comme en mélodie pour fo lo , ou feul»
( F. D . C. )
ENIF, ( Afiron-, ) étoile de la troiiiertle gfàndeüf *
fituée à la bouche de Pégaze, que l’on appelle aufli
Enf6c Afpheras. Elle eft défignée par la lettre t dans
nos catalogues ; Son afeenfion droite, en 17510, étoit
31a*1 58' 17^, & fa déclinaifon 8d 44' 31'' boréal*
( M. d e l a L a n d e . )
ENJOUEMENT, S. m. ( Moral. ) c*eft la gaieté dè
l’efprit, Il naît d’une imagination riante, qui badine
& plaifante fur les objets qui l’exercent. Cette qualité
annonce ordinairement un homme qui a beaucoup
de connoiflânce, 8c qui eft maître de fa matière. Les
hommes d’un efprit enjoué font de bonne compa*
gnie, & Sont defirés dans toutes les fociétés. Les per-*
Tonnes de ce cara&ere ont rarement.des chagrins,
c’eft - à “dire, que ce qui eft un fujet d’affliétion pour
les autres, les affefte fort peu, ou du moins pas long-*
tems. (-p)
ENKELEUSTIQUË, ( Mufiq. des anc.} Maxîmô
de T y r rapporte qu’il y avoit un mode enkèleufliqué
propre à ceux qui pourfuivoientl’ennemi, ( F . D . C’.)
ENKIOPING, ENECOPIA, ( Gèogr. ) ville du
royaume de Suede, dans l’Upland , & dans la capitainerie
d’Upfal,fur un terreinfertile. Elle eft fort
ancienne, ayant été fous le paganifme, le fiege ordinaire
des rois de Fierdhundra » tributaires du fouve-*
rain général du pays, qui réfidoit dans Upfal. Divers
défaftres, tels qu’iheendies ,invafions d’ennemis, lui
ont fait perdre beaucoup de la fplendeur qu’elle peut
avoir eue: elle étoit encore fous la papauté, ornéè
d’églifes & de fondations, dont elle n’étale plus au-»
jourd’hui que les ruines. Sa place à la diete eft la qua-*
rante-neuvième dans l’ordre des villes. Long. 34. 5*
lat. 5$ . 5q. ( D. G. )
EN M ELODIE, ( Mufiq.) Voye^ En h a rm o n ie ,
( Mufiq. ) Suppl. ( F. D . C. )
ENNEACHORDE, ( Mufiq. des anc, ) inftrument
qui ayoit neuf cordes. ( F. D . C. )
ÉNQÜERÈ, v. âtt. ('terme de Èlafohf) Ori nômtftë
armes en enquere, celles dont les pièces dè métal font
fur un champ de métal, ou celles qui étant de couleur
fe trouvent fur un champ dé eouléùft '
Armes à enquéri, fe dit aufli d’un Chef dé métal,
chargé de pièces pareillement de métal, ôu dè celui
qui étant de Couleur, eft chargé de pièces dè couleur.
Ce terme vient du vieux verbe gaülôis ènqùere,
s’enquérir, s’informer; parce que les armoiries dé
métal fut métal, ou de coulettr fur Côtilêur, étant
contre l’ufage de l’art héraldique, donnent occafion
de demander pourquoi on les pohe âinfi.
Bourbon de Buffet de Chalus, à Paris; éa%ur,à
trois fleurs de lys f o r , Un bâton de güeïtleS péri ait centre
de fecu ; au chef d’argent chargé d’une croix potehcèe
d’or, cantonné de quatre croifèùeS de même. Armes â
enquere. ( G. D . L. T. )
EN - REPOS, (terme de Blafon.') fe dit dit cerf, dii
lion & de quelques autres animaux fâuvâges qui fé
repofent ayant lé ventre à terre : on excepte le lièvre
qui, en pareille fituatidn eft dit en - fdruiè.
De Bertrand de Moleville, de Montéfquiéil, en
Languedoc ; d’or au cerf en - repos de gueules, ait pied
f un arbre de finople; au chefd’azur chargé d’une étoile
f argent à côté de deux bèfans du champ de Ûècu.
( G .D .L .T . )
ENSEMBLE, f. m. ( Beaux-Arts. )Confidéref un
objet dans fon enfemble, c’eft obferver l’effet que pro-
duifent fur nous les parties en tant qu’elles forment
un feul tout. On confidere un bâtiment dans fon enfemble,
lorfqu’on examine fa forme, fa grandeur, fort
cara&ere, fans faire attention à aucune partie dé détail.
Voir Venfemble d’un tableau, c’eft diriger l’attention
fur lé fentiment qu’excite en nous la réunion
de tous les objets »foitpar rapport au fujet Ou à l’èf-
prit du tableau, foit Amplement à l’égard de l’harmonie
des couleurs, ou de l’arrondiffement, ou du clair-
obfcur. Même dans les ouvrages dont on ne peut ap-
percevoir qu’une partie à la fois, comme dans les
produ&ions des arts de la parole, il eft poflïble de
n’y voir que f enfemble. Quand ces ouvrages font bien
faits, ils annoncent dès l’abord leurcarâ&ére , & c e
caraâere donne l’idée d’un enfémble auquel on rapporte
immédiatement chaque partie à mefurê qu’elle
le développe. Toute piece d’éloquence ou de poëfie,
doit reffemblér à une compofition de mufique ,oîi dès
le début tout concourt à fixer lecafa&ere de la fym-
phonie, du concert, ou de l’aria. Si donc on juge en-
fuite chaque partie non en elle-même, & détachée
du tout, mais dans fa connexion avec ce tout qu’on
a preffenti, c’eft confidérer l’ouvrage dans fôn en-
' femble.
Il y a ici une obfervation très-importante à faire.
C ’eft que certains Ouvrages de l’art n’ônt pour but
que l’effet du tôut-enfemblé, enforte que lés parties
n’y entrent qu’autant qu’elles tiennent au tout ; tandis
que d’autres produ&ions n’ônt prinCipalemént en
Vue que les parties de détail. 11 en éft dés autres ouvrages
de l’art comme de la peinture. On voit des
partages , où aucun objet confidéréèn particulier ne
mériteroit l’attention du Connôifleur, mais cés objets
réunis enfemble forment danSleur totalité une vue
des plus riantes: d’un autre côté il y a des comédies
dont l’enfemble n’eft prefque rien ; mais qui font très-
eftimables par le détail aes caraôéres. Dans tout
édifice la façade demande à être vue dans l’enfemble,
aile ne contient aucune partie qùi y foit placée pour
elle-même, toutes y font pour contribuer à l’effet de
l’enfemble. 11 n’en eft pàs âinfi de l’inténéur dii bâtiment
, ni même dès pièces d’ün jardin ; là chaque
partie prefque n’exifte que pour elle-même; il n’y
en a que bien peu qüi fôiénf déffinéès' â l’effet de
Venfemble. Et.pour doftftef encore un autre exemple,
\Odyffee demande à être Vue principalement dans
'fenfemble, & l’Iliade dans le détail : c’eft fous ces ai-
ferens points de vue qii’il faut confidérer & juger
cès deux pôëmès.
.Cette différence dâhS le but exigé aufli une mâ*
ffiërê différente dans l’exécütion. L’artifte qui fe pro*
pofe principalement l’effet du tout-enfemble, doit y
fubordonner chaque objet particulier, & ne lui don^
ner que la forme, là grandeur, le fini, qui convient
le mieux à l ’effet général. Mais fiau contraire il a pouf
but les beautés de détail, il doit travailler chaque
partie avec le plus grand foin, Sc ne s’occuper de Ven-
femble , qii’autant qu’il eft néceffaire pour y mettré
de PuniFqrntité & une Üàifon méchanique. ( Cet article
ejl tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de M.
SüLZER. )
Ensemble , ( Muf. ) Cè n’eft guère qu’à l’exécu-
tion que ce terme s’applique dans la mufique, lorf*
que les cOncertâns font fi parfaitement d’accord „foit
pour l’intonation , foit pour la mefure, qu’ils feni“
blent être tous animés d’un même efprit, & que l’exé-
cutiôn rend fidèlement à l’oreille tout ce que l’oeil
voit fur la partition,
Venfemble ne dépend pas feulement de l’habileté
avec laquelle chacun lit fa partie, mais de lW l l i -
gence avec laquelle ilenfentle caraétere particulier,
& la liaifqri avec lè tout ; foit pour phrafer avec exac*
titude, foit pour fui vre la precifiondes moiivemens
fôit pour faifir le moment & les nuances des forts Sc
des doux; foit enfin pour ajouter aux ornemens marqués,
Ceux qui font fl néceflairement fuppofés par
l’auteur, qu’il n’eft permis à perfonne de les omet-*
tre. Les muficiens ont beau être habiles, il n’y a d’en-
femble qu’autânt qifite ont l’intelligence de la mufiqué
qu’ils exécutent, 8c qu’ils s’entendent entr’èux : caf
il feroit impoftïble de mettre un parfait enfemble dans
un Concert de fourds, ni dans une mufique dont le
ftyle feroit parfaitement étranger à Ceux qui l’exécu-*
tent. Ce font fur-tout les maîtres de mufiquè
conduéteurs Sc chefs d’orcheftre, qui doivent guider
ou retenir ou preffer les muficiens poiir mettre partout
Venfemble ; 8c c’eft ce que fait toujours un bon
premier violon par une certaine charge d’exécution
qui en imprime fortement le caraâere dans routes les
oreilles. La voix récitante eft affujettie à la baffe Sc 4
à la mefure ; le premier violon doit écouter & fuivre ^
la voix ; la fymphonie doit écouter & fuivfé le premier
violon : enfin le clavecin, qu’on fuppofe tenu
par lé compofiteur, doit être le véritable Sc premier
guide de tout.
Eli générai, plus le f ty le , les périodes, les phrales, *
la mélodie Sc l’harmonie ont de caraétere, plus l’en^
femble eft facile à faifir ; parce que la même idée imprimée
vivement dans tous les efprits préfidë à toute
l’exécution. Au contraire, quand la- mufique ne dit
rien, 8c qu’on n’y fent qu’une fuite de notes fanslial-
fon, il n’y à point de tout auquel chacun rapporte fa
partie, Sc l’exécution va toujours mal. Voilà pourquoi
la mufique françoïfe n’eft jamais enfemble. ( S )
* ENSK1RK.EN, ( Gèogr. ) petite ville de ^Veft-
phalie appellëe Enskitren dans le Dicl. raif. des
Sciences, &c.
ENSTHAL, ( Gèogr. ) quartier du duché de Styrie,
dans le cercle d’Autriche, en Allemagne, C ’eft un
des plus montueux de la contrée ; cependant on y
trouve les villes de Bruck fur Ia.Muehr, Si de Ro-
tenmann,avec treize bourgs tenant marché, unë
âbbàye Sc trois couvens. (D . G .)
§ ENTABLEMENT, ( Architecture. )C*eft la par-*
tie fupérieure de l’ordre, qui eft foutenue par le chapiteau
des colonnes. Pour remonter à la premiers
origine, Sc â la nature de l’entablement, concevons
qu’un homme de bon fens ait entrepris de fe faire urt
abri, un couvert, avant que l’arehiteflure fût réduite