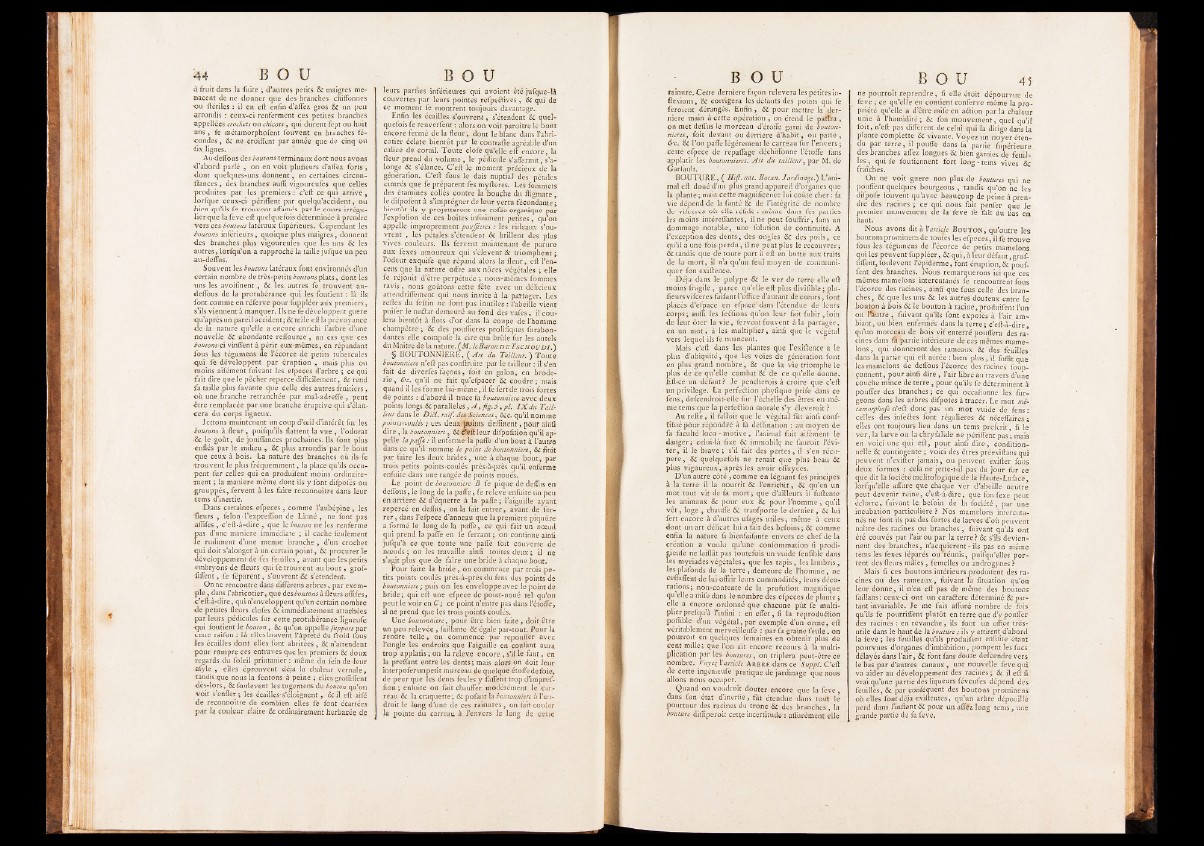
à fruit dans la fuite ; d’autres petits & maigres menacent
de ne donner que des branches chiffonnes
•ou ftériles : il en eft enfin d’affez gros 6c un peu
•arrondis : ceux-ci renferment ces petites branches
appeliées crochets ou chicots , qui durent fe'pt ou .huit
ans , fe métamorphofent fou vent en branches fécondes
, & ne croiffent par année que de cinq ou
dix lignes.
Au-dëffous des boutons terminaux dont nous avons
d ’abord parlé , on en voit plufieurs d’affez forts,
dont quelques-uns donnent, en certaines circonstances
, des branches- auffi vigoureufes que celles
produites par les premiers : c’eft cé qui arrive,
Jorfque ceux-ci périffent par quelqu’accident, ou
bien qu’ils fe trouvent affamés, par le cours irrégulier
que lafeve eft quelquefois déterminée à prendre
vers ces boutons latéraux fupérieurs. Cependant les
Coûtons inférieurs, quoique plus maigres, donnent
des branches plus vigoureufes que les uns 6c les
autres ».lorfqu’on a rapproché la taille jufque un peu
au-deffus.
Souvent les boutons latéraux font environnés d’un
certain nombre de très-petits boutons plats, dont les
•uns les avoifinent , 6c les autres fe trouvent au-
deffous de la protubérance qui les foufient : là ils
■ font comme en réferve pour fuppléer atix premiers,
s’ils viennent à manquer. Ilsme fe développent guere
qu’après un pareil accident; & telle eft la prévoyance
de la nature qu’elle a encore enrichi L’arbre d’une
nouvelle 6c abondante reffource , au cas que: ces
boutons-ci vinffent à périr eux-mêmes, en répandant
fous les tégumens de l’écorce de petits tubercules
qui fe développent par éruption , mais plus ou
moins aifément fuivant les efpeces d’arbre ; ce qui
-fait dire que le pêcher reperce difficilement, 6c rend
fa taille plus favante que celle des autres fruitiers,
-où une branche retranchée par mal-adreffe , peut
•être remplacée par une branche éruptive qui s’élancera
du corps ligneux.
Jettons maintenant un coup d’oeil d’intérêt fur les
boutons à fleur, puifqu’ils flattent la vue , l’odorat.
■6c le goût, de jouiffances.prochaines. Ils font plus
-enflés par le milieu , & plus arrondis'par le bout
que ceux à bois. La nature des branches où ils fe
'trouvent le plus fréquemment, la place qu’ils occu-
■ pent fur celles qui en produifent moins ordinairement
; la maniéré même dont ils y font difpofés ou
•grouppés, fervent à les faire reconnoître dans leur
iems d’inertie.
Dans certaines efpeces, comme l’aubépine, les-
fleurs , félon l’expreffion de Linné , ne font pas
.aflifes ,-c’eft-à-dire , que le bouton né les renferme
pas d’une maniéré immédiate ; il cache feulement
le rudiment d’une menue branche , d’un crochet
qui doit s’alonger à un.certain point, 6c procurer le
■ développement de fes feuilles, avant que les petits
embryons de fleurs qui fe trouvent au b out, grof-
fiffent, fe féparent, s’ouvrent 6c s’étendent.
On ne rencontre dans différens arbres, par exemp
le , dans l’abricotier, que desboutons à fleurs aflifes,
c ’eft-à-dire, qui n’enveloppent qu’un certain nombre
de petites fleurs clofes &-immédiatement attachées
par leurs pédicules fur cette protubérance ligneufe
-qui foutient le bouton, & qu’ôn appelle fupport par
cette raifon : là elles bravent l’âpreté du froid fous
les écailles dont elles font abritées , 6c n’attendent
pour rompre ces entraves que les premiers & doux
•regards du foleil printanier : même du fein de-leur
-afyle , elles éprouvent déjà la chaleur vernale,
tandisque nous la Tentons à peine. ; elles grofliffent
des-lors, 6c foulevent les tugemens du bouton qu’on
voit s’enfler ; les écailles1 s’éloignent, & il eft aiflé
de reconnoître de combien elles fe font écartées
par la couleur claire 6c ordinairement herbacée de
leurs parties inférieures qui avoient été jufque-Ià
couvertes par leurs pointes refpeitives , 6c qui de
ce moment fe montrent toujours davantage.
Enfin les écailles s’ouvrent, s’étendent 6c quelquefois
fe renverfent : alors on voit paroître le bout
encore fermé de la fleur, dont le blanc dans l’abricotier
éclate bientôt par le contrafte agréable d’un
calice de corail. Toute clofe qu’elle eft encore, la
fleur prend du volume , le pédicule s’affermit s’a-
longe & s’élance. C ’eft le moment précieux de la
génération. C’eft fous le dais nuptial des pétales
cintrés que fe préparent fes myfteres. Les fommets
des étamines collés contre la bouche du ftigmate,
le difpofent à s’imprégner de leur vertu fécondante ;
bientôt ils y projetteront une rofée organique par
l’explofion de ces boîtes infiniment petites, qu’on
appelle improprement poujjieres : les rideaux s’ouvrent
, les pétales-s’étendent & brillent des plus
vives couleurs. Ils fervent maintenant de parure
aux fexes amoureux qui s’élèvent & triomphent ;
l’odeur exquife que répand alors la fleur, eft l’encens
que la nature offre aux noces végétales ; elle
fe réjouit d’être perpétuée ; nous-mêmes fommes
ravis, nous goûtons cette fête avec un délicieux
attendriffement qui nous invite à la partager. Lés
reftes du feftin ne font pas inutiles : l’abeille vient
puifer le neôar demeuré au fond des vafes, il coulera
bientôt à flots d’or dans la coupe de l’homme
champêtre ; 6c des pouffieres prolifiques furabon-
dantes elle compofe la cire qui brûle fur les autels
du Maître de la nature. (AL Le Baron d e Ts c h o u d i .')
§ BOUTONNIERE, ( Art du TailUur. ) Toute
boutonnière n’eft pas conftruite par le tailleur : i i s ’en
fait de diverfes façons, foit en galon, en broderie
, &c. qu’il ne fait qu’efpacer 6c coudre ; mais
quand il les forme lui-même, il fe fert de trois fortes
de points : d’abord il trace fa boutonnière avec deux
points longs & parallèles, A , fig. 5 , pl. I X du T ail’
Leur dans le Dicl. raif. des Sciences, 6cc. qu’il nomme
points-coulés ; ces deux points deflînent, pour ainfi
dire , la boutonnière, 6c eteft leur difpofition qu’il appelle
Lapajje ; il enfermé la pafle d’un bout à l’autre
dans ce qu’il nomme Le point de boutonnière, 6c finit
par faire les deui brides, une à chaque bout, par
trois petits points-coulés près-à-près qu’il enferme
enfuite dans une rangée de points noués.
Le point de boutonnière B fe pique de deffus en
deffous, le long de la paffe, fe releve enfuite un peu
en arriéré 6c d’équerre à la paffe ; l’aiguille ayant
repercé en deffus, on la fait entrer, avant de ferrer
, dans l’efpece d’anneau que la première piquûre
a formé le long de la paffe, ce qui fait un noeud
qui prend la paffe en fe ferrant ; on continue ainfi
jufqu’à ce que toute une "paffe foit couverte de
noeuds ; on les travaille ainfi tontes deux'; il ne
s’agit plus que de faire une bride à chaque bout.
Pour faire la bride, on commence par trois petits
points coulés près-à-près du fens des points de
boutonnière ; puis on les enveloppe avec le point de
bride ; qui eft une efpece de point-noué tel qu’on
peut le voir en C ; ce point n’entre pas dans l’étoffe,
il ne prend que les trois points coulés.
Une boutonnière, pour être bien faite, doit être
un peu relevée, Taillante 6c égale par-tout. Pour la
rendre telle, on commence par repouffer avec
l’ongle les endroits que l’aiguille en coufant aura
trop applatis ; on la relev,e encore , s’il le faut, en
la preffant entre les dents ; mais alors on doit leur
interpofer un petit morceau de quelque étoffe de foie,
de peur que les dents feules y fâffent trop d’impref-
fion ; enluite on fait chauffer modérément le car-
rêaù & la craquette; & pofant la boutonnière à l’endroit
le long d’une de ces rainures, on fait couler
la pointe du carreau à l’euYers le long de cette
rainure. Cette derniere façon relevera les petites inflexions,
6c corrigera les défauts des points qui fe
feroient dérangés. Enfin, 6c pour mettre la f e r mere
main à cette opération, on étend, le pattra ,
on met deffus le morceau d’étoffe garni de boutonnières,
foit devant ou derrière d’habit , ou patte ,
&c. 6c l ’on paffe légèrement le carreau fur l’envers ;
.cette, efpece de repaffage déchiffonne l’étoffe fans
applatir les boutonnières. Art du tailleur ^ par M.'de
Garfault.
BOUTURE, ( Hiß. nat. Botan. Jardinage.) L’ani-
imal eft doué d’un plus grand appareil d’organes que
la plante'; mais cette magnificence lui coûte cher: fa
vie dépend de la fanté 6c dq l’intégrité dé nombre
de vifeeres où elle réfide : même dans fes parties
les moins intéreffantes, il ne peut fouffrir, fans un
dommage notable, une folutiön de continuité. A
l’exception des dents, des ongles 6c des poils, ce
qu’il a Une fois perdu, il ne peut plus le recouvrer;
6c tandis que de toute pareil eft en butte aux traits
de la mort, il n’a qu’un feul moyen de communiquer
fon exiftence.
Déjà daiis le 'polype 6c le ver de terre elle eft
moins fragile , parce qu’elle eft plus divifible; plufieurs
vifeeres faifant l’office d’autant de coeurs, font,
placés d’elpace en efpace’ dans l’étendue de leurs
corps ; auffi les ferions qu’on leur fait fubir , loin
de leur ôter la v ie , ferventfouvent à la partager,
en un mot, à les multiplier, ainfi que le végétal
vers lequel ils fe nuancent.
Mais c’eft: dans les plantes que l’exiftence a le
plus d’ubiquité, que lès voies de génération font
en plus grand nombre, 6c que la vie triomphe le
plus de ce qu’elle combat & de ce qu’elle donné.
Eft-rce un défaut? Je pencherois à croire que c’eft
un privilège; La perfe&ion phyfiqiie prife dans ce
fens, defcendroit-elle fur l’échelle des êtres en même
tems que la perfeâion morale s’y éleveroit ?
Au refte, il falloir que le végétal fut ainfi eonf-
titué pour répondre à la deftination : au moyen de
fa faculté loco - motive, l’animal fuit aifément le
danger; celui-là fixe 6c immobile ne fauroit l’évite
r , il le brave ; s’il fait des pertes, il s’en récu-,
pere, 6c quelquefois ne renaît que plus beau 6c
plus vigoureux, après les avoir eflùyées.
D’un autre cô té, comme en léguant fes principes
à la terre il la nourrit 6c l’enrichit, & qu’en un
mot tout vit de fa mort ; que d’ailleurs il fuftente
les animaux 6c pour eux 6c pour l’homme, qu’il
v ê t , loge , chauffe 6c tranfporte le dernier, 6c lui'
fert encore à d’autres ufages utiles ; même à ceux
dont un art délicat lui a fait des befoins ; 6c comme
enfin la nature fi bienfaifante envers ce chef de la
création a voulu qu’une confommation fi prodi-
gieufe ne laiflât pas toutefois un vuide fenfible dans
les myriades végétales, que les tapis les lambris ,
les plafonds de la terre, demeure de l’homme, ne
ceffaffent de lui offrir leurs commodités, leurs décorations;
non-contente de la profulion magnifique
qu’elle a mife dans le nombre des efpeces.de plante ;
elle a encore ordonné que chacune put fe multiplier
prefqu’à l’infini : en effet, fi la reproduction
poffible d’un végétal,par exemple d’un orme, eft
véritablement merveilleufe : par fa graine feule, on
pourroit en quelques femaines en obtenir plus de
cent mille; que l’on ait encore recours à là multiplication
par les boutures, on triplera peut-être ce
nombre. Voyc^Yarticle Arbre dans ce Suppl. C ’eft
de cette ingénieufe pratique de jardinage que nous
allons nous occuper. ^
Quand on voudroit douter encore que la fe v e ,
dans fon état d’inertie, fut étendue dans tout le
pourtour des racines du tronc &.des branches , la
bouture diffiperoit cette incertitude : aflùrément elle
ne pourroit reprendre, fi elle étoit dépourvue de
feve ; ce qu’elle en contient confer.ve même la propriété
qu’elle a d’être mife en a&ion par la chaleur
unie à l’humidité ; 6c fon mouvement, quel qu’il
foit, n’eft pas différent de celui qui la dirige dans la
planté cômplette 6c vivante. Voyez un noyer étendu
par térre, il pouffe dans fa partie fupérieure
des branches affez longues 6c bien garnies de feuille
s , qui fe foutiennent fort long- tems vives ÔC
fraîches.
On ne voit guere non plus de boutures qui ne
pouffent quelques bourgeons , tandis qu’on ne les
difpofe fouvent qu’avec beaucoup de peine à prendre
des racines ; ce qui nous fait penfèr Que le
premier mouvement de la feve fe fait du bas en
haut.
Nous avons dit à \ article Bo u to n , qu’outre les
boutonsprominens de toutes les efpeces, il fe trouye
loijs les tégumens de l’écorce de petits , mamelons
qui les peuvent fuppléer, & qui, à leur défaut, grof-
fiffent, foulevent l’épiderme, font éruption, 6c pouffent
des branches-. Nous remarquerons ici que ces
mêmes mamelons intercutanés fe rencontrent fous
l’écorce des racines, ainfi que fous‘celle des branches,
6c que les uns 6c les autres douteux entre le
bouton à bois & le bouton à racine, produifent l’un
ou 1®utre , fuivant qu’ils font expofës à l’air, ambiant,
ou bien enfermés dans la terre ; c’eft-à-dire
qu’un morceau de bois v if enterré pouffera des racines
dans f l ’'partie inférieure de ces mêmes mamelons
, qui donneront des rameaux 6c des feuilles
dans la partie qui eft aérée : bien plus, il fuffit que
les mamelons de deffous l’écorce des. racines foup-
çohnent, pour ainfi dire , l’air libre au travers d’une
couche mince de terre, pour qu’ils fe déterminent à
pouffer des branchés ; ce qui occalionne les fur-
geons dans les arbres difpofés à tracer. Le mot mè?
tàmorphofe n’èft donc, pas' un mot vuide de fens:
celles des infeftes font régulières 6c néceffaires ;
elles ont toujours lieu dans un tems preferit, fi le
v e r , la larve ou la chryfalidé ne périffent pas ; mais -
en voici une qui eft, pour ainfi dire-, conditionnelle
& contingente ; voici des êtres préexiftans qui
peuvent n’exifter jamais, ou peuvent éxifter fous
deux formes : cela ne jette-t-il pas du jour fur ce
que dit la fociété mélitologique de la Hauté-Lufacë,
lorfqu’elle aflùre que chaque ver d’abeille neutre
peut devenir reine, c’eft-à-dire, que fon fexe peut
éclorre, fuivant le. befoin de la fociété , par une
incubation particulière ? Nos mamelons intercuta-
riés ne font-ils pas des fortes de larves'd’où'peuvent
naître des racines ou branches, fuivant qu’ils ont
été couvés par l’air ou par la terre? 6c s’ils deviennent
des branches, n’acquierent - ils pas en même
tems les fexes féparés ou réunis, puifqu’elles portent
dès fleurs mâles, femelles ou aridrogynes ?
Mais fi ces boutons intérieurs produif ent des racines
ou des rameaux, fuivant Ta fituation qu’oa
lèur donne, il n’en eft pas de même des boutons1
faillans : ceux-ci ont un cara&ere déterminé & partant
invariable. Je me fuis aflùré nombre de fois;
qu’ils fe pourriffent plutôt en terre que d’y pouffer
des racines : en revanche, ils font un office très-
utile dans le haut de la bouture ; ils y attirent d’abord
la feve ; les feuilles qu’ils produifent enfuite étant
pourvues d’organes d’imbibition, pompent les fucs
délayés dans l’air, 6c font fans doute defeendre vérs
le bas par d’autres canaux , une nouvelle feve qui
va aider au développement des racines ; & il eft fi
vrai qu’une partie des liqueurs féveufes dépend des
feuillès, 6c par conféqiient des boutons prominens
où elles font déjà exiftentes, qu’un arbre dépouillé
perd dans l’inftant 6c pour un afféz long tems , une
grande partie de fa feve.