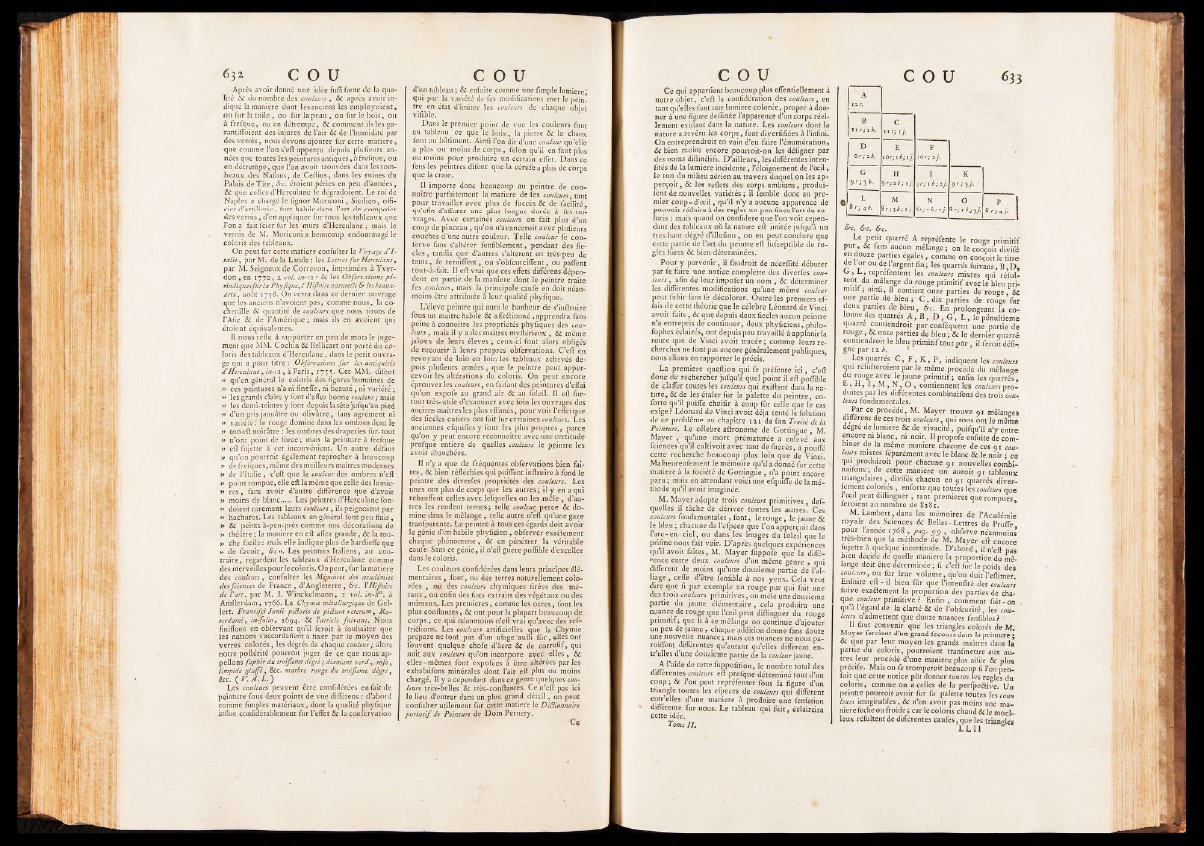
Après avoir donné une idée fuflifante de la qualité
& du nombre des couleurs , & après avoir indiqué
la maniéré dont les anciens les emplqyoient,
ou fur la toile , ou fur la peau , ou fur le bois, ou
à frefque, ou en détrempe, & comment ils les ga-
rantiffoiént des injures de l’air & de l’humidité par
des vernis, nous devons ajouter fur cette matière,
■ que comme l’on s’eft apperçu depuis piufieurs années
que toutes les peinturesantiques., à frefque, ou
-en «détrempe, que l’on avoit trouvées dans les tombeaux
des Nafons, de Ceftius, dans, les ruines du
Palais de T ite, &c. étoient péries en peu d’années,
& que celles d’Herculane fe dégradoient. Le roi de
Naples a chargé le lignor Moriconi, Sicilien , officier
d’artillerie, fort habile dans l’art de compofer
des vernis, d’en appliquer fur tous les tableaux que
l ’on a fait fcier fur les murs d’Herculane ; mais le
vernis de M. Moriconi a beaucoup endommagé le
coloris des tableaux.
On peut fur cetté matière confulter le Voyage d 'I- '
salie, par M. de la Lande : les Lettres fur Herculane,
par M. Seigneuxde Correvon, imprimées à Yver-
cion , en 1770, 2 vol. in-12 : & les Obfervations périodiques
fur la Phyfique, V Hifloire naturelle & les beaux-
arts., août 1756. On verra dans ce dernier ouvrage
que les anciens n’avoient pas, comme nous, la cochenille
& quantité de couleurs que nous tirons de
TA fie & de l’Amérique ; mais ils en avoient qui
étoient équivalentes.
Il nous refte à rapporter en peu de mots le jugement
que MM. Cochin & Bellicart ont porté du coloris
des tableaux d’Herculane, dans le petit ouvrage
qui a pour titre : Obfervations fur les antiquités
d'Herculane, in-12, à Paris, 1755. Ces MM. difent
« qu’en général le coloris des figures humaines de
» ces peintures n’a ni fineffe, ni beauté, ni variété ;
» les grands clairs y font d’affez bonne couleur ; mais
» les demi-teintes y font depuis la tête jufqu’au pied
» d’un gris jaunâtre ou olivâtre, fans agrément ni
» variété i le rouge domine dans les ombres dont le
» ton eft noirâtre : les ombres des draperies fur-tout
» n’ont point de forcé ; mais la peinture à frefque
» eft fujette à cet inconvénient. Un autre défaut
v qu’on pourroit également reprocher à beaucoup
» defrefques,même desmeilleurfc maîtres modernes
» de l’Italie, c’eft que la couleur dés ombres n’eft
» point rompue, elle eft la même que celle des lumie-
» res, fans avoir d’autre différence que d’avoir
» moins de blanc..... Les peintres d’Herculane fon- j
» doient rarement leurs couleurs , ils peignoient par
» hachures. Les tableaux en général font peu finis,
» & peints à-peu-près comme nos décorations de
» théâtre ; la maniéré en eft affez grande, & la tou-
» che facile : mais elle indique plus de hardieffe que
» de favoir, &c ». Les peintres Italiens, au contraire,
regardent les tableaux d’Herculane comme
des merveilles pour le coloris. On peut, fur la matière
des couleurs, confulter les Mqnoires des académies
desfciences de France , d’Angleterre, &c. VHifoire
de Part, par M. J. Winckelmann, 2 vol. in-8°. à
Amfterdam, 1766. La Chymie métallurgique de Gel-
lert. Francifci Junii picloris de piclura veterum, Ro-
terdami, infolio, 1694. & l’article fuivant. Nous
finiffons en obfervant qu’il feroit à fouhaiter que
les nations s’accordaffent à fixer par le moyen des
verres colorés, les dégrés de chaque couleur ; alors
notre poftérité pourroit juger de ce que nous appelions
faphir du troijîeme degré ; diamant verd, rofe,
limpide glaffé, &c. marbre rouge du troifeme dégré,
& c . ( V .A .L . )
Les couleurs peuvent être confidérées en fait de
peinture fous deux points de vue différens : d’abord
comme fimples matériaux, dont la qualité phyfique
influe confidérablement fur l’effet & la confervation |
d’un tableau ; & enfuite comme une fimple lumière"
qui par la variété de fes modifications met le peintre
en état d’imiter les couleurs de chaque objet
vifible.
Dans le premier point de vue les couleurs font
au tableau ce que le b o is , la pierre & la chaux
font au bâtiment. Ainfi l’on dit d’une couleur qu’elle
a plus ou moins de corps, félon qu’il en faut plus
ou moins pour produire un certain effet. Dans ce
fens les peintres difent que la cérufe a plus de corps
que la craie.
Il importe donc beaucoup au peintre de con-
noître parfaitement la1 matière de fes couleurs, tant
pour travailler avec plus de fuccès & de facilité,
qu’afin d’aflurer une plus longue durée à fes ouvrages.
Avec certaines couleurs on fait plus d’un
coup de pinceau , qu’on n’avanceroit avec piufieurs
couches d’une autre couleur. Telle couleur fe con-
ferve fans s’altérer fenfiblement, pendant des fie-
cles, tandis que d’autres s’altèrent en très-peu de
tems, fe terniflent , ou s’obfcurciflent, ou paflent
tout-à-fait. Il eft vrai que ces effets différens dépendent
en partie de la maniéré dont le peintre traite
{es couleurs y mais la principale caufe en doit néanmoins
être attribuée à leur qualité phyfique.
L’éleve peintre qui aura le bonheur de s’inftruire
fous un maître habile & affeftionné , apprendra fans
peine à connoître les propriétés phyfiques des couleurs
, mais il y a des maîtres myftérieux , & même
jaloux de leurs éleves ; ceux-ci font alors obligés
de recourir à leurs propres obfervations. C’eft en
revoyant de loin en loin les tableaux achevés depuis
piufieurs années, que le peintre peut apper-
cevoir les altérations du coloris. On peut encore
éprouver les couleurs, en faifant des peintures d’eflai
qu’on expofe au grand air & au foleil. Il eft fur-
tout très-utile d’examiner avec foin les ouvrages des
anciens maîtres les plus eftimés, pour voir l’effet que
des fieçles entiers ont fait fur certaines couleurs. Les
anciennes efquiffes y font les plus propres , parce
qu’on y peut encore reconnoître avec une certitude
prefque entière de quelles couleurs le peintre les
avoit ébauchées.
Il n’y a que de fréquentes obfervations bien faites
, & bien réfléchies qui puiflent inftruire à fond le
peintre des diverfes propriétés des couleurs. Les
unes ont plus de corps que les autres ; il y en a qui
rehauflent celles avec lefquelles on les mêle , d’autres
les rendent ternes ; telle couleur^ perce & dominé
dans le. mélange , telle autre n’eft qu’une gaze
tranfparente. Le peintre à tous ces égards doit avoir
le génie d’un habile pbyficien , obferver exactement
chaque phénomène, & en pénétrer la véritable
caufe,- Sans ce génie, il n’eft guere poflible d’exceller
dans le coloris.
Les couleurs confidérées dans leurs principes élémentaires
, font, ou des terres naturellement colorées
, ou deS couleurs chymiques tirées des métaux,
ou enfin des fucs extraits des végétaux ou des
animaux. Les premières, comme les ocres, font les
plus confiantes, & ont pour la plupart beaucoup de
corps ; ce qui néanmoins n’eff vrai qu’avec des ref-
tri&ions. Les couleurs artificielles que la Chymie
prépare ne font pas d’un ufage'aufli fu r , elles ont
îpuvent quelque chofe d’âcre & de corrofif, qui
nuit aux couleurs qu’on incorpore avec elles , &
elles - mêmes font expofées à être altérées par les
exhalaifons minérales dont l’air eft plus ou moins
chargé. Il y a cependant dans ce genre quelques couleurs
très-belles & très-conftantes. Ce n’eft pas ici
le lieu d’entrer dans un plus grand détail, on peut
confulter utilement fur cette matière le Dictionnaire
portatif de Peinture de DomPernety,
G ;
Ce qui appartient beaucoup plus eflentiellement à
notre objet, c’eft la confidération des couleurs y en
tant qu’elles font une lumière colorée, propre à donner
à une figure deflinée l’apparence d’un corps réellement
exiftant dans la nature. Les couleurs dont la
nature a revêtu les corps, font diverfifiées à l’infini.
On entreprendroit en vain d’en faire l’énumération,
& bien moins encore pourroit-on les défigner par
des noms diftin&ifs. D ’ailleurs, les différentes inten*
fîtes de la lumière incidente, l’éloignement de l’oe il,
le ton du milieu aérien au travers duquel on les ap-
perçoit, & les reflets des corps ambians, produi-
fent de nouvelles, variétés ; il femble donc au premier
coup-d’oe il, qu’il n’y a aucune apparence de
pouvoir réduire à des réglés un peu fixes l’art du coloris
: mais quand on confidere que l’on voit cependant
des tableaux oîi la nature eft imitée jufqu’à un
frès^haut dégré d’illufion , on en peut conclure que
cette partie de l’art du peintre eft fufceptible de réglés
fûres & bien déterminées.
Pour y parvenir, il faudroit de néceflité débuter
par fe faire une notice complette des diverfes couleurs
, afin de leur impofer un nom , & déterminer
les différentes modifications qu’une même couleur
peut fubir fans fe décolorer. Outre les premiers ef-
fàis de cette théorie que le célébré Léonard de Vinci
avoit faits, & que depuis deux fiecles aucun peintre
n’a entrepris de continuer, deux phyficiens, philo-
fophes éclairés, ont depuis peu travaillé à applanir la
route que de Vinci avoit tracée ; comme leurs recherches
ne font pas encore généralement publiques,
nous allons en rapporter le précis.
La première queftion qui fe préfente ic i , c’eft
donc de rechercher jufqu’à quel point il eft poflible
de clàfler toutes les couleurs qui exiftent dans la nature,
& de les étaler fur la palette du peintre, en-
forte qu’il puifle choifir à coup fur celle que le cas
exige? Léonard de Vinci avoit déjà tenté la folution
de ce problème au chapitre 121 de fon Traité delà
Peinture. Le célébré aftronome de Gottingue, M.
Mayer ,• qu’une mort prématurée a enlevé aux
fciences'qu’il cultivoit avec tant de fuccès, a pouffé
cette recherche beaucoup plus loin que de Vinci.
Malheureufement le mémoire qu’il a donné fur cette ■
matière à la fociété de Gottingue , n’a point encore
paru ; mais en attendant voici une efquiflè de la méthode
qu’il avoit imaginée.
M. Mayer adopte trois couleurs primitives, desquelles
il tâche de dériver toutes les autres. Ces
couleurs fondamentales, font, le rouge, le jaune &
le bleu; chacune de l’efpece que l’on apperçoit dans
l’arc -en -c iel, pu dans les images du foleil que le
prifmé nous fait voir. D ’après quelques expériences
qu’il avoit faites, M. Mayer fuppofe que la différence
entre deux couleurs d’un même genre , qui
different de moins qu’une douzième partie de l’air
liag e, celle d’être fenfiblè à nos yeux. Cela veut
dire que fi par exemple au rouge pur qui fait une
des trois couleurs primitives, on mêle une douzième
partie du jaune élémentaire, cela produira une
nuance de rouge que l’oeil peut diftinguer du rouge
primitif; que fi à ce mélange on continue d’ajouter
un peu de jaune, chaque addition donne fans doute
une nouvelle nuance; mais ces nuances ne nous pa-
roiffent differentes qu’autant qu’elles different en-
tr*elles d’une douzième partie de la couleur jaune.
A l’aide de cette fuppofition, le nombre total des
differentes couleurs eft prefque déterminé tout d’un
coup; & l’on .peut repréfenter fous la figure d’un
triangle toutes les efpeces de couleurs qui different
entr’elles d’une maniéré à produire une fenfation
différente fur nous. Le tableau qui fuit, éclaircira
cette idée.
Tome II,
A
i i r .
B
11 r j i b.
C
M
D
Or j 2 b.
E F
i oV,- a j.
G
9 r;ib .
H
9 r>2 b s 1 )■
I
9 r; ib ; a/.
s K
i r '> 3/-
L M N 0 P
8 r ; 4 b.
H ü k B 8 r; i b; % j. 8 f i 4/.-
&c. &c. &c.
Le petit quarré A repréfente le rouge primitif
pur , & fans aucun mélange; on le conçoit divifé
en douze parties égalés, comme on conçoit le titre
de 1 or ou de 1 argent fin; les quarrés fuivans, B ,D ,
t y , L , reprefentent les couleurs mixtes qui réful-
tent du mélangé du rouge primitif avec le bleu primitif
; ainfi, B contient onze parties de'rouge, &
une partie de bleu ; C , dix parties de rouge fur
deux parties de bleu, &c. En prolongeant la colonne
des quarrés A , B , D , G , L , le pénultième
quarre contiendroit par conféquent une partie de
rouge, 6c onze parties de bleu ; & le dernier quarré
contiendroit le bleu primitif tout p u r , il feroit défi-
gne par 12 b. 11
Les quarrés C , F , K , P , indiquent les couleurs
qui refulteroient par le même procédé du mélange
du rouge avec le jaune primitif; enfin les quarrés,
E , H , I , M , N , O , contiennent les couleurs produites
par les différentes combinaifons des trois couleurs
fondamentales.
ce procédé, M. Mayer trouve 91 mélanges
difterens de ces trois couleurs, qui tous ont le même
degre de lumière & de vivacité, puifqu’il n’y entre
encore ni blanc, ni noir. Il propofe enfuite de combiner
de la même maniéré chacune de ces 91 couleurs
mixtes féparément avec le blanc & le noir ; ce
qui produiroit pour-chacune 91 nouvelles combinaifons;
de cette maniéré on auroit 91 tableaux
triangulaires , divifés chacun en 91 quarrés diversement
coloriés , enforte que toutes les couleurs que
1 oeil peut diftinguer , tant premières que rompues ;
feroient au nombre de 8281.
M. Lambert, dans les mémoires de l’Académîè
royale des Sciences & Belles - Lettres de Pruffe
pour l’année 1768 , pag. c,9 , obfetve néanmoins’
tres-bien que la méthode de M. Mayer eft encore
fujette à quelque incertitude. D’abord , il n’èft pas
bien décidé de quelle maniéré la proportion du mélange
doit être déterminée ; fi c’eft fur!lé poids des
couleurs y ou fur leur volume, qu’on doit l’eftim!er.
Enfuite eft r- il bien fur que l’intenfité des couleurs
fuive exactement la proportion des parties de chaque
couleur primitive ? Enfin , comment fait-on .
qu’ à l’égard de la clarté & de l’obfcuritë, les cou-,
leurs n’admettent que douze nuanfces fenfiblés ? *
Il faut convenir que les triangles colorés de M;
Mayer feroient d’un grand fecours dans la peinture ;
& que par leur moyen les grands maîtres dans la
partie du coloris, pourroient tranfmettre aux autres
leur procédé d’une maniéré plus aifée & plus
précife. Mais on fe tromperoit beaucoup fi l’on pen-
ïoit que cette notice pût donner toutes les réglés du
coloris, comme on a celles de la perfpeétive. Un
peintre pourroit avoir fur fa palette toutes les cou*
leurs imaginables, & n’en avoir pas moins une maniéré
feche ou froide ; car le coloris chaud & le moelleux
réfultentde différentes caufes, que les triangles
1