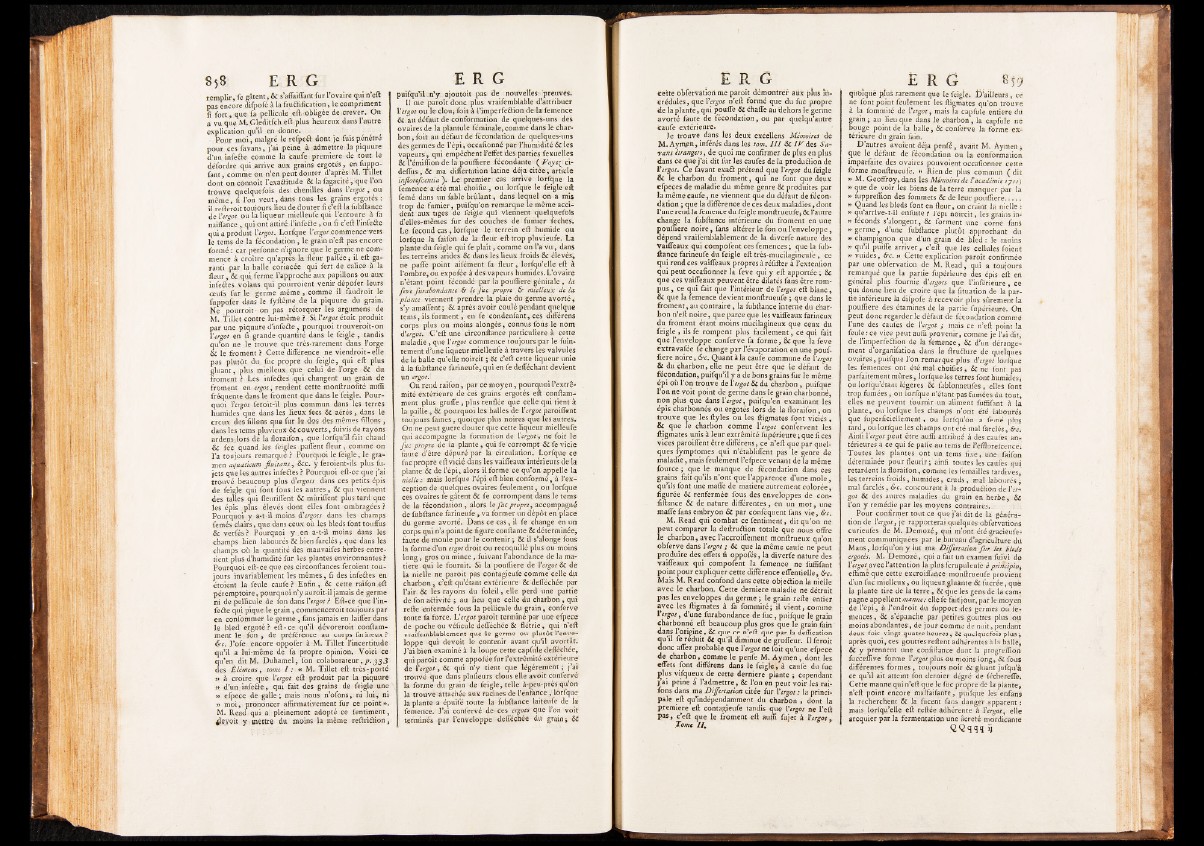
remplir, fe gâtent, & s’affaiffarit fur l’ovaire qui n’eft
pas encore difpofé à la fruâûfîcation, le compriment
fi fort., que fa pellicule efficobligée dégrever. On
a vu.que MyGleditfch eft plus heureux .dans l’autre
explication qu’il en donne. ; _
Pour moi, malgré le refpe& dont je fuis pénétré
pour, cesïavans, j’ai peine, à admettre la piquure
d’un infe&e comme la caufe première, de tout- le
défordre qui arrive aux grains ergotes ,, en fuppo-
fant, comme on n’en peut douter d’apres: M. Tillet
dont on connoît l’exaftitude & la fagacité, que l’on
trouve quelquefois des> chenilles dans l ergot, ou
même, fi l’on veut, dans tous les grains ergotés :
il refteroit toujours lieu de douter fi c’eft la fubftance
de Yergotow la liqueur mielleufe qui l’entoure à fa
naiffance , qui ont attiré l’infeûe , ou fi c’eft l’infeûe
qui a produit Vergot. Lorfque Yergot.commence-vers
le tems de la fécondation, le grain n’eft pas encore
formé : car perfonne n’ignore que le germe ne commence
à croître qu’après la fleur paflee ; il eft garanti
par la balle coriacée qui fert de. calice à la
fleur, 6c qui, ferme l’approche aux papillons ou aux
infeétes .volans qui pourroient venir déppfer leurs
neufs fur le germe même, comme il ; faudrait le
fuppofer dans le fyftême de la piquure du grain.
Ne .pourrait-on pas rétorquer lés argumens de
M. Tillet contre lui-même ? Si Yergot étoit produit
par une piquure d’infe&e, pourquoi trouveroit-on
Vergot en fx grande quantité dans le feigle » tandis
qu’on ne le trouve que trèsrrarement dans l’orge
& le froment ? Cette différence ne viendroit-elle
pas plutôt du.;lue propre du feigle, qui eft plus
gluant, plus mielleux, que celui de l’orge 6c du
froment ? Les infeôes .qui. changent un grain de
froment en ergot, rendent c.ette monftruofité aufli
fréquente dans le froment que dans le feigle. Pourquoi
Y ergot feioit-il plus commun dans les terres
humides que dans les lieux fecs & aérés, dans le
creux des filions que fur le.dos des mêmes filions ,
dans les tems pluvieux & couverts, fui vis de rayons
ardeps^lors de la floraifon, que lorfqu’il fait chaud
6c fee quand les feigles paffent fleur, comme on
l ’a toujours remarque? Pourquoi lefè igle, le gra-
men aquaticum jLuitans, &c. y feroient-ils plus fu-
jets que les autres infeftes ? Pourquoi eft-ce que j’ai
trouvé beaucoup plus d'ergots dans ces petits épis
de feigle qui font fous les autres, 6c qui.viennent
des tafles qui fleuriffent 6c mûriffent plus tard que
les épis . plus élevés dont elles font ombragées ?
Pourquoi y a-t-il moins &ergots dans les champs
femés clairs, que dans ceux oii les bleds font touffus
& verfés ? Pourquoi y .en a-t-il moins dans les
champs bien labourés & bien fardés, que dans les
champs, oii la quantité des mauvaifes herbes entretient
plus d’humidité fur les plantes environnantes ?
Pourquoi eft-ce. que ces circonftances feroiént toujours
invariablement les mêmes, fi des infe&es en
étoient la feule caufe ? Enfin, & cette raifon eft
péremptoire, pourquoi n’y auroit-il jamais de germe
ni de pellicule de fon dans Yergot ? Eft-ce que l’in-
fe&e qui pique le grain, commencerait toujours par
en confommer le germe , fans jamais en laiffer dans
le bled ergoté ? eft - ce qu’il dévoreroit conftam-
ment le fon , de préférence au corps farineux ?
&c. J’ofe encore oppofer à M. Tillet l’incertitude
qu’il a luiTmême de fa propre opinion. Voici ce
qu’en dit M. Duhamel, fon colaborateur, p . 3 3 3
des Élémens, tome I : « M. Tillet eft très-porté
» à croire que Y ergot eft produit par la piquure
>> d’un.infefte , qui fait des grains de feigle une
»» efpece de galle ; mais nous n’ofons,. ni lui',' ni
» moi, prononcer affirmativement fur ce point ».
M. Read-qui a.. pleinement adopté ce fentiment;
Revoit y . mettre du moins la même reftri&ion,
puifqu’il n’y ajoutoit pas de nouvelles: preuves.
Il me paroît donc plus vraifemblable d’attribuer
Vitrgot ou le clou; foit à l’imperfeâion delà: femence
& au défaut de conformation de quelqués-ùns des
ovaires de la plantule lcminale, comme dans le charbon,
foitiau défaut de fécondation de quelques-uns
des germes de l’épi, occafionné par l’humidité & les
vapeurs, qui empêchent l'effet des parties fexuelles
& l’émiffion de la pouffiere fécondante (Voye^ ci-
deffus , 6c ma differtation latine déjà citée ; article
infiorefeentia). Le premier cas arrive lorfque la
femence a-été mal choifie, ou lorfque le feigle eft
femé. dans un fable brillant, dans lequel on a mis
trop de fumier , puifqu’on remarque le même acci-
dènt aux tiges de feigle qui viennent quelquefois
d’elles-rmêmes fur des couches de fumier feches.
Le fécond cas, lorfque le terrein eft humide ou
lorfque la faifon de la fieiir eft trop pluvieufe. La
plante du feigle qui fe plaît, comme on l’a vu , dans
les terreins arides 6c dans les lieux froids & élevés,
ne paffe point aiféinent fa fleur, lorsqu'elle eft à
l’ombre, ou expoféeà des vapeurs humides. L’ovaire
n’étant point fécondé parila pouffiere génitale, la
feve furabondante & le fuc propre & mielleux de la
- plante viennent prendre la plaie du germe avorté ;
s’y amaffent; & après; avoir coulé pendant quelque
tems, ils.forment, en fe condenfant, ces différens
corps plus ou moins alongés, connus fous le nom
d'ergot. .C’eft une circonftance particulière à cette
maladie, que Y ergot commence toujours par le fuin-
tement d’une liqueur mielleufe à travers les valvules
de la balle qu’elle noircit ; 6c c’eft cette liqueur unie
à la fubftance farineufe, qui en fe defféchant devient
qn ergoté
On rend raifon, par ce moyen, pourquoi l’extrémité
extérieure de ces grains ergotés eft conftam-
ment plus groffe , plus renflée que celle qui tient à
la paille, 6c pourquoi les balles de Y ergot paroiffent
toujours faines, quoique plus noires que les autres.
On ne peut guere douter que cette liqueur mielleufe
qui accompagne la formation de Yergot', ne foit le
fuc propre de la plante, qui fe corrompt 6c fe v icie
faute d’être dépuré par la circulation. Lorfque ce
fuc propre eft vicié dans les vaifleaux intérieurs de là
plante & de l’épi, alors il forme ce qu’on appelle la
n i e l l emais lorfque l’épi eft bien conformé, à l’exception
de quelques ovaires feulement, ou lorfque
ces ovaires fe gâtent 6c fe corrompent dans le tems
de la fécondation, alors \e fuc propre, accompagné
j de fubftance farineufe, va former un dépôt en placé
du germe avorté. D a n s c e c a s ,il fe change en un
corps quin’a point de figure confiante & déterminée,
faute de moule pour le contenir ; & il s’albnge fous
la forme d’un ergot droit ou recoquillé plus ou moins
long, gros ou mince, fuivant l’abondance de la matière
qui le fournit. Si la pouffiere de l’ergot 6c de
la nielle ne paroît pas contagieufe comme celle dp.
charbon , c’eft qu’étant extérieure & defféehée par
Pair 6c les rayons du foleil, elle perd une partie
de fon aâivité ; au lieu que celle du charbon , qui
refte enfermée fous la pellicule du grain, conferve
toute fa force. Vergot paroît terminé par une efpeCé
de poche ou véficule defféehée & flétrie, qui n’eft
vraifemblablement que le germe ou plutôt l’enveloppe
qui devoit le contenir avant qu’il avortât.
J’ai bien examiné à la loupe cette capfule defféehée,
qui paroît comme appofée fur l’éxtrêmité extérieure
de Y ergot, 6c qui n’y tient que légèrement ; j’ai
trouvé cjue dans plufiéurs clous elle avôit confervé
la forme du grain de feigle, telle à-peu-près qu’on
là trouve attachée aux racines de l’énfance , lorfque
la plante a épuifé toute la fubftance laitèùfe de la
femence. J’ai confervé de-ces ergots que l’on voit
terminés par l’enveloppe defféehée du grain; 6c
fcette obfervation me paroît démontrér aiix plus incrédules,
que Y ergot n’eft formé que du fuc propre
de la plante, qui pouffe & chaffe au dehors le germe
avorté faute de fécondation, ou par quelqu’autre
caufe extérieure.
Je trouve dans les deux excellais Mémoires dé
M. Aym,en, inférés dans les tom. I I I 6c I V des Sa-
vans étrangersy de quoi me confirmer de pfus en plus
dans ce que j’ai dit fur les caufes de la production de
V ergot. Ce favant exaû prétend que Y ergot du feigle
& le charbon du froment, qui ne font que deux
efpeces de maladie du même genre & produites par
la même caufe, rie viennent que du défaut de fécondation
; que la différence de ces deux maladies, dont
l’une rend la femence du feigle monftr ueufe* 6c l’autre
change la fubftance intérieure du froment en une
poumere noire, fans altérer le fon ou l’enveloppe,
dépend vraifemblablement de la diverfe nature des
Vaxffeaux qui compofent ces femences ; que la fubftance
farineufe du feigle eft très-mucilagineufe, ce
qui rend ces vaifleaux propres à réfifter à l’extenfion
qui peut occafionner la feve qui y eft apportée ; 6c
que ces vaifleaux peuvent être dilatés fans être rompus
, ce qui fait que l’intérieur de Y ergot eft blanc,
& que la lemencé devient monftrueufe ; que dans le
froment, au contraire, la fubftance interne du charbon
n’eft noire, que parce que les vaifleaux farineux
du froment étant moins mueilagineux que ceux du
feigle , ils fe rompent plus facilement, ce qui fait
que l’enveloppe conferve fa forme, 6c que la feve
extravafée fe change par l’évaporation en une pouffiere
noire j &c. Quant à la caufe commune de Y ergot
& du charbon, elle ne peut être que le défaut de
fécondation, puifqu’il y a de bons grains fur le même
épi oit l’oii trouve de Y ergot 6c du charbon, puifque
l’on rte voit point de germe dans le grain charbonné,
non plus que dans Y ergot, puifqu’en examinant les
épis eharbonnés ou ergotés lors de la floraifon, on
trouve que les ftyles ou les ftigmates font viciés,
& que le charbon comme Yergot confervent les
ftigmates unis à leur extrémité fupérieure ; que fi ces
vices paroiffent être différens, ce n’eft que par quelques
fymptomes qui n’établiffent pas le genre de
maladie, mais feulement l’efpece venant de la même
fource ; que le manque de fécondation dans ces
grains fait qu’ils n’ont que l ’apparence d’une mole,
qu’ils font, une maffe de matière autrement colorée,
figurée 6c renfermée fous des enveloppes de con-
fiftance & de nature différentes, en un mot, une
maffe fans embryon 6c par conféquent fans v ie , &c.
M. Read qui combat ce fentiment, dit qu’on ne
peut comparer la deftruétion totale que nous offre
le charbon, avec l’accroiffement monftrueux qu’on
obferve dans Yergot ; 6c que la même caufe ne peut
produire des effets fi oppofés, la diverfe nature des
vaifleaux qui compofent la femence ne fuffifant
point pour expliquer cette différence effentielle, &c.
Mais M. Read confond dans cette objeûion la nielle
avec le charbon. Cette derniere maladie ne détruit
pas les enveloppes du germe ; le grain refte entier
avec les ftigmates à fa fommité; il vient, comme
Yergot, d’une furabondarice de fuc, puifque le grain
charbon!^ eft beaucoup plus gros que le grain fain
dans l’origine, 6c que ce n’eft que par la déification
ou’il fe réduit 6c qu’il diminue de groffeur. Il ferait
donc affez probable que Yergot ne foit qu’une efpece
de charbon, comme le penfe M. Aymen, dont les
effets font différens dans le feigle , à caufe du fuc
plus vifqueux de cette derniere plante ; cependant
j’ai peine ^ l’admettre, 6c l’on en peut voir les rai-
fons dans ma Differtation citée fur Yergot : la principale
eft qu’indépendamment du charbon , dont la
première eft contagieufe tandis que Yergot ne l’eft
pas, c’eft que le froment eft aufli fujet à Yergot,
Tome I I ,
qùbiqtiè piluS rarement que le feiglëi iTaiileùrs j cé
ne font point feulement les ftigmates qu’on trouvé
à la fommité de Yergot j mais la capfule entière dü
grain ; au lieu que dans le charbon, la capfule ne
bouge point de la balle, & conferve la forme extérieure
du grain fain.
D ’autres avoient déjà penfe, avant M. Àyriteri ;
que le defaut de fécondation ou la conformation
imparfaite des ovaires pou voient occafionner cette
forme monftrueufe. « Rien de plus commurt ( dit
» M. Geoffroy, dans les Mémoires de Cacadémie 1711)
>> que de voir les biens de la terre manquer par la
» fuppreflion des fommets & de leur pouffiere. ; . . .
» Quand les bleds font en fleur, on craint la nielle :
» qu’arrive-t-il enfuite ? l’épi hoircit, les grains in-
» féconds s alongent, 6c forment une • corne fâns
» germe, d’urie fubftarice plutôt approchant du
» champignon que d’un grain de bled : le moins
» qu’il puiffe arriver , c’eft que les cellules foienf
» vuides, &c. » Cette explication paroît confirmée
par une obfervation de M. Read, qui a toujours
remarque que la partie fupérieute des épis eft en
general plus fournie déergots que l’inférieure, ce
qui donne lieu de croire que la fituation de la partie
inferieure la difpofe à recevoir plus sûrement la
pouffiere des étaminesfte la partie fupérieure. On
peut donc regarderie défaut de fécondatiori comme
l’une des Caufes de Yergot ; mais ce n’eft point là
feule : ce viee peut aufli provenir, comme je l’ai diîj
de l’imperfedtion de la femence, 6c d’un dérangement
d’organifation dans la ftruéhire de quelques
ovaires, puifque l’on remarque plus d'ergot lorfque
les femenees ont été mal choifies, 6c ne font paâ
parfaitement mûres, lorfque les terres font humides;
ou lorfqu’étant légères 6c fablonneufes , elles font
trop fumées j ou lorfque n’étant pas fumées du tout,
elles ne peuvent fournir un aliment fuffifant à là
plante, ou lorfque les champs n’ôrit été labourés
que fuperficiellement, pu Jorfqu’on a femé plus
tard, ou lorfque les champs ont été rital farcies, &d
Ainfi Yergot peut être aufli attribué à des caufes antérieures
à ce qui fe pâlie au tems de l’effloreicence*
Toutes les plantes ont un tems f ix é , une.- faifori
déterminée pour fleurir ainfi toutes les caufes qui
retardent la floraifon, comme les femâilles tardives,
les terreins froids, humides, çruds, mal labourés;
mal fardés, &c. concourent à la production de IV-
got 6c des autres maladies-du grain en herbe » 6c
l’on y remédie par les moyens contraires...
Pour confirmer tout ce que j’ai dit de la génération
de Yergot, je rapporterai quelques obfervations
curieufes de M. Demozé, qui m?ont été gradeufe-»
ment communiquées par je. bureau d’agriculture dit
Mans, lorfqu’on y lut ma Differtation fur les bleds
ergotés. M. Demozé, qui a fait un examen fuivi de
Yergot avec l’attention la plu$ fçrupuleufe é principio,
eftimè que cette excroiflariee monftrueufe provient
d’un fuc mielleux, ou liqueutÿgluànte 6c fucrée, que
la plante tire de la terre, & que les gens de .la camf
pagne appellent manne: elle fe fait jour, par le moyen
de l*épi , à l’endroit du fupport des germes on fe-
mences, & s’épanche par petites goutres plus .pu
moins abondantes, de jouf comme de nuit, pendant
deux fois vingt-quatre heures, 6c quelquefois plus ;
après quoi, ces gouttes reftent adhérentes à la balle,
& y prennent une confiftance dont la progreffipn
fucceffive forme Yergot plus ou moins long, & fous
différentes formes , toujours noir & gluant jufqu’à
ce qu’il ait atteint fon dernier degré de fécherèffe*
Cette manne qui n’eft que le fuc propre de la plante;
n’eft point encore mâlfaifarite, puifque les enfans
la recherchent & la fucent fans danger apparent :
mais lorlqu’elle eft reftée adhérente à Y ergot, elle
arcquier par la fermentation une âcreté mordicante
Q Q q q q ij