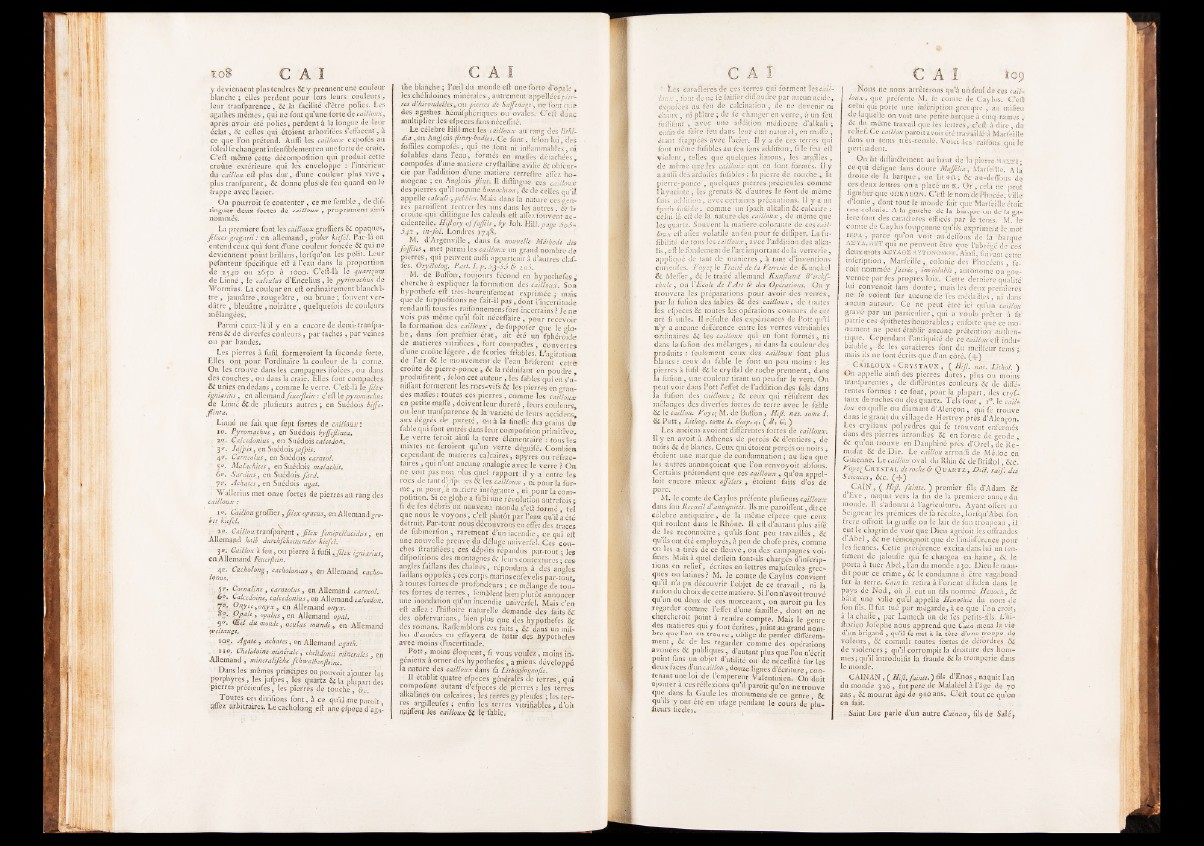
y deviennent plus tendres & y prennent une couleur
blanche; elles perdent pour lors leurs couleurs,
leur tranfparence, 8c la facilité d’être polies. Les
agathès mêmes, qui ne font qu’une forte de cailloux,
après:avoir été polies, perdent à la longue de leur
é c la t, 8c celles qui étoient arborifées s’effacent, à
ce que l’on prétend. Auffi les cailloux expofés au
foleil fe changent infenfiblement en une forte de craie.
C ’eft même cette décompofition qui produit cette
croûte extérieure qui les enveloppe : l’intérieur
du caillou eft plus dur, d’une couleur plus vive ,
plus tranfparent, 8c donne plus de feu quand on le
frappe avec l’acier.
On ppurroit fe contenter , ce me femble , de dif-
tinguer deux fortes de cailloux , proprement ainfi
nommés.
La première font.les cailloux greffiers 8c opaques,
flicesgregarii * ;en. allemand, grober kiefel. Par-là on
entend ceux qui font d’une couleur foncée 8c qui ne
deviennent point brillans, lorfqu’on les polit. Leur
pefanteur fpécifique eft à l’ eau dans la proportion
de 1540 ou 2650 à 100.0. C’eft-là le quantum
de Linné , le calculas d’Encelius, le pyrimachus de
Wormiusî La couleur en eft ordinairement blanchâtre
, jaunâtre , rougeâtre, ou brune ; fouvent verdâtre
, bleuâtre , noirâtre , quelquefois de couleurs
mélangées;
Parmi ceux-là il y en a encore de d,emi-tranfpa-
rens 8c de diverfes couleurs, par taches , par veines
ou par bandes.
Les pierres à fufil formeroient la fécondé forte.
Elles ont pour l’ordinaire la couleur de la corne.
On les trouve dans les campagnes ifolées, ou dans
des couches , q u dans la craie. Elles font compares
& unies en dedans , comme le verre. C’eft-là le filex
igniarius, en allemand feuerjlein : c’eft le pyromachus
de Linné 8c de plufieurs autres ; en Suédois biffe-
fin ta , .
Linné ne fait que fept fortes de cailloux :
ie . Pyromachus , en Suédois byjfefinta.
2,or. Çalcçdonius , en Suédois calcedon.
v 3 a* JafPl? > en Suédois jafpis.
4p. Cqrneolus, en Suédois carneol.
5°- Malachites, en Suédois mqlachit.
6°. Sardius, en Suédois fard.
yp. Achates, en Suédois agat,
■ "Waliénas met onze fortes de pierres ail rang des
cailloux : _ . 0 ‘
i o. Ca\llou groffier, fdex opacus, en Allemand grobif
Iqeftl, ■ ... ' ■ . . - ... ,
. 2P. Caillou. tranfparent, filcx femipellucidfts, en
Allemand halb durchfcheinender kiefel. -
3p. Caillou à feu, ou pierre à fufrl,Jilex igniarius,
en Allemand Feuer/lein.
4g. Cacholong, cacholonius, en Allemand caçlio-
lonus.-
-, 5?* Cornaline, carneolus, en Allemand carneol.
6°. Çplcedoine, calcedonius, e$ Allemand-calcedon,
75* V ny ci tpnyx, en Allemand onyx.
$Z‘ P/?a(e > opalus, ep Allemand opal.
9 e'* 4U monde, oçylai mjtndk , en Allemand
yrçltauge.
iot. A g r n ,. whates, en Allemand agaih.'
II». Chilidàine miriimU, chtüdomi ràmrj/es , en
Allemand , mlntralifchr. fchwalh^nfitln^. . '
Dans les mêmes principes; oa pouvéit ajoiiter l'es
porphyres , les jalpes , les quartz & la plupart des
pierres précieufes, les. pierres de touche , 6 C.
Toutes cçs divifions font, à ce qu’il,me paroît
alfez arbitraires. Le cacholong eft une çfpeced’agathe
blanche ; l’oeil du monde eft une forte d’opale ,
les chélidoines minérales , autrement appelléespierres
d'hirondelles,,ou pierres de Saffenage , ne font que
des agathes hémifphcriques ou ovales. C ’eft donc
multiplier les efpeces fans néceffité.
Le célébré Hill met les cailloux au rang des lithU
dia ,en AngLois flinty-bodies. Ce fon t, félon lui, des
foffiles compofés , qui ne font ni inflammables, ni
folubles dans l’eau, formés en maffes détachées
compofés d’une matière cryftalline avilie 8c obfcur-
cie par l’addition d’une matière terreftre affez homogène
; .en Anglois f in i. Il diftingue ces cailloux
des pierres qu’il nopime homochroa, 8c de celles qu’il
appelle caLculi ,pebbles.Mms dans la nature ces genres
paroiflènt rentrer les fins dans les autres, Ôc la
croûte qui diftingue les calculs eft affez fouvent accidentelle.
Hiflory o f fojfils , by Joli. Hill. page 5o5- .
J42 , in-fol. Londres 1748.
M. d’Argenville, dans fa nouvelle Méthode des
fojjiles, met parmi les cailloux un grand nombre de
pierres, qui peuvent auffi appartenir à d’autres claf-
fes. OryÛolog, Part. /. p. 5g-S6 & 20S.
M. de Buffon, toujours fécond en hypothefes
cherche à expliquer la formation des cailloux. Son
hypothefe eft très-heureufement exprimée ; mais
que de fuppofitions ne fait-il pas , dont l’incertitude
rend auffi tous fes raifonnemensfort incertains? Je ne
vois pas même qu’il foit néceffaire , pour recevoir
la formation des cailloux , de fuppofer que le globe
, dans fon premier état, ait été un fphéroide
de matières vitrifiées , fort compares, couvertes
d’une croûte légère , de feories friables. L’agitation
de l’air & le mouvement de l’eau briferent cette
croûte de pierre-ponce , & la réduifant en poudre ,
produifirent, félon cet auteur , les fables qui en s’unifiant
formèrent les rocs-vifs & les pierres en grandes
mafles : toutes ces pierres , comme les cailloux
en petite maffe , doivent leur dureté, leurs couleurs
ou leur tranfparence & la variété de leurs accidens*
aux degrés de pureté | ou à la fineffe des grains de
fable qui font entrés dans leur compofition primitive.
Le verre feroit ainfi la terre élémentaire : tous les
mixtes ne feroient qu’un verre déguifé.. Combien
cependant de matières calcaires, apyres ou réfractaires
, qui n’ont aucune analogie avec le verre ? On
ne voit pas non nlus quel rapport il y a entre les
rocs de tant d’ofpi :es & les cailloux , ni pour la forme
, ni pourra matière intégrante , ni pour la com-
ppfition. Si ce globe â fubi une révolution autrefois;
fi de fes débris un nouveau monde s’eft formé , tel
que npus le voyons, c ’eft plutôt par l’eau qu’il a été
détruit. Par-tout nous découvrons en effet des traces
de fiibmerfion, rarement; d’un inc.endie, ce qui eft
une nouvelle preuve du déluge univerfel. Ces couches
fti atifiees ; ces dépôts répandus par-tout ; les
difpofitions des montagnes'& leurs contextures ; ces
angles faillans des. chaînes, répomlanS. à des angles
faillans oppofés ; ces'por.ps marins enfevelis par-tout,
à toutes fortes de profondeurs ; ce mélange de toutes
fortes de terres , femblent bien plutôt annoncer
une inondation qu’un incendie univerfel. Mais c’en
eft affez: l’hiftoire naturelle demande des faits Sc
des obfervations, bien plus que des hypothefes 8c
des romans. Raffemblon'S ces faits , fc .dfins un millier
d années en eflayera de bâtir des hypothefes
avec moins d’incertitude.
Pott, moins éloquent, fi vous voule'z, moins ingénieux
à orner des.hypothefes , a mieux développé
la nature des cailloux dans fa Lithqgeo gpofe.J .
Il établit quatre efpeces générales de terres, qui
eompofent autant d’efpeces dé pierres : les terres
alkalines ou calcaire? ; lès ferres gypfeufes ; les terres
argilleufes ; enfin les terres vitrifiables, d’où
Unifient les cailloux le fahlç,
' Lés caraäetes de ces-terres qui forment les cailloux
, font de ne fe laifler cliffoudre par aucun acide,
expofées au feu de calcination , de ne devenir ni
chaux , ni plâtre ; de fe changer en verre, à un -feu
ffiffifant , avec une addition médiocre d’alkali ;
enfin de faire feu dans leur état naturel, en maffe ,
étant frappées avec l’acier. Il y a de ces terres qui
font même fufibles au feu fans addition, fi le feu eft
violent, telles que quelques limons, les arg-illes ,
de même que les cailloux qui en font formés. Il y
a auffi des ardoifes fufibles : la pierre de touche ; la
pierre-ponce , quelques pierres précieufes comme
l ’hyacinte , les grenats 8c d’autres le font-de même
fans addition, avec certaines précautions. Il y a un
fpath fufible, comme un fpath alkalin 8c calcaire ;
celui-là eft de la nature des cailloux, de même que
les quartz. Souvent la matière colorante de ces cailloux
eft affez volatile au feu pour fe diffiper. La fu-
fibilité de tous les cailloux, avec l ’addition des alka-
lis, eft le fondement de l’art important delà verrerie,
appliqué de tant de maniérés , à tant d’inventions
curieufes. Voye* le Traite de la Verrerie de Kunckel
8c Meffçr, 8c le traité allemand Kunftund JVerchf-
chule, ou l’Ecole de l'Art & des Operations, On y
trouvera les .préparations pour avoir des -verres,
par la fufion des fables 8c des cailloux, de toutes
les efpeces 8c toutes les opérations connues de cet
art fi utile. Il réfulte des expériences de Pott qu’il
n’y a aucune différence entre les verres vitrifiables
ordinaires 8c les cailloux qui en font formés, ni
dans la fufion des mélanges , ni dans la couleur des
produits : feulement ceux des cailloux font plus
blancs : ceux du fable le font un peu moins : les
pierres à fufil 8c le cryftal de roche prennent, dans
la fufion, une couleur tirant un peu fur la vert. On
peut voir dans Pott l’ effet de l’addition des fels dans
la fufion des cailloux ; 8c ceux qui réfultent des
mélanges des diverfes fortes de terre avec le fable
8c le caillou. Voye[ M. de Buffon , Hiß. nat. tome /.
8c Pott, Lithog, tome I. chap. 4. ( B. C. Y
Les anciens a voient différentes fortes de cailloux.
Il y èn avoit à Athènes de percés 8c d’entiers , de
noirs 8c de blancs. Ceux qui étoient percés ou noirs *
étoient une marque de condamnation ; au lieu que
les autres annonçoient que l’on renvoyoit abfous.
Certains prétendent que çes cailloux, qu’on appel-
loit encore mieux ojfelets , étoient faits d’os de
porc.
M. le comte de Caylus préfente plufieurs cailloux
dans fon Recueil d'antiquités. Ils me paroiflènt, dit ce
célébré antiquaire., de la même efpece que ceux
qui roulent dans le Rhône. Il eft d’autant plus aifé
de les reçonnoître, qu’ils font peu travaillés, 8c
qu’ils ont été employés, à peu de chofe près, comme
on les a tirés de ce fleuve, ou des campagnes voi-
fines. Mais à quel deffein font-ils chargés d’inferip-
tions en relief, écrites en lettres majufcules grecques
ou latines ? M. le comte de Caylus convient
qu’il n’a pu découvrir l’objet de ce travail , ni la
raifon du choix de cette matière. Si l’on n’avoit trouvé
qu’un ou deux de ces morceaux, on auroit pu les
regarder comme l’effet d’une famille, dont on ne
chercheroit point à rendre compte. Mais le genre
des matières qui y font écrites, joint au grand nombre
que l’on en trouve , oblige de penfer différemment
, 8c de les regarder comme des opérations
avouées 8c publiques, d’autant plus que l’on n’écrit
point fans un objet d’utilité ou- de néceffité fur les
deux faces d’un caillou, douze lignes d’écriture contenant
une loi de l’empereur Valentinien. On doit
ajouter à ces réflexions qu’il paroît qu’on ne trouve
que .dans la Gaule les nYonumens de ce genre 8c
qu’ils y ont été en ufage pendant le cours de plu-
iieurs fiecies. v I
Nous tie nous arrêterons qu’à un feul de ces cailloux,
que préfente M. le comte de Caylus. C ’eft
celui qui porte une rnfeription grecque , au milieu
de laquelle on voit une petite barque à cinq rames ,
8c du même travail que les lettres,- e’eft à dire , de
relief. Ce caillou paroît avoir été travâillé à Marfeille
dàn? un tems très-reculé. Voici, des raifons qui le
perfuadent. , *
On lit diftinâement au haut de la pierre m a s s i*
ce qui déftgne l'ans doute MaJJilia, Marfeille.. A la
droite de la barque, on lit <i>n ; & au-deffous de
ces deux lettres on a plaeëuin K. Or , cela ne peut
fignifief que ehn. C ’eft le nomdePhocée; ville
d’Ionie, dont tout le monde fait que Marfeille étoic
une colonie. A la gauche de la barque ou de la galère
font des carafteres effacés par le tems. M . l e
comte de Caylus foupçonne qu’ils expriment le mot
iepa , parce qu’on voit au-deffous de la Jbarque
A2) y a . AYT qui ne peuvent être que l’abrégé de ces'
deux mots a s YAoe aytonomos. Ainfi, fuivant cette
infeription, Marfeille colonie des Phocéens , fe-
roit nommee facrée, inviolable , autonome ou gouvernée
par fes.propres loix. Cette derniere qualité
lui convenoit fans doute; mais les deux premières
ne fe voient fur aucune de fes médailles, ni dans
aucun auteur. Ce ne peut être icr qu’un caillou'
gravé par un particulier, qui a voulu prêter à fa
patrie ces épitheteshonorables ; enforte que ce monument
ne peut établir aucune prétention authentique.
Cependant l’antiquité de ce oz/V/^-eft indubitable
, &c les carafteres font du meilleur tems ;
mais ils ne font écrits que d’un côté. (4-)
C ailloux - C r y s t au x , ( Hiß. nat. Lithol. )
On appelle ainfi des pierres dures, plus ou moins
tranlparentes, de différentes' couleurs 8c de différentes
formes : ce font, pour la plupart, des cryf-
taux dé rochés ou des quartz. Tels fon t , i°. le caiU
tou en quille ou diamant d’Alençon , qui fe trouve
dans le granit du village de Hertrey près d’Alençon*
Les cryftaux polyèdres qui fe trouvent enfermés
dans des pierres arrondies 8c en formé de geode ,
8c qu’on trouve en Dauphiné près d’Orel , de Re-
mufat 8c de Die. Le caillou arrondi de Médoc en
Guienn'e. Le caillou oval du Rhin 8c de Briftol, &c.
Voye{ C r y s t a l déroché & Q u a r t z , Dïcl. raif. des
Sciences, ,&c. (+ )
C A IN , ( Hiß. fainte. ) premier fils d’Adam 8c
d’Eve , naquit vers la fin de la première année du
monde. Il s’adonna à l’agriculture. Ayant offert au
Seigneur les prémices de fa réçolte, lorfqu’Abel fon
frere offroit la graillé ou le lait de fon troupeau , il
eut le chagrin de voir que Dieu agréoit les offrandes
d’A b e l, 8c ne témoignoit que de l’indifférence pour
les fiennes. Cette préférence excita dans lui un lern
timent de jaloufie qui fe changea en haine, 8c le
porta à tuer A bel, l’an du monde 130. Dieu le mau*
dit pour ce crime, 8c le condamna à être vagabond
fur la terre. Caïnie retira à l’orient d’Eden dans le
pays de Nod, où il eut un fils nommé Henoch, 8c
bâtit une ville qu’il appella Henochie du nom de
fon fils. Il fut tué par mégarde, à ce que l’on croit,
à la chaffe, par Lamech un de fes petits-fils. L’hi-
ftorien Jofephe nous apprend que Gain,mena, la vie
d’un brigand , qu’il fe mit à la tête d’une troupe de
voleurs, 8c commit toutes fortes de défordres 8ç
de violences ; qu’il corrompit la droiture des hommes;
qu’il introduifit la fraude Scia tromperie dans
le monde.
CAINAN, ( Hiß. fainte. ) fils d’Enos, naquit l’an
du monde 326, rùtpere de Malaléel à l’âge de 70
ans, 8c mourut âgé de 910 ans. C ’eft tout ce qu’on
en fait.
. Saint Luc parle d’un autre Cdinan, fils de Salé,