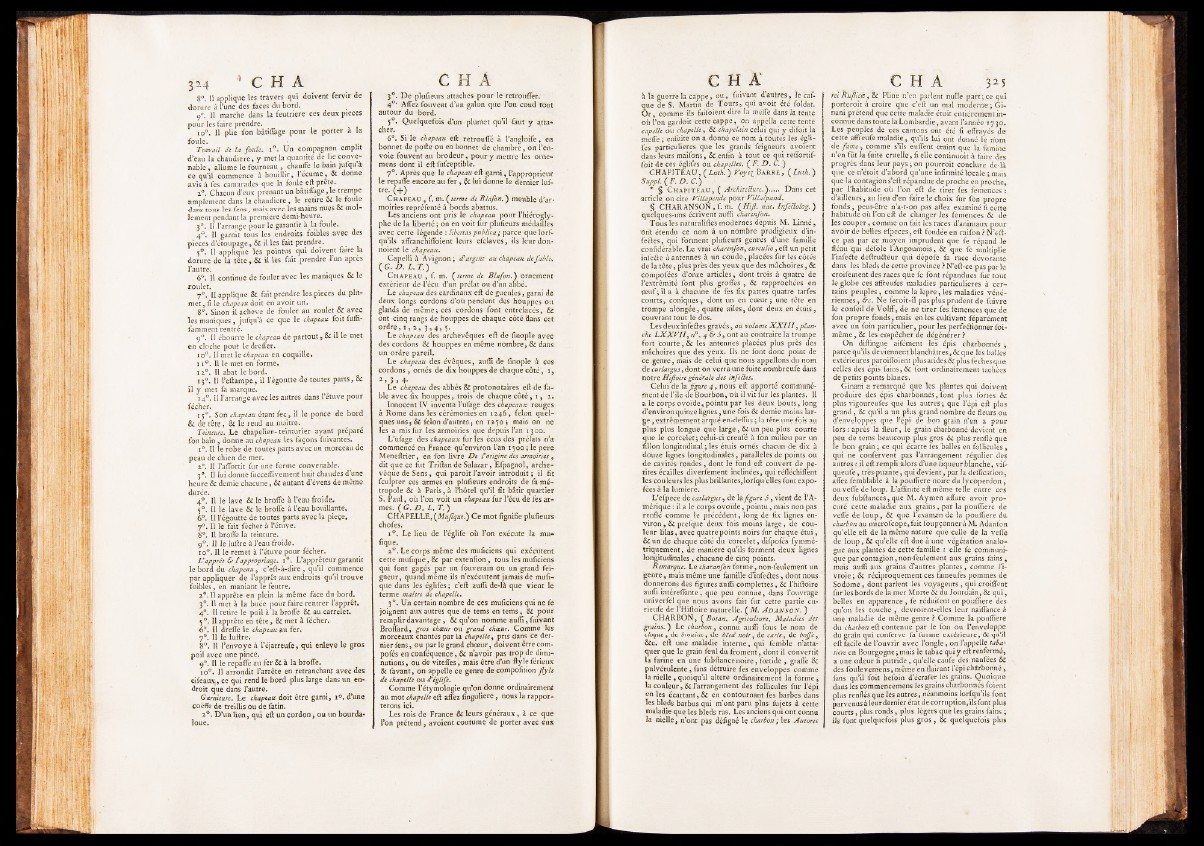
8°. Il applique les travers qui doivent fervir de
dorure à l’une des faces du tord.
9°. Il marche dans la feutriere ces deux pièces
.pour les faire prendre.
. io°. Il plie fon bâtiflage pour le porter à la
foule.
Travail de la. foule. i° . Un compagnon emplit
d’eau la chaudière, y met la quantité de lieconve*
nable, allume le fourneau , chauffe le bain jufqu à
ce qu’il commence à bouillir, l’ecume, & donne
avis à fes camarades que la foule eft prête»
2°. Chacun d’eux prenant un bâtiflage , 1e trempe
amplement dans la chaudière, le retire 6c le foule
dans tous les fens, mais avec les mains nues 6c mollement
pendant la première demi-heure.
3°. Il l’arrange pour le garantir a la foule»
4°. Il garnit tous les endroits foibles avec des
pièces d’étoupage, & il les fait prendre.
5°, Il applique les pointus qui doivent faire la
dorure de la tê te , 6c il les fait prendre l’un après
l’autre.
<a°.. Il continue de fouler avec les maniques & le
roulet.
7°. II applique Si fait prenclre les pièces du plumet,
ü le chapeau doit en avoir un.
8°. Sinon il achevé de fouler au roulet & avec
les maniques, jufqu’à ce que le chapeau foit fuffi-
famment rentré.
9°. Il ébourre le chapeau de partout , 6c il le met
en cloche pour le dreffer.
io ° . Il met le chapeau en coquille»
i i ° . 11 le met en forme»
1 2°. Il abat le bord.
130. Il l’eftampe, il ïégoutte de toutes parts, &
il y met la marque»
140. Il l ’arrange avec les autres dans l’étuve pour
fécher»
150. Son chapeau étant fe c , il le ponce de bord
& de tête, & le rend au maître.
Teinture. Le chapelier-teinturier -ayant préparé
fon bain, donne au chapeau les façons fuivantes.
i° . Il le robe de toutes parts avec un morceau de
peau de chien de mer.
20. Il l’affortit fur une forme convenable.
3°. Il lui donne fucceflivement huit chaudes d’une
heure & demie chacune, & autant d’évens de même
durée.
40. Il le lave & l e broffe à Peau froide.
50. Il le lave & le broffe à l’eau bouillante.
6°. Il l’égoutte de toutes parts avec la pieçe,
70. Il le fait fécher à l’étuve.
8°. Il broffe la teinture.
90. Il le luftre à l’eau froide.
io ° . Il le remet à l’étuve pour fécher.
U apprêt & Üappropriage. i° . L’apprêteur garantit
le bord du chapeau, c ’eft-à-dire, qu’il commence
par appliquer de l’apprêt aux endroits qu’il trouve
foibles, en maniant le feutre.
2®. Il apprête en plein la même face du bord.
3°. Il met à la buée pour faire rentrer l’apprêt.
4°. Il retire le poil à la broffe 6c au carrelet.
50. Il apprête en tête, & met à fécher.
6°. II dreffe le chapeau au fer.
70. Il le luftre.
8°. Il l’envoye à l’éjarreufe, qui enleve le gros
poil avec une pince.
90. Il le repaffe au fer & à la broffe.
io ° . 11 arrondit l’arrête en retranchant avec des
cifeauxj, ce qui rend le bord plus large dans un endroit
que dans l’autre.
Garniture. Le chapeau doit être garni, i° . d’une
coëffe de treillis ou de fatin.
2°. D’un lien, qui eft un cordon , ou un bourda-
loue.
3°. De plufieurs attaches pour le retrouffer.
4°* Affez fouvent d’un galon que l’on coud tout
autour du bord.
5°. Quelquefois d’un plumet qu’il faut y atta*
cher.
6°. Si le chapeau eft ïetrouffé à l’angloife, en
bonnet de pofte ou en bonnet de chambre, on l’envoie
fouvent au brodeur, pour y mettre les orne-
mens dont il eft fufceptible.
7°. Après que le chapeau eft garni, l’approprieuf
le repaffe encore.au fer , & lui donne le dernier litftre
(+ ) I I
C hapeau , f. m. ( terme de Blafon. ) meuble d’ar*
moiries repréfenté à bords abattus.
Les anciens ont pris le chapeau pôuf l’hiéroglyphe
de la liberté ; on en voit fur plufieurs médailles
avec cette légende : libertas publica; parce que lorl-
qu’ils affranchiffoient leurs efclaves, ils leur don-
noient le chapeau.
Capelïi à Avignon ; chargent au chapeau de fable-,
f G. D . L .T .)
C h a p e a u , f. m. ( terme de Blafon.) ornement
extérieur de l’écu d’un prélat ou d’un abbé.
Le chapeau des cardinaux eft de gueules, garni de
deux longs cordons d’où pendent des houppes ou
glands de même ; ces cordons font entrelacés, ÔC
ont cinq rangs de houppes de chaque côté flans cet
ordre, 1 , 2 , 3 ,4 , 5.
Le chapeau des archevêques eft de finople avec
des cordons & houppes en même nombre, & dans
un ordre pareil.
Le chapeau des évêques, aufli de ftnople à ces
cordons , ornés de dix houppes de chaque côté, 1,
2 > 3 > 4*
Le chapeau des abbés & protonotaires eft de fable
avec fix houppes, trois de chaque cô té, 1 , 2 *
Innocent IV inventa l’ufage des chapeaux rouges
à Rome dans les cérémonies en 1246, félon quelques
uns , & félon d’autres, en 1250; mais on ne
les a mis fur les armoiries que depuis l’an 1300.
L’ufage des chapeaux fur les écus des prélats n’a
commencé en France qu’environ Pan 1500; le pere
Meneftrier, en fon livre De torigine des armoiries,
dit que ce fut TriftandeSalazar, Efpagnôl, archevêque
de Sens, qui paroît l’avoir introduit ; il fit
fculpter ces armes en plufieurs endroits de fa métropole
& à Paris, à l’hôtel qu’il fit bâtir quartier
S. Paul, oit l’on voit un chapeau fur l ’écu de fès armes.
( G. D . L. T. )
CHAPELLE, {Mufique.) Ce mot lignifie plufieurs
chofes.
i ° . Le lieu de l’églife oh l’on exécute la mu»
lique.
2°. Le corps même des muficiens qui exécutent
cette mufique, & par extenfion, tous les muficiens
qui font gagés par un fouverain ou un grand fei-
gneur, quand même ils n’exécutent jamais de mufique
dans les églifes ; c’eft aufli de-là que vient le
terme maître de chapelle.
30. Un certain nombre de ces muficiens qui ne fe
joignent aux autres que de tems en tems, 6c pour
remplir davantage , 6c qu’on nomme aufli, fuivant
Broflard, gros choeur ou grand choeur. Comme les
morceaux chantés par la chapelle, pris dans ce dernier
fens, ou par le grand choeur, doivent être com-
pofés en conféquence, & n’avoir pas trop de diminutions,
ou de vîteffes j mais être d’un ftyle férieux
& favant, on appelle ce genre de compofition fiyle
de chapelle ou déglife.
Comme l’étymologie qu’on donne ordinairement
au mot chapelle eft allez linguliere, nous la rapporterons
ici.
Les rois de France & leurs généraux, à ce que
l’on prétend, avoient coutume de porter avec eux
à îâ guerre là cà’ppe, o u , fuivant d autrès, lé calque
de S. Martin de Tours, qui avoit été foldat-.
O r , comme ils faifoient dire la mefle dans la tente
où l’on gardoit cette cappe, ôn àppella cette tente
cdpelle ou chapelle, & chapelain celui qui y difoit la
méfié ; enfuice on a donné ce nom à toutes les égli-
fes particulières que les grands feigneùrs avoient
dans leurs màifons, & enfin à tout ce qui reffôrtif-
foit de ces églifes ou chapelles. {F . D . C .)
CHAPITEAU, ( Luth. ) Voyel Ba r r e , {Luth.)
Suppl. ( F. D . C. ) .
* § C h a p it e a u , ( Architecture.)..-... Dans cet
article on cite Villapènde pour Villalpand.
§ CHARANSON, f. m. {WJl. nat. Infectolog. )
quelques-uns écrivent aufli charenfon. ^
Tous les naturaliftês modernes depuis M-. Linné,
'Orit étendu ce nom â un nombre prodigieux d’infectes
, qui forment plufieurs genres d’une famille
confidérable. Le vrai charenfon, curculid, eft un petit
infeéte à antennes à un coudé, placées fur les côtés
de la tête, plus près des yeux que des mâchoires, &
compofées d’onze articles, dont trois à quatre de
l’extrémité font plus .greffes , & rapprochées en
oe u f ; il a à chacune de fes fix patt es quatre tarfes
•courts, coniques, dont un en coeur ; une tête en
trompe alongée, quatre ailes, dont deux en étuis,
couvrant tout le dos.
Les deuxirtfeâes gravés, au volume X X I I I ,p la n che
L X X V I I , n°. 4 & 5 , ont au contraire la tfompe
fort courte, & les antennes placées plus près des
mâchoires que des yeux. Ils ne font donc point de
ce genre, mais de celui que nous appelions du nom
de curlargus, dont on verra une fuite nombreufe dans
notre Hifioire générale des ihfectes.
Celui de la figure 4 , nous eft apporté 'communément
de l’île de Bourbon, où il vit fur les plantes. Il
a le corps ovoïde, pointu par les deux bouts, long
d’environ quinze lignes, une fois & demie moins large
, extrêmement arqué en-deffus ; la tête une fois au
plus plus longue que large, 6c un peu plus courte
que le corcelet; celui-ci creùfé à fon milieu par un
fillon longitudinal ; les étuis ornés chacun de dix à
douze lignes longitudinales, parallèles de points o u ,
de cavités rondes, dont le fond eft couvert de petites
écailles diverfement inclinées, qui réfléchiflent
les couleurs les plus brillantes,lorfqu’elles font expo-
fées à la lumière.
L’efpece de carlargus, de la figure 5 , vient de l’Amérique
: il a le corps ovoïde, pointu, mais non pas
renflé comme le précédent, long de fix lignes environ
, & prefque deux fois moins large, de couleur
lilas, avec quatre points noirs fur chaque étui,
6c un de chaque côté du corcelet, difpofés fymmé-
triquement, de maniéré qu’ils forment deux lignes
longitudinales , chacune de cinq points»
Remarque. Le charanfon forme, non-feulement un
genre, mais même une famille d’infeétes, dont nous
donnerons des figures aufli complettes, 6c l’hiftoire
aufli intéreflànte, que peu connue, dans l’ouvragé
iiniverfel que nous avons fait fur cette partie cu-
rieufe de l ’Hiftoire naturelle. ( M. Ad an so n . )
CHARBON, ( Botan. Agriculture. Maladies des
grains. ) Le charbon, connu aufli fous le nom de
cloque, de brouine, de bled noir, de carie, de boffe,
& c . eft une maladie interne, qui femble n’attaquer
que le grain feul du froment, dont il convertit
la farine en une fubftancenoire, foetide , grafle &
pulvérulente, fans détruire fes enveloppes comme
la nielle, quoiqu’il altéré ordinairement la forme,
la couleur, & l’arrangement des follicules fur l’épi
en les écartant, & en contournant fes.barbes dans
les bleds barbus qui m’ont paru plus fujets à cette
maladie que les bleds ras. Les anciens qui ont connu
la nielle, n’ont pas défigné le charbon ; les Autores
reiRuftica, & Pline n’en parlent nulle part; ce qui
porteroit à croire que c ’eft un mal moderne; Gi-
nani prétend que cette maladie étoit entièrement inconnue
dans toute la Lombardie, avant l’année 1730.
Les peuples de ces cantons ont été fi effrayés de
cette affreufe maladie, qu’ils lui ont donné le n'om
de famé -, comme s’ils euffent craint que la famine
n’en fût la fuite cruelle, fi elle conrinuoit à faire des
progrès dans leur pays ; on pourroit conclure de-là
que ce n’étoit d’abord qu’une infirmité locale ; mais
que la contagion s’eft répandue de proche en proche,
par l’habitude où l’on eft de tirer fes femences :
d’ailleurs, au lieu d’en faire le choix fur fon propre
fonds, peut-être n’a-t-on pas allez examiné fi cette
habitude où l’on eft de changer les femences & de
les couper, comme on fait les races d’animaux pouf-
avoir de belles efpeces , eft fondée en raifon ? N ’eft-
ce pas par ce moyen imprudent que fe répand le
fléau qui défoie l’Angoumois, & que fe multiplié
l’infe&e deftru&eur qui dépofe fa race dévorante
dans les bleds de cette province ? N’eft-ce pas par le
croifement des races que fe font répandues fur tout
le globe ces affreufes maladies particulières à certains
peuples, comme la lepre, les maladies vénériennes,
&c. Ne feroit-il pas plus prudent de fuivre
le confeil de V o lff, de ne tirer fes femences que de
fon propre fonds,mais eh les cultivant féparément
avec un foin particulier, pour les perfectionner foi-
même , & les empêcher de dégénérer ?
On diftingue aifément les épis charbOnnés ,
parce qu’ils deviennent blanchâtres, & que les balles
extérieures paroiffoient plus arides 6c plusfeches que
celles des épis fains, & font ordinairement tachées
de petits points-blancs-.
Ginani a remarqué que les plantes qui doivent
produire des épis charbonnés, font plus fortes &
plus vigoitreufes que les autres ; que l’épi éft plus
grand, & qu’il a un plus grand nombre de fleurs ou
d’enveloppes que l’épi de bon grain n’en a pour
lors : après la fleur, îe grain charbornié devient en
peu de tems beaxicoup plus gros 6c plus renflé que
le bon grain ; ce qui écarte les balles en follicules,
qui ne confervent pas l ’arrangement régulier des
autres : il eft rempli alors d’une liqueur blanche, vif**
queufe, très-puante, qui devient, par la déification,
affez femblable à la pouflïere noire du lycoperdon,
ouveffe de loup. L’affinité eft.même telle entre ces
deux fubftances, que M. Aymen affure avoir procuré
'cette maladie aux grains, par la poufliere de
veffe de loup, & que f examen de la poufliere dü.
charbon au microfcope, fait fotipçonner à M. Adanfon
qu’elle eft de la même nature que celle de la veffe
de loup, & qu’elle eft due à une végétation analogue
aux plantes de cette famille ■: elle fe communt»
que par contagion, tion-feulement aux grains fains ,
mais aufli aux grains d’autres plantes, comme l’i-
vroie ; &C réciproquement ces fameufes pommes dè
Sodome, dont parlent les voyageurs , qui croiffent
fur les bords de la mer Morte 6c du Jourdain, & qui,
belles en apparence , fe réduifent en poufliere dès
qu’on les touche , devroient-elles leur naiffance à
une maladie de même gènre ? Comme la poufliere
du charbon eft contenue par le fon Ou l’enveloppe
du grain qui conferve fa forme extérieure, & qu’il
eft facile de l’ouvrir avec l’ongle, on l’appelle tabatière
en Bourgogne ; mais le tabac qui ÿ eft renfermé,
a une odeur fi putride, qu’elle caufe des naufées
des foule vemens, même en flairant l’épi ch£rbonné,
fans qu’il foit befoin d’écrafer les grains. Quoique
dans les commenceméns les grains charbonnés foient
plus renflés que lés autres, néanmoins lorfqu’ils font
parvenus à leur dernier état de corruption, ils font plus
courts, plus ronds, plus légers que les grains faihs ;
ils font quelquefois plus gros, 6c quelquefois plus