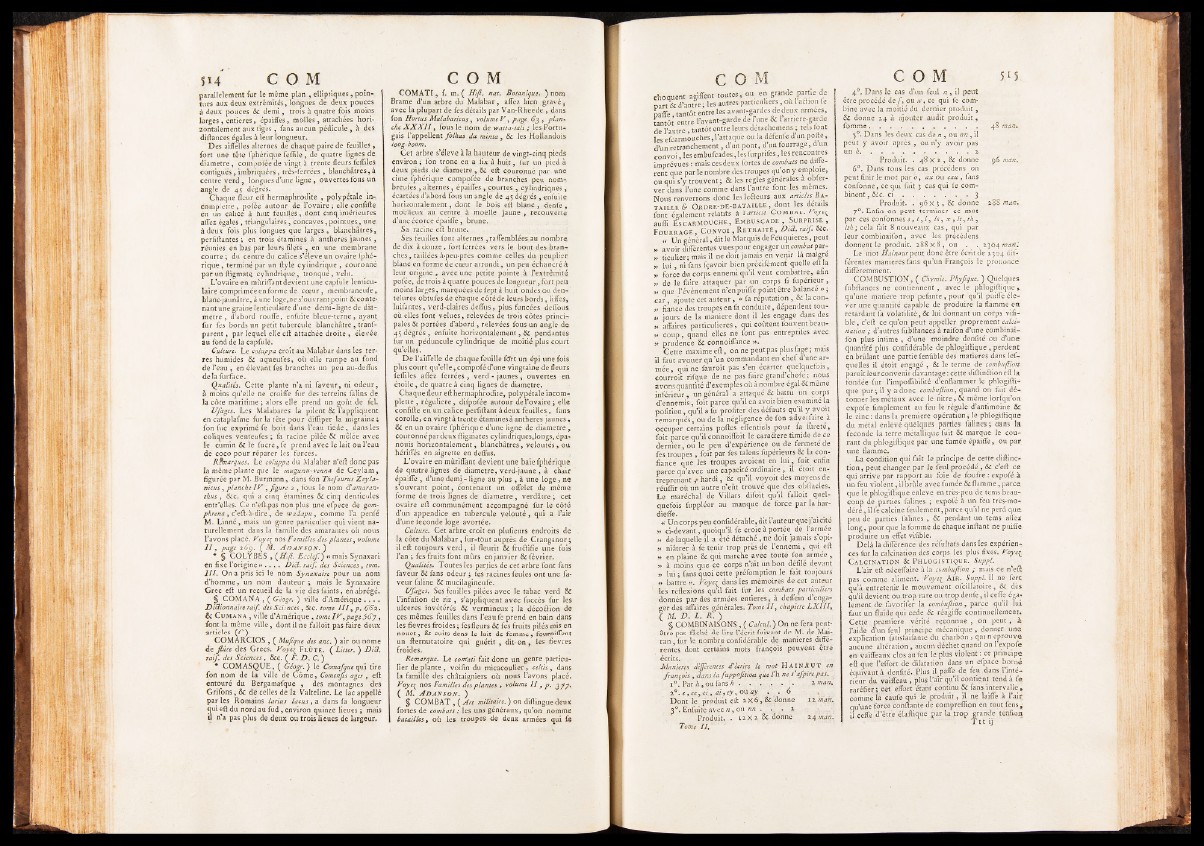
parallèlement fur le même plan , elliptiques, pointues
aux deux extrémités, longues de deux pouces
à deux pouces & demi, trois à quatre fois moins
larges, entières, épaiffes, molles , attachées horizontalement
aux tiges , fans aucun pédicule, à des
diftances égales à leur longueur.
Des aiffelles alternes de chaque paire de feuilles ,
fort une tête fphérique feflile, de quatre lignes de.
diamètre, compofée de vingt à trente fleurs fefliles
contiguës, imbriquées , très-ferrées , blanchâtres, à |
centre verd , longues d’une ligne, ouvertes fous un
angle de 45 dégrés.
Chaque fleur, eft hermaphrodite , polypétale in-
complette, poféè autour de l’ovaire; elle conflfte
en un calice à huit feuilles,,dont cinq intérieures
aflez égales , triangulaires, concaves, pointues, une.
à deux fois plus longues que larges, blanchâtres*
perfiftantes ; en trois étamines à anthères j.aunes ,
réunies en bas par leurs filets , en une membrane
courte ; du centre du calice s’élève un ovaire fphérique
, terminé par un ftyle cylindrique , couronne
par un ftigmate cylindrique, tronqué, velu.
L’ovaire en mûriffant devient une capfule lenticulaire
comprimée en forme de coeur, membraneufe,
blanc-jaunâtre, à une loge,ne s’ouvrant point & contenant
une graine lenticulaire d’une demi-ligne de diamètre
, d’abord ronfle, enfuite bleue-terne, ayant
fur fes bords un petit tubercule blanchâtre , tranf-
parent, par lequel elle eft attachée droite , élevée
au fond de la capfule.
Culture. Le coluppa croît au Malabar dans les terres
humides & aqueufes, oit elle rampe au fond
de l’eau , en élevant fes branches un peu au-defliis
delà furface.
Qualités. Cette plante n’ a ni faveur, ni odeur,
à moins qu’elle ne croiffe fur des terreins félins de
la côte maritime ; alors elle prend un goût de fel.
Ufages. Les Malabares la pilent & l’appliquent
en cataplafme fur la tête pour difliper la migraine;
fon fuc exprimé fe boit dans l’eau tiede, dans les
coliques venteufes ; fa racine pilée & mêlée avec
le cumin & le fucrè, fe prend avec le lait ou l’eau
de coco pour réparer les forces.
Remarques. Le coluppa du Malabar n’eft donc pas
la même plante que le mugunu-venna de Ceylam,
figurée par M. Burmann, dans fon Thcfaurus Zeyla-
meus , planche I P , figure 2 , fous le nom di amaran-
thus , 6tc. qui a cinq étamines & cinq denticules
entr’elles. Ce n’efkpas non plus une efpece de gom-
phrena, c’eft-à-dire, de wadapu, comme l’a penfe
M. Linné, mais un genre particulier qui vient naturellement
dans la famille des amarantes oit nous
l ’avons placé. Voye{ nos Familles des plantes, volume
I I , page 26g. ( M. A d a n s o n . )
* § COLYBES , ( H f l Ecclef.) «mais Synaxari
en fixe l’origine» . . . . D i cl. raif. des Sciences, tom.
I I I . On a pris ici le nom Synaxaire pour un nom
d’homme, un nom d'auteur ; mais le Synaxaire
Grec eft un recueil de la vie desfaints, en abrégé.
§ COM AN A , ( Géogr. ) ville d’Amérique . . . .
Dictionnaire raif. des Sciences , &C. tome I I I , p. 662.
& CüMANA , ville d’Amérique , tome I P \page 56j ,
font la même ville, dont il ne falloit pas faire deux
articles. (C.)
COMARCIOS , ( Mujîque des anc. ) air ou nome
de flûte des Grecs. Voyè^ Flûte. ( Lit ter. ) Dicl.
raif. des Sciences, &c. ( F. D . C. )
* COMASQUE, ( Géogr.') lé Comafque qui tire
fon nom de la ville de Corne, Comcnfes ager, eft
entouré du Bergamafque , des montagnes des
Grifons, & de celles de la Valteline. Le lac appellé
par les Romains Larius lacus, a dans fa longueur
qui eft du nord au fud, environ quinze lieues ; mais
ü n’a pas plus de deux ou trois lieues de largeur.
CÔM A T I , f. m. ( Hift. nat. Botanique. ) nom
Brame d’un arbre du Malabar, aflez bien gravé,
avec la plupart de fes détails par Van-Rheéde , dans
fon Hortus Malabaricus, volume V , page, 63 , plan-
che X X X I l , fous le nom de watta-tali ; les Portugais
l’appellent folhas da mima, & les Hollandois
loog-boom.
Cet arbre s’élève à la hauteur de vingt-cinq pieds
environ; fon tronc en a fix à huit, fur un pied à
deux pieds.de diamètre, & eft couronné par une
cime l'phérique compofée de branches peu nom-,
breufes , alternes, épaiffes , courtes , cylindriques ,
écartées d’abord fous un angle de 45 degrés , enfuite
horizontalement, dont le bois eft blanc , denfe ,
moelleux au centre à moelle jaune , recouverte
d’une écorce épaiffe, brune.
Sa racine eft brune.
Ses feuilles font alternes ,raflemblées au nombre,
de dix à douze, fort ferrées vers le bout des.branches
, taillées à-peu-près comme celles du peuplier
blanc en forme de coeur arrondi, un peu échancré à
leur origine, avec une petite pointe à l’extrémité,
pofée, de trois à quatre pouces de longueur, fo,rt. peu
moins larges, marquées de fept à huit ondes ou den-’ .
telures obtufes de chaque côté de leurs bords, liffes,
luifantes, verd-claires deflus, plus foncées deflous
oii elles font velues, relevées de trois côtes princir»
pales & portées d’abord , relevées fous un angle de
45 dégrés , enfuite horizontalement, & pendantes
fur un péduncule cylindrique de moitié plus court
qu’elles.
De l’aiflelle de chaque feuille fort un épi une fois
plus court qu’elle, compofé d’une vingtaine de fleurs
fefliles aflez ferrées, verd - jaunes, ouvertes en
étoile, de quatre à cinq lignes de diamètre.
Chaque fleur eft hermaphrodite, polypétale incom-
plette , régulière, difpofée autour de l’ovaire ; elle
conflfte en un calice perflftant à deux feuilles, fans
corolle, en vingt à trente étamines à anthères jaunes,
&C en un ovaire fphérique d’une ligne de diamètre ,
couronnépardeux ftigmates cylindriques,longs, épa-?
nouis horizontalement, blanchâtres, veloutés, ou
hériffés en aigrette en deflus.
L’ovaire en mûriffant devient une baie fphérique
de quatre lignes de diamètre, verd-jaune , à chair
épaiffe , d’une demi - ligne au plus , à une lo ge, ne
s’ouvrant point , contenant un offelet de même
forme de trois lignes de diamètre , verdâtre ; cet
ovaire eft communément accompagné fur le côté
d’un appendice en tubercule velouté, qui a l’air
d’une fécondé loge avortée.
Culture. Cet arbre croît en plufieurs endroits de
la côte du Malabar, fur-tôut auprès de Cranganor ;
il eft toujours v e rd , il fleurit & fruûifie une fois
l’an ; fes fruits font mûrs en janvier & février.
Qualités. Toutes les parties de cet arbre font fans
faveur & fans odeur ; lès racines feules ont une faveur
faline & mucilagineufe.
Ufages. Ses feuilles pilées avec le tabac verd &
l’infufion de riz , s’appliquent avec fuccès fur les
ulcérés invétérés & vermineux ; la décoâion de
ces mêmes feuilles dans l’eau fe prend en bain dans
les fievres froides ; fes fleurs & fes fruits pilés mis en
nouet, & cuits dans le lait de femme, fourniflent
un fternutatoire qui guérit , dit-on, les fievres
froides.
Remarque. Le contati fait donc un genre particulier
de plante , voifin du micacoulier, celtis, dans
la famille des châtaigniers oit nous l’avons placé.
Voye{ nos Familles des plantes , volume I I , p. 3 J y*,
( M. A d a n s o n . )
§ COMBAT , ( Art militaire. ) on diftingue deux
fortes de combats : les uns généraux, qu’on nomme
1 batailles, oit les troupes de deux armées qui fe
choquent agiffent toutes, ou en grande partie Je-
part & d’autre; les autres particuliers ou 1 a&on fe
paffe tantôt entre les avantpgardes de deux années,
tantôt entre l’ayant-gardedeÿune & 1 arnere-garde
de l’autre , tantôt entre leurs detachemens ; tels lont
les efcarmotiches, l’attaque ou la défenfe d’un pofte,
d’un retranchement, d’un pont, d’un fourrage, d un
convoi, les embufeades, les furprifes, les rencontres
imprévues : mais ces deux fortes de combats ne different
que par le nombre des troupes qu’on y emploie,
ou qui s’y trouvent ; & les réglés générales a obier-
ver dans l’une comme dans l’autre font les memes.
Nous renverrons donc leslefteurs aux articles Ba t
a i l l e & Ojidre-de-batail le , dont les details
font également relatifs à Yarticle C om b a t . Voye^
aufli Esca rm o uche, Embuscade , Surprise ,
Fourrage , C onvoi , R e t r a it e , Dict. raif. &c.
« Un général, dit le Marquis de Fe'uquieres, peut
» avoir differentes vues pour engager un combat par-
» ticulier; mais il ne doit jamais en venir là maigre
» lu i , ni fans fçavoir bien précifément quelle eft la
» force du corps ennemi qu’il veut combattre, afin
» de le faire attaquer par un corps fi fupérieur ,
» que l’événement n’en puiflè point être balancé » ;
c a r , ajoute cet auteur, « fa réputation , & lacon-
» fiance des troupes en fa conduite, dépendent tou-
h jours de la maniéré dont il les engage dans des
» affaires particulières, qui coûtentfouventbeau-
» coup, quand elles ne' (ont pas- entreprifes avec
» prudence & connoiffance ».
Cette maxime eft, on ne peut pas plusfage; mais
il faut avouer qu ’un commandant en chef d’une armée,
qui ne fauroit pas s’en écarter quelquefois,
courroit rifque de ne pas faire grand’chofe ; nous
avons quantité d’exemples où à nombre égal & même
inférieur, un général a attaqué & battu un corps
d’ennemis, foit parce qu’il en avoit bien examiné la-
pofition, qu’il a fu profiter des défauts qu’il y avoit
remarqués, ou de la négligence de fon adverfaire à
occuper certains poftes effentiels pour fa fûreté,
foit parce qu’il connoiffoit le cara&ere timide de ce
dernier, ou le peu d’expérience ou de fermeté de
fes troupes , foit par fes talens fupérieurs & la confiance
que les troupes avoient en lu i, foit enfin
parce qu’avec une capacité ordinaire , il é'tôit entreprenant
,* h ardi, & qu’il voyoit des moyens de
réuflir où un autre n’eût trouvé que des obflacles.
Le maréchal de Villars difoit qu’il falloit quelquefois
fuppléer au manque de force par la har-
dieffe. . . . ,
« Un corps peu confidérable, dit l’auteur que j’ai cité
» ci-deyant, quoiqu’il fe croie à portée de l’armée
» de laquelle il a été détaché , ne doit jamais s’opi-
» niâtrer à ie tenir trop près de l’ennemi, qui eft
» en plaine & qui marche avec toute fon armée ,
» à moins que ce corps n’ait un bon défilé devant
» lui ; fans quoi cette préfomptidn le fait toujours
» battre ». Voyei dans les mémoires de cet autour
les réflexions qu’il fait fur les combats particuliers
donnés par des armées entières, à deffein d’engager
des affaires générales. Tome //, chapitre L X I I I ,
? M. D . L. R. )
§ COMBINAISONS., ( Calcul. ) On n e fera peut-
être pas fâché de lire l’écrit fuivant de M. de.Mai-
ran, fur le nombre confidérable de maniérés différentes
dont certains mots françôis peuvent être
écrits,; .-.y
Maniérés différentes décrire le mot H A IN À U T en
françôis , dans la fuppojition que /’h ne s'afpire pas.
i ° . Par h , ou fans h ‘ . . z many
a°. e , ee ,-ci, ai ,c y , o\l ay . . 6
Dont le produit eft 1X 6 , & jdonne i l ynari.
30. Enfuite avec n , ou nn . . . i
Produit. . i l X i & donne 14 mâfa
Tome II.
4°. Dans le cas d’un feul n , il peut
être procédé de ƒ , ou x , Ce qui fe combine
avec 1a moitié dit dernier produit,
& donne 24 à ajouter audit produit,
fortune. . ...............................................48/724^»
50. Dans les deux cas de n , ou nn, il
peut y avoir après , ou n’y avoir pas
Un. h. . ;.. . . . .. . . . . . . 2
Produit. . 48 X 2 , & donne £6 man.
6°. Dans tous les_ cas précédens on
peut finir le mot par ô, au Ou eau , fans
Confonne, ce qui fait 3 cas qui fe combinent
, & c . c i ....................... ..... . 3
Produit. . 96 x 3 , & donne 288 tnani
70. Enfin on peut terminer cé mot
par ces confonnes s , t , l , Is^xy lty th ,
Ith; cela fait 8 nouveaux Cas, qui par
leur cômbinaifon, avec les précédens
donnent le produit. z88 x 8 , ou . . 2304 rtiarll
Le mot Hainaut peut donc être écrit de 1304 dit-*
férentes maniérés fans qu’un François le prononce
différemment.
COMBUSTION, ( Chymie. Phyflqué. ) Quelques
fubftances ne contiennent, avec le phlogiftique*
qu’une matière trop pefante , pour qu’il puiflè élever
une quantité Capable de produire la flamme en
retardant fa volatilité,& lui donnant un corps vifi-
ble, c’eft ce qu’on peut appeller proprement calci»
nation ; d’autres fubftances à raifon d’une combinai--
fon plus intime , d’une moindre denlité ou d’une
quantité plus confidérable de phlogiftique , perdent
en brûlant une partie fenfible des matières dans lef-
quelles il étoit engagé , & le terme de combufliort
paroît leur convenir davantage : cette diûin&ion eft la
fondée fur l’impoflibilité d’enflammer le phlogifti-*
que pur ; il y a donc combiifliony quand on fait détonner
les métaux avec le nitre, & même lorfqu’on
expofe Amplement au feu le régule d’antimoine &
le zinc : dans la première opération ; le phlogiftique
du métal enleve quelques parties falines ; dans la
fécondé la terre métallique fuit & marque le courant
du phlogiftique par une fumée épaiffe, ou par
une flamme.
La condition qui fait le principe de cette diftinc-
tion, peut changer par le feul procédé , & c’eft ce
qui arrivé par rapport au foie de foufre : expofé.à
un feu violent, il brûle avec fumee & flamme, parce,
que le phlogiftique enleve en très-peu de tems beaucoup
de parties falines ; expofé à un feu très-modéré
, ilfe calcine feulement,parce qu’il ne perd qua
peu de parties falines , & pendant un tems allez
long , pour que lafomme de chaque inftant ne puiflè
produire un effet vifible.
Delà la différence des réfultats dans les expériences
fur la calcination des corps, les plus fixes. Voyeiç.
Calcination & Phlogjstique. Suppl.
L’air eft nécelfaire à la combuflion ; mais ce n’eft
pas comme aliment. Voye^ A i r . Suppl. Il ne fert
qu’à entretenir le mouvement ofcillatoire, & dès
qu’il devient ou trop rare ou trop denfe, il ceffe éga-!
lement de favorifer la combuflion, parce qu’il lui
faut un fluide qui cede & réagiffe continuellement.
Cett,e,, première vérité reconnue , on peut , à
l’aide d’un feul principe mécanique1, donner, une
explication fàtisfaifante du charbon, qui n éprouvé
aucune altération, aucun déchet quand on 1 expofe
en vaiffeaux clos au feu le plus violent : ce principe
eft que l’effort de dilatation dans un efpace borne
équivaut.à denfité. .Plus il paflè de feu dans 1 intérieur
du vaiffeau , plus l’air qu il contient tend à fe
raréfier ; cet effort étant continu & fans intervalle,
comme la çaufe qui le produit., il ne laiflè à l’air
qu’une force confiante de compreflion en. tautfens,
il ceffe d’être élaftique par la trop grande ténflon
< ' .............. ' T t t ij'"