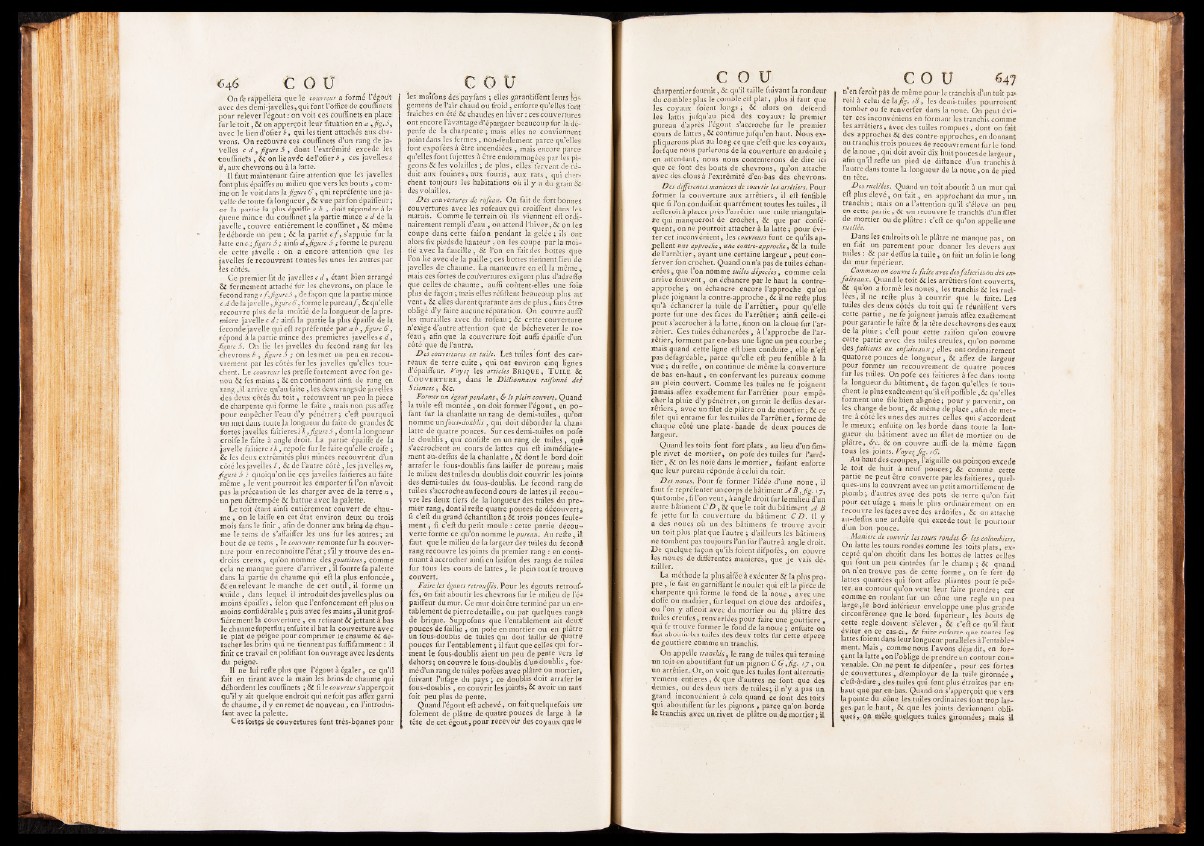
On fie rappellera que le couvreur a formé l’égout
avec dès demi-javelles* qui font l’office de couffinets
pour relever l’égôut : on Voit ces couffinets en place
fur le toit ,&onap perçoit leur fitu&tion en a ,
avec le liend’ofier qui les tient attachés auxche*
vrons. On recouvre ces couffinets d’un rang de javelles
c d , figure 3 , dont l’extrémité excede les
couffirieîs , & on lièavéc deTofier b , ces javelles c
d 9 aux chevrons ou à la latte.
Il faut maintenant faire attention que les javelles
font plus épaiffes au milieu que vers les bouts , comme
on le voit dans la figure 6' -, qui repréfente une javelle
de toute fa longueur, & vue parfon épaiffeur ;
or la partie la plus épaiffeà b , doit répondre â la
âueue fhince du couffinet ; la partie mince c d de la
javelle, couvre entièrement le couffinet, & même
le déborde un peu ; & la partie e ƒ , s’appuie fur la
Jatte en c-,* figure â ; ainfi d , figure 5 ; forme le pureau
de cette jâvelle : on a encore attention que les
tavelles fe recouvrent toutes les unes lès autres par
les côtés.
Ce premier lit de javelles c d , étant bien arrangé
& fermement attaché fur les chevrons, on place lé
fécond rang e f i figure 5 , de façon que la partie mince
c d de là javelle, figure 6 , forme le pureau/, & qu’elle
recouvre plus de la moitié de la longueur de la première
javelle c d: ainfi la partie la plus épaiffe de la
fécondé javelle qui eft repréfentée par a b 9 figure C ,
répond à la partie mince des premières javelles c d ,
figure 5. On lie les javelles du fécond rang fur les
chevrons b , figure 5 $ on les met un peu en recouvrement
par les côtés fur les javelles qu’elles touchent.
Le couvreur les preffe fortement avec fon genou
& fes mains ; & en continuant ainfi de rang en
rang, il arrive qu’au faîte , les deux rangs de javelles
des deux côtés du to i t , recouvrent un peu la piece
de charpente qui forme le faîte , mais non pas affez
pour empêcher l’eau d’y pénétrer ; c’eft pourquoi
on met dans toute ja longueur du faîte de grandes &
fortes javelles faîtieres i k , figure S , dont-la longueur
croife le faîte à angle droit. La partie épaiffe de la
javelle faîtiere / k , repofe fur le faîte qu’elle croife ;
& les deux extrémités plus minces recouvrent d*un
côté les javelles / , & de l’autre cô té , les javellés m9
figuré â : quoiqu’on lie ces javelles faîtieres au faîte
même * le vent pourroit les emporter fi l’on n’avoit
pas la précaution de les charger avec de la terre n ,
un peu détrempée & battue avec la palette.
Le toit étant ainfi entièrement couvert de chaume
, on le laiffe en cet état environ deüx ou trois
mois farts le finir , afin de donner aux brins de chaume
le tems de s’affaiffer les uns fut les aütfes; ait
bout de ce tems , le couvreur remonte fur la couverture
pour en reconhoître l’état ; s^l y trouve dès endroits
creux, qu’On nomme des gouttières * commé
cela ne manque guere d’arriver, il fourre fa palette
dans la partie du chaume qui eft la plus enfoncée,
& en relevant le manche de cet outil, il forme un
vuide , dans lequel il introduit des javelles plus ou
moins épaiffes, félon que l’enfoncement eft plus ou
moins coniidérable ; puis avec fes mains, il unitgrof-
fièrement la couverture , en retirant & jettant à bas
le chauntefuperflü;enfuite il bat la couverture avec
le plat de peigne pour comprimer le chaume & détacher
les brins qui ne tiennent pas fuffifamment : il
finit ce travail enpoliffant fon ouvrage avec les dents
du peigne.
Il ne lui réfte plus que l’égout à égaler, ce qu’il
fait en tirant avec la main les brins de chaume qui
débordent les couffinets ; & fi le couvreur s’apperçoit
qu’il y ait quelque endroit qui nefoit pas affez garni
de chaume » il y en remet de nouveau, en l’introdui-
fant avec la palette.
Ces fortçs de couvertures font très-bqnnes pour
les m allons dès pay fans ; elles garanïiffent leurs; 16-
gemens de l ’air chaud ou froid, enforte qu’elles font
fraîches en été & chaudes en hiver : ces couvertures
ont encore Pàvantage d’épargner beaucoup fur la dé-*
penfe de la charpente ; mais elles ne conviennent
point dans les fermes, non-feulement parce qu’elles
font expofees à etre incendiées , mais encore parce
qu’elles font fujettes à être endommagées par les pigeons
& les volailles ; de plus, elles" fervent de réduit
aux fouines*'aux fouris, aux rats, qui cherchent
toujours les habitations où il y a du grain ôe-
des volailles.
Des couvertures de rôfeau. On fait de fort bonnes
couvertures avec les rofeaux qui croiffent dans les
marais. Comme le terrein où ils viennent eft ordinairement
rèmpli d’eau , on attend l’hiver ,& on les
coupe dans cette faifôn pendant la gelée ; ils ont
alors fix pieds de hauteur * on les coupe par la moitié
avec la faucille* & l’on en fait des bottes que
l’on lie avec de la paille ; ces bottes tiennent lieu de
javelles de chaume. La manoeuvre en eft la même *
mais ces fortes de çouVertures exigent plus d’adreffe
que celles de chaume, auffi coûtent-elles une fois
plus de façon ; mais elles réfiftent beaucoup plus ait
vent , & elles durent quarante ans de plus , fans êtrê
obligé d’y faire aucune réparation. On couvre auffi
les murailles avec du rofeau ; & cette couverture
n’exige d’autre attention que de bêcheveter le ro-
féau g afin que la couverture foit auffi épaiffe d’un
côté que de l’autre.
Des couvertures in tuile. Les tuiles font des carreaux
de terre cuite 9 qui ont environ cinq ligrtes
d’épaiffeur. Voye£ les articles Br iq u e * T uile &
C o u vertu re* dans le Dictionnaire raifonné deè
Sciences * &c.
Former un égout pendant, & le plein couvert. Quand
la tuile eft montée , on doit former l’égout, en po-
fant fur la chanlatte un rang de demi-tuiles , qu’oit
nomme unfous-doûblis , qui doit déborder la chanlatte
de quatre pouceà. Sur ces demi-tuiles on pdfë
le doublis , qui cônfifte en un rang de tuiles, qui
s’accrochent au cours de lattes qui eft immédiatement
au-deffus de la chanlatte, & dont le bord doit!
arrafer le fous-doubüs fans laiffer de pureau ; mais
le milieu des tuiles du doublis doit couvrir les joint»
des demi-tuiles du fous-doublis. Le fécond rang de
tuiles s’accroche au fécond cours de lattes ; il recouvre
les deux tiers de la longueur des tuiles du pre--
mier rang, dont il refte quatre pouces de découvert*
fi c’eft du grand échantillon ; & trois pouces feulement
, fi c’eft du petit moule : cette partie découverte
forme ce qu’on nomme lé pureau. Au refte, il
faut que le milieu de la largeur des tuiles du fécond
rang recouvre les joints du premier rang : en continuant
à accrocher ainfi en liaifon des rangs de tuiles
fur tous les cours de lattes, le plein toit fe trouve»
couvert.
Faire Us égouts retrouffés. Pour les égouts retrouf-
fés, on fait aboutir les chevrons fur le milieu de l’é-
paiffeur du mur. Ce mur doit être terminé par un entablement
de pierre détaillé* ou par quelques rangs
de brique. Suppofons que l’entablement ait deu#
pouces de faillie , on pofe en mortier ou en plâtre
un fous-doublis de tuiles qui doit faillir de quatre
pouces fur l’entablement ; il faut que celles qtii forment
le fous-doublis aient un peu de pente vers \d
dehors; on couvre le fous-doublis d’un doublis, for-’
mé d’un rang de tuiles pofées avec plâtre ou mortier,-
fuivant l’ufage du pays ;• ce doublis doit arrafer 1«
fous-doublis , en couvrir les joints, & avoir un tanî
foit peu plus de pente.
Quartdl’égout eft achevé, on fait quelquefois uw
folement de plâtre de quatre pouces de large à la
têtç de cet égout, pour recevoir des coyaux que te
charpentier fournit, & qu’il taille fuivant la rondeuf
du comble : plus le comble eft plat * plus il faut que
les coyaux foîent longs ; & alors on delcend
les lattis jufqu’au pied des coyaux: le premier
pureau d’après l’égout s’accroche fur le premier
cours de lattes, & continue jufqu’en haut. Nous expliquerons
plus au long ce que c’eft que les coyaux,
lorfque nous parlerons de la couverture en ardoife ;
en attendant, nous nous concernerons de dire ici
que ce font des bouts de chevrons, qu’on attache
avec des clous à l’extrémité d’en-bas des chevrons.
Des différentes maniérés de couvrir les arrêtiers. Pour
former la couverture aux arrêtiers, il eft fenfible
que fi l’on conduifoit quarrément toutes les tuiles, il
refteroit à placer près l’arrêtier une tuile triangulaire
qui manqueroit de crochet, & que par confé-
quent, on ne pourroit attacher à la latte ; pour éviter
cet inconvénient, les couvreurs font ce qu’ils appellent
une approche, une contre-approche, & la tuile
de l’arrêtier, ayant une certaine largeur, peut con-
ferver fon crochet. Quand on n’a pas de tuiles échan-
crées, que l’on nomme tuiles dépecées, comme cela
arrive fou vent, on échancre par le haut la contre-
approche ; on échancre encore l’approche qu’on
place joignant la contre-approche, & il ne refte plus
qu’à échancrer la tuile de l’arrêtier, pour qu’elle
porte fur une des faces de l’arrêtier; ainfi celle-ci
peut s’accrocher à la latte, finon on la cloue fur l’ar-
xêtier. Ces tuiles échancrées, à l ’approche de l’arrêtier,
forment par en-bas une ligne un peu courbe;
mais quand cette ligne eft bien conduite , elle n’eft
pas défagréable, parce qu’elle eft peu fènfible à la
vue ; du refte, on continue de même la couverture
de bas en-haut, en confervant les pureaux comme
au plein couvert. Comme les tuiles ne fe joignent
jamais^affez exaâement fur i’arrêtier pour empêcher
la pluie d’y pénétrer, on garnit le deffus des arrêtiers,
avec un filet de plâtre ou de mortier ; & ce
filet qui entame fur les tuiles de l’arrêtier, forme de
chaque côté une plate * bande de deux pouces de
largeur.
Quand les toits font fort plats , au lieu d’un fim-
ple rivet de mortier, on pofe des tuiles fur l’arrê-
tier, & on les noie dans le mortier, faifant enforte
que leur pureau réponde à celui du toit.
Des noues. Pour fe former l’idée d’une noue, il
faut fe repréfenter un corps de bâtiment A B ,fig. iy9
qui tombe, fi l’on veut, à angle droit fur le milieu d’un
autre bâtiment C D , & que le toit dit bâtiment A B
fe jette fur la couverture du bâtiment C D . Il y
a des noues où un des bâtimens fe trouve avoir
un toit plus plat que l’autre ; d’ailleurs les bâtimens
ne tombent pas toujours l’un fur l’autre à angle droit.
D e quelque façon qu’ils foient difpofés, on couvre
les noues de différentes maniérés, que je vais détailler.
La méthode la plus aifée à exécuter & la pjùs propre
, (e fait en garniffant lé noiilet qui eft là pièce de
charpente qui forme le fond de la noue, avec une
dolle ou madrier, fur lequel on cloue des afdoifes,.
ou 1 on y affeoit avec du mortier ou di> plâtre des
tuiles creufes, renverfées pour faire une gouttière ,
qui fe trouve former le fond de la noue ; enfùite on
fait aboittir-les tuiles des deux1 toits fur cette efpece
de gouttière comme.un tranchis.
On appelle tranchis, le rang de tuiles qui termine
un tojt en aboutiffant fur un pignon C G ,fig. ry , ou
ùn arrêtier. Or, on voit.que, les tuiles,font alternativement
entières , & que d’autres ne font q,ue des.
demies, où des deux tie,rs de tuiles; il n’y a pas un
grand inconvénient à cela quand ce font des.toitk
qui aboutiffent fur les pignons , parce qu’on borde
le tranchis avec un rivet de plâtre ou,de mortier; il
îî en feroit pas de même pour le trânehis tî\in toît pa*
reil à celui de la/*. 18, les demi-tuiles pourroient
tomber ou fe renverfer dans la noue. On peut éviter
ces inconvéniens en formant les tranchis comme
les arfêtiers* avec des tuiles rompues, dont on fait
des approches & des contre-approches, en donnant
au tranéhis trois pouces de recouvrement furie fond
de la noue, qui doit avoir dix huit pouces de largeur,
afin qu’il refte un pied de diftance.d’un tranchis à
l’autre dans toute la longueur de la noue, ou de pied
en tête.
Des ruellees. Quand un toit aboutit à un mur qui
eft plus élevé, on fait, en approchant du mur, un
tranchis ; mais on a l’attention qu’il s’élève un peit
en cette partie, & on recouvre le tranchis d’un filet
de mortier ou de plâtre : c’eft ce qu’on appelle uns
ruellèe.
Dans les endroits où le plâtre ne manque pas, oii
en fait un parement pour donner les devers aux
tuiles : & par deffus la tuile, on fait un folin le long
du mur fupérieur.
Comment on couvre le faîte avec des faîteriti ou des en*
faîteaux. Quand le toit &les arrêtiers font couverts,
& qu’on a formé les noues, les tranchis & les niellées
, il n,e refte plus à couvrir que le faîte. Les
tuiles des deux côtés du toit qui fe réunifient vers
cette partie, ne fe joignent jamais affez exaâement
pour garantir le faîte & la tête des chevrons des eaux’
de la pluie ; c’eft pour cette raifon qu’on- couvre
cette partie avec des tuiles creufes, qu’on nomme
des faîtieres ou enfaîteaux ; elles ont ordinairement
quatorze pouces de longueur, & affez de largeur
pour former un recouvrement de quatre pouces
fur les tuiles. On pofe c es faîtieres à fec dans toute
la longueur du bâtiment, de façon qu’elles fe touchent
le plusexa&ement qu’il eft poffible ,& qu’elles
forment une file bien alignée ; pour y parvenir, on
les change de bout, & même de place, afin de mettre
à côté les unes des autres celles qui. s’accordent
le mieux ; enfuite on les borde dans toute la Ion-*
gueur du bâtiment avec un filet de mortier ou de
plâtre, &c. & on couvre auffi de la même façon
tous les joints. Voye^ fig. iC,
Au haut des croupes, l’aiguille ou poinçon excede
le toit de huit a neuf polices-; & comme cette
partie ne peut être couverte par lès faîtieres ,■ quel*
ques-uns la couvrent avec un petit amortiffement de
plomb ; d’autres- avec des pots de terre qu’on fait
pour cetnlàge ; mais le plus ordinairement on en
recouvre les faces avec des a r d o i f e s& on attache
au-deffus une ardoife qui excede tout le pourtouf
d’un bon pouce.
Maniéré de couvrir les tours rondes & les colombiers.
On latte les tours rondes comme les toits plats, ex-
cepté qu’on choifit dans les bottes de lattes celles
qui font un peu cintrées fur le champ ; & quand
On n’en trouve pas de cette fo rm e o n fe fert de
lattes quarrées qui font-affez pliantes pour fe prê-*
ter.au contour qu’on veut leur faire prendre; caC
comme en roulant fur un cône une réglé un peu
large,,,le bord inférieur enveloppe une plus grande
circonférence que. le bord fuperieur, les bouts de
cette réglé doivent s’élever , & c’eft ce qu’il faut
éviter en-ce cas-ci-, & faire enforte que toutes les
lattes foient dans leur longueur parallèles à l’entable-*
ment. Mais, comme nous, l’avons déjà dit, en for-*
çant la latte,.on.l’oblige de- prendre un contour convenable,
On ,ne peut fe difpenfer, pour ces fortes
couvertures, ,d’employer de la tuile gironnée,
c’eft-àrdire , des tuiles qui- font plus étroites par en*
haut que par en-fias. Quand on s ’apperçoit que vers
Ja pointe du ,cône lps tuiles ordinaires font trop Iar-
gescpar; le haut, & que les joints deviennent obli*
q u e s o n m,ê,le quelques tuiles gironnées; mais il
1