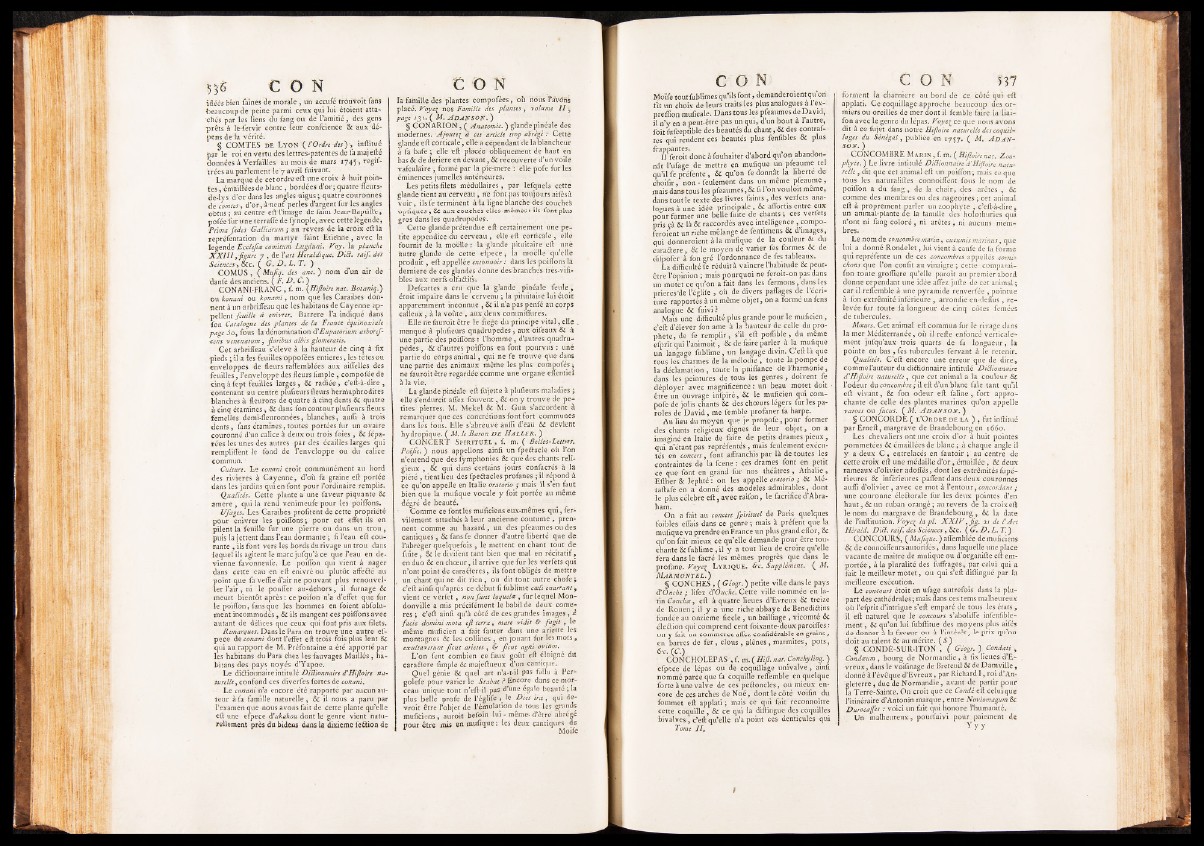
iâéé's bien faines de morale , un accufé trôüVoit fàhs
beaucoup de peine parmi ceux qui lui étoient attachés
par les liens du fang ou de l’amitié, des gens
prêts à le-fervir contre leur confidence & aux'dépens
de la vérité,
§ COMTES de L y o n ( l'Ordre des') -, inftitué
par le roi en vertu des lettres-patentes de fa majefté
données à Verfailles au mois de mars 1745 ? re&^“
trées au parlement le 7 avril fuivant.
La marque de cet ordre eft une croix à huit pointes
»émaillées de blanc, bordées d’or; quatre fleurs-
de-lys d’or dans les angles aigus ; quatre couronnes
de comtes » d’or, àmeuf perles d’argent fuï les angles
obtus; au centre eft l’image defaint Jean-Baptifte,
poféefur «ne terraffe de fynople, avec cette légende*
-Prima fedes Galliàrum >• au revers de la croix eft là
repréfentation du martyr faint Etienne, avec la
legende Ecclefia comitum Lugduni. Voy. la planche
X X IH , figure y , de Y art Héraldique. Dict. raif. dis
Sciences-, & c . ( G. D . L. T. )
COMUS , ( Mufiq. des anc. ) nom d’un air de
danfe des anciens. ( F. D. C. )
CONANl-FRANC , f. m. (Hijtoîre nat. Botaniq.)
ou konani ou konami, nom que les Caraïbes donnent
à un arbriffeau que les habitans de Cayenne appellent
feuille à enivrer. Barrere l’a indiqué dans
ion Catalogue des .plantes de la France équinoxiale
pave iô , fous la dénomination d'Eupatàrium arbôref-
ccns venenatùm, fioribus albis glomeratis.
Cet arbriffeau s’élève à la hauteur de cinq à fix
pieds ; il a les feuilles oppofées entières, les têtes ou
enveloppes de fleurs raffemblées aux aiffelles des
feuilles, l’enveloppe des fleurs Ample , compofée de
cinq à fept feuilles larges, & radiée , c’eft-à-dire ,
•contenant au centre plufieurs fleurs hermaphrodites
blanches à fleurons de quatre à cinq dents & quatre
à cinq étamines -, & dans fon contour plufieurs fleurs
femelles demi-fleuronnées» blanches, aufli à trois
dents, fans étamines, toutes portées fur un ovaire
couronné d’un calice à deux ou trois foies , & fépa-
rées les unes des autres par des écailles larges qui
rempliffèrit le fond de l’enveloppe ou du calice
commun. •
Culture. Le conani croît communément au bord
des rivières à Cayenne, d’où la graine efl portée
dans les jardins qui en font pour l’ordinaire remplis.
Qualités. Cette plante a une faveur piquante &
amere , qui la rend venimeufe pour les poiffons.
Ufages. Les Caraïbes profitent de cette propriété
pour enivrer les poiffons ; pour cet effet ils en
pilent la feuille fur une pierre ou dans un trou ,
puis la jettent dans l’eau dormante ; li l’eau eft courante
, ils font vers les bords du rivage un trou dans
lequel ils agitent le marc jufqu’à ce que l’eau en devienne
favonneufe. Le poiffon qui vient à nager
dans cette eau en eft enivré ou plutôt affe&é au
point que fa veflie d’air ne pouvant plus renouvel-
ler l’air , ni le pouffer au-dehors, il fumage &
meurt bientôt après : ce poifon n’a d’effet que fur
le poiffon, fans que les hommes ' en foient abfolu-
ment incommodés , & ils mangent ces poiffons avec
autant de délices que ceux qui font pris aux filets.
Remarques. Dans le Para on trouve une autre efpece
de conani dont l’effet eft trois fois plus lent &
qui au rapport de M. Préfontaine a été apporté par
les habitans du Para chez les fauvages Maillés, habitans
des pays noyés d’Yapoe.
Le diélionnaire intitulé Dictionnaire d" Hifloire naturelle
, confond ces diverfes fortes de conani.
Le conani n’a encore été rapporté par aucun auteur
à fa famille naturelle, & il nous a paru par
l’examen que nous avons fait de Cette plante qu’elle
eft une efpece à’ukakou dont le genre vient naturellement
près du bidens dans la dixième feétion de
la famille des plantes cômpofées, dît rioiis l’aVdns
placé. Voyei nos Famille des plantes, volume I I -,
page 131. ( M. A D A N SO N . )
§ GONARION, ( -Anatomie. ) glande pinéale de$
modernes. Ajoute£ à cet article trop abrégé : Céttè
glandeeft corticale, elle a cependantde la blancheur
d fa bafe ; elle eft placée obliquement de haut en
bas & de deriere eh devant, & recouverte d’un voile
vafculàire -, formé par là pie-mere elle pofe fur les
éminences jumelles antérieures.
Les petits filets médullaires, par lèfqüels cette
glande tient au cerveau, rie font pas toujours aifésà
v o ir , ilsfe terminent à ia ligne blanche des couche^
optiques, & aux couches elles-mêmes : ils font plus
gros dans les quadrupèdes.
Cette glande prétendue èft certainement une petite
appendice du cerveau , elle eft corticale, elle
fournit de la moelle : la glande pituitaire eft unè
autre glande de cette efpece* la moelle qu’elle
produit, eft appellée entonnoir : dans les poiffons là
derniere de ces glandes donne des branches très-vifi-
blès aux nerfs olfaâifV.
Defcartes a cru que la glandé, pinéale feu le,
étoit impaire dans le cerveau ; la pituitaire lui étoit
apparemment inconnue , & il n’a pas penfé au corps
calleux, à la v oûte, aùx^déux commiflùrès.
Elle rie fauroit être lé fiége du principe vita l, elle .
manqué à plufieûrs quadrupèdes, auxoifëaux& à
une partie des poiffons i l’homme , d’autres quadrupèdes
, & d’autres poiffons en font pourvus : unè
partie du corps animal, qui ne fe trouve que dans
une partie des animaux même les plus comportés ;
ne fauroit être regardée comme une organe effentiei
à la vie.
La glande pinéale eft fujette à plufieurs maladies £
elle s’endurcit affez fouvent, & on y trouve de petites
pierres. M. Mekel & M. Gun s’accordent à
remarquer que ces concrétions font fort communes
dans les fous. Elle s’abreuve aufli d’eau & devient
hydropique. ( M. le Baron d e Ha l l e r . )
CONCERT Spirituel , f. m. ( Belles-Lettres.
Poèfîe. ) nous appelions ainfi un fpeôa'Cle où l’on
n’entënd que des fymphonies & que des chants religieux
, & qui dans certains jours confacrés à la
piété , tient lieu des fpettâcles profanes ; il répond à
ce qu’on appelle en Italie oratorio >• mais il s’en faut
bien que la mufique vocale y foit portée au même
dégré de beauté.
Comme ce font lès mufici'ens eux-mêmes qui, fer^
vilement attachés à leur ancienne coutume , prennent
comme au hazard, un des pfeaumes ou des
cantiques, & fans fe donner d’autre liberté que de
l’abréger quelquefois , le mettent en chant tout de
fuite, & le divifent tant bien que mal en récitatif,
en duo & en choeur, il arrive que fur les verfets qui
n’ont point de caraâeres, ils font obligés de mettre
un chant qui ne dit rien, ou dit tout autre chofe;
c’eft ainfi qu’après ce début fi fublime coeli enarrant 9
vient ce v e r fe t, non fu n t loquelce , fur lequel Mon-
donville a mis précifément le babil de deux come-
res ; c’eft ainfi qu’à côté de ces grandes images, à
fa d e domini mot a eft terra * mare vidit & fugit , le
même iriuficien a fait fauter dans une ariette leS
montagnes & les collines , en jouant fur lés mots ,
exultaverunt Jicut arietts, & ficu t agni oviUrn.
L ’on fent combien ce faux goût eft éloigné du
caraâere fimple & majeftueux d’un cantique.
Quel génie & quel art n’a-t-il pas fallu à Per-
golefe pour varier le Stabat ? Encore dans ce morceau
unique tout n’eft-il pas d’une égale beauté ; la
plus belle profe de l’églife | le Dies ira, qui de-
vroit être l’objet de l’émulation de tous les grands
muficiens, auroit befoin lui - meme* d’être abrégé
pour être mis en mufique : les deux cantiques de
Moïfe
Moïfe tout fublimes qu’ils font, demanderoient qu’on-
fît un choix de leurs traits.les plus analogues à l’ex-
preflîon mufieale. Dans tous les pfeaumes de David,-
il n’y en a peut-être pas un qui, d’un bout à l’autre,
foit fufceptible des beautés du chant, & des contraires
qui rendent ces beautés plus fenfibles & plus
frappantes» , ,
Il feroit donc à fôuhaiter d’abord qu on abandonnât
l’ufage de mettre en mufique un pfeaume tel
qu’il fe préfente , & qu’on fe donnât la liberté de
choifir, non - feulement dans un même pfeaume ,
mais dan» tous les pfeaumes, & fi l’on vouloit même,
dans tout le texte des livres faints , des verfets analogues
à une idée principale, & affortis entre eux
pour former Une belle fuite de chants ; ces verfets
pris çà & là & raccordés avec intelligence , compo-
feroîent un riche mélange de fentimens & d’unages,
qui donneroient à la mufique de la couleur & du
cara&ere, & le moyen de varier fes formes & de
difpofer à fon gré l’ordonnance de fes tableaux.
La difficulté fe réduit à vaincre l’habitude & peut^
être l’opinion ; mais pourquoi ne feroit-on pas dans
un motet ce qu’on a fait dans les fermons, dans les
prières'de l’églife , où de divers partages de l’écriture
rapportés à un même objet, on a forme un fens
analogue & fuivi ?
Mais une difficulté plus grande pour le muficien,
c’ eft d’élever fon ame à la Mùteur de celle du prophète,
de fe remplir, s’il eft poflible, du même
efprit qui l’animoit, & de faire parler à la mufique
un langage fublime, un langage divin. C eft là que
tous les charmes de la mélodie , toute la pompe de
la déclamation , toute la puiffance de 1 harmonie,
dans les peintures de tous les genres, doivent fe
déployer avec magnificence : un beau motet doit •
être un ouvrage infpiré, & le muficien qui com-
pofe de jolis chants 6c des choeurs légers fur les paroles
de D avid, me femble profaner fa harpe.
Au lieu du moyen que je propofe, pour former
des chants religieux dignes de leur objet, on a
imaginé en Italie de faire de petits drames pieux,
qui n’étant pas repréfentes, mais feulement exécutés
en concert, font affranchis par là de toutes les
contraintes de la feene : ces drames font en petit
ce que font en grand fur nos théâtres , Athalie,
Efther & Jèphté : on les appelle oratorio ; & Mé-
taftafe en a donné dés modèles admirables, dont
le plus célébré e ft , avec raifon, le facrifice d’Abra-
ham.
On a fait au concert fpirituel de Paris quelques
foibles effais dans ce genre ; mais à prefent que la
mufique va prendre en France un plus grand effor, &
qu’on fait mieux ce qu’elle demande pour être touchante
& fublime , il y a tout lieu de croire qu’elle
fera dans le facré les mêmes progrès que dans le
profane. Voye^ L Y R IQ U E . ,&c. Supplément. ( M.
Ma r m o n Te l . )
§ CONCHES, ( Gèogr. ) petite ville dans le pays
à'Onche ; lifez d'Ouche. Cette ville nommée en latin
Conclia, eft à quatre lieues d’Evreux & treize
de Rouen ; il y a une riche abbaye de Benediétins
fondée au onzième fiecle, un bailliage , vicomté &
éleftion qui comprend cent foixante-deux paroiffes :
on y fait un commerce affez confidérable en grains,
en barres de fe r , clous, jilênes, marmites, pots,
&c. (C.)
CONCHOLEPAS , f. m. ( Hijt. nui. Conchyliog. )
efpece de lépas ou de coquillage uniyalve, ainfi
nommé parce que fa coquille reflèmble en quelque
forte à unè valve de ces peâoncles, ou mieux encore
de ces arches d eN o é , dont le côté voifin du
fommet eft applati ; mais cè qui fait reconnoitre
cette coquille, & ce qui la diftingue des coquilles
bivalves-, c’eft qu’elle n’a point ces denticules qui
Tome II.
fonlient la charnière au bord de ce côté qui eft
applati. Ce coquillage approche beaucoup des or-
miersou oreilles de mer dont il femble faire la liai-
fon avec le genre du lépas. Poye^ ce que nous avons
dit à ce fujet dans notre Hifloire naturelle des coquillages
du Sénégal, publiée en 1757. ( M. A d AN-
so n . )
CONCOMBRE Marin , fi m* ( Hifioirenat. Zoo»
phyte. ) Le livre intitulé Dictionnaire d'Hifloire natu*
relie, dit que cet animal eft un poiffon ; mais ce que
tous les naturaliftes connoiffent fous le nom de
poiffon a du fang, de la chair, des arêtes , &:
comme des membres ou des nageoires ; cet animal
eft à proprement parler un zoophyte , c’eft-à-dire ,
un animal-plante de la famille des holothuries qui
n’ont ni fang coloré, ni arêtes, ni aucuns mem**
bres.
Le nom de concombre marin, cucumis màrinus, que
lui a donné Rondelet, lui vient à caufe de fa forme
.qui repréfente un de ces concombres appellés cornichons
que l’on confit au vinaigre ; cette comparai-
fon toute grofliere qu’elle paroît au premier abord
donne cependant une idée affez jufte de cet animal ;
car il reffemble à une pyramide renverfée , pointue
à fon extrémité inférieure , arrondie en-deffus , relevée
fur toute fa longueur de cinq côtes femées
de tubercules»
Moeurs. Cet animal èft commun fur le rivage dans
la mer Méditerranée, où il refte enfoncé verticalement
jufqu’aux trois quarts. de fa longueur, la
pointe en bas , fes tubercules fervant à le retenir.
Qualités. C’eft encore une erreur que de dire.,
comme l’auteur du diâiônnaire intitulé Dictionnaire
d’Hifloire naturelle, que Cet animal a la couleur &
l’odeur du concombre ; il eft d’un blanc fale tant qu’il
eft vivant, & fon odeur eft faline, fort approchante
de celle des plantes marines qu’on appelle
varoes ou fucus. (M . A d a n s o n . )
§ CONCORDE ( l’Ordre de l a ) , fut inftitué
par Erneft, margrave de Brandebourg en 1660.
Les chevaliers ont une croix d’or à huit pointes
pommetées & émaillées de blanc4 .à chaque angle il
y a deux C , entrelacés en fautoir ; au centre de
cette croix eft une médaille d’o r , émaillée, & deux
rameaux d’o livier adoffés, dont les extrémités fupé-
rieures & inférieures partent dans deux couronnes
aufli d’olivier , avec ce mot à l’entour, concordant ;
une couronne éle&orale fur les deux pointes d’en
haut, & uri ruban orangé ; au revers de la croix eft
le nom du margrave de Brandebourg, & la date
de l’inftitution. Voye£ la pl. X X IV , fig. 21 de P Art
Hérald. Dict. raif. des Sciences, &c. ( G. D . L. T. )
CONCOURS, ( Mufique.') affemblée demuficiens
& de èonnoiffeurs autorifés, dans laquelle une place
vacante de maître de mufique ou d’organifte eft emportée
, à la pluralité des fuffrages, par celui qui a
fait le meilleur motet, ou qui s’eft diftingué par la
^meilleure exécution.
Le concours étoit en ufage autrefois dans la plupart
des cathédrales; mais dans ces tems malheureux
où l’efprit d’intrigue s’eft emparé de tous les états ,
il eft naturel que le concours s’aboliffe inferifible-
ment, & qu’on lui fubftitue des riioyens plus aifés
de donner à la faveur ou à l’intérêt, le prix qu’on
ftoit au talent & au mérite. ( 51)
§ CONDÉ-SUR-ITON , ( Géogt. ) Condati >
Condceum , bourg de Normandie , à fix lieues d’Evreux
, dans le voifinage de Breteuil & de Damville,
donné à l’évêque d’Evreux, par Richard I , roi d’Angleterre
, duc de Normandie, avant de partir pour'
la Terre-Sainte. On croit que ce Condé eft celui que
l’itinéraire d’Antonin marque* entre Noviomagum &
Durocaffes : voici un fait qui honore l’humanité.
Un malheureux , pourfuivi pour paiement de
Y y y
/