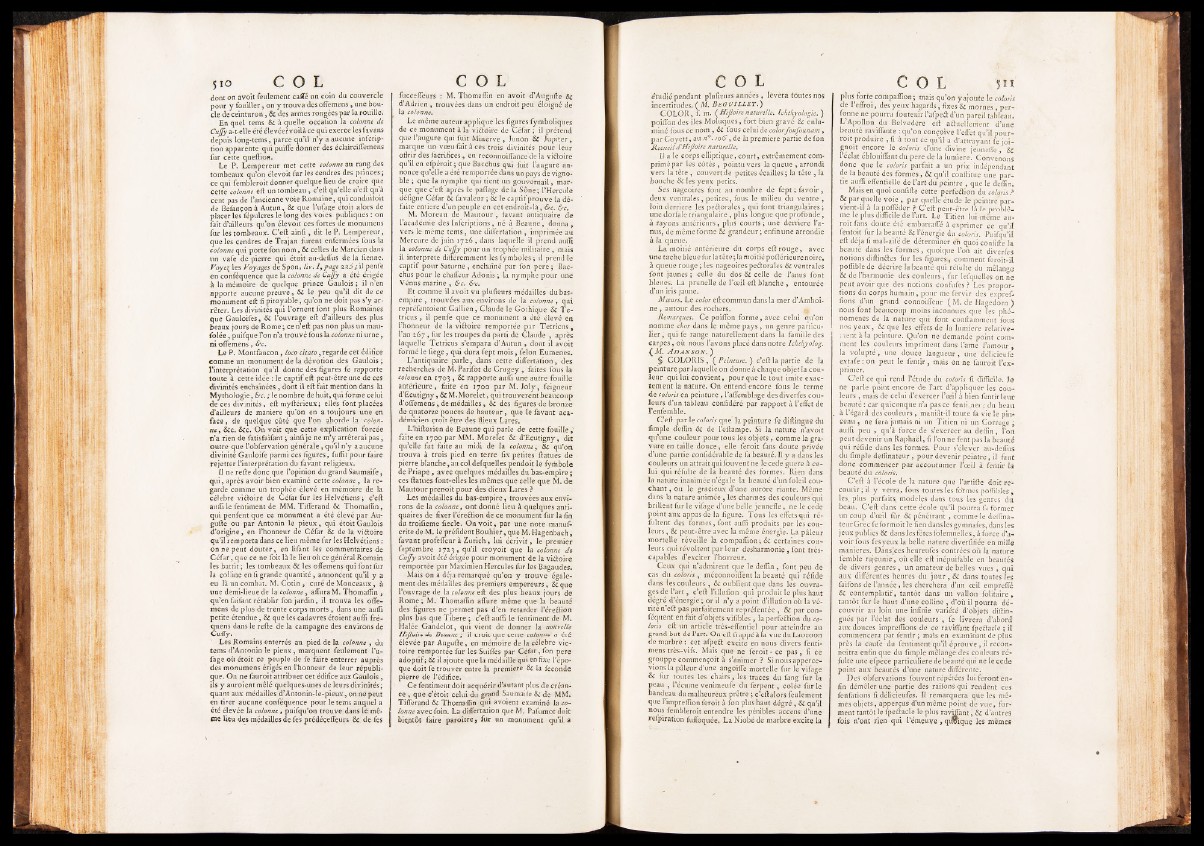
dont on avoit feulement caffé un coin du couvercle
pour y fouiller, on y trouva desoffemens , une boud
e de ceinturon, & des armes rongées par la rouille.
En quel tems & à quelle occaiion la colonne de
Cuffy a-t-elle été élevée? voilà ce qui exerce les favans
depuis long-tems, parce qu’il n’y a aucune infcrip-
tion apparente qui puiffe donner des éclairciffemens
fur cette queftion.
Le P. Lempereur met cette colonne au rang des
tombeaux qu’on élevoit furies cendres des princes;
ce qui fembleroit donner quelque lieu de croire que
cette colonne eft un tombeau, c’eft qu’elle n’eft qu’à
cent pas de l’ancienne voie Romaine, qui conduisit
de Befançon à Autun, 6c que l’ufage étoit alors de
placer les fépulcres le long des voies publiques : on
fait d’ailleurs qu’on élevoit ces fortes de monumens
fur les tombeaux. C’eft ainfi, dit le P. Lempereur,
que les cendres de Trajan furent enfermées fous la
colonne qui porte fon nom, 6c celles de Marcien dans
un vafe de pierre qui étoit au-deffus de la tienne.
Voye\_ les Voyages de Spon, liv. I , page 22J; il penfe
en conféquence que la colonne de Cuffy a été érigée
à la mémoire de quelque prince Gaulois ; il n’en
apporte aucune preuve, 6c le peu qu’il dit de ce
monument eft fi pitoyable ', qu’on ne doit pas s’y arrêter.
Les divinités qui l’ornent font plus Romaines
que Gauloifes, 6c l’ouvrage eft d’ailleurs des plus
beaux jours de Rome ; ce n’eft pas non plus un mau-
folé e , puifque l’on n’a trouvé fous la Colonne ni urne,
ni offemens, &c.
Le P. Montfaucon, loco citato, regarde cet édifice
comme un monument de la dévotion des Gaulois ;
l ’interprétation qu’il donne des figures fe rapporte
toute à cette idée : le captif eft peut-être une de ces
divinités enchaînées , dont il eft fait mention dans la
Mythologie, &c. ; le nombre de huit, qui forme celui
de ces divinités, eft myftérieux ; elles font placées
d’ailleurs de maniéré qu’on en a toujours une en
fa ce , de quelque côté que l’on aborde la colonne
y 6cc. 6cc. On voit que cette explication forcée
n’a rien de fatisfaifant ; ainfi je ne m’y arrêterai pas,
outre que l’obfervation générale, qu’il n’y a aucune
divinité Gauloife parmi ces figures, fuffit pour faire
rejetter l’interprétation du favant religieux.
II ne refte donc que l’opinion du grand Saumaife,
qui, après avoir bien examine cette colonne , la regarde
comme un trophée élevé en mémoire de la
célébré viâoire de Céfar fur les Helvétiens ; c’eft
aufli le fentiment de MM. Tifferand 6c Thomaflin,
qui penfent que ce monument a été élevé par Au-
gufte ou par Antonin le pieux, qui étoit Gaulois
d’origine, en l’honneur de Céfar 6c de la victoire
qu’il remporta dans ce lieu même fur les Helvétiens :
on ne peut douter, en lifant les commentaires de
Céfar, que ce ne foit là le lieu oit ce. général Romain
les battit; les tombeaux 8c les offemens qui font fur
la colline en fi grande quantité, annoncent qu’il y a
eu là un combat. M. Cotin , curé de Monceaux, à
une demi-lieue de la colonne , affuraM. Thomaflin ,
qu’en faifant rétablir fon jardin, il trouva les offemens
de plus de trente corps morts , dans une aufli
petite étendue, 6c que les cadavres étoient aufli fré-
quens dans le refte de la campagne des environs de
Cuffy.
' Les Romains enterrés au pied de la colonne , du
tems d’Antônin le pieux, marquent feulement l’u-
fage oit étoit ce peuple de fe faire enterrer auprès
des monumens érigés en l’honneur de leur république.
On ne fauroit attribuer cet édifice aux Gaulois,
ils y auroientmêlé quelques-unes de leurs divinités;
quant aux médailles d’Antonin-le-pieux, on ne peut
en tirer aucune conféquence pour le tems auquel a
été élevée la colonne, puifqu’on trouve dans lé même
lieu des médailles de fes prédéceffeurs 6c de fes
fucceffeurs : M. Thomaflin en avoit d’Augufte 8c
d’Adrien , trouvées dans un endroit peu éloigné de
la colonne;
Le même auteur applique les figures fymboliqües
de ce monument à la vi&ôire de Céfar ; il prétend
que l’augure qui fuit Minerve, Junon 6c Jupiter,
marque un voeu fait à ces trois divinités pour leur
offrir des facrifices, en reconnoiffance'de la vi&oire
qu’il en efpéroit ; que Bacchus qui fuit l’augure annonce
qu’elle a été remportée dans un pays de vignoble
; que la nymphe qui tient un gouvernail, marque
que c’eft après le paffage de la Sône; l’Hercule
défigne Céfar 8c fa valeur ; 6c le captif prouve la défaite
entière d’un peuple en cet endroit-là, &c. &c.
M. Moreau de Mautour , lavant antiquaire de
l’académie des Infcriptions, né à Beaune, donna ,
vers le même tems, une differtation , imprimée au
Mercure de juin 1726 , dans laquelle il prend aufli
la colonne de CuJJy pour un trophée militaire , mais
il interprète différemment les fymboles ; il prend le
captif pour Saturne , enchaîné par fon pere ; Bacchus
pour le chaffeur Adonis ; la nymphe pour une
Vénus marine , &c. &c.
Et comme il avoit vu plufieurs médailles du bas-
empire , trouvées aux environs de la colonne , qui
repréfentoient Gallien, Claude le Gothique 8c Te-
tricus, il penfe que ce monument a été élevé en
l’honneur de la vittoire remportée par Tetricus,
l’an 267, fur les troupes du parti de Claude , après
laquelle Tetricus s’empara d’Autun , dont il avoit
formé le fiege, qui dura fept mois, félon Eumenes.
L’antiquaire parle, dans cette diflèrtation, des
recherches de M. Parifot de Crugey , faites fous la
colonne en 1 7 0 3 ,8c rapporte aufli une autre fouille
antérieure, faite en 1700 par M. Jo ly, feigneur
d’Ecutigny, 8c M.Morelet, qui trouvèrent beaucoup
d’offemens, de médailles, 8c des figures de bronze
de quatorze pouces de hauteur, que le favant académicien
croît être des dieux Lares.
L’hiftorien de Beaune qui parle de cette fouille
faite en 1700 par MM. Morelet 8c d’Ecutigny, dit
qu’elle fut faite au midi de la colonne, 8c qu’on
trouva à trois pied en terre fîx petites ftatues de
pierre blanche, au col defquelles pendoit le fyihbole
de Priape, avec quelques médailles du bas-empire ;
ces ftatues font-elles les mêmes que celle que M. de
Mautour prenoit pour des dieux Lares ?
Les médailles du bas-empire, trouvées aux environs
de la colonne, ont donné lieu à quelques antiquaires
de fixer l’éreâion de ce monument fur la fin
du troifieme fiecle. On v o it , par une note manuf*
crite de M. le préfident Bouhier, que M. Hagenbach ,
favant profeffeur à Zurich, lui écrivit, le premier
feptembre 1723, qu’il croyoit que la colonne de
Cuffy avoit été érigée pour monument de la vi&oire
remportée par Maximien Hercules fur les Bagaudes.
Mais on a déjà remarqué qu’on y trouve également
des médailles des premiers empereurs, 6c que
l’ouvrage de la colonne eft des plus beaux jours de
Rome; M. Thomaflin affure même que la beauté
des figures ne permet pas d’en retarder l’éreâion
plus bas que Tib.ere ; c’eft aufli le fentiment de M.
Halée Gandelot, qui vient de donner la nouvelle
Hfioire de Beaune ; il croit que cette colonne a été
élevée par Augufte, en mémoire de la célébré victoire
remportée fur les Suiffes par Céfar, fon pere
adoptif; 6c il ajoute que la médaille qui en fixe l’époque
doit fe trouver entre la première 6c la fécondé
pierre de l’édifice.
Ce fentiment doit acquérir d’autant plus de créance
, que c’étoit celui du grand Saumaile 6c de MM.
Tifferand 6c Thomaflin qui avoient examiné la colonne
avec foin. La differtation que M. Pafumot doit
bientôt faire paroître, fur un monument qu’il, a
étudié pendant plufieurs années, lèvera toutes nos
incertitudes. ( M. Be g u il l e t .')
COLOR , f. m. {Hifioirenaturelle. Ichthyologie. )
poiffon des îles Moluques, fort bien gravé 6c enluminé
fous ce nom , 6c fous celui de colorfoufounam,
par C oyett, au n°. /oé', de la première partie de fon
Recueil d?Hifioire naturelle.
Il a le corps elliptique, court, extrêmement comprimé
par les côtés , pointu vers la queue , arrondi
vers la tête , couvert de petites écailles; la tête , la
bouche 6c les yeux petits.
Ses nageoires font au nombre de fept ; favoir ,
deux ventrales, petites, fous le milieu du ventre ,
loin derrière les pectorales , qui font triangulaires ;
line dorfale triangulaire, plus longue que profonde,
à rayons antérieurs, plus courts ; une derrière l’anus,
de même forme 6c grandeur; enfin une arrondie
à la queue.
La moitié antérieure du corps eft rouge, avec
une tache bîeuefur la tête; la moitié poftérieurenoire,
à queue rouge ; les nageoires peétorales 6c ventrales
font jaunes ; celle du dos 8c celle de l’anus font
bleues. La prunelle de l ’oeil eft blanche, entourée
d’un iris jaune.
Moeurs. Le color eft commun dans la mer d’Amboi-
n e , autour des rochers.
Remarques. Ce poiffon forme, avec celui qu’on
nomme ekor dans le même pays, un genre particulier,
qui fe range naturellement dans la famille des
carpes, oii nous l’avons placé dans notre Ichthyolog.
( M. A d a n s o n . )
§ COLORIS , ( Peinture. ) c’eft la partie de la
peinture par laquelle on donne à chaque objet la couleur
qui lui convient, pour que le tout imite exactement
la nature. On entend encore fous le terme
de coloris en peinture, l ’affemblage desdiverfes couleurs
d’un tableau confidéré par rapport à l’effet de
l’enfemble.
C’eft par le coloris que la peinture fe diftingue du
fimple deflin 8c de l’eftampe. Si la nature n’avoit
qu’une couleur pour tous les objets, comme la gravure
en taille douce, elle feroit fans doute privée
d’une partie confidérable de fa beauté. II y a dans les
couleurs un attrait qui fouvent ne lecede guere à celui
qui réfiilte de la beauté des formes. Rien dans
la nature inanimée n’égale la beauté d’un foleil couchant
, ou le gracieux d’une aurore riante. Même
dans la nature animée , les charmes des couleurs qui
brillent fur le vifage d’une belle jeuneffe, ne le cede
point aux appas de la figure. Tous les effets qui ré-
fultent des formes, font aufli produits par les couleurs,
6c peut-être avec la même énergie. La pâleur
mortelle réveille la compaflion; 8c certaines couleurs
qui révoltent par leur desharmonie, font très-
capables d’exciter l’horreur.
Ceux qui n’admirent que le deflin, font peu de
cas du coloris , méconnoiffent la beauté qui réflde
dans les couleurs , 6c oublient que dans les xouvra-
ges de l’a r t, c’eft l’illufion qui produit le plus haut
degré d’énergie ; or il n’y a point d’illufion où la vérité
n’eft pas parfaitement repréfentée , 6c par con-
féquent en fait d’objets vifibles , la perfettion du coloris
eft un article très-effentiel pour atteindre au
grand but de l’art. On eft frappé à la vue du Laocoon
de marbre : cet afpeft excite en nous divers fenti-
mens tres-vifs. Mais que ne feroit - ce pas , fi ce
grouppe commençoit à s’animer ? Si nousapperce-
vions la pâleur d’une angoiffe mortelle fur le vifage
6c fur toutes les chairs, les traces du fang fur la
peau , l’écume venimeufe du ferpent, colée fur le
bandeau du malheureux prêtre ; c ’eft alors feulement
que l’imprefîion feroit à fon plus haut dégré , 6c qu’il
nous fembleroit entendre les pénibles accens d’une
refpiration fuffoquée. La Niobé de marbre excite la
plus forte cômpaflion; mais qu’on y ajoute le coloris
de l ’effroi, des yeux hagards, fixes 6c mornes , per-
fonne ne pourra foutenir l’afpeftd’un pareil tableau.
L’Apollon du Belvedere eft aauellement d’une
beauté raviffante : qu’on conçoive l’effet qu’il pour-
roit produire ,f i à tout ce qu’il a d’attrayant fe joig
n i t encore le coloris d’une divine jeuneffe, 8C
l’éclat éblouiffant du pere de la lumière. Convenons
donc que le coloris parfait a un prix indépendant
de la beauté des formes, 6c qu’il conftitue une partie
aufli effentielle de l’art du peintre , que le deffim
Mais en quoi confifte cette perfeâion du colàris ï
6c par quelle voie , par quelle étude le peintre parvient
il à la pofféder ? C ’eft peut-être là le problème
le plus difficile de l’art. Le Titien lui-même au-
roit fans doute été embarraffé à exprimer ce qu’il
fentoit fur la beauté 6c l’énergie du coloris. Puifqu’il
eft déjà fi mal-aifé de déterminer eh quoi confifte la
beauté dans les formes, quoique l’on ait diverfes
notions diftin&es fur les figures,,; comment feroit-il
poflible de décrire la beauté qui réfulte du mélange
6c de l’harmonie des couleurs, fur lefquelles on ne
peut avoir que des notions confufes ? Les proportions
du corps humain, pour me fervir des expref-
fions d’un grand connoiffeur ( M. de Hagedorn )
nous font beaucoup moins inconnues que les phénomènes
de la nature qui font conftamment fous
nos yeux, 8cqueTes effets de la lumière relative-
; vent à la peinture. Qu’on ne demande point comment
les couleurs impriment dans l’ame l’amour ,
la volupté, une douce langueur, une délicieufe
extafe : on peut le fentir, mais on ne fauroit l’exprimer.
C ’eft ce qui rend l’étude du coloris fi difficile. Je
ne parle point encore de l’art d’appliquer les couleurs
, mais de celui d’exercer l’oeil à bien fentir leur
beauté : car quiconque n’a pas ce fenti nerç du béait
à l’égard des couleurs , maniât-il toute fa vie le pinceau,
ne fera jamais ni un Titien ni un Correge ;
aufli peu , qu’à force de s’exercer au deflin, l’otl
peut devenir un Raphaël, fi l’on ne fent pas la beauté
qui réfide dans les formes. Pour s’élever au-deffus
du fimple deflinateur, pour devenir peintre, il faut
donc commencer par accoutumer l’oeil à fentir la
beauté du coloris.
C’eft à l’école de la nature que l’artifte doit recourir;
il y verra, fous toutes les foYmes poflibles j
lesv plus parfait^ modèles dans tous les genres du
beau. C ’eft dans cette école qu’il pourra fe former
un coup d’oeil fur & pénétrant , comme le deflinateur
Grec feformoit le fien dans les gymnafes, dans les
jeux publics & dans les fêtes folemnelles, à force d’avoir
fous fes yeux la belle nature diverfifiée en mille
maniérés. Dansjces heureufes contrées où la nature
femble rajeunie, où elle eft inépuifable en beautés
de divers genres , un amateur de belles vues , qui
aux différentes heures du jo u r , & dans toutes les
faifons de l’année, les cherchera d’un oeil empreffé
& contemplatif, tantôt dans un vallon fôlitaire ,
tantôt fur le haut d’une colline , d’où il pourra découvrir
au loin une infinie variété d’objets diflin-
gués par l’éclat des couleurs , fe livrera d’abord
aux douces impreflions de ce raviffant fpeûacle ; il
commencera par fentir ; mais en examinant de plus
près la caufe du fentiment qu’il éprouve, il recon-
noîtra enfin que du fimple mélange des couleurs réfulte
une efpece particulière de beauté qui ne le cede
point aux beautés d’une nature différente.
Des obfervations fouvent répétées lui feront enfin
démêler une partie des raifons qui rendent ces
fenfations fi délicieufes. II remarquera que les mêmes
objets, apperçus d’un même point de vue, forment
tantôt le fpeûacle le plus raviffant“ & d’autres
fois n’ont rien qui l’émeuve, qiroique les mêmes