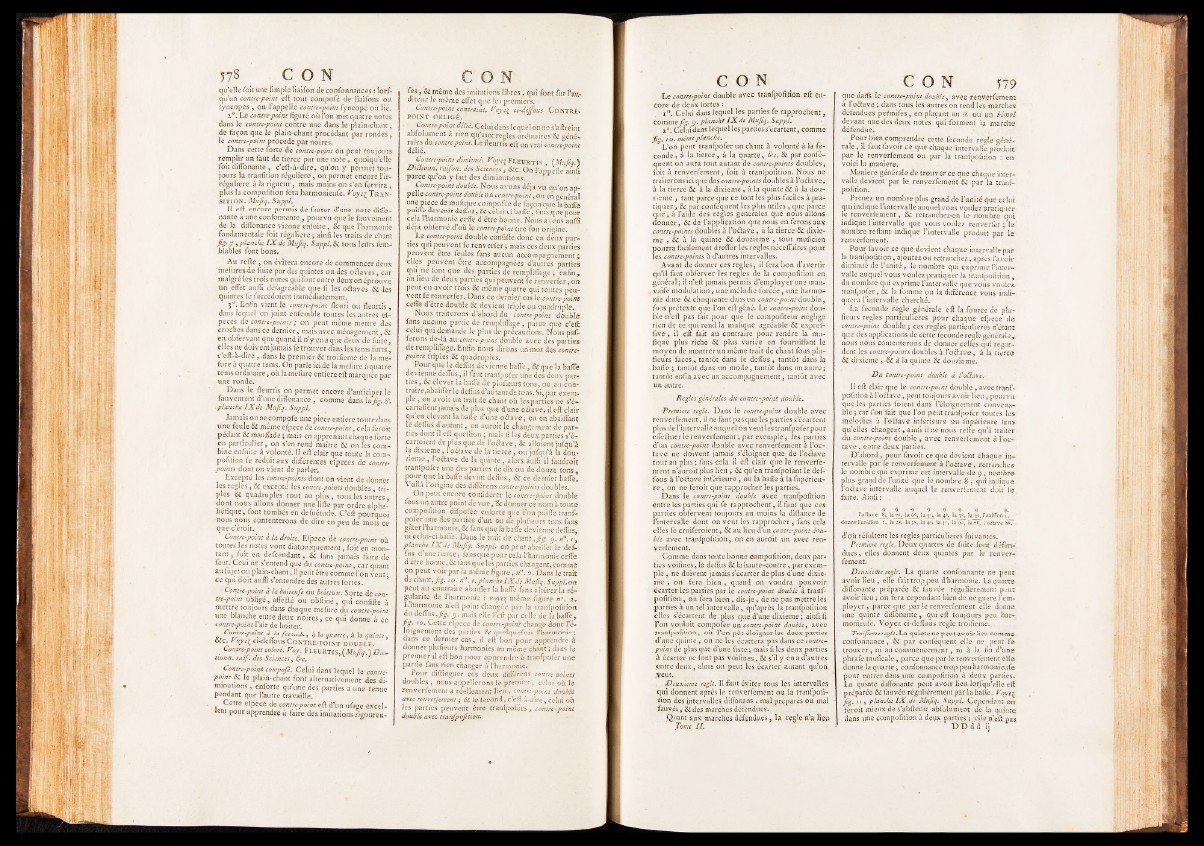
qu’elle fojt une firiïple lialfon de confonnances : lorsqu'un
contre-point eft tout compofé de liaifons ou
fyncopes , on l’appelle contre-point Syncopé ou lié.
2°. Le contre-point figuré où l’on met quatre notes
dans le contre-point contre une dans le plain-chant,
de façon que le plain-chant procédant par rondes,
le contre-point procédé par noires.
Dans cette forte de contre-point oh peut toujours
remplir un faut de tierce par une note, quoiqu’elle
foit diffonante, c’eft-à-dire, qu’on y permet toujours
la tranfition régulière , on permet encore mm
régulière- à la rigueur, mais moins on s’en Servira,
plus la composition fera harmonieufe. Voye^ Transition.
Mujîq. Suppl.
Il eft encore permis de fautér d’une note diffo-
nante à une confonnante , pourvu que le fauvement
de la diffonance vienne enfuite, & que l’harmonie
fondamentale foit régulière ; ainfi les traits de chant
■ fig. y , planche I X de Mujîq. Suppl. & tous leilrs Semblables
Sont bons.
Au refte , on évitera encore de commencer deux
mefures de Suite par des quintes ou des odlaves, car
malgré les trois notes qui font entre deux on éprouve
un effet aufli défagréable que li les odlaves & -les
quintes Se fuccédoient immédiatement.
30. Enfin vient le contre-point fleuri Ou fleurtis ,
dans lequel ôn joint enfemble toutes les autres ef-
peces de contre-points ; on peut même mettre des
croches dans ce dernier, mais avec ménagement, &
en obfervant que quand il n’y en a que deux de Suite,
elles ne doivent jamais Se trouver dans les tems forts,
c’eft-à-dire, dans le premier & troifieme de la me-
fure à quatre tems. On parle ici de la mefure à quatre
tems ordinaire, où la mefure entière eft marquée par
une ronde.
Dans le fleurtis on permet encore d’anticiper le
fauvement d’une diffonance , comme dans la fia. 8'.
.planche IX d e Mujîq. Suppl.
Jamais on ne compofe une piece entière toute dans
une feule & meme efpece de contre-point, cela Seroit
pédant & mauffade ; mais en apprenant chaque forte
en particulier, on s’en rend maître & on les combine
enfuite à volonté. Il eft clair que toute la composition
Se réduit aux différentes efpeces de contrepoints
dont on vient de parler.
Excepté les contre-points dont on vient de donner
les réglés, & excepté les contre-points doubles , triples
& quadruples tout au plus , tous les autres ,
dont nous allons donner une lifte par ordre alphabétique,
font tombés en defuétude. C’eft pourquoi
nous nous contenterons de dire en peu de mots ce
que c’étoit.
Contre-point à la droite. Efpece de côntre-point où
toutes les notes vont diatoniquement, foit en montant
, Soit en defeendant, & fans jamais faire de
faut. Ceci ne s entend que du contre-point, car quant
au Sujet ou plain-chant, il peut être comme l’on veut ;
ce qui doit aufli s’entendre des autres fortes.
Contre-point à la boiteufe ou boiteux. Sorte de contre
point obligé, affeclé ou obftiné, qui confifte à
mettre toujours dans chaque mefure du contre-point
une blanche entre deux noires, ce qui donne à ce
contre-point 1 air de boiter.
Contre-point à la fécondé, à la quarte, à la quinte,
occ. royc{ ci-deflous C ontre-point d ouble.
Contre-point coloré, Koy. Fleurtis, CMufiq.XDie-
tionn.raif. des Sciences, &c.
Contre-point compofé. Celui dans lequel le contre-
point & le plain-chant font alternativement des diminutions
, enforté ja ’iine des parties a une tenue
pendant que l’autre travaille.
Cette efpece de contre-point eft d’un nfape excellent
pour apprendre à faire des imitations rigoureu-
Ses, & même des imitations libres, qui font fur ^auditeur
le même effet que les premiers.
Contre-point contraint. Voye^ ci-deffbus CONTREPOINT
OBLIGÉ.
Contrepoint délié. Celui dans lequel on ne s’âftreint
absolument à rien qu’aux réglés ordinaires & géné-
rales du contre-point. Le fleurtis eft un vrai contre-point
délié.
Contre-point diminué. Voye^ Fleurtis , (Mufiq.)
Diclionn. raifon. des Sciences, tkc. On l’appelle ainfi
parce qu’on y fait des diminutions.
Contre-point double. Nous avons déjà vu qu’on appelle
contre-point double un contre-point, ou en général
une piece de mufique compofée de façon que labafle
puiffe devenir deflus, & celui-ci baffe, fans que pour
cela l’harmonie ceflé d’être bonne. Nous avons aufli
déjà obferve d’où le contre-point tire fon origine.
Le contre-point double confifte donc en deux parties
qui peuvent fe renverfer ; mais ces deux parties
peuvent être feules fans aucun accompagnement;
elles peuvent être accompagnées d’autres parties
qui ne font que des parties de rempliflage ; enfin ,
au lieu de deux parties qui peuvent fe renverfer, on
peut en avoir trois & même quatre qui toutes peu-
ventfe renverfer. Dans ce dernier cas le contre-point
celle d’être double & devient triple ou quadruple.
Nous traiterons d abord-du contre-point double
fans aucune partie de rempliflage, parce que c’eft
celui qui demande le plus de précautions. Nous paf-
ferons de-là au contre-point double avec des parties
de rempliflage. Enfin nous dirons un mot des contrepoints
triples & quadruples.
Pour que le deflus devienne baffe, & que la baffe
devienne deflus, il faut tranfpofer une des deux parties
, & elever la baffe de plufleurs tons, ou.au contraire,
abaifler le deflus d’au'tant de tons. Si, par exemple
, on avoit un trait de chant où les parties ne s’é-
cartaffent jamais de plus que d’une odlave, il eft clair
qu en élevant la baffe d’une odlave, ou en abaiflant
le deffus d’autant, on auroit le changement de parties
dont il eft queftion ; mais fi les deux parties s’é-
caftoient de plus que de l’odlave, & alloient jufqu’à
la dixième, l’odlave de la tierce, ou jufqu’à la dou-
zieme f l’odlave de la quinte, alors aufli il faudroit
tranfpofer une des parties de dix ou de douze tons ,
pour que la baffe devint deffus, & ce dernier baffe.
Voilà 1 origine des différens contre-points doubles.
On.peut encore confidérer le contre-point double
fous un autre point de vue donner ce nom à toute
compofition difpofée enforte que l’on puiffe tranf-
pofer une des parties d’un Ou de plufieurs tons fans
gaterl harmonie, & fans que la bafle devienne deffus,
ni celui-ci baffe. Dans le trait de chant ,fig. g . n°. 1 9
planche IX d e Mujîq. Suppl, on peut abaifler le deffus
d’une tierce, fans que pour cela l’harmonie cefle
d etre bonne, & fans que les parties changent, comme
on peut voir par la même figure, n°. 2. Dans le trait
de chant, fig. /o. n ° . t . planche IX d e Mujîq. Suppl,on.
peut au contraire abaifler la baffe fans altérer la régularité'
de l’harmonie : voye{ même figure n°. 2 .
L harmonie n’eft point changée par la tranfpofition
du deffus,fig.c>. mais elle l’eft par celle de la baffe,
fig. 10. Cette éfpece de contre-point change donc l’éloignement
des parties & quelquefois l’harmonie;
dans ce dernier cas, il eft bon pour apprendre à
donner plufieurs harmonies au même chant ; dans le
premier il eft bon pour apprendre à tranfpofer une
partie fans rien changer à l’harmonie.
Pour difti nguer cés deux différens contre-points
doubles , nous appellerons le premier, celui où le
renverfement a réellement lieu , contre-point double
avec renverfement ; & le fécond, c’eft à-dire, celui oh
les parties peuvent être tranfpofées, contre-point
double avec tranfpojition.
Le contre-point double avec tranfpofition eft. en-
core de deux fortes :
i° . Celui dans lequel les parties fe rapprochent,
comme fig-S- planche I X de Mujîq. Suppl.
20. Celui dans lequel les parties s’écartent, comme
fia. 10. même planche.
L’on peut tranfpofer un chant à volonté à la fécondé
, à la tierce, à la quarte, &c. & par confé-
querit on aura tout autant de contre-points doubles,
foit à renverfement, foit à tranfpofition. Nous ne
traiterpns ici que des contre-points doubles à l’odlave,
à la tierce & à la dixième, à la quinte & à la douzième
, tant parce que ce font les plus faciles à pratiquer
, & par conféquent les plus utiles , que parce
qu e , à l’aide des regies générales que nous allons
donner, & de l’application que nous en ferons aux
contre-points doubles à l’odlave, à la tierce & dixième
, & à la quinte & douzième , tout muficien
pourra facilement dreffer les regies néceffaires pour
les contre-points à d’autres intervalles.
Avant de donner ces regies-, il fera bon d’avertir
qu’il faut obferver les regies de la compofition en
général; il n’eft jamais permis d’employer une mau-
.vaife modulation, une mélodie forcée, une harmonie
dure & choquante dans un contre-point double,
fous prétexte que l’on eft gêné. Le contre-point double
n’eft pas fait .pour que le compofiteur néglige
rien dç ce qui rend la mufique agréable & expref-
f iv e , il eft fait au contraire pour rendre la mufique
plus riche & plus variée en fourniffant le
moyen de montrer un même trait de chant fous plufieurs
faces , tantôt dans le deffus , tantôt dans la
baffe ; tantôt dans un mode, tantôt dans un autre;
tantôt enfin avec un accompagnement, tantôt avec
un autre.
Regies générales du contre-point double.
Première regie. Dans le contre-point double avec
renverfement, il ne faut pas que les parties s’écartent
plus de l'intervalle auquel on veut les tranfpofer pour
effedluer le renverfement ; par exemple, les parties
d’un contre-point double avec renverfement à l’octave
ne doivent jamais s’éloigner que de l’odlave
tout au plus ; fans cela il èft clair que le renverfe-
ment n’auroit plus lieu , & qu’en tranfpôfant le def-
fous à l’odlave inférieure , ou la baffe à la fupérieu-
r e , on ne feroit que rapprocher les parties..
Dans le contre-point double avec tranfpofition
entre les parties qui fe rapprochent, il faut que ces
parties obfervent toujours au.moins la diftance de
l’intervalle dont on veut les rapprocher, fans cela
elles fe croiferoient, & au lieu d’un contre-point double
avec tranfpofitionr, on en auroit un avec renverfement.
Comme, dans toute bonne tfompofition, deux parties
voilines, le deffus & la haute-contre, par exemple
, ne doivent jamais s’écarter de plus d’une dixième
, on fera bien , quand on voudra pouvoir,
écarter les parties par le contre-point double à tranfpofition
, on fera bien , dis-je, de ne pas mettre les
parties à un tel intervalle, qu’après la tranfpofition
elles s’écartent de plus que d’une dixième ; ainfi fi
l’on vouloit compofer un contre-point double, avec
tranfpofition, où l’on put éloigner les deux parties
d’une quinte, on ne les écartera pas dans ce contrepoint
de plus que d’une fixte ; mais fi les deux parties
à écarter ne font pas voifines, & s’il y en a d’autres
entre deux, alors on peut les écarter autant qu’on
.veut.
Deuxieme regie. Il faut éviter tous les intervalles
qui donnent après le renverfement ou la tranfpofi-
tion des intervalles diffonans , mal préparés ou mal
fauves, & des marches défendues.
Quant aux marches défendues, la regie n’a lieu
Tome II,
que darifc le contre-point double^ avec renverfement
à l’odlave ; dans tous les autres on rend les marches
défendues pefmifes, en plaçant un ou un. bémol
devant une des deux notes qui forment la marche
défendue.
Pour bien comprendre cette fécondé réglé générale
, il faut favoir ce que chaque intervalle produit
par le renverfement ou par la tranfpofition :. en
voici la pianjere.
Maniéré générale de trouver ce que chaque intervalle
devient par le renverfement & par la tranfpofition.
Prenez un nombre plus grand de l’unité que celui
qui indique l’intervalle auquel vous voulez pratiquer
le renverfement, & retranchez-en le nombre qui
indique l’intervalle que vous voulez renverfer ; le '
nombre reliant indique l’intervalle produit par le
renverfement.
Pour favoir ce que devient chaque intervalle par
la tranfpofitiop, ajoutez ou retranchez;, après l’avoir
diminué de l’unité, le nombre qui exprime l’intervalle
auquel*vous voulez pratiquer la tranfpofition,
du nombre qui exprime l’intervalle que vous voulez
tranfpofer, & la fomme ou la différence vous indiquera
l’intervalle cherché.
La fécondé réglé générale eft la foiirce dé plufieurs
réglés particulières pour chaque efpece de
: contre-point double ; ces réglés particulières n’étant
que des applications de cette fécondé réglé générale,
nous nous contenterons de donner celles qui regardent
les contre-points doubles à l’odlave, à la tierce
& dixième, & à la quinte & douzième.
D u contre-point double à C octave.
Il eft clair que le contre-point double , avec tranfpofition
à l’oèlave, peut toujours avoir lieu, pourvu
que les parties foient dans l’éloignement convenable
; car l’on fait que l’on peut tranfpofer toutes les
mélodies à l’oèlave inférieure ou fupérieure fans
qu’elles changent, ainfi il ne nous refte qu’à traiter
du contre-point double , avec renverfement à l’octave
, entre deux parties.
D’abord , pour favoir ce que devient chaque intervalle
par le renverfement à l’oélave, retranchez
le nombre qui exprime cet intervalle de 9, nombre»
plus grand de l’unité que le nombre 8 , qui indique
l'octave intervalle auquel le renverfement doit fe
faire. Ainfi : .
„ ' 9 9. 9 9 9 1 ,9 9 9; ’ I o£taye 8, la 7e, la 6ç, la 5 e, la 4e, la 3«), la ae, l’umffon 1.- '
donne l’uaiffon i, la 2e, la 3e,. la 4s la 5e, la 6c, la7«, l’odlave 8»T
d’où réfultent les réglés particulières fuivantes.
Première réglé. Deux quartes de fuite font défendues,
elles donnent déux quintes- par le renver-'
fement.
Deuxieme réglé. La quarte confonnante ne peut
. avoir lieu, elle fait trop peu d’harmonie. La quarte
diffonante préparée & fauvée régulièrement peut
avoir lieu ; ôn fera cependant bien de ne guere l’employer
, parce que par le renverfement elle donne,
une quinte diffonante, qui eft toujours-peu har-
monieùfe. Voyez ci-deffous réglé troifieme. .
Troifieme réglé. La quinte ne peut avoir lieu comme
confonnance, & par conféquent elle ne peut fe
trouver, ni au commencement, ni à la fin d’une
phrafe muficale , parce que par le renverfement elle
donne la quarte ; confonnance trop peu harmonieufe
pour entrer dans une compofition à deux parties.
La quinte diffonante peut avoir lieu Ior/qu’elle eft
préparée & fauvée régulièrement par la,baffe. Poye^
fig. 1 1 , planche I X de Mujîq. Suppl. Çepjendant on
feroit mieux de s’abftenir abfoluniept. de la quinte
dans une compofition à de\ix parties'; .elle n’eft pas
J D D d d ij ”