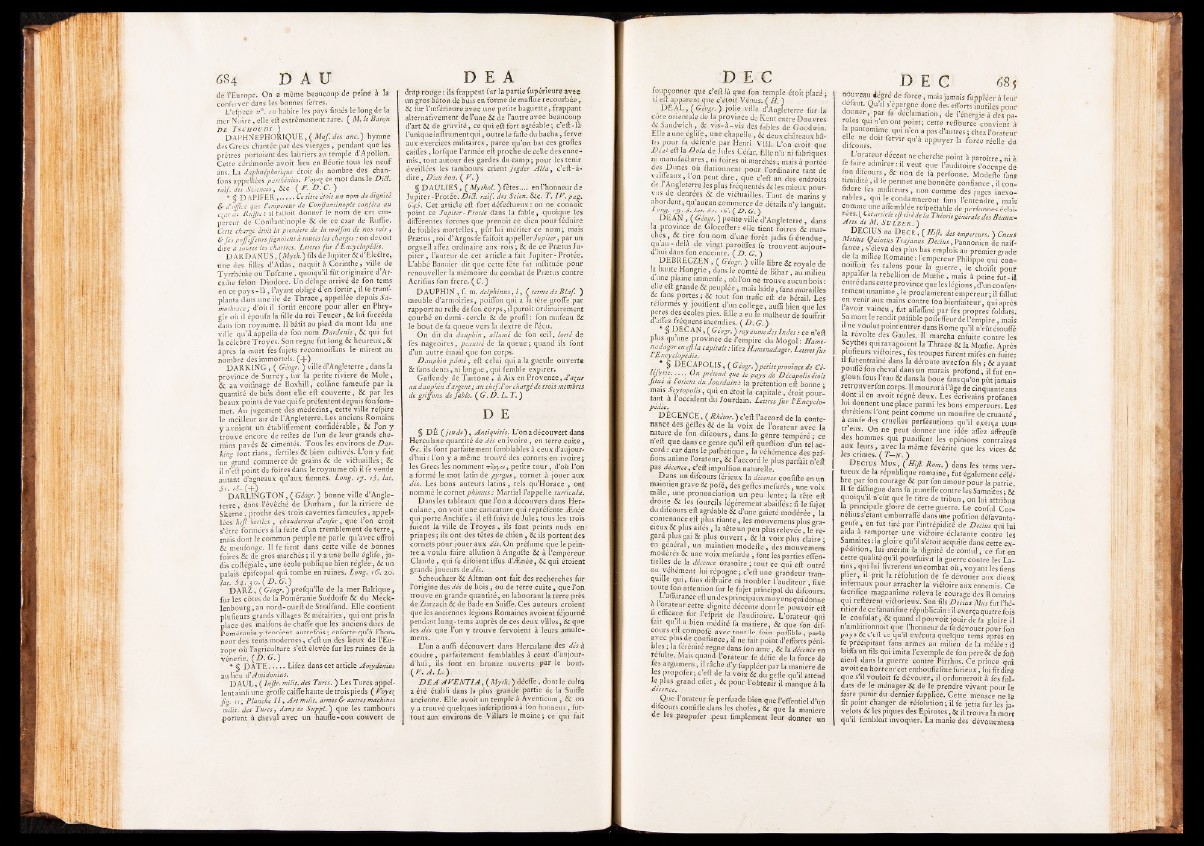
de l’Europe. On a même beaucoup dé peiné à la
conferver dans' les bonnes ferres.
L’efpecè n°. 10 habite les pays fitués le long de la
mer N oire, elle eft extrêmement rarè. ( M. le Baron
DE T s CHOÜDI. )
DAPHNÉPHORIQUE, ( Muf des anc.) hymne
des Grecs chàntêe par des vierges, pendant que les
prêtres portoiént des laliriers au temple d’Apollon.
Cette cérémonie avoit lieu en Beotie tous les neuf
ans. La daphnépkorique étoit du nombre des chan-
fons appellées parthènies. Voyeç ce mot dans le Dicl.
ràif. des Sciences, &c. ( F • D . C. ) . . . ,
* ^ £)a PIFER , .......Ce titre étoit un nom de dignité
& d'office que L'empereur de Conjlantinople conféra au
czardt Rujfte : il falloit donner le nom de cet empereur
de C.onftantinople & de ce czar de Ruffie.
Cette charte étoit La première de la maifôn de nos rois ,
&fes poffeffeursJignoient à toutes les charges : on devoit
dire à toutes les chartres. Lettres fur VEncyclopédie.
DA RD A NUS, (Myth.) fils de Jupiter & d ’£le£lre,
une des filles d’Atlas, naquit à Corinthe, ville de
Tyrrhénie pii T ofcane, quoiqu’il fut originaire d’Arcadie
félon Diodbre. Un déluge arrivé de fon tems
en ce p a y s - là , l’ayant obligé d’en fortir, il fe tranl-
planta dans une île de Thrace, appellée depuis Sa-
mothrace; d’oii il fortit encore pour aller en Phry-
cie 011 il épôufa la fille du roi Teucer, & lui fuccéda
dans fon royaume. Il bâtit au pied du mont Ida une
ville qu’il appella de fon nom Dardante , 6c qui fut
là célébré T royes. Son régné fut long & heureux,&
âprès fa mort fes fujets reconnoiffans le mirent au
nombre des immortels. (+ )
DARK.1N G , ( Géogr.) villë d’Angleterre, dans la
province de Surrey, fur la petite riviere de Mole,
& au voifinage de Boxhill, colline fameufe par la
quantité débuts dont elle eft couverte, & par les
beaux points dé vue qui fè préfentent depuis fon fom-
met. Au jugement des médecins, cette ville refpire
le meilleur air de l’Angleterre. Les anciens Romains
y avoient un établiffement considérable, & l’on y
trouve encore de relies de l’un de leur grands chemins
paves & cimentés. Tous les environs de Dar-
kin° font rians, fertiles & bien cultivés. L’on y fait
un grand commeïce de grains & de viéluaillès ; &
il n’eft point de foires dans le royaume où ilfe vende
autant d’agneaux qu’aux fiennes. Long. ty. i S . lat.
H B U M !
DARLINGTON, ( Géogr. ) bonne ville d’Angleterre
, dans l’évêché de Durham, fur la riviere de
Skerne ; proche des trois cavernes fameufes, appellées
hefl kettles , chauderons d?enfer , que l’on croit
s’être formées à la fuite d’un tremblement de terre,
mais dont le commun peuple ne parle qu’avec effroi
& menfonge. Il fe tient dans cette ville de bonnes
foires & de gros marchés ; il y a une belle églife, jadis
collégiale, une école publique bien réglée, & un
palais épifcopal qui tombe en ruines. Long. ÏC. 2.0.
lat. 64. 20 .( D .G . ) „a
D A R Z , ( Géogr. ) pfefqu’île de la mer Baltique,
fur les côtes de la Poméranie Suédoife & du Meck-
lenbourg,au nord-oueftdeStràlfùnd. Elle contient
plufieurs grands villages & métairies, qui ont pris la
place des mâifons de chaffe que les anciens ducs de
Poméranie y tenojent autrefois ; enforte qu’à l’honneur
des tèms modernes, c’eft un des lieux de l’Europe
oîi l’agriculture s’ëft élevée fur les ruines de la
vénerie. (D .G . )
* § D A T E ........Lifez dans cet article Amydenius
au lieu A’Amidonius.
D AUL, ( Inftr. milit. des Turcs. ) Les Turcs appellent
ainfi une groffe caifle haute de trois pieds ( Voye^
fia. 11, Planche I I , Art milit. armes & autres mdchines
milit. des Turcs, dans ce Suppl.") que les tambours
portent à cheval avec un haune-cou couvert de
drap rôtfg'e : ils frappent fur la partie Supérieure avec
un gros bâton de buis en forme de maffue recourbée,
& fur l’inférieure avec une petite baguette, frappant
alternativement de l’une & de l’autre avec beaucoup
d’art & de gravité, ce qui eft fort agréable ; c’eft-là
l’unique infiniment qui, outre le fafte du bacha, ferve
aux exercices militaires, parce qu’on bat ces grofles
caiffes, lorfque l’armée eft proche de celle des ennemis,
tout autour des gardes du camp; pour les tenir
éveillées les tambours crient jegder A lla , c’eft -à-
dire, Dieu bon. ( P. )
§ DAULIES, ( Mythol. ) fêtes.... en l’honneur de
Jupiter-Protée. Dicl. raifi des Scien. S cc. T. IP.pag.
S4S. Cet article eft fort défectueux : on ne connoît
point ce Jupiter - Protée dans la fable, quoique les
différentes formes que prenoit cè dieu pour féduire
de foibles mortelles, pût lui mériter ce nom; mais
Prætus ,roi d’Argosfe faifoit appeller Jupiter, par un
orgueil affez ordinaire aux rois ; & de ce Prætus Jupiter,
l’auteur de cet article a fait Jupiter-Protée.
L’abbé Bannier dit que cette fête fut inftituée pour
renouveller la mémoire du combat de Prætus contre
Acrifius fon frere. ( C. )
DAUPHIN , f. m. delphinus, i , ( terme de Blaf. )
meuble d’armoiries, poiffon qui a la tête groffe par
rapport au refte de fon corps, il paroît ordinairement
courbé en demi-cercle 6c de profil: fon mufeau de
le bout de^fa queue vers la dextre de l’écu.
On dit du dauphin, allumé de fon oe il, lorré de
fes nageoires, pcautre de fa queue ; quand ils font
d’un autre émail que fon corps.
Dauphin pâmé, eft celui qui a la gueule ouverte
& fans dents, ni langue., qui femble expirer.
Gaffendy de Tartone , à Aix en Provence, cPa^ur
au dauphin P argent; au chef d'or chargé de trois membres
de griffons de fable. ( G. D . L . T. )
D E
§ DÉ (jeu de), Antiquités. L’on a découvert dans
Herculane quantité de dés en ivo ire, en terre cuite,
&c. ils font parfaitement femblables à ceux d’aujourd’hui:
l’on y a même trouvé des cornets en ivoire;
les Grecs les nomment vrupyoi, petite tour, d’où l ’on
a formé le mot latin de pyrgus, cornet à jouer aux
dés. Les bons auteurs latins j .tels qu’Horace , ont
nommé le cornet phimus: Martial l’appelle turricula.
Dans les tableaux que l’on a découvers dans Herculane
, on voit une caricature qui repréfente Ænée
qui porte. Anchife ; il eft fuivi de Jule ; tous les trois
fuient la ville de Troyes , ils font peints nuds en«
priapes ; ils ont des têtes de chien, 6c ils portent des'
cornets pour jouer aux dés. On préfume que le peintre
a voulu faire allufion à Augufte & à l’empereur
Claude , qui fe difoient iffus d’Ænée, & qui étoient
grands joueurs de dés.
Scheuchzer 6 c Altman ont fait des recherches fur
l’origine des dès de bois, ou de terre cuite, que l’on
trouve en grande quantité, en labourant la terre près
de Zurzach & de Bade en Suiffe. Ces auteurs croient
que les anciennes légions Romaines avoient féjourné
pendant long-tems auprès de ces deux villes, & que
les dés que l’on y trouve Tervoient à leurs amufe-
mens.
L’on à aufîi découvert dans Herculane des dés >à
coudre, parfaitement femblables à ceux d’aujourd’hui
, ils font en bronze ouverts • par le bout.
( ' ' . A . L . f
D E A A V EN T ÏA , ( Myih.) dé'effe, dont le culte
a été établi dans la plus grarndé partie de la Suiffe
ancienne. Elle à voit un temple à Aventicum, & on
y a trouvé quelques inferiptions à fon honneur, fur-
tout aux environs de \ illars le moine ; ce qui fait
fc^!P.Ç°nn-r ç’ eft là que fon temple étoit placé ;
il eft apparent,-qù;e s-’étpit Véiuts..( HM:d . sppratsüt
^DEétL j GÇiïigw ).. jolie .ville d’Angleterre fur .la
côte Orientale de la pro vince de Kent entré Dou vres.’
Sandwich Sc v is -à - viSi dïsrfalàtes de<Go6d*in.-
Elle a une églife, une chapelle,, & deux châteaux bâtis
pour fa détende par Henri Vltl. L'on croit que
BW - t& p A o U de Jules Céfar, Elle n’a ni fabriques
m manufactures. ni ftfiqôfcat marchés; mais à portée,
- ?/JP unes ,ou Rationnent pour l’ordinaire tant de
vaiüeaux, I on peut dire, que c’eft un des endroits
de ,1 Angleterre Iss plus fréquentés & les mieüx pour-
vus de denrees &c de viétuailles. Tant de marins y
abordent, qu’aucun commerce de détails n’y languit.
Long, icf. fiijat. St. i&. ( D .G . )
1 D E A N , (Geogr. ) petite ville d’Angleterre, dans
la province de Glocefter : elle tient foires &c marchés,
&c tire fon nom d’une forêt jadis fi étendue ,
qu au g delà de vingt paroiffes fe trouvent aujour-
d hui dans fon enceinte. ( D .G . )
DEBRECZEN j'( Géogr. ) ville libre & royale de
la haute Hongne, dans le comté de Bihar, au milieu
d une plaine immenfe, où l’on ne trouve aucun bois :
elle: elt grande & peuplée, mais laide, fans murailles
& lans portes ; & tout fon trafic eft de bétail. Les
reformes ÿ jouiffent d’un college, auffi bien que les
j f r^S c‘^s,eco^es P‘es« LRe a eu le malheur de fouffrir
d aflez frequens incendies. ( D . G. )
§ DEC AN , ( Géogr. ) royaume des Indes :■ ce n’eft
plus qu une province dé l’empire du Mogol: Hatne-
nadagor en eft la capitale : lifez Hamenadager. Lettres fur
l Encyclopédie.
§ DEÇA POLIS, ( Géogr. ) petite ptovtnce de Cè-
léjyrie.. . . . On prétend que le pays de Dècapolisétoit
Jituc a c orient du Jourdain: la prétention eft bonne ;
.mais Scytopolis, qui en étoit la capitale, étoit pourtant
à l’occident du Jourdain. Lettres fur P Encyclopédie.
.
D ÉCENCE, ( Rhètor.) c’eft l’accord de la contenance
des geftes & de la voix de l’orateur avec la
nature de fon difeours, dans le genre tempéré ; ce
n eft que dans ce genre qu’il eft queftion d’un tel accord
: car dans le pathétique, la véhémence des paf-
ûons anime l’orateur, & l’accord le plus parfait n’eft
pas décence, c’eft impulfion naturelle.
Dans un difeours férieux la décence confifte en un
maintien grave 6c pofé, des geftes mefurés, une voix
male, une prononciation un peu lente; la tête eft
droite & les fourcils légèrement abaiffés: fi le fujet
du difeours eft agréable & d’une gaieté modérée, la
contenance efl plus riante, les mouvemens plus gracieux
& plus ailes , la. tête un peu plus relevée, le regard
plus gai & plus ouvert, & la voix plus claire ;
ên general, un maintien modefte, des mouvemens
modérés & une voix .mefurée , font les parties effen-
tielles de la décence oratoire ; tout ce qui eft outré
ou véhément lui répugne ; c’eft une grandeur tranquille
qui, fansdiftraire ni troubler l ’auditeur 8 fixe
toute fon attention fur le fujet principal du difeours.
L aflurance eft un des principauxmoyens qui donne
à 1 orateur cètte dignité décente dont le pouvoir eft
fi efficace fur l’efprit de l’auditoire. L ’orateur qui-
lait qu il a bien médité fa matière, & que fon difeours
eft. compofé avec tout'le foin poffible, parlé
avec plus de confiance, il ne fait point d’efforts pénibles
; la feremté régné dans foh ame, & la décence en
reluire. Mais quand l’orateur fe défie de la force de
les argu mens, il tâche d’y fuppléer par la maniéré de
Jes propofer; c’eft de la voix 6c du gefte qu’il attend
le plus grand effet, 6c pour-l’obtenir il manque à la
decence.
Que l'orateiif fe perfuade bien que l’eflentiel d’un
dilconrs confifteidans les chofes, & que la mauiere
de les jjcapofer qieut fimplement leur donner un
nouveau degfd de forge, «ais jamais fiippldèr à letif
defaut. Qu’il s’épargne dbuc. dés efforts'iiiutiles pour
donner-,, par fa déaknlatioh ; de l’énérgie à des p».
rôles qui n’en ont poinr; cette rdlburce convient à
la pantômtnie qui n’en a pas d'autfes',ijchez l’orateur
elle ne doit iervtr qu'à appuyer la forée réelle du
aneours.
L’orafeuf décent néicherche point à paroître, ni à
le taire admirer : il veut -^tie l’auditoire s’occupe dg
Ion difeours, &• non de fa perfonne. Modefte fans
timidité j il fe permet une honnête confiance, il con-
lidere fes auditeurs, non comme des juges inexorables
, qui le condamneront fans ^entendre mais
comme une affemblée refpeftable de perfonnes éclai*
rees. (Cet article eft tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts de M. Sü L Z E R . )
DKCIUS ou D ece'-,:( Ùifl. M ) Cneui
Mmus Qumius Ttajajius Decms, Pannonien de naif*
lance, selevà des plus bas emplois au premier gradé '
de la milice Romatnet l’empereur Philippe qui con-
noiffott fes-talens pour la guerre', le choiftt pour
appaifèr la rébellion de Moefie , mais à peine fut-il
entre dans cette province que les légions, d’un confen*
tement unanime, le proclamèrent empereur; il fallut
en venir aux nfiains contre fon bienfaiteur, qui après
I avoir vaincu , fut affaffiné par fes propres foldats*
ba mort le rendit paifible poffeffeurde l’empire, mais
il ne voulut point entrer dans Rome qu’il n’eût étouffé
la révolté des Gaules. Il marcha enfuite contre les
beythes quiravagoient la Thrace & la Moefie. Après
plufieurs viêloires, fes troupes furent mifes en fuite:
il rut entraîné dans la déroute avec fon fils ; 6c ayant
pouffé fon cheval dans un marais profond , i l fut englouti
fous 1 eau & dans la boue fans qu’on pût jamais
retrouver fon corps. Il mourut à l’âge de cinquante ans
dont il en avoit régné deux. Les écrivains profanes
lui donnent une place parmi les bons empereurs. Les
chrétiéns l’ont peint comme un monftre de cruauté,
à caufe des cruelles perfécütions qu’il exerça con-
tr’eitx. On ne peut donner une idée affez affreufe
des hommes qui puniffent les opinions contraires
aux leurs, avec la même févériré que les vices 6c
les crimes. ( T— jv. )
D egiüs Mus, (Hift. Rom.) dans les tems vertueux
de la république romaine, fut également célébré
par fon courage & par fon amour pour la patrie.
II fe diftingua dans fa jeuneffe contre les Samnites ; &
quoiqu’il n’eût que le titre de tribun, on lui attribua
la principale gloire de cette guerre. Le conful Cornélius
s’étant embarraffé dans me pofition défavanta-
geufe, en fut tiré par l’intrépidité de Decius qui lui
aida à remporter une vidoire éclatante contre les
Samnites : la gloire qu’il s’étoit acquife dans cette expédition;
lui mérita la dignité de conful, cè fut en
éette qu'alité qu’il pourfuivit la guerre contre les Latins
, qui lui livrèrent un combat où , voyant les fiens
plier,, il prit la réfolution de fe dévouer aux dieux
infernaux pour arracher la viélôire aux ennemis. Ce
facrifice magnanime releva le courage des Romains
qui relièrent viélorieiix. Son fils Decius Mus fut l’héritier
dé ce fanatifme républicain : il exerça quatre foià
le eonfulat, 6c quand il pou voit jouir de fa gloire il
n ambitionhoit que l’honnéùf de fe dévouérpour fon
pgys & e’èft ce qu’il exécuta quelque tems après en
fe précipitant fans armes au milieu de la mêlée : iî
laiffa un fils qui imita l’exemplfe de fon pere & de fort
aïeul dans la guerre contre Pirrhus. Ce prince qui
avoit en horreut cet enthoufiafme furieux, lui-fit dire
que s’il vouloit fe dévoiler; il ordonneroit 1 fes fol-
dats dè: le ménager & de le prendre vivant pour le
faire punir du dernier fiipplice. Cette menacé ne le
fit point d&nger de réfolution ; il fe jetta fur les javelots
& les piques des Epirotes, & il trouva la mort
qu’il femhloit invoquer. La manie des dévouenïens