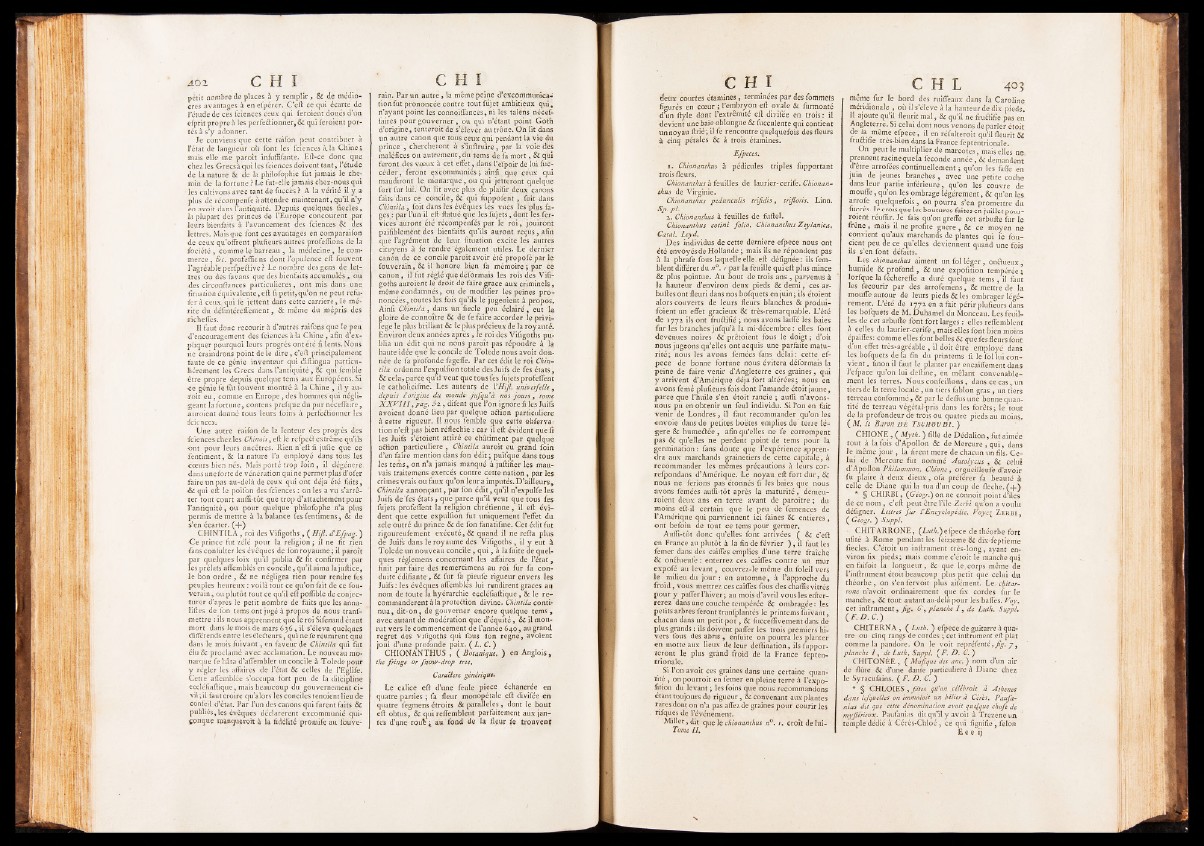
petit nombre de places à y remplir , & de médiocres
avantages à en efpérer. C ’eft ce qui écarte de
l’ctude de ces fciences ceux qui feroient doués d’un
efprit propre à les perfectionner, & qui feroient portés
à s’y adonner.
Je conviens que cette raifon peut contribuer a
l’état de langueur où font les fciences à.la Chine;
mais elle me paroît infuffifante. Eft-ce donc que
chez les Grecsàqui les fciences doivent tant, l’étude
de la nature & de la philofophie fut jamais le chemin
de la fortune ? Le fut-elle jamais chez-nous qui
les cultivons avec tant de fuccès ? A la vérité il y a
plus de récompenfe à attendre maintenant,qu’il n’y
en avoit dans r antiquité. Depuis quelques fiecles,
la plupart des princes de l’Europe concourent par
leurs bienfaits à l’avancement des fciences & des
lettres. Mais que font ces avantages en comparaifon
de ceux qu’offrent plufieurs autres profeflions de la
fociété , comme le barreau , la médecine, le commerce
, &c. profeflïcns dont l’opulence eft fouvent
l ’agréable perfpeftive ? Le nombre des gens de lettres
ou des fa vans que des bienfaits accumulés, ou
des circonftances particulières, ont mis dans unq
fituatiôn équivalente, eft fi petit,cju’on ne peut r'efii-
fer à ceux, qui fe jettent dans cette carrière, le mérite
du défintéreffement, & même du mépris des
richeffes.
Il faut donc recourir à d’autres raifons que le peu
•d’encouragement des fciences à la Chine, afin d’expliquer
pourquoi leurs progrès ont été fi lents. Nous
ne craindrons point de le dire , c’eft principalement
faute de ce génie inventeur qui diftingua particuliérement
les Grecs dans l’antiquité, qui femble
-être propre depuis quelque tems aux Européens. Si
•ce génie fe fût fouvent montré à la Chine , il y au-
roit eu , comme en Europe, des hommes qui négligeant
la fortune, contens prefque du pur néceffaire,
•auroient donné tous leurs foins à perfectionner les
fciences.
Une autre raifon de la lenteur des progrès des
iciences chez les Chinois, eft le refpeét extrême qu’ils
•ont pour leurs ancêtres. Rien n’eft fi jufte que ce
fentiment, & la nature l’a employé dans tous les
coeurs bien nés. Mais porté trop loin , il dégénéré,
dans une forte de vénération quine permet plus Ü’ofer
faire un pas au-delà de ceux qui ont déjà été faits,
■ & qui eft le poifon des fciences : on les a vu s’arrêter
tout court aufli-tôt que trop d’attachement pour
l ’antiquité, ou pour quelque philofophe n’a plus
permis de mettre à la balance fes fentimens, & de
s ’en écarter. (-J-)
CHINTILA , roi des Vifigoths , ( Hiß. fEfpag. )
G e prince fut zélé pour la religion ; il ne fit rien
fans confulter les évêques de fonroyaume;il paroît
par quelques loix qu’il publia & fit confirmer par
les prélats affemblés en concile, qu’il aima lajuftice,
le bon ordre , & ne négligea rien pour rendre fes
peuples heureux : voilà tout ce qu’on fait de ce fou-
verain, ou plutôt tout ce qu’il eft poflible de conjecturer
d’après le petit nombre de faits que les anna-
liftes de fon tems ont jugé à propos de nous transmettre
: ils nous apprennent que le roi Sifenand étant
mort dans le mois de mars 636, il s’éleva quelques
différends entre leséleûeurs, qui nefe réunirent que
dans le mois fuivant, en faveur de Chintila qui fut
élu & proclamé avec acclamation. Le nouveau monarque
fe hâta d’afiëmbler un concile à -Tolede pour
y régler les affaires de l’état & celles de l’Eglife.
Cette affemblée s’occupa fort peu de la dilcipline
eccléfiaftique, mais beaucoup du gouvernement civil
; il faut croire qu’alors les conciles tenoient lieu de
confeil d’état. Par l’un des canons qui furent faits &
publiés, les évêques déclarèrent excommunié quiconque
manqueroït à la fidélité promifç au fouverain.
Par un autre, la même peine d’excommunication
fut prononcée contre tout fiijet ambitieux qui,
n’ayant point les connoiffances, ni les tâlèns' nécef-
faires pour gouverner, ou qui n’étant point Goth
d’origine, tenteroit de' s’élever àutrône. On lit dans
un autre canon que tous ceux qui pendant la vie du
prince , chercheront à s’i,nflruire, par la voie dès
maléfices ou autrement , du tems de fa mort, & qui
feront des voeux à cet effet, dans l’eïpoir de lui fuc-
çéder, feront excommuniés; ainfi que ceux qui
maudiront le monarque, ou qui jetteront quelque
fort fur luï. Ôn lit avec plus de plaifir deux canons
faits dans ce concile, & qui fuppofent , {bit dans
Chintila: , foit dans les évêques les vues les plus fa-
gesi par l’un il eft-ftatué qu,e les fujets, dont les fer-
vicès aürpnt été récompenfés par le ro i, jouiront
paifiblemènt des bienfaits qu’ils auront reçus , afin
que l’agrément de leur fituatiôn excite les autres
citoyens à fe rendre~également utiles. Le dernier
canôn de ce concile paroît avoir été propofélpar le
fouveràin, & il honore bien fa mémoire ; par cç
canon, il fut réglé que déformais les rois des Vifigoths
auroient le droit de faire grâce aux criminels ,
même condamnés , ou de modifier les peines prononcées,
toutes les fois qu’ils le jugeoient à propos.
Ainfi Chintila, dans un fiecle peu éclairé, eut la
gloire de connoître & de fe faire accorder le privilège
le plus brillant & le plus précieux de la royauté.
Environ deux années après , le roi des Vifigoths publia
un édit qui ne nous paroît-pas répondre à la
haute idée que le concile de Tolede nous avoit donnée
de fa profonde fageffe. Par cet édit le roi Chin-
ilia ordonna l’expulfion totale des Juifs de fes états,
& cela, parce qu’il veut que tous fes fujets profelfent
le catholicifme. Les auteurs de Y Hiß. univerfelle ,
depuis Üorigine du monde jufqu a nos jours, tome
X X V I I I 7pag. âz , difent que l’on ignore fi les Juifs
avoient donné lieu par quelque aélion particulière
à cette rigueur. Il nous femble que cetfe obferva-
tion n’eft pas bien réfléchie : car il eft évident que fi
les Juifs s’ëtoient attiré ce châtiment par quelque
aflion particulière , Chintila auroit eu grand foin
d’en faire mention dans fon édit; puifque dans tous
les tems, on n’a jamais manqué à juftifier les mauvais
traitemens exercés contre cette nation, par les
crimes vrais ou faux qu’on leur a imputés. D ’ailleurs,
Chintila annonçant, par fon édit, qu’il n’expulfe les
Juifs de fes états, que parce qu’il veut que tous fes
fujets profeffent la religion chrétienne, il eft évident
que cette expulfion fut uniquement l’effet du
zele outré du prince & de fon fanatifme. Cet édit fut
rigoureufement exécuté, & quand il ne refta plus
de Juifs dans le royaume des Vifigoths, il y eut à
Tolede un nouveau concile, q u i, à lafuite de quelques
réglemens concernant les affaires de l’é ta t,
finit par faire des remercimens au roi fur fa conduite
édifiante, & fur fa pieufe rigueur envers les
Juifs : les évêques affemblés lui rendirent grâces au
nom de toute la hyérarchie eccléfiaftique, & le recommandèrent
à la proteèlion divine. Chintila continua,
dit-on, de gouverner encore quelque tems,
avec autant de modération que d’équité, & il mourut
vers le commencement de l’année 640, au grand
regret des Vifigoths qui fous fon regne, avoient
joui d’une profonde paix. ( L. C. )
CHIONANTHUS , ( Botanique. ) en Anglois,
the fringe or fnow-drop tree.
Caractère générique.
Le calice eft d’une feule pièce échancrée en
quatre parties ; fa fleur monopétale eft divifée en
quatre fegmens étroits & paralleles , dont le bout
eft obtus, & qui reffemblent parfaitement aux jantes
d’qnq roubi au fond de la fl£ur fe trouvent
ideüx courtes étaminès » terminées par des fommets
figurés en coeur ; l’enibryon eft ovale & furmonté
d’un ftyle dont l’extremité eft divifée en trois : il
devient une baie oblongiie & fucculente qui contient
un noyau ftrié; il fe rencontre quelquefois des fleurs
à cinq pétales & à trois étamines.
Efpeces.
1. Chionanthus à pédicules triples fupportant
trois fleurs.
Chionanthus à feuilles de laurier-cerife. Chionanthus
de Virginie.
Chionanthus pedunculis trifidis, trifloris. Linn. HH
z. Chionanthus à feuilles de fuftel.
Chionanthus cotint folio. Chionanthus Zeylanica.
Catal. Leyd.
Des individus de cette derniere efpece nous ont
été envoyés de Hollande ; mais ils ne répondent pas
à la phrafe fous laquelle elle, eft défignée: ils fem-
blent différer du n°. 1 par la feuille qui elt plus mince
& plus pointue. Au bout de trois ans , parvenus à
la hauteur d’environ deux pieds & demi, ces ar-
buftes ont fleuri dans nos bofquets en juin ; ils étoient
alors couverts de leurs fleurs blanches & produiraient
un effet gracieux & très-remarquable. L’été
de 1772 ils ont fruélifié ; nous avons laiffé les baies
fur les branches jufqu’à la mi-décembre: elles font
devenues noires & prêtoient fous le doigt ; d’où
nous jugeons qu’elles ont acquis une parfaite maturité;
nous les avons femées fans délai: cette efpece
de bonne fortune nous évitera déformais la
peine de faire venir d’Angleterre ces graines, qui
y arrivent d’Amérique déjà fort altérées ; nous en
avons femé plufieurs fois dont l’amande étoit jaune,
parcêque l’huile s’en étoit rancie ; aufli n’avons-
nôus pu en obtenir un feul individu. Si l’on en fait
venir de Londres , il faut recommander qu’on les
envoie dans de petites boëtes emplies de terre légère
& hume&ée, afin qu’elles ne fe corrompent
pas & qu’elles ne perdent point de tems pour la
germination: fans doute que l’expérience apprendra
aux marchands grainetiers de cette capitale, à
recommander les memes précautions à leurs cor-
refpondans d’Amérique. Le noyau eft fort dur, &
nous ne ferions pas étonnés fi les baies que nous
avons feméés aufli-tôt après la maturité, demeu-
roient deux ans en terre avant de paroître ; du
moins eft-il certain que le peu de fémences de
l’Amérique qui parviennent ici faines & entières ,
ont befoin de tout ce tems pour germer.
Aufli-tôt donc qu’elles font arrivées ( & c’eft
en France au plutôt à la fin de février ) , il faut les
femer dans des caiffes emplies d’une terre fraîche
& on&ueufe : enterrez ces caiffes contre un mur
expofé au levant, couvrez-lè même du foleil vers
le milieu du jour : en automne, à l’approche du
froid, vous mettrez ces caiffes fous des chaflis vitrés
pour y paffer l’hiver ; au mois d’avril vous les enterrerez
dans une couche tempérée & ombragée : les
petits arbres feront tranfplantés le printems fuivant,
chacun dans un petit p o t , & fucceflivemeftt dans de
plus grands : ils doivent paffer les trois premiers hivers
fous des abris , enfuite on pourra les planter
en motte aux lieux de leur deftination, ils fuppor-
îeront le plus grand froid de la France fepten-
trionale.
Si.l’on avoit ces graines dans une certaine quantité
, on pourroit en femer en pleine terre à l’expo-
fition du levant ; les foins que nous recommandons
étant toujours de rigueur, & convenant aux plantes
rares dont on n’a pas affez de graines pouf courir les
rifques de l’événement.
Miller, dit que le chionanthus n°. 1, croît de lui-
Tome II.
meme fur le bord des ruiffeaux dans la Caroline
méridionale , où il s’élève à la hauteur de dix pieds.
Il ajoute qu’il fleurit m al, & qu’il ne fruélifie pas en
Angleterre. Si celui dont nous venons de parler étoit
de la même efpece, il en réfulteroit qu’il fleurit &
fructifie tres-bien dans la France feptentrionale.
On peut le multiplier de marcotes, mais elles ne
prennent racine que la fécondé année, & demandent
d’être arrofées continuellement ; qu’on les faffe en
juin de jeunes branches , avec une petite coche
dans leur partie inférieure, qu’on les couvre de
moufle, qu’on les ombrage légèrement, & qu’on les.
arrofe quelquefois, on pourra s’en promettre du
fuccès. Je crois que les boutures faites en juillet pour-
roient reuffir. Je fais qu’on greffe cet arbufte fur le
frene f mais il ne profite guere , & ce moyen ne
convient qu’aux marchands de plantes qui fe foule
n t peu de ce qu’elles deviennent quand une fois
ils s’en font défaits.
Les chionanthus aiment un fol léger , on&ueux "
humide & profond , & une expofition tempérée ;
lorfque la féchereffe a duré quelque tems , il faut
les Secourir par des arrofemens, & mettre de la
moufle autour de leurs pieds & les ombrager légèrement.
L’été de l ’pqzen a fait périr plufieurs dans
les bofquets de M. Duhamel du Monceau. Les feuilles
de cet arbufte font fort larges : elles reffemblent
à celles du laurier-cerife, mais elles font bien moins
épaiffes: comme elles font belles & que fes fleurs font
d’un effet très-agréable , il doit être employé dans
les bofquets de la fin du printems fi le fol lui convient
, finon il faut le planter par encaiffement dans
l’efpace qu’on lui deftine, en mêlant convenablement
les terres. Nous confeillons, dans ce cas, un
tiers de la terre locale ,un tiers fablon gras , un tiers
terreau confommé, & par le deffus une bonne quantité
de terreau végétabpris dans les forêts ; le tout
de la profondeur de trois ou quatre pieds au moins.
(M . le Baron DE Ts c h o v d i . )
CHIONE, ( Myth. ) fille de Dédalion, fut aimée
tout à la fois d’Apollon & de Mercure , qui, dans
le même jour , la firent mere de chacun un fils. Celui
de Mercure fut nommé Autolycus , & celui
d’Apollon Philammon. Chione , orgueilleufe d’avoir
fu plaire à deux dieux , ofa préférer fa beauté à
celle de Diane qui la tua d’un coup de fléché. ( + )
* § CHIRBI, (Géogr.) on ne connoît point d’îles
de ce nom , c’eft peut-être l’ile Zerbi qu’on a voulu
défigner. Lettres fur VEncyclopédie. Voyer Z erbi ,
( Géogr. ) Suppl.
■ CHITARRONE, (Zar/z.) efpece de théorbe fort
ufité à Rome pendant les feizieme & dix-feptieme
fiecles. C’étoit un infiniment très-long, ayant environ
fix pieds; mais comme c’étoit le manche qui
en faifoit la longueur, & que le,corps même de
l’inftrument étoit beaucoup plus petit que celui du
théorbe , on s’en fervoit plus aifément. Le. cfitar-
rone n’avoit ordinairement que fix cordes fur le
manche, & tout autant au-delà pour les baflès. Voy.
cet infiniment, fig. 6 , planche I , de Luth. Suppl.
( F .D .C . )
CHITERNA , ( Luth. ) efpece de guitarre à quatre
ou cinq rangs de cordes ; cet infiniment eft plat
comme la pandore. On le voit repréfenté, fig. 7 ,
planche 1 , de Luth. Suppl. ( F. D. C. )
CHITONÊE , ( Mujjque des anc. ) nom d’un air
de flûte & d’une danfe particulière à Diane chez
le Syracufains. ( F. D. Ç. )
* § CHLOIES , fêtes qû'on célébroit d Athènes
dans lefquelles on immoloit un bélier à Cérhs. Paufa-
nias dit que cette dénomination avoit quelque chofe de
myjlérieux. Paufanias dit qu’il y avoit à Trezene un
temple dédié à Cérès-Chloé, ce qui fignifie, félon
E e e i;