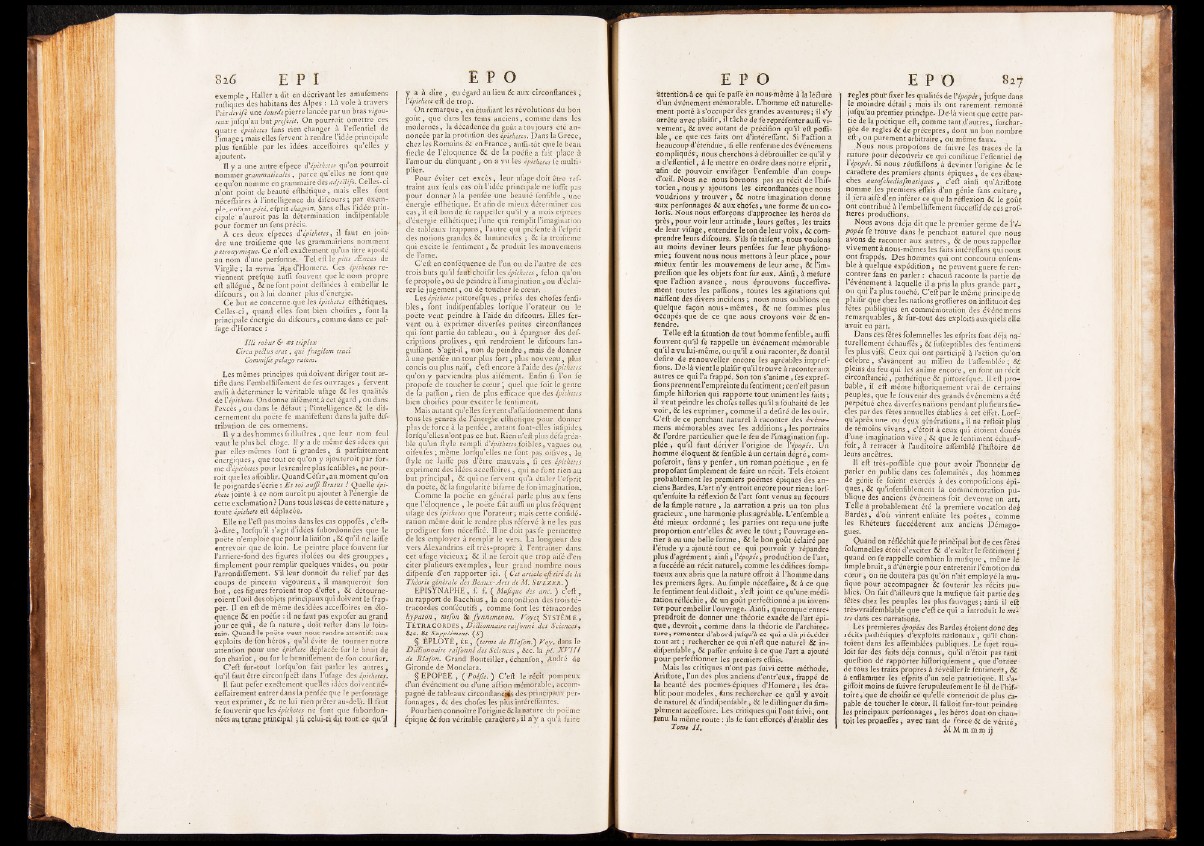
exemple , Haller a dit en décrivant les artîufemerts
ruftiques des habitans des Alpes : Là vole à travers
Pair divifé une lourde pierre lancée par un bras vigoureux
jufqu’au but prefcrit. On pourroit omettre ces
quatre épithetes fans rien changer à l’effentiel de
l’image ; mais elles fervent à rendre l’idée principale
plus fenfible par les idées acceffoires qu’elles y
ajoutent.
Il y a une autre efpece d'‘épithetes qu’on pourroit
nommer grammaticales, parce qu’elles ne font que
ce qu’on nomme en grammaire des adjectifs. Celles-ci
n’ont point de beaute efthetique 9 mais elles font
néceffaires à l’intelligence du difcours ; par exemple,
enfant gâté, efprit chagrin. Sans elles l’idéè principale'
n’auroit pas la détermination indifpenfable
pour former un fens précis.
À ces deux efpeces d'épithetes, il faut en joindre
une troilieme que les grammairiens nomment
patronymique. Ce n’eft exactement qu’un titre ajouté
au nom d’une perfonne. T el eft le pius Æneas de
Virgile ; la votvio. 'Hpa d’Homere. Ces épithetes reviennent
prefque aufli fouvent que le nom propre
eft allégué, & ne font point deftinées à embellir le
difcours, ou à lui donner plus d’énergie.
Ce but ne concerne.que les épiehetes efthétiques.
Celles-ci, quand elles font bien choifies , font la
principale énergie du difcours, comme dans ce paf-
fage d’Horace :
Illi robuf & as triplex
Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commifit pelago ratem.
Les mêmes principes qui doivent diriger tout ar-
tifte dans Pembelliflement de fes ouvrages , fervent
aufli à déterminer le véritable ufage & les qualités
de l’épithète. On donne aifémentà cet égard , ou dans
l’excès, ou dans le défaut ; l’intelligence & le di(-
cernement du poète fe manifeftent dans la jufte dif-
tribution de ces ornemens.
Il y a des hommes fi illuftres , que leur nom feul
vaut le plus bel éloge. Il y a de même des idées qui
par elles-mêmes font fi grandes, fi parfaitement
énergiques, que tout ce qu’on y ajôuteroit par forme
d'épithetes pour les rendre plus fenfibles, ne pourroit
que les affoiblir. Quand Céfar, aù moment qu’on
le poignarde s’écrie : Et toi auffi Brutus ! Quelle épithète
jointe à ce nom auroitpu ajouter à l’énergie de
cette exclamation ? Dans tous les cas de cette nature,
toute épithete eft déplacée.
Elle ne l’ eft pas moins dans les cas oppofés , c’eft-
à-dire, lorfqu’il s’agit d’idées fubordonnées que le
poète n’emploie que pour la liaifon , & qu’il ne laifle
entrevoir que de loin. Le peintre place fouvent fur
l’arriere-fond des figures ifolées ou des grouppes ,
fimplement pour remplir quelques vuides, ou pour
l’arrondiffement. S’il leur donnoit du relief par des
coups de pinceau vigoureux, il manqueroit fon
b u t , ces figures feroient trop d’effet, & détourne-
roient l’oeil des objets principaux qui doivent le frapper.
Il en eft de même des idées acceffoires en éloquence
& en poéfie : il ne faut pas expofer au grand
jour ce q ui, de fa nature , doit refter dans le lointain.
Quand le poète veut nous rendre attentifs aux
exploits de fon héros, qu’il évite de tourner notre
attention pour une épithete déplacée fur le bruit de
fon chariot, ou fur le henniffement de fon courfier.
C ’ eft fur-tout lorfqu’on fait parler lés autres,
qu’il faut être circonfpe£f dans l’ufage des épithetes.
Il faut pefer exa&ement quelles idées doivent né-
ceffairement entrer dans la penfée que le perfonnage
veut exprimer, & ne lui rien prêter au-delà. Il faut
fe fouvenir que les épithetes ne font que fubordonnées
au terme principal j fi celui-ci dit tout.ce- qu’il
y a à dire , eu égard ait lieu & aux circonftances ;
Vépithete eft de trop.
On remarque, en étudiant les révolutions du bon
goût, que dans les terns anciens, comme dans les
modernes, la décadence du gofit a toujours été annoncée
par la profufion des épithetes. Dans la G rece,
chez les Romains & en France, aufîi-tôt que le beau
fiecle de l’éloquence & de la poéfie a fait place à
l’amour du clinquant 3 on a vu ies épithetes fe multiplier.
Pour éviter cet excès, leur ufage doit être ref-
traint aux feuls cas oii l’idée principale ne fuffit pas
pour donner à la penfée une beauté fenfible , une
énergie efthétique. Et afin de mieux déterminer ces
Cas, il eft bon de fe rappeller qu’il y a trois efpeces
d’énergie efthétique; l’une qui remplit l’imagination
de tableaux frappans, l’autre qui préfente à l’efprit
des notions grandes & lumineufes ; & la troifieme
qui excite le fentiment, & produit les mouvemens
de l’ame.
C ’eft en conféquence de l’un ou de l’autre de ces
trois buts qu’il faut choifir les épithetes, félon qu’on
fe propofe, ou de peindre à l’imagination, ou d’éclairer
le jugement, ou de toucher le coeur.
Les épithetes pittorefques , prifes des chofes fenfibles
, font indifpenfables lorfque l ’orateur ou le
poète veut peindre à l’aide du difcours. Elles fervent
ou à exprimer diverfes petites circonftances
qui font partie du tableau, ou à épargner des def-
criptions prolixes, qui rendroient le difcours lan-
guiffant. S’agit-il, non de peindre., mais de donner
à une penfée un tour plus fo r t , plus nouveau, plus
concis ou plus naïf, c’eft encore à l’aide des épithetes
qu’on y parviendra plus aifément. Enfin fi l’on fe
propole de toucher le coeur \ quel que foit le genre
de la paflion, rien de plus efficace que des épithetes
bien choifies pour exciter le fentiment.
Mais autant qu’ elles fervent d’affaifonnement dans
tous les genres de l’énergie efthétique pour donner
plus de force à la penfée, autant font-elles infipides
lorfqu’elles n’ont pas ce but. Rien n’eft plus défagréa-
ble qu’un ftyl.e rempli à'épitketesToibles, vagues ou
oifeufes ; même lorfqu’elles ne font pas ôifives, le
ftyle ne laifle pas d’être mauvais, fi Ces épithetes
expriment des idées acceffoires , qui ne font rien au
but principal, & qui ne fervent qu’à étaler l’efprit
du poète, & la fingularité bifarre de fon imagination.
Comme la poéfie en général parle plus aux fens
que l’éloquence , le poète fait auffi un plus fréquent
ufage des épithetes que l’orateur; mais cette confidé-
ration même doit le rendre plus réfervé à ne les pas
prodiguer fans néceffité. Il ne doit pas fe permettre
de les employer à remplir le vers. La longueur des
vers Alexandrins eft très-propre à l’ëntrainer dans,
cet ufage vicieux; & il ne ferôit que trop aifé d’en
citer plufieurs exemples, leur grand nombre nous
difpenfe d’en rapporter ici. ( Cet article ejltirè de la
Théorie générale des Beaux-Arts de M. SULZER. )
EPISYNAPHE, f. f. ( Mujique des and. ) c’e f t ,
au rapport de Bacchius, la conjonction des trois tétracordes
confécutifs , comme font les tétracordes
hypatori, mefon & fynneménàn. Voÿé{ SystÊM e ,
TÉTRACORDES, Dictionnaire raifonné des Sciences,
&c. & Supplément. (S)
§ ÉPLOYÉ, ÉE, (terme de Blafon.) Voÿ,.dans le
Dictionnaire raifonné des Sciences , &c. la pi. X V I I I
de Blafon. Grand Bouteiller, échanfon, André de
Gironde de Monclara.
§ EPOPÉE , ( Poéfie. ) C’eft le récit pompeux
d’un événement ou d’une aftion mémorable; accompagné
de tableaux circonflancjjés des principaux personnages
, & des chofes les plus intéreffantes.
Pourbien connoître l’origine & la nature du poème
épique êc fon véritable caractère, il n’y a qu’à faire
attention.à ce qui fe paffe èn nous-mêm'e à latéêlurè
’d’un événement mémorable. L’homme eft naturellement
porté à s’occuper des grandes aventurés ; 11 s’y
arrête avec plaifir, il tâche de fe repréfehter auffi vivement;
& avec autant de précifiôn qü’il eft poffi-
b le , ce que ces faits ont d’intéfeffaïit. Si l’aétion à
beaucoup d’étendue, -fi elle renferme des'évenemens
compliqués-, nous cherchons à débrouiller ce qu’il y
a d’effentiel, à le mettre en ordre dans notre efprit,
afin de pouvoir envifager l’enfemble d’un coup-
d’oeil. Nous ne nous bornons pas au récit de l’hifi-
torien, nous y àjoûtons les circonftances que nous
voudrions y trouver , & notre imagination donne
aux perfonnages & aux chofes, une forme & un coloris.
Nous nous efforçons d’approcher les héros de
près, pour voir leur attitude, leurs geftes, lès traits
de leur vifage, entendre le ton de leur v o ix , & comprendre
leurs difcours. S’ils fe taifent, nous voulons
au moins deviner leurs penfées fur leur phyfiono-
mie ; fouvent nous nous mettons à leur p lace, pour
mieux fentir les mouvemens de leur ame, & l’inV-
preffion que les objets font fur eux. Ainfi, à mèfure
que l’aâion avance -, nous éprouvons fucceffivë-
ment toutes les paffions, toutes les agitations qui
naiffent des divers incidens ; nous nous oublions en
quelque façon nous-mêmes, & ne fommes plus
occupés que de ce que nous croyons voir & entendre.
Telle eft la fituation de tout homme fenfible , auffi
fouvent qu’il fe rappelle un événement mémorable
qu’il a vu lui-même, ou qu’il a ouï raconter, & dont il
defire de renouveller encore les agréables impref-
iions. De*là vient le plaifir qu’il trouve à raconter aux
autres ce qui l’a frappé. Son ton s’anime, fes expref-
iions prennent l’empreinte du fentiment ; ce n’eft pas un
limple hiftorien qui rapporte tout uniment les faits ;
il veut peindre les chofes telles qu’il a fduhaité de les
vo ir , & les exprimer, comme il a defiré de les buir.
C ’eft de ce penchant naturel à raconter des événe-
mens mémorables avec les additions ; les portraits
& 1 ordre particulier que le feu de l’imagination fup-
plée , qu’il faut dériver l’origine de \ épopée. Un
homme éloquent & fenfible à un certain dégré, com-
poferoit, fans y penfer, un roman poétique , en fe
propofant fimplement de faire un récit. Tels étoient
probablement les premiers poèmes épiques des anciens
Bardes. L’art n’y entroît encore pour rien : lorf-
qu’enfuite la réflexion & l’art font venus au fecours
de la fimple nature, la narration a pris un ton plus
gracieux, une harmonie plusagréable. L’enfemble a
été mieux ordonné ; les parties ont reçu une jufte
proportion entr’elles & avec le tout ; l’ouvrage entier
à eu une belle forme, & le bon goût éclairé par
l ’étudè y a ajouté tout ce qui pouvoit y répandre
plus d’agrément ; ainfi * Vépopée ; production de l’art;
a fuccédéàu récit naturel; comme les édifices fompr
tueux aux abris que la nature offroit à l’homme dans
les premiers âges. Au fimple néceffaire, & à ce que
le fentiment feul d i&oit, s’eft joint ce qu’une méditation
réfléchie, & un goût perfectionne a pu inventer
pour.embellir l’ouvrage. Ainfi, quiconque entrer
prendroit de donner une théorie exaCte dé:l’àrt épique
, devroit, comme dans la théorie de l’architecture
; remonter d ’abord jufqu’à ce qui a dû pfécédei1
tout art ; rechercher ce qui h’eft que naturel & indifpenfable
, & paffer enfuite à ce que l*ai;t a ajouté
pour perfectionner les premiers effais.
Mais les critiques n’ont pas .fuivi cette métHodé.
Ariftote, l’un des plus anciens d’entr’éux , frappé dë
la beauté des pbëmes-épiqùes d’Homerë, les établit
pour modèles., &ns rechercher ce qu’il y avoit
de naturel & d’indifpenfable, & le diftingtier du fimplement
açceffoire. Les critiques qui l’ont fuivi:, ont
(tenu la même route : ils fe font efforcés d’établir dès
Tome I I .
réglés ptrnï fixer les qualités de l'épopée , jufque dans
le moindre detail ; mais ils ont rarement, remonté
jufqu’au premier principe. De-là vient que cette partie
de la poétique eft, comme tant d’autres , furchar-
gée de réglés & de préceptes, dont un bon nombre
e f t , ou purement arbitraire, ou même faux.
Nous nous prppofons de fuivre. les tracés de I9
nature pour déçpiiyrir ce qui conftitue ï’effentiel dp
l'épopée. Si nous réuffiffpns à deviner l’origine & le
caràdere des premiers chants épiques , (le ces ébauj-
ches autofehediafmatiques c’eft ainfi qu’Àriftote
nomme ;les premiers èffais d’un génie fans .culture ;
il fera aifé d’en inférer ce que la réflexion & ie goût
ont contribué à l’embelliffement îucceffif de ces grof-
fieres produdions.
Nous avons déjà dit que ie premier germe de ÎV-?
popée fê trouve dans le penchant naturel que nous
ayons de raconter aux autres, & dé nous rappeller
vivement à nous-mêmes les faits intérèffans qui nous
ont frappes. Des hommes qui ont concouru enfem-
ble à quelque expédition ; ne peuvent guefe fe ren?
contrer fans en parler : chacun raconte la partie de
l’evenement à laquelle il à pris la plus grande part,
ou qui l’a plus touché. C’eft par le même principe de
plaifir que chez les nations groffieres on inftituoit des
fetes pübliqüës en commémoration des étféHémenà
remarquables, & fur-tout dçs exploits aüxqùelS elle
avoit eu part.
Dans ces fêtes folemnelles les efprits font déjà naturellement
échauffés , 6t fùfçeptibles des fentiment
les plus vifsl Ceux qui ont participé à l’adiôn qu’oti
célébré, s’àvâncent au milieu de l’affemblee ; Si
pleins du feu qui les anime encore, en font un récif
circonftancié, pathétique &£ pittor'efque. Il eft pro-^
bable, il eft même hiftoriqiiement vrai de Certains
peuples, que le fouvenir des grands évéhemèns a été
perpétué chez diverfes nations pendant plüfiéursfie-
cles par des fêtes annuelles établies à cet êffet. Lorf-'
qu’après Une ou deux générations , il rië reftoit plus
de témoins vi va ns, c’étoit à ceüx qui étoient doués
d une imagination v iv e , ÔC que le fehtiment échauf--
foit, à fetràcér à l’auditoire âfleniblé l’hiftôire dé
leurs ancêtres.
Il eft très-poffibie que pour avoir rhonnéur de
parler empublic dans ces folemnités, des hommes
de gériië le foieht exercés à dès cqmpbfitions épiques;
& qu’infehfiblement là commémoration publique
des anciens événeinens loit devenue un art.
Telle a probablement été la première vocation des
BardèS, d’où vinrent enfuite les poètes, comme
les Rhéteurs fuccéderent aux anciens Démagogues;
Quâhd on réfléchit que lé principal but de ces fêtes
folemnelles étoit d’exciter & d’exalter ie fehtiment •
quand on fe rappelle combien la mufi'qué , même lé
fimple bruit, à d’énergie pour entretenirrémotion dii
coeur ; on hé doutera pas qu’dn n’ait employé là mu-
fiqüé pour accompagner & foutenir les réèits publics.
Oh fait d’ailleurs que la mufiquè fait partie des
fêtes-chez les peuples les plus fauv'agës ; aihfi il eft
très-vraifemblablè que c’eft ce qui a introduit le me*
tre dans cès narrations.
Lès premières épopées des Bardes étoient donc dès
récits pathétiques d’èxplbits hàtiônaUx, qii’il chan-
toient dans lès affemblées publiques. Lé fujët rou-
loit filr dès faits déjà Connus, qu’il ri’étoit pas tarit
queftibn dé rapporter hiftoriquemeht, qire d’orner -
de tous lès tràits proprës à févëillerlè fentimerit, &
à enflammer lès efprits d’ùn zélé patriotique. Il s’a- '
giffoit moins de fuivre fcrupuleufemerit le fil de l’hif-
toirefque de choifir cè qu’ellé cbnterioit de plus capable
de toucher le cèeur. Il fàlloit fur-tout peindre
les principaux perfonnages, les héros dont on ehan-r
toit les proiieffes ; avec tarit 4e fdree & de vérité ,
M M m m m i j