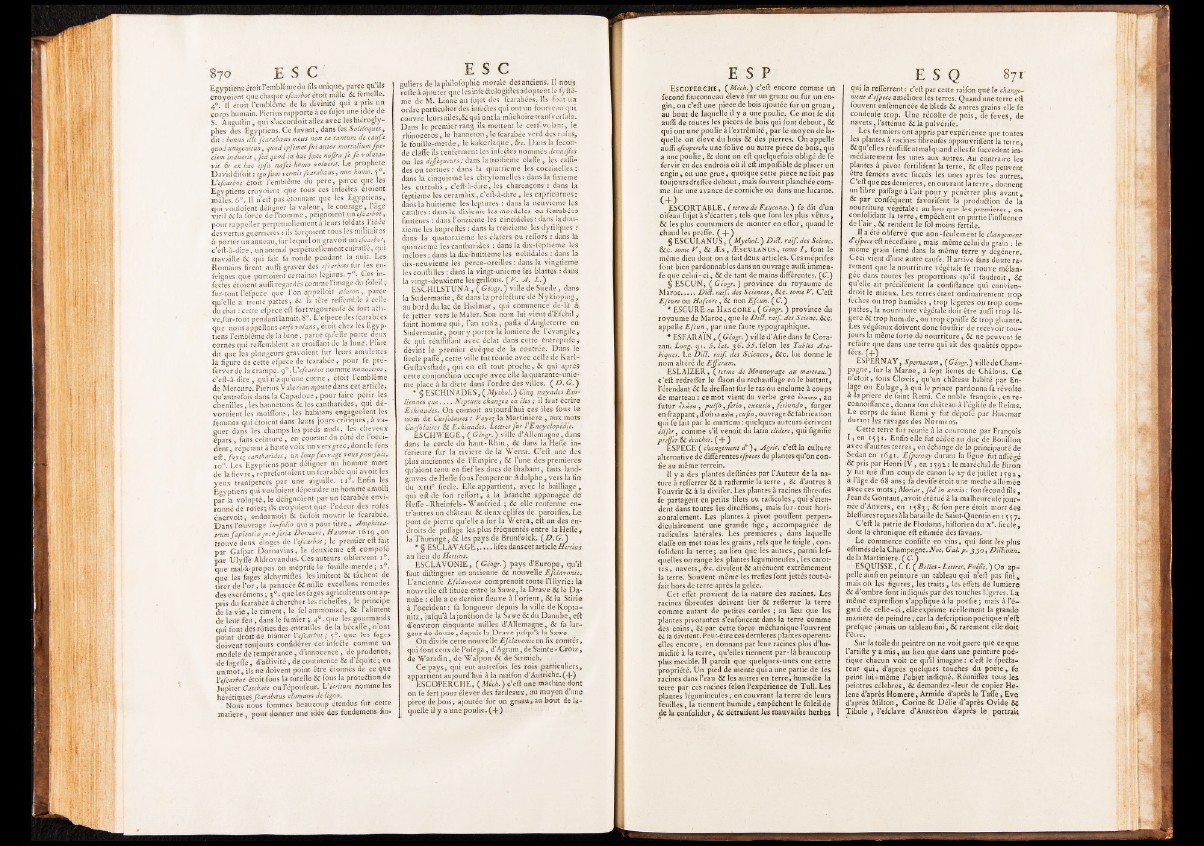
Egyptiens éfoît l’emblème du fils unique, parce qu ils
croyoient que chaque efcarbot étoit mâle & femelle.
4°. 11 étoit l’emblème de la divinité qui a pris un
corps humain. Pierius rapporte à ce fujet une idee de
S. Auguftin, qui s’accordoit affez avec les hiéroglyphes
dès Egyptiens. Ce favant, dans fes Soliloques,
dit : bonus ilU fcaraboeus meus non eu tantum de edufa
quod unigenitus, quod ipfemet fui autor mortdliuiri fpe-
ciem induerit ,fed quod in hdcfoece noftrafefe vOluta-
vit & ex hac ipfa nafci hotrio voluerit. Le prophète
Daviddifoit : ego-funi vertnis fcaraboeus, non hotno. 50.
Vefcarbot étoit Femblêm'e du pere, parce que les
Egyptiens croyoient que tous ces infeftes etoient
mâles. 6°. Il n’eft pas étonnant que les Egyptiens,
qui vouioient défigner la valeur, le courage , lage
viril & la force de l’homme, peignoient un efcdrboty
pour rappeiler perpétuellement à leurs foldats 1 idee
des vertus guerrières : ils forçoient tous les militaires
à porter un anneau, fur lequel on gravoit un efcarbot,
c’ eft-à-dire., un animal perpétuellement cuiraffe, qui ;!
travaille & qui fait fa ronde pendant la nuit. Les
Romains firent aufli graver des efcarbotsliîr les en-
feignes que portoient certaines légions. 70. Cès infectes
étoient aufli regardés comme 1 image du foleil,
fur-tout l’efpece que l’on appelloit oeluron, parce
qu’elle a trente pattes, & la tête reffemble à celle
du chat : cette efpece eft fort vigoureufe & fort a&i-
ve,fur-tout pendant la nuit. 8°. L efpece desfearabees
que nous appelions cerfs volans, et oit chez les Egyptiens
l’emblème de la lune, parce qu’elie porte deux
cornes qui reffemblent au croiffant de la lune. Pline
dit que les plongeurs gravoient fur leurs amulettes
la figure de cette efpece de fearabee, pour fe pre-
ferver de la crampe. 9°.L'efcarbot nommemorioceros,
c’ eft-à-dire , qui n’a qu’une corne , efoit Fembleme
de Mercure. Pierius Valerian ajoute dans cet article,
qu’autrefois dans la Capadoce, pour faire périr les
chenilles, les hannetons & les cantharides , qui dévoraient
les moiffons, les habitans engageoiènt les
femmes qui étoient dans leurs jours critiques , à vaguer
dans les champs les pieds nuds, les cheveux
epars , fans ceinture , en courant du côte de 1 occident
, répétant à haute voix un vers grec, dont le fens
eft, fuye{ cantharides, un loupfauvâge vouspourfuit.
io ° . Les Egyptiens pour défigner un homme mort
de lafievre, repréfentoient un fearabée qui avoit les
yeux tranfpercés par un:e aiguille. i i ° . Enfin les
Egyptiens qui vouioient dépeindre un homme amolli
par la volupté, le défignoient par un fearabee environné
de rôles; ils croyoient que l odeur des rofes
énervoit, endormoit & faifoit mourir le fearabée.
Dans l’ouvrage in-folio qui a pour titre , Amphitea-
trum fapientioe joco ferice Dorhdvi, Hanovioe 1619 , on
trouve deux éloges de l'efcarbot ; le premier eft fait
par Gafpar Dôrnavius, le deuxieme eft compofé
par Ulyffe Aldrovandus. Ces auteurs obfervent i° .
que mal-à-propos on méprife le fouille-merde ; 20.
que les fages alchymiftes les imitent & tâchent de
tirer de l’o r , la panacée & mille excellens remedes
des excrémens ; 30. que les fages agriculteurs ont appris
du fearabée à chercher les richeffes, le principe
de la v i e , le ciment, le fel ammoniac, & l’aliment
de leur feu , dans le fumier ; 40. que les gourmands
qui font des rôties des entrailles de la bécafle, n’ont
point droit de blâmer Veféarbot ; 50. que les fages
doivent toujours confidérer cet infefte comme un
modelé de tempérance, d’innocence , de prudence,
de fageffe, d’a&ivité, dé continence & d’équité; en
un m ot, ils ne doivent point être étonnés de ce que
Y efcarbot étoit fous la tutelle & fous la proteaion de
Jupiter Catebate oul’époufeur. L ’écriture nomme les
hérétiques fcaraboeus clamans detigno.
Nous nous fommes beaucoup étendus fur cette
matière, pour donner une idée des fondemens fingulîers
de la philofo'phie morale des anciens. Il nous
refte à ajouter que les infe ftologiftes adoptent le fyftê-
me de M. Linné au fujet des fearabées, Ils font un
ordre particulier des infe&es qui ont un fourreau qui
couvre’ leürs ailes,ôe qui ontla mâchoiretranfverlàle.
Dans le premier rang ils mettent le cerf-volant, le
rhinocéros, le hanneton, le fearabée verd des rofes,
le fouille-merde, le kakerlaque, &c. Dans la fécondé
claffe ils renferment les infe&es nommés dermefes
ou les dijfiqueurs : dans la trôifieriie claffe , les caflî-
des ou tortues : dans la quatrième les coccinelles :
dans la cinquième les chryfômelles : dans la fixieme
les ciirèulis, c’eft-à-dire, les eharençons : dans la
feptieme les cerambix, c’eft-à-dire , les capricornes:
dans la huitième les leptures : dans la neuvième les
càrabes : dans la dixième les mordeles ou fearabées
fauteurs : dans Fonzieme les cincideles : dans la douzième
les bupreftes : daris la treizième les dytifques i
dans la quatorzième les élaters ou reffors : dans la
quinzième les cantharides : dans la dix-feptieme les
méloes : dans la dix-huitième les neltidales : dans la
dix-néuvieme les percé-oréilles : dans la vingtième
les eouftilles : dans la vingt-unieme les blattes : dans
la vingt-deuxieme les grillons. {V . A . L .)
ESCHILSTUNA , ( Géogr. ) ville de Suède , dans
la Sudermanie, & dans la préfe&urë de Nykioping*
au bord du lac de Hielmar, qui commence de-là- à
fe jetter vers le Maler. Son nom lui vient d’Efchil ^
faint homme qui, l’an 1082, pafla d’Angleterre en1
Sudermanie, pour y porter là lumière de l’évangile,-
& qui réufliffant avec éclat dans cette êntreprjfey
devint le premier évêque de la eontrée. Dans le
fieele paffé, cette' ville fut réunie avec e.élle de Karl-'
Guftavsftadt, qui en eft tout proche , & qui après*
cette conjonûion occupe avec elle la quarante-unie-
me place à la diete dans l’ordre des Villes. ( D. G. )r
* § ESGHINADES , ( Mythol. ) Cinq noyades^ Eto*
Viennes que. . . . Neptune changea en îles ; il faut écrite
Echinades. On connort aujourd’hui ces' îles fous le
nom de Curfolaires : Voye^Xa Martiniere , Uux mots
. Curfolaires & Echinades. Lettres fur l'Encyclopédie.
ESCHWEGË, ( Géogr. ) .ville d’Allemagne, dans1
dans le cercle du haut-Rhin, & dans la Heffe inférieure
fur la riviere de la1 V e r ra . C ’eft une des'
plus anciennes de l’Empire, & l’unè des premières*
qu’aient-tenu en fief les ducs de Brabant, faits landgraves
de Heffe fous Fempereur Adolphe, vers la fin
' du x n ie fieele. Elle.appartient, avec le bailliage,
qui eft de fon reffort, à la’ branché appanagée de
Heffe -Rheinfels -V an fried ; & elle renferme en-
tr’autres un châteaiv & deux églifes de paroiffes. Le
pont de pierre qu’elle a fur la V e r r a , eft un des endroits
de paffage les plus fréquentés entre la Heffe i
la Thuringe, & les pays de Brunfwick. (D . G. )
* § ESCLAVAGE, . . . . lifez dans cet article Hertius
au lieu de Hertins.
ESCLAVONIE, ( Géôgr.) pays d’Europe, qu’il
faut diftinguer en ancienne ôc nouvelle Efclavonie*
L’ancienne Efclavonie comprenoit toute l’Iliyrie: la
nouvelle eft fituée entre la Sawe, la Drave & le Danube
: elle a ce dernier fleuve à l’orient, & la Stirie
à l’occident : fa longueur depuis la ville de Kopta-*
nitz, jufqu’à la jonftionde la Save & du Danube, eft
d’environ cinquante milles d’Allemagne, & fa largeur
de douze, depuis la Drave jufqu’à la Save.
Oh divifé cette nouvelle Efclavonie en fix comtés,
qui font ceux de Pofega, d’Agram, de Sainte - Croix*
de Waradin, de 'Valpon & de Sirmich. .
Ce pays; qui eut autrefois fes rois particuliers,
appartient aujourd’hui à la maifon d’Autriche. (+ )
ESCOPERCHE, ÇMéch.)V e f t une machine dont
on fe fert pour élèver des fardeaux, au moyen d’une
piece de bois, ajoutée fur un gruau, au bout de laquelle
il y a une poulie, (.ftf.)
EscoPËRétiE, (itfécé.) c’eft encore comme un
fécond fauconneau élevé fur un gruau ou fur un engin,
ou c’eft une piece de bois ajoutée fur un gruau,
au bout de laquelle il y à une poulie. Ce mot fe dit
aufli de toutes les pièces de bois qui font debout, &
qui ont une poulie à l’extrémité, par le moyen de laquelle
on éleve du bois & des pierres. On appelle
aufli efeoperche une folive ou autre piece de bois, qui
a une poulie, & dont on eft quelquefois obligé de fe
fervir en des endrois oii il eft impoflîble de placer un
engin, ou une grue, quoique cette piece ne foit pas
toujours dreflëe debout, mais fouvent planchée comme
fur une avance de corniche ou dans une lucarne.
( + )
ESCORTABLE, {termede Fauconn.") fe dit d’un
oifeau fujet à s’écarter ; tels que font les plus vêtus,
& les plus coutumiers de monter en effor, quand le
chaud les preffe. ( + )
§ ESCULANUS, ( Mythol. ) Dicl. raif. des Scienc.
& c . tome V , & Æ s , ÆscULANUS, tome / , font le
même dieu dont on a fait deux articles. Ces méprifes
font bien pardonnables dans un ouvrage aufli immen-
fe que ce lu i-ci, & de tant de mains différentes. (C.)
§ ESCUN, ( Géogr. ) province du royaume de
Maroc.......Dicl. raif. des Sciences, &c. tome P. C ’eft
EJcure ou Hafcore, & non Efcun. ( (7.)
* ESCURE ou Hascore , ( Géogr. ) province du
royaume de Maroc, que le Dicl. raif. des Scienc. &c.
appelle Efcun, par une faute typographique.
* ESFARAÎN, ( Géogr. ) ville d’Afie dans le Cora-
zan. Long. ot. S. lat. 3 6 . 55. félon les Tables Arabiques.
Le Dicl. raif. des Sciences, &c. lui donne le
nom altéré de Effaram.
ESLAIZER, ( terme de Monnoyage au marteau;)
c ’eft redreffer le flaon du réchauffage en le battant,
l’étendant & le dreflant fur le tas ou enclume à coups
de marteau : ce mot vient du verbe grec i\*um, au
futur eAaVa, pulfo ^ferio, excutio, feriundo, forger
en frappant, d’oii tXatria. , cujio, ouvrage & fabrication
qui fe fait par le marteau : quelques auteurs écrivent
•élifer, comme s’il venoit du latin elidere, qui fignifie
prefler & écacher. ( + )
ESPECE ( changement ) , -Agric. c’eft 1a- Culture
alternative de différentes efpeces de plantes qu’on confie
au même terrein.
Il y a des plantes deftinées par l’Auteur de la nature
à refferrer & à raffermir la terre , & d’autres à
l ’ouvrir & à la divifer. Les plantes à racines fibreufes
fe partagent en petits filets ou radicules, qui s’étendent
dans toutes les direâions, mais fur-tout horizontalement.
Les plantes à pivot pouffent perpendiculairement
une grande tige, accompagnée de
radicules latérales. Les premières , dans laquelle
claffe on met tous les grains, tels que le feigle, confondent
la terre;.au lieu que les autres, parmi lesquelles
on range les plantes légumineufes, les carottes
, navets, &c, divifent & atténuent extrêmement
la terre. Souvent même les treflesfont jettes tout-à-
fait hors de terre après la gelée.
Cet effet provient de la nature des racines. Les
racines fibreufes doivent lier & refferrer la terre
comme autant de petites cordes ; au lieu que les
plantes pivotantes s’enfoncent dans la terre comme
des coins, & par cette force méchanique l’ouvrent
& la divifent. Peut-être ces dernieres plantes operent-
elles encore, en donnant par leur racines plus d’humidité
à la terre, qu’elles tiennent par-là beaucoup
plus meuble. Il paroît que quelques-unes ont.cette
propriété. Un pied de mente qui a une partie de fes
racines dans l’eau & les autres en terre, humeâe la
terre par ces racines félon l’expérience de Tull. Les
plantes légumineufes, en couvrant la terré de leurs
feuilles la tiennent humide, empêchent le foleil de
fie la çonfoüder, U détruifent les mauvaifes herbes
qui la refferrent : c’eft par cette raifon qué le changement
d'efpece améliore les terres. Quand une terre eft
fouvènt enfemencée de bleds & autres grains elle fe
condenfe trop. Une récolte de pois, de feves, de
navets, l’atténue & la pulvérife.
Les fermiers ont appris par expérience que toutes
les plantes à racines fibreufes appauvrillent la terre,
&qu elles réufîiffentmalquand ellesfe fuccedent immédiatement
les unes aux autres. Au contraire les
plantes à pivot fertilifent la terre, & elles peuvent
etre femées avec fuccès lès unes après les autres.
C’eft que ces dernieres, en ouvrant la terre , donnent
un libre paffage à l’air pour y pénétrer plus avant,
& par conféquent favorifent la produéliôn de la
nourriture végétale : au lieu que les premières, en-
confolidant la terre, empêchent en partie l’influence
de l’a ir , & rendent le fol moins fertile.
Il a été obfervé que non-feulement le changement
efpece eft néceffaire, mais même celui du grain : le
même grain femé dans la même terre y dégénéré.
Ceci vient d’une autre caufe. Il arrive fans doute rarement
que la nourriture végétale fe trouve mélangée
dans toutes les proportions qu’il faudrait, &
qu elle ait préèifément la confiflance qui conviendrait
le mieux. Les terres étant ordinairement trop
feches ou trop humides , trop légères ou trop comp
a re s, la nourriture végétale doit être aufli trop légère
& trop humide, ou trop épaiffe & trop gluante.
Les végétaux doivent donc louffrir de recevoir toujours
la même forte de nourriture, & ne peuvent fe
refaire que dans une terre qui ait des qualités oppo-
fées. (+ )
ESPERNAY, Spernacum, {Géogr.') ville de Cham-
pagne, fur la Marne, à fept lieues de Châlons. Ce
n étoit, fous Clovis, qu’un château habité par En-
lage ou Eulage, à qui le prince pardonna fa révolte .
à la priere de faint Remi. Ce noble françois, en re-
connoiflance, donna fon château à l’églife de Reims.
Le corps de faint Remi y fut dépofe par Hincmar
durant les ravages dès Normans.
Cette terre fut réunie à la cçuronne par François
I , en 1531. Enfin elle fut cédée au duc de Bouillon
avec d’autres terres, en échange de la principauté de
Sedan en 1641. Ëfpernay durant la ligue fut aflïégé
& pris par Henri IV , en 1592 : le maréchal de Biron
y fut tué d’un coup de canon le 27 de juillet 1592 ,
à l'âge de 68 ans; fa devifeétoit une meche allumée
avec ces mots ; Moriar, fed in armis: fon fécond fils ,
Jean de Gontaut, avoit été tué à la malheureufe journée
d’Anvers, en 1583 ; & fon pere étoit mort des
bleflures reçues à-la bataille de Saint-Quentin en 15 57^
C’eft la patrie de Flodonn, hiftorien du x e. fieele,
dont la chronique eft eftimée dès favans.
Le commerce confifte en vins, qui font les plus
eftimés de la Champagne. Not. Gai. p. 33 à, Diclionm.
delà Martiniere. (G .)
ESQUISSE, f. f. ( B elles-Lettres. Poéfie. ) On appelle
ainfi en peinture un tableau qui n’eft pas fini,
mais ofi les figures ; les traits, les effets de lumière
& d ’ombre font indiqués par des totfehes légères. La
même expreflîon s’ applicjue à la poéfie ; mais à l’égard
de celle - c i , elle exprime réellement la grande
maniéré de peindre ; caria defeription poétique n’eft
prefque jamais un tableau fini, 6c rarement elle doit
l’être.
Sur la toile du peintre on ne voit guere que ce que
l’artifte y a mis, au lieu que dans une peinture poétique'chacun
voit ce qu’il imagine: c’eft le fpeâa-
teur -qui, d’après quelques touches du poëte, fe
peint lui-même l’objet indiqué. Réunifiez tous les
peintres célébrés, & demandez-leur de copier He-
lenë d’après Homère, Armide d’après le T affe, Eve
d’après Milton, Corine & Délie d’après Ovide 6c
Tibule , l’efclave d’Anacréon d’apres le portrait