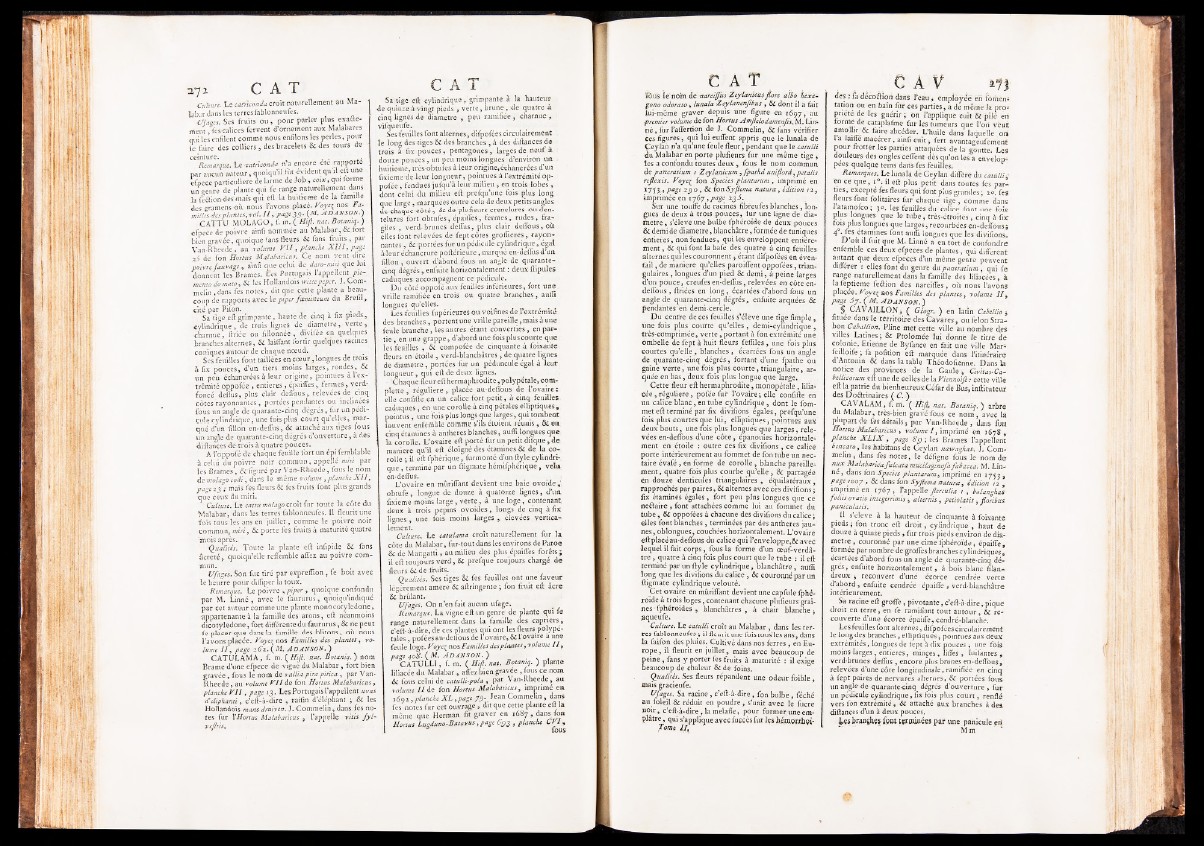
Culture. Le caCricondu croît naturellement au Mal
a b a r .dans les terres l'ablonneufes. <
UJaots. Ses fruits o u , pour parler plus exacte- «
ment,Tes-c-alices fervent d’ornement aux Malabares
qui les enfilent comme nous enfilons les perles, pour
le faire des colliers, des bracelets & des tours de
ceinture. t , ,
Remarque. Le xatriconda n’a encore -ete rapporte
par aucun auteur, quoiqu’il fût évident qu il eft une
efpece particulière de larme de Job, coix, qui forme
un ©enre de plante qui fe range naturellement dans
la fe&ion-des maïs qui eft la huitième de la famille
des.crâniens où nous l’avons placé. Voye^ nos FamilUs
des plantes,-vol, I I , page3 ^. 4 DAN SON.)
CA T TU MOLAGO, f. m. ( H f i . nat. Botaniq. )
efpece de poivre ainfi nommée au Malabar, & fort
bien gravée, quoique fans fleurs & fans fruits , par
Van-Rheede, au volume V U , planche X I I I , page
a i de fon Bonus Malabadcus. Ce nom veut dire
poivre fuiivqge, ainfi que celui de daro-nùri que lui
donnent les Brames. Les Portugais 1 appellent pie-
mémo do mato, & les Hollandais wittepeper. J.Com-
melin , dans fes notes, dit que cette plante a beaucoup
de rapports avec le piper fcemincum du Brefil,
cite par Pifon. ■ x . .
Sa tige eA grimpante , haute de cinq a fix pieds ,
cylindrique, de trois lignes de diamètre, verte,
charnue, ftriée ou fillonnée , diviiée en quelques
branches alternes, 8c laiflant lortir quelques racines
coniques autour de chaque noeud.
Ses feuilles font taillées en coeur, longues de trois
â fix pouces, d’un tiers moins larges, rondes, 8c
un peu échancrées à leur origine, pointues à l’extrémité
oppofée , entières , épaiffes, fermes , verd-
foncé deffus, plus clair deflous, relevecs de cinq
côtes rayonnantes, portées pendantes ou inclinées
ibus un angle de quarante-cinq degrés, fur un pédicule
cylindrique, une fois plus court qu’elles, marqué
d’un fillon en-deffus , 8c attache aux tiges fous
un angle de quarante-cinqdégrés d’ouverture, à des
difiances de trois à quatre pouces.
A l’oppofé de chaque feuille fort un épi femblable
à celui du’poivre noir commun, appelle miri par
les Brames, 8c figuré par Vân-Rheede, fous le nom
de molago c o ü , dans le même volume , planche X I I ,
page 23 ; mais fes fleurs 8c fes fruits font plus grands
que ceux du miri.
Culture. Le cattu molago croît fur toute la côte du
Malabar, dans les terres fablonneufes. 11 fleurit une
fois tous les ans en juillet, comme le poivre noir
commun, miri, 8c porte fes fruits à maturité quatre
'mois après.
Qualités. Toute la plante eft infipide 8c fans
âcreté, quoiqu’elle reffemble affez au poivre commun.
Ufages. Son fuc tiré par expreffion, fe boit avec
le beurre pour difliper la toux.
Remarque. Le poivre -, piper, quoique confondu
par M. Linné, avec le faururus, quoiqu’indiqué
par cet auteur comme une plante monocotyledone,
appartenante à la famille des arons, eft neanmoins
dicotyledone, fort différente du faururus, 8c ne peut
fe placer que dans la famille des blitons, oîi nous
l’avons placée. Voye£ nos Familles des plantes, volume
I l , page 262. ( M. A d an so n . )
CATULAMA, f, m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) nom
Brame d’une efpece de vigne du Malabar, fort bien
gravée, fous le nom de vallia pira pitica , par Van-
Rheede , au volume P I I de fon Hortus Malabaricus,
planche V I I , page 13. Les Portugais l’appellent uvas
d'diphanti, c’eft-à-dire , raifin d’éléphant ; 8c les
Hollandois mans druiven. J. Commelin, dans fes notes
fur VHortus Malabaricus , l’appelle yitis fy l-
yejlris,,
Sa'tige eft -cylindrique, grimpante à la hauteur
-de quinze à vingt pieds , verte, brune, de quatre à
cinq lignés de diamètre , peu ramifiée, charnue ,
vifqueufe.
Ses feuilles font alternes, difpofées oirculairement
le long des tiges 8c des branches , à des diftances de
trois à fix pouces, pentagones , larges de neuf à
douze pouces, un peu moins longues d’environ un
huitième, très-obtufes à leur origine, échancrées d’un
fixiemedeieur longueur, pointues à l’extrémité oppofée
, fendues jufqu’à leur .milieu , en trois lobes ,
dont celui du milieu eft prefqu’une fois plus long
que large, marquées outre cela de deux petits angles
de chaque cô té , 8c de plufieurs crenelures ou dentelures
fort obtufes, épaiffes, fermes, rudes, fragiles
, verd-brunes deffus, plus clair deffous,où
elles font relevées de fept côtes groffieres, rayonnantes,
8c portées fur un pédicule cylindrique, égal
à leur échancrure poftérieure, marqué en-deffus d’un
fillon , ouvert d’abord fous un angle, de quarante-
cinq degrés, enfuite horizontalement : deux ftipules
caduques accompagnent ce pédicule.
Du côté oppofé aux feuilles inférieures, fort une
vrille ramifiée en trois ou quatre branches, aufti
longues qu’elles.
Les feuilles fupérieures ou voifines de l’extrémité
des branches , portent une vrille pareille, mais à une
feule branche, les antres étant converties , en partie
, en une grappe, d’abord une foispluscourte que
les feuilles , 8c compofée de cinquante à foixante
fleurs en étoile, verd-blanchâtres , de quatre lignes
de diamètre, portées fur un péduncule égal à leur
longueur, qui eft de deux lignes.
'Chaque fleur eft hermaphrodite , polypérale, com-
plerte , régulière, placée au-deffous de l’ovaire:
elle confifte.en un calice fort petit, à cinq feuilles
caduques, en une corolle à cinq pétales elliptiques,
pointus , une fois plus longs que larges, qui tombent
ibuvent enfemble comme s’ils étoient réunis , & en
cinq étamines à anthères blanches, auffi longues que
k corolle. L’ovaire eft porté fur un petit difque, de
maniéré qu’il eft éloigné des étamines 8c de la corolle
; il eft fphérique, furmonté d’un fty le cylindrique
, terminé par un ftigmate hémifphérique, vel»
en-deffus. 4 .
L’ovaire en muriffant devient une baie ovoïde,'
ebtufe, longue de douze à quatorze lignes, d’un
fixieme moins large, v erte, à une loge, contenant,,
deux à trois pépins ovoïdes, longs de cinq à fix
lignes, une fois moins larges , élevées verticalement.
Culture. Le catulama croît naturellement fur la
côte du Malabar, fur-tout dans les environs de Paro-e
8c de Mar.gatti, au milieu des plus épaiffes forêts;
il eft toujours verd, 8c prefque toujours chargé de
fleurs ôc de fruits.
Qualités. Ses tiges 8c fes feuilles ont une faveur
légèrement amere 8c aftringente ; fon fruit eft âcre
8c brûlant.
Ufages. On n’en fait aucun ufage.
Remarque. La vigne eft un genre de plante qui fe
range naturellement dans la famille des câpriers,
c’eft-à-dire, de ces plantes qui ont les fleurs polypétales
, polées au-deffous de l’ovaire, 8c l’ovaire a une
feule loge. Voye£ nos Familles des plaques, volume I I ,
page 408. (AL A d a n s o n . ) . . ,
C A TU L L I , f. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) plante
liliacée du Malabar, affez bien gravée , fous ce nom
8c fous celui de catulli-pola , par Van-Rheede, au
volume H de fon Hortus Malabaricus, imprimé en
: 1692, planche X L , page 75). Jean Commelin, dans
fes notes fur cet ouvrage , dit que cette plante eft la
même que Herman fit graver en 1687, dans fon
Hortus Lugduno-Batavus, page 633 , planche C V Iy
fous
fôus le nom dé narciffus Zeylanicus flore albo hexà-
gono odorato , lunala Zeylanenflbus , 8c dont il a fait
lui-même graver depuis une figure en 1697, au
premier volume de fon Hortus Amflelodantenjis. M. Linné
, fur l’affertion de J. Commelin, 8c fans vérifier
ces figures, qui lui euffent appris que le lunala de
Çeÿlàh n’a qu’une feule fleur, pendant que le catulli
mi Malabàr en porte plufieurs fur une même tige >
îes a confondu toutes deux * foüs lé nom commun
de pancratium 1 Zeylanicum , fpathâ unfiorâ f petalis
reflexis. Voye£ fon Species plantarum, imprimé en
1753 , page 2C)0, 8c fonSyflema naturce, édition 12,
imprimée en 1767 9page
Sur une touffe de racines fibreufes blanches, longues
de deux à trois pouces, fur une ligne de dia-
rfnetfe, s’élève une bulbe fphéroïde de deux pouces
8c demi de diamètre , blanchâtre, formée de tuniques
èntieres, non fendues, qui les enveloppent entière^
ment, 8c qui font la bafe des quatre à cinq feuilles
alternes qui les couronnent j étant difpofées en éventail
, de maniéré qu’elles paroiffent oppofées triangulaires
, longues d’un pied Sc demi * à peine larges
d’un pouce, creufesen-deffus, relevées en côte en-
deffous , ftriées en long, écartées d’abord fous un
angle dé quarante-cinq dégrés, enfuite arquées 8c
pendahtes eii demi-cerclé.
Du centfe de ces feuilles s’élevé Une tige fimple,
line fois plus courte qu’elles , demi-cylindrique ,
très-comprimée, v erte, portant à fon extrémité une
ombelle de fept à huit fleufs feffiles, une fois plus
courtes qu’e lle , blanches, écartées fous un angle
de quarante-cinq dégrés, fortant d’une fpathe ou
gaîne verte, une fois plus courte, triangulaire, arquée
én bas, deux fois plus longue que largéi
Cette fleur eft hermaphrodite, monopétale, liliacée
, régulière, pofée fur l’ovaire ; elle confifte en
un calice blanc, en tube cylindrique -, dont le Commet
eft terminé par fix divifiôns égales, prefqu’une
fois plus courtes que lui, elliptiques, pointues àüx
deux bouts j une fois plus longues que larges, relevées
en-deffous d’une cô te, épanouies horizontale^-
ment en étoile : outre ces fix divifiôns , ce calicé
porte intérieurement au fommet de fon tube un nectaire
évafé, en forme de corolle, blanche pareillement
, quatrè fois plus courbe qu’elle j & partagée
çn douze denticules triangulaires , équilatéraux,
rapprochés par paires, & alternes avec ces divifiôns ;
fix étamines égales, fort peu plus longues que ce
neftaire, font attachées comme lui au fommet du
tube, & oppofées à chacune des divifiôns du calice;
elles font blanches, terminées par des anthères jaunes,
oblongues, couchées horizontalement. L’ovaire
•eft placé au-deffous du calice qui l’enveloppe,& avec
lequel il fait corps, fous la forme d’un oeuf-verdâtre
, quatre à cinq fois plus court que le tube : il eft
terminé par un ftyle cylindrique, blanchâtre, auffi
long que les divifiôns du calice, & couronné par un
ftigmate cylindrique velouté.
Cet ovaire en muriffant devieht une capfule fphéroïde
à trois loges, contenant chacune plufieurs graines
• fphéroïdes , blanchâtres , à chair blanche j
^queufe.
Culture. Le catulli croît au Malabar, dans les terres
fablonneufes ; il fleurit une fois tous’ les ans, dans
la faifon des pluiesi Cultivé dans nos ferres, en Europe,
il fleurit en juillet, mais avec beaucoup de
peine, fans y porter fes fruits à maturité : il exige
beaucoup de chaleur & de foins.
Qualités. Ses fleurs répandent une odeur foible,
mais gracieufe.
Ufages. Sa racine, c’eft-à-dire, fon bulbe, féché
au foleil & réduit eh poudre, s’unit avec, le fucre
noir, c’eft-à-dire, la melaffe, pour former une emplâtre
, qui s’applique avec fuecès fur lçs bimôrrhçï-
Tome II,
des i fa decoâion dans l’eau > empîôÿéë en fomen*
tation ou en bain fur ces parties, a de même la pro*
priété de les guérir ; ôn l’appliqué cuit & pilé eri
formé de cataplafme fur les tumeurs que l’on veut
Ü M faire abcéder. L’huile dans laquelle oii
la laifle macerer, ainfi cuit * fert avantâgeufement
pour frotter les parties attaquées de la goutte; Les
douleurs des ongles ceffent dès qu’on les a enveloppées
quelque tems daris fes feuilles;
Remarques. Le lunala de Geylan diffère du catulli f
en ce que, i°-. il eft plus petit dans toutes fes parties,
excepte fes fleurs qui font plus grandes ; 20. fes
fleurs font folitaires fur chaque tige , comme dans
l atamofco; 3^. les feuilles du- calice font une fois
plus longues que le tube , très-étroites * cinq à fix:
fois plus longues que larges, recourbées en-deflous ;
4 *^ s ^ am\nes fo°t auffi longues que les divifionsi
D ’oîi il fuit que M. Linné a eu tort de confondre
enfemble ces deux efpeces de plantes, qui different
autant que deux efpeces d’un même genre peuvent
différer : elles font du genre du pancratium, qui fè
range naturellement dans la famille des liliaeées, à
la feptieme feftion des narcifles, où nous l’avons
placée. Voye^ aos Familles des plantes, volume II^
page Sy. ( M. A d a n so n . )
§ CAVA1LLON ; ( Géogr. ) en latin CabtlUo ;
ntuee dans le territoire desCàvares, ou félon Stra-
bon Cabdllion. Pline met cette ville au nombre d,es
villes ^ Latines ; & Ptolomée lui donne le titre dé
colonie. Etiennë de Byfance en fait une ville Mari
feilloife ; fa pofition eft marquée dans l’itinérairê
d Antonin & dans la table Théodofienne. Dans la
notice des provinces de la G au le ; Civitas-Ca-
bellicorum eft une de celles de la Viennoife : cette ville
eft la patrie du bienheureux Céfar de Bus, inftituteur,
des Doôrinaires ( C.~)
CAVALAM, f. ni. ÇHiJÎ, nat. Èotaniq. ) arbrè
du Malabar, très-bien gravé fous ce nom , avec là
plupart de fes détails, par Van-Rheede , dans fon
Hortüs Malabaricus ; volume ƒ , imprimé eh 1678 ,
planche X L I X , page Sc) ; les Brames l’appellent
bencaro, les habitans de Ceylari riawaghaS', J. Com-
m d in , dans fes notes, le défigne fous le nom de
nux Malabaric'afulcatamücUaginofa fabàcea. M. Linné,
dans fon Species plantarum j imprimé en Î753 ,
page iooy , &dansfon Syflema naturce, édition 12 y
imprimé en ï 7 6 7 , l’appelle flerculia i , balanghas
foliis ovatis integerrimis ■> alternis, puiolatis j floribus
paniculatis.
Il s’élève à la hauteur de cinquante à foixante
pieds ; fon tronc eft droit, cylindrique , haut de
douze à quinze pieds > fur trois pieds environ de diamètre
,, couronné par une cime fphéroïde j épaiffe,
formée par nombre de grolfes branches cylindriques i
écartées d abord fous un angle de quarante-cinq dégrés
, enfuite horizontalement, à bôîs blanc filandreux
^ recouvert d’uné écorce cendrée verte
d’abord, enfuite cendrée épaiffe i verd-blanchâtre
intérieurement;
Sa racine eft grofle , pivotante, c’eft-à-dire, pique
droit en terre, en fe ramifiant tout autour, 6c recouverte
d’une écorce épaiffe, cendré-blanche.
Les feuilles font altérnes, difpofées circulairement
le longd es branches $ elliptiques 5 pointues aux deux
extrémités, longues de iept à dix pouces , une fois
moins larges, entières, minces, lifl'es , luifanres ,
verd-brunes deflus , encore plus brunes en-deffous>
relevées d’une côte longitudinale j ramifiée en cinq
à fept paires de nervures alternés, & portées fous,
un angle de quarante-cinq dégrés d’ouverture , fur
un pédicule cylindrique, fix fois plus cou rt, renflé
vers fon extrémité, & attaché aux branches à des
diftances d’un à deux pouces,
jrfs branches font terminées par une panîcule eii
Mm