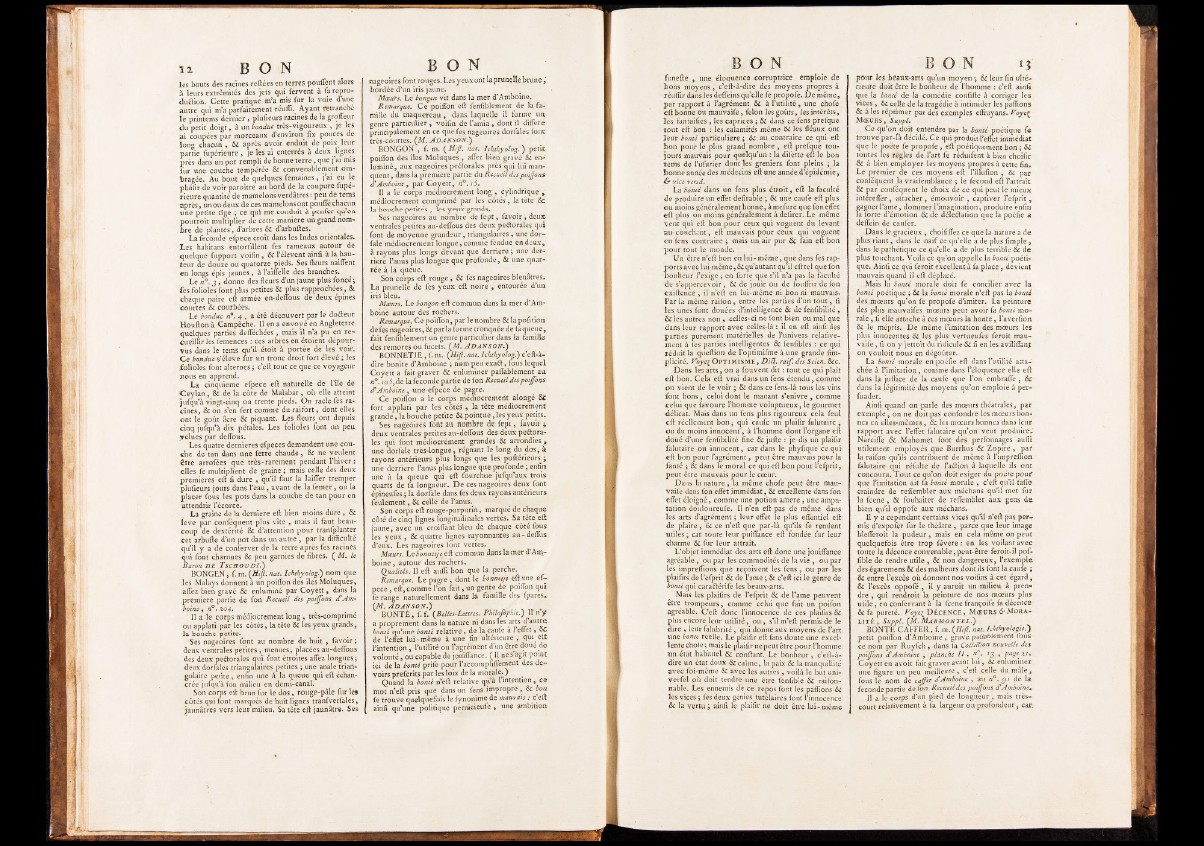
les bouts des racines reftées en terres pouffent alors
à leurs extrémités des jets qui fervent à la reproduction.
Cette pratique m’a mis fur la voie d’une
autre qui m’a parfaitement reuffi. Ayant fttranche
le printems dernier> plulieurs racines de la groffeur
du petit doigt, à un bonduc très-vigoureux , je les
ai coupées par morceaux d’environ lix pouces de
long chacun , 8c après avoir enduit de poix leur
partie fupérieure , je les ai enterrés à deux fignes
près dans un pot rempli de bonne terre, que j ai mis
fur une couche tempérée 8c convenablement ombragée.
Au bout de quelques femaines, j ai eu le
plailir de voir paroître au bord de la coupure fupérieure
quantité dé mamelons verdâtres: peu de tems
après, un on deux de ces mamelons ont poulïè chacun
une petite tige ; ce qui me conduit à penfer qu’on
pourroit multiplier de cette maniéré un grand nombre
de plantes, d’arbres 8c d’arbuftes.
La fécondé efpece croît dans les Indes orientales.
Les habitans entortillent fes rameaux autour de
quelque fupport voilin, 8c l’élevent ainli à la hauteur
de douze ou quatorze pieds. Ses fleurs naiffent
en longs épis jaunes, à l’aiuelle des branches. ^
Le n°. j , donne des fleurs d’un jaune plus foncé;
fes folioles font plus petites 8c plus rapprochées , &
chaque paire eft armée en-deffous de deux épines
courtes 8c courbées.
Le bonduc n°. 4 , a été découvert par le doéteur
Houfton à Campêche. Il en a envoyé en Angleterre
quelques parties defféchées , mais il n’a pu en recueillir
les femences : ces arbres en étoient dépourvus
dans le tems qu’il étoit à portée de-les voir.
Ce bonduc s’élève Au- un tronc droit fort élevé ; les
.folioles font alternes ; c’eft tout ce que ce voyageur
nous en apprend.
La cinquième efpece eft naturelle de l’île de
C e y la n , 8c de la côte de Malabar , oîi elle atteint
jufqu’à vingt-cinq ou trente pieds. On racle fes racines,
& on s’en fert comme du raifort, dont elles
ont le goût âcre 8c piquant. Les fleurs ont depuis
cinq jufqu’à dix pétales. Les folioles font un peu
ye'lues par deffous.
Les quatre dernierescfpeces demandent une couche
de tan dans une ferre chaude, 8c ne veulent
titre arrofées que très-rarement pendant l’hiver:
elles fe multiplient de graine ; mais celle des deux
premières eft fi dure , qu’il faut la laiffer tremper
plufieurs jours dans l’eau, avant de la femer, ou la
placer fous les pots dans la couche de tan pour en
attendrir l’écorce.
La graine de la derniere eft bien moins dure, 8c
leve par conféquent plus vîte , mais il faut beaucoup
de dextérité 8c d’attention pour tranfplanter
cet arbufte d’un pot dans un autre , par la difficulté
qu’il y a de conferver de la terre après fes racines
qui font charnues 8c peu garnies de fibres. ( M. le
Baron DE TscnoUDI.')
BONGEN, f. m. {Hijl. nat. Ickthyolog.) nom que
les Malays donnent à un poiffon des îles Moluques,
affez bien gravé 8c enluminé par C o y e tt, dans la
première partie de fon Recueil des poijfons d’Amboine
, n°. 204.
Il a le corps médiocrement lon g , très-comprimé
ou applati par les côtés, la tête 8c les yeux grands,
la bouche petite.
Ses nageoires font au nombre de huit , favoir ;
deux ventrales petites, menues, placées au-deffous
des deux peÛorales qui font étroites affez longues ;
deux dorfales triangulaires petites ; une anale triangulaire
petite, enfin une à là queue qui eft échan-
crée jufqu’à fon milieu en demi-canal.
Son corps eft brun fur le dos, rouge-pâle fur le»
côtés qui font marqués de huit lignes tranfverfales,
jaunâtres vers leur milieu. Sa tête, eft jaunâtre. Ses
nageoires font rouges. Les yeux ont la prunelle brune 9
bordée d’un iris jaune:}
Moeufs. Le bongen vit dans la mer d’Amboine.
Remarque. Ce poiffon eft fenfiblement de la famille
du maquereau , dans laquelle il forme un
genre particulier , voifin de l’amia , dont il diffère
principalement en ce que fes nageoires dorfales font
très-courtes. {M. A d a n so n .)
BONGON , f. m. ( Hijl. nat. Ickthyolog. ) petit
poiffon des îles Moluques , affez bien gravé 8c enluminé,
aux nageoires pectorales près qui lui manquent
, dans la première partie du Recueil despoijjons,
aAmboine, par C o y e tt, n°. ï5.
Il a lé corps médiocrement long , cylindrique ,
médiocrement comprimé par les côtés, la tête 8c
la bouche petites , les yeux grands.
Ses nageoires au nombre de fept, favoir ', deux
ventrales petites au-deffous des deux pectorales qui
font de moyenne grandeur, triangulaires , une dor-
fale médiocrement longue, comme fendue en deux,
à rayons plus longs devant que derrière ; une derrière
l’anus plus longue que profonde, & une quar-
rée à la queue.
Son corps eft rouge, 8c fes nageoires bleuâtres.
La prunelle de fes yeux eft noire , entourée d’un
iris bleu.
Moeurs. Le bongon eft commun dans la mer d’Amboine
autour des rochers.
Remarque. C e poiffon, par le nombre 8c la pofition
de fes nageoires, 6c par la forme tronquée de fa queue,
fait fenfiblement un genre particulier dans la famille
des remores oufucets. (AL A d a n s o n .)
BONNETJE, f. m. {Hijl. nat. Ichthyolog.) c’eft-à-
dire bonite d’Amboine ; nom peu exaCt, fous lequel
Coyett a fait graver 8c enluminer paffablement au
n°. 10S, de la fécondé partie de fon Recueil des poijfons
d’Amboine, une efpece de pagre.
Ce poiffon a le corps médiocrement alongé &
fort applati par les côtés , la tête médiocrement
grande, la bouche petite & pointue, les yeux petits.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ;
deux ventrales petites au-deffous des deux pectorales
qui font médiocrément grandes 8c arrondies ,
une dorfale très-longue, régnant le long du dos, à
rayons ahtérieurs plus longs que les pofterieùrs ;
une derrière l’anus plus longue que profonde ; enfin
une à la queuê qui eft fourchue jufqu’aux trois
quarts de fa longueur. De ces nageoires deux font
épineufes ; la dorfale dans fes deux rayons antérieurs
feulement, 8c celle de l’anus.
Son corps eft rouge-purpurin, marqué de chaque
côté de cinq lignes longitudinales vertes. Sa tete eft
jaune, avec un croiffant bleu de. chaque cote fous
les yeux , 8c quatre lignes rayonnantes au-deffus
d’eux. Les nageoires font vertes.
Moeurs. Le bonnetje eft commun dans la mer d’Am-
boine, autour des rochers.
Qualités. Il eft aufli bon que la perche.
Remarque. Le pagre, dont le bonnetje eft une efpece
, eft, comme l’on fait, un genre de poiffon qui,
fe range naturellement dans la famille des fpares,
CM. A d a n s o n .')
BON TÉ , f .f . (.Belles-Lettres. Philofàphie.) J!n’y
a proprement dans la nature ni dans les arts d auI£S
bonté qu’une bonté relative, de la caufe à 1 effet f oc
de l’effet lui-même à une fin-ultérieure , qu» elt
l’ intention , l’utilité ou l’agrément d’un être doue de
volonté, ou capable de jouiffance. ( Il ne s agit point
ici de la bonté prife pour l’accorapliflèment des devoirs
preferits par les loix de la morale^)
Quand la bonté n’eft relative qu’à l’intention, ce
mot n’eft pris que dans un fens impropre , 8c bon
fe trouve quelquefois le fynonime de mauvais : ceft
ainfi qu’une politique pernicieufe , une ambition
funefte., une éloquence corruptrice. emploie de
bons moyens , c’eft-à-dire des moyens propres à
réuflir dans les deffeins qu’elle fe propofe. De même ,
par rapport à Tagrément 8c à futilité, une chofe
eft bonne ou mauvaife , félon les goûts, les intérêts,
les fantaifies , les caprices ; 8c dans ce fens pfefque
tout eft bon les calamites même 8c les fléaux ont
leur bonté partituliere ; 8c au, contraire ce qui eft
bon pour le plus grand nombre , eft prefque toujours
mauvais pour quelqu’un : la difette eft le bon
tems de Tufurier dç>nt les greniers font pleins ; la
bonne ahrîéë des médecins eft une année d’épidémie,
& vice versa. .
Là'bonté dans un fens plus étroit, eft la faculté
de produire un effet defirable ; 8c une caufe eft plus
ou moins généralement bonne, à mefure que fon effet
eft plus ou moins généralement à defirer. Le même
vent qui eft bon pour ceux qui voguent du levant
au couchant, eft mauvais pour ceux qui voguent
en fens contraire ; mais un air pur 8c fain eft bon
pour tout le monde.
Un être n’eft bon en lui-même, que dans fes rapports
avec lui-même, 8c qu’autant qu’il eft tel que fon
bonheur l’exige ; en forte que s’il m’a pas-la faculté
de s’appercevoir, 8c de jouir ou de fouffrir de fon
exiftence , i f n’eft en lui-même ni bon ni mauvais.
Par la même raifon, entre les parties d’un tou t, fi
les unes font douées d’intelligence & de fenfibilité ,
8c les autres non , celles-ci ne font bien ou mal que
dans leur rapport avec celles-là : il en eft ainfi des
parties purement matérielles de l’univers relativement
à fés partiès intelligentes 8c fenfibles : ce qui
réduit la queftion de l’optimifme à une grande fim-
plicité. Voye{ OPTIMISME, Dicl, raif. des Scien. 8cc.
Dans les arts, on a fouvent dit : tout ce qui plaît
eft bon. Cela eft vrai dans un fens étendu, comme
on vient de le voir ; 8c dans ce fens-là tous les vins
font bons, celui dont le manant s’enivre , comme
celui que favoure l’homme voluptueux, le gourmet
délicat. Mais dans un fens plus rigoureux cela feul
eft réellement bon, qui caufe un plaifir falutaire,
Ou du moins innocenté, à l’homme dont l’organe eft
doué d’une fenfibilité fine 8c jufte : je dis un plaifir
falutaire ou innocent, car dans le phyfique ce qui
eft bon pour l’agrément, peut être mauvais pour la
fanté ; 8c dans le moral ce qui eft bon pour l’efprit,
peut être mauvais pour le coeur.
Dans la nature, la même chofe peut être mauvaife
dans fon effet immédiat, 8c excellente dans fon
effet éloigné, comme une potion amere , une amputation
dpuloureufe. Il n’en eft pas de même dans
les arts d’agrément ; leur effet le plus effentiel eft
de plaire, 8c ce n’eft que par-là qu’ils fe rendent
utiles ; car toute leur puiffance eft fondée fur leur
charme 8c fur leur attrait.
L’objet immédiat des arts eft donc une jouiffance
agréable, ou par les commodités de la vie , ou par
les impreflions que reçoivent les fens , ou par les
plaifirs de l’efprit 8c de l’ame ; 8c c’eft ici le genre de
bonté qui caraétérife les beaux-arts.
Mais les plaifirs de l’efprit 8c de Pâme peuvent
etre trompeurs, comme celui que fait un poifon
agréable. C’eft donc l’innocence de ces plaifirs 8c
plus encore leur utilité, o u , s’il m’eft permis de le
dire , leur falubrité, qui donne aux moyens de l’art
une bonté réelle. Le plaifir eft fans doute une excellente
chofe ; mais le plaifir ne peut être pour l’homme
Un état habituel 8c confiant. Le bonheur, c’eft-à-
dire un état doux 8c calme, la paix 8c la tranquillité
avec foi-même 8c avec les autres , voilà le but.uni-
verfel où doit tendre une être fenfible 8c raifon-
nable. Les ennemis de ce repos font les paffions 8c
les viçes ; fes deux génies tutélaires font l’innocence
,8c la vertu ; ainfi le plaifir ne doit être lui-même
pour les beaux-arts qu’un moyen *, 8c leur fin ultérieure
doit être le bonheur de l’homme : c’eft ainfi
que la bonté de la comédie çonfifte à corriger les
vices , 8c celle de la tragédie à intimider les paffions
8c à les réprimer par des exemples effrayans. Voye^
Moeurs, Suppl.
Ce qu’on doit entendre par la bonté poétique fe
trouve par-fà décidé. Ce qui produit l’effet immédiat
que le poète fe propofe, eft poétiquement bon ; 8c
toutes les réglés de l’art fe réduifent à bien choifir
8c a bien employer les moyens propres à cette fin.
Le premier de ces moyens eft l’illufion , 8c par
conféquent la vraifemblancé ; le fécond eft l’attrait
8c par conféquent le choix de ce qui peut le mieux
intéreffer, attacher, émouvoir , captiver l’efprit,
gagner Tarne, dominer l’imagination, produire enfin
la forte d’émotion 8c de délégation que la poéfie a
deffein de caufer.
Dans le gracieux , choififfez ce que la nature a de
plus riant, dans le naïf ce qu’elle a de plus fimple,
dans le pathétique ce qu’elle a de plus terrible & de
plus touchant. Voilà ce qu’on appelle la bonté poétique.
Ainfi ce qui feroit excellent à fa place, devient
mauvais quand il eft déplacé«
Mais la bonté morale doit fe concilier avec la
bonté poétique ; 8c la bonté morale n’eft pas la bonté
des moeurs qu’on fe propofe d’imiter. La peinture
des plus mauvaifes moeurs peut avoir fa bonté morale
, fi elle attache à ces moeurs la honte, l’averfion
8c le mépris. De même l’imitation des moeurs les
plus innocentes 8c les plus vertueufes feroit mauvaife
, fi on y jettoit du ridicule 8c fi en les aviliffant
on vouloit nous en dégoûter.
La bonté morale en poéfie eft dans l’utilité attachée
à l’im itation, comme dans l’éloquence elle eft
dans la juftice de la caufe que Ton embraffe , 8c
dans la légitimité des moyens qu’on emploie à per-
fuader.
Ainfi quand on parle des moeurs théâtrales, par
exemple, on ne doit pas confondre les moeurs bonnes
en elles-mêmes, 8c les moeurs bonnes dans leur
rapport avec l’effet falutaire qu’on veut produire»
Narciffe 8c Mahomet font des perfonnages aufli
utilement employés que Burrhus 8c Zopire, par
la raifon qu’ils contribuent de même à l’impreflion
falutaire qui réfulte de l’aélion à laquelle ils ont
concouru. Tout ce qu’on doit exiger du poète pour
que l’imitation ait fa bonté morale , c’eft qu’il faffe
craindre de reffembler aux méchans qu’il met fur
la feene, 8c fouhaiter de reffembler aux gens de
bien qu’il oppofe aux méchans.
Il y a cependant certains vices qu’il n’eft pas permis
d’expofer fur le théâtre , parce que leur image
blefferoit la pudeur, mais en cela même on peut
quelquefois être trop févere : en les voilant avec
toute la décence convenable, peut-être feroit-il pof-
fible de rendre utile , 8c non dangereux, l’exemple
des ëgaremens 8c des malheurs dont ils font la caufe ;
8c entre l’excès où donnent nos voifins à cet égard,
8c l’excès oppofé , il y auroit un milieu à prendre
, qui rendroit la peinture de nos moeurs plus
utile, en confervant à la feene françoife fa décence
8c fa pureté. Voye1 D écence, Moeurs & Moralité
, Suppl. {M. Marmontel.)
BONTE CAFFER, f. m. {Hiß. nat. Ichthyologie.')
petit poiffon d’Amboine , gravé paffablement fous
ce nom par R u y fch d a n s fa Collection nouvelle des
poijfons d’Amboine , planche I I , n°y ’3 r Pa§e_ ■l , ‘
Coyett en avoit fait graver avant lu i, 8c enlummer
une figure un peu meilleure, ceft celle du male,
fous le nom de cafter £Amboine , au n°;Ç)i de la
fécondé partie de ton Recueil des poijfons £ Amboine*
Il a le corps d’un pied de longueur , mais très-
court rèlativement à fa largeur ou profondeur, car.