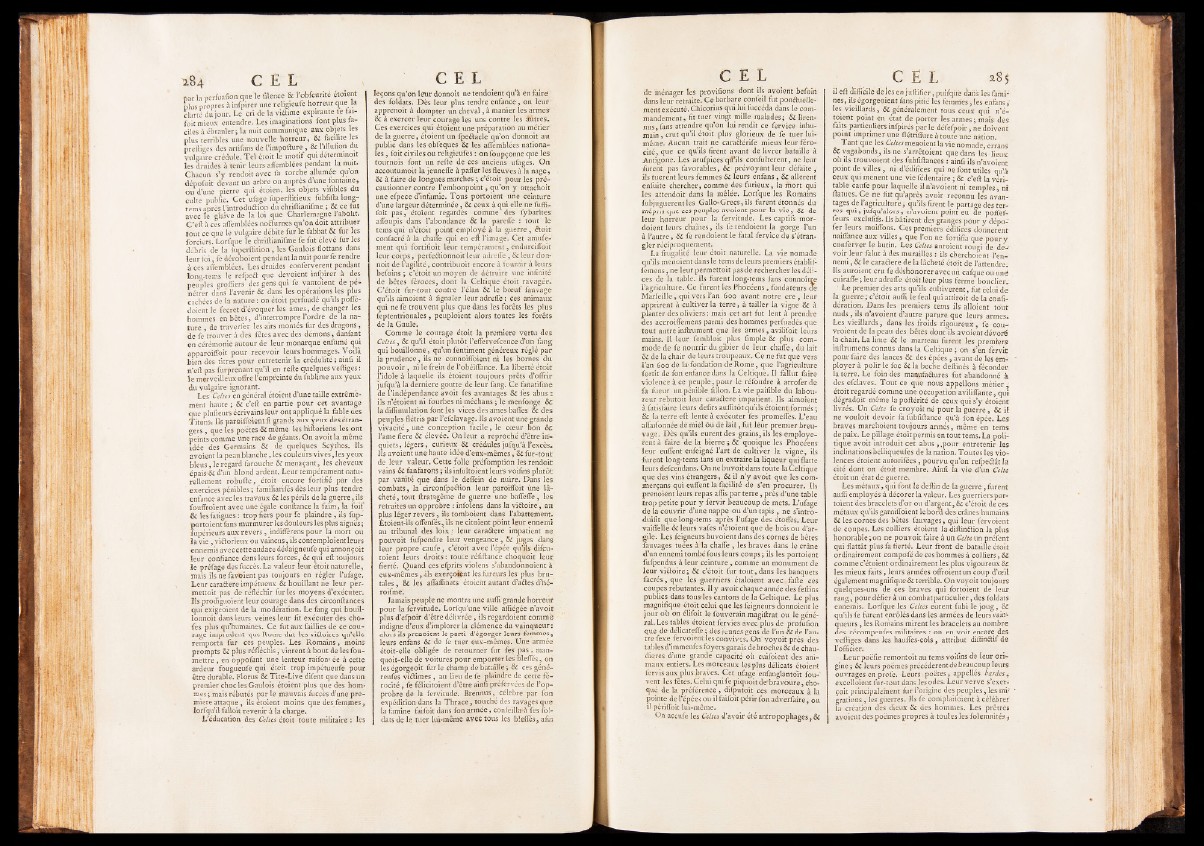
par la perfuafion que le filence & l’obfcurité étoient
plus propres àinfpirer une religieufe horreur que la
Clarté du jour. Le Cri de la viaime expirante le tai-
folt mieux entendre. Les imaginations font plus faciles
à ébranler; la nuit communique aux objets les
plus terribles une nouvelle horreur, 8c facilite les
preftiges des artifans de l’impofture , 8c l’illufion du
vulgaire crédule. T e l étoit le motif qui determinoit
les druides à tenir leurs afl'emblées pendant la nuit*
Chacun s’y rendoit avec fa torche allumée quon
dépofoit devant un arbre ou auprès d’une fontaine,
ou d’une pierre qui étoien. les objets vifibles du
culte public. Cet ufage fuperftitieux fubfifta long-
tems après l’introduaion du chriftianifme.; 8c ce fut
avec îe glaive de la loi que Charlemagne l’abolit.
C ’eft à ces afl'emblées no&urnes qu’on doit attribuer
tout ce que le vulgaire débité fur le fabbat 8c fur les
forciers. Lorfque le chriftianifme fe fut élevé fur les
débris de la iuperftitiôn, les Gaulois flottans dans
leur fo i, fe déroboient pendant la nuit pourfe rendre
à ces afl'emblées. Les druides conferverent pendant
long-tems le refpeû que dévoient infpirer à des
peuples groflîers des gens qui fe vantoient de pénétrer
dans* l’avenir 8c dans les opérations les plus
cachées de la nature : on étoit perfuadé qu’ils poffé-
doient le fecret d’évoquer les âmes, de changer les
hommes en bêtes, d’interrompre l’ordre de la nature
de traverfer les airs montés fur des dragons,
de fe trouver à des fêtes avec des démons, danfant
en cérémonie autour de leur monarque enfumé qui
apparoiffoit pour recevoir leurs hommages. Voilà
bien des titres pour entretenir la crédulité ; ainfi il
n’eft pas furprenant qu’il en refte quelques veftiges :
le merveilleux offre l’empreinte du fublime aux yeux
du vulgaire ignorant.
Les Celtes en général étoient d’une taille extrêmement
haute ; & c’eft en partie pour cet avantage
que plufieurs écrivains leur ont appliqué la fable des
Titans. Ils paroiffoient fi grands aux yeux des étrangers
, que les poètes 8c même les hiftoriens les ont
peints comme une race de géants. On avoit la même
idée des Germains 8c de quelques Scythes. Ils
avoient la peau blanche, les couleurs vives, les yeux
bleus, le regard farouche 8c menaçant, les cheveux
épais-& d’un blond ardent. Leur tempérament naturellement
robufte, étoit encore fortifié par des
exercices pénibles ; familiarifés dès leur plus tendre
enfance avec les travaux 8c les périls de la guerre, ils
fouffroient avec une égale confiance la faim, la foif
& les fatigues : trop fiers pour îe plaindre , ils fup-
portoient fans murmurer les douleurs les plus aiguës ;
fupérieurs aux revers, indifférens pour la mort ou
la vie , viûorieux ou vaincus-, ils contemploient leurs
ennemis avec cette audace dédaigneufe qui annonçoit
leur confiance dans leurs forces, 8c qui eft toujours
le préfage desfuccès.La valeur leur étoit naturelle,
mais ils ne favfcient pas toujours en régler l’ufage.
Leur caraéfere impétueux 8c bouillant ne leur per-
mettoit pas de réfléchir fur les moyens d’exécuter.
Ils prodiguoierit leur courage dans des circonftances
. qui exigeoient de la modération. Le fang qui bouil-
lonnoit dans leurs veines leur fit exécuter des cho-
fes plus qu’humaines. Ce fut aux faillies de ce courage
imprudent que Rome dut les victoires qu’elle
remporta fur ces peuples. Les Romains, moins
prompts 8c plus réfléchis,’ vinrent à bout de les fou-
mettre , en oppofant une lenteur raifonr ée à cette
ardeur fougueufe qui éîcit trop impétueufe pour
être durable. Florus 8c T ite-Live difent que dans un
premier choc les Gaulois étoient plus que des hommes
; mais rébutés par le mauvais fuccès d’une première
attaque , ils étoient moins que des femmes,
lorfqu’il falloit revenir à la charge.
L ’éducation des Celtes étoit toute militaire : les
leçons qu’on leur donnoit ne tendoient qu’à en faire
des foldats. Dès leur plus tendre enfance, on leur
apprenoit à dompter un cheval, à manier les armes
8c à exercer leur courage les uns contre les âûtres.
Ces exercices qui étoient une préparation au métier
de la guerre, étoient un fpeftacle qu’on donnoit au
public dans les obfeques 8c les afl'emblées nationales
, foit civiles ou religieufes : on foupçonne que les
tournois font un refte de ces anciens ufages. On
accoutumoit la jeuneffe à paffer les fleuves à la nage,
8c à faire de longues marches ; c’étoit pour les. précautionner
contre l’embonpoint, qu’on y attachoit
une efpeee d’infamie. Tous portoiertt une ceinture
d’une largeur déterminée, 8c ceux à qui elle ne fuffi-
foit pas, étoient regardés comme des fybarites
affoupis dans l’abondance 8c la pareffe : tout le
tems qui n’étoit point employé à la guerre, étoit
confacré à la chafle qui en eft l’image. Cet amufer
ment qui fortifioit leur tempérament, endurciffoit
leur corps, perfe&ionnoit leur adreffe , & leur donnoit
de l’agilité, contribuoit encore à fournir à leurs
befoins ; c’étoit un moyen de détruire une infinité
de bêtes féroces, dont la Celtique étoit ravagée.
C ’étoit fur-tout contre l’élan 8c le boeuf fauvage
qu’ils aimoient à fignaler leur adreffe : ces animaux
qui ne fe trouvent plus que dans les forêts les plus
feptentrionales, peuploient alors toutes les forêts
de la Gaule.
Comme le courage étoit la première vertu des
Celtes, & qu’il étoit plutôt l’effervefcence d’un fang
qui bouillonne, qu’un fentiment généreux réglé par
la prudence, ils ne connoiffoient ni les bornes du
pouvoir , ni le frein de l’obéiffance. La liberté étoit
l’idole à laquelle ils étoient toujours prêts d’offrir
jufqu’à la derniere goutte de leur fang. Ce fanatifme
de l ’indépendance avoit fes avantages 8c fes abus :
ils n’étoient ni fourbes ni méchans ; le menfonge 8c
la diflimulation font les vices des âmes baffes 8c des
peuples flétris par l’efclavage. Ils avoient une grande
vivacité, une conception facile, le coeur bon 8c
l’ame fiere 8c élevée. On leur a reproché d’être in-
quiets, légers, curieux 8c crédules jufqu’à l’excès.
Ils avoient une haute idée d’eux-mêmes, 8c fur-tout
de leur valeur. Cette folle préfomption les rendoit
vains 8c fanfarons ; ils infiiltoient leurs voifins plutôt
par vanité que dans le deffein de nuire. Dans les
combats, la circonfpecfion leur paroiffoit line lâcheté,
tout ftratagême de guerre une baffeffe, les
retraites un opprobre : infolens dans la vittoire, au
plus léger revers, ils tomboient dans l’abattement.
Étoient-ils offenfés, ils ne citoient point leur ennemi
au tribunal des loix : leur cara&ere impatient ne
pouvoit fufpendre leur vengeance, 8c juges dans
leur propre caufe, c’étoit avec l’épée qu’ils difçu-
toient leurs droits : toute réfiftance choquoit leur
fierté. Quand ces efprits violens s’abandonnoient à
eux-mêmes, iis exerçoèent les fureurs les plus brutales
, 8c les affaflinats étoient autant d’attes d’hé-
roïfme.
Jamais peuple ne montra une auffi grande horreur
pour la fervitude. Lorfqu’une ville afliégée n’avoit
plus d’efpoir d’être délivrée , ils regardoient commè
indigne d’eux d’implorer la clémence du vainqueur :
alors ils prenoient le parti d’égorger leurs femmes,
leurs enfans 8c de fe tuer eux-mêmes. Une armée
étoit-elle obligée de retourner fur fes" pas „ man-
quoit-elle de voitures pour emporter les blefles, on
les égorgeoit fur le champ de bataille ; 8c ces géné-
reufes viftimes , au lieu de fe plaindre de cette férocité,
fe félicitoient d’être ainfi préfervées de l’opprobre
de la fervitude. Brennus, célébré par fon
expédition dans la Thrace, touche des ravages que
la famine faifoit dans fon armée, confeilla*à fes foldats
de le tuer lui-même avec tous les bleffés, afin
de ménager les provifions dont ils avoient befoiri
dans leur retraite. Ce barbare confeil fut ponâuelle-;
ment exécuté. Chicorius qui lui fucceda dans le commandement,
fit tuer vingt mille malades; 8c Brën-
nus, fans attendre qu’on lui rendît ce fervice inhumain
, crut qu’il étoit plus glorieux de fe tuer lui-
même. Aucun trait ne caraâérife mieux leur férocité,
que ce qu’ils firent avant de livrer bataillé à
Antigone. Les arufpices qd’ils confulterent, ne leur
furent pas favorables, 8c prévoyant leur défaite,
ils tuerent leurs femmes 8c leurs enfans, 8c allèrent
enfuite chercher, comme des furieux, la mort qui
les attendoit dans la mêlée. Lorfque les Romains
fubjuguerent les Gallo-Grecs, ils furent étonnés du
mépris que ces peuples avoient pour la v ie , 8c de
leur horreur pour la fervitude. Les captifs mor-
doient leurs chaînes, ils fe tendoient la gorge l’un
à l’autre, 8c fe rendoient le fatal fervice de s’étrangler
réciproquement.
La frugalité leur étoit naturelle. La vie nomade
qu’ils menoient dans le tems de leurs premiers établif-
femens? ne leur permettoit pas de rechercher les délices
de la table. Ils furent long-tems fans connoître
l’agriculture. Ce furent les Phocéens, fondateurs de
Marfeille, qui vers l’an 600 avant notre ere , leur
apprirent à cultiver la terre, à tailler la vigne 8c à
planter des oliviers : mais cet art fut lent à prendre
des accroiffemens parmi des hommes perfuadés que
tout autre infiniment que les armes, avilifoit leurs
mains. 11 leur fembloit plus fimple 8c plus commode
de fe nourrir du gibier de leur chaffe, du lait
8c de la chair de leurs troupeaux. Ce ne fut que vers
l ’an 600 de la*fondation de Rome, que l’agriculture
fortit de fon enfance dans la Celtique. Il fallut faire
violence à ce peuple, pour le réfoudre à arrofer de
fa fueur un pénible fillon. La v ie paifible du laboureur
rebutoit leur caraâere impatient. Ils aimoient
àfatisfaire leurs defirs aufîitôt qu’ils étoient formés ;
8c la terre eft lente à exécuter fes promeffes. L ’eau
affaifonnée de miel ou de lait, fut leur premier breuvage.
Dès qu’ils eurent des grains, ils les employèrent
à faire de la bierre ; 8c quoique les Phocéens
leur euffent enfeigné l’art de cultiver la vigne, ils
furent long-tems fans en extraire la liqueur qui flatte
leurs defcendans. On ne buvoit dans toute la Celtique
que des vins étrangers, 8c il n’y avoit que les com-
merçans qui euffent la facilité de s’en procurer. Ils
prenoient leurs repas affis par terre, près d’une table
trop petite pour y fervir beaucoup de mets. L ’ufage
de la couvrir d’une nappe ou d’un tapis , ne s’intro-
duifit que long-téms après l’ufage des étoffes. Leur
vaiffelle 8c leurs vafes n’étoient que de bois ou d’argile.
Les feigneurs buvoient dans des cornes de bêtes
fauyages tuées à la chaffe , les braves dans le crâne
d’un ennemi tombé fous leurs coups ; ils les portoient
fufpendus à leur ceinture, comme un monument de
leur vittôire ; 8c c’étoit fur tout, dans les banquets
facrés, que les guerriers étaloient avec,fafte ces
coupes rebutantes. Il y avoit chaque année des feftins
publics dans tous»les cantons de la Celtique. Le plus
magnifique étoit celui que les feigneurs donnoient le
jour oii on élifoit le fouverain magiftrat ou le général.
Les tables étoient fervies avec plus de profufion
que de déücateffe ; des jeunes gens de l’un 8c de l’autre
fexe fervoient les convives. .On" yoÿoit près des
tables d’immenfes foyers garnis de broches 8c de chau-
die,res d’une grande capacité oii cuifoient des animaux
entiers. Les morceaux les plus délicats étoient
fervis aux plus\braves. Cet ufage'enfanglantoit fou-
vent les fêtes. Celui qui fe piquoit de*bravoure, choqué
de la préférence , difputoit ces morceaux à la
pointe de l’épée-c ou il faifoit périr fon adverfaire, ou
il périffoit lui-même.
On accufe les Celtes d’ayoir été antropophages, 8c
il eft difficile d’e îes en jtiftifier, puifqüe dans les famines,
ils egorgeoient fans pitié les femnies, les énfàns ;
les vieillards, 8c généralement tous ceux qui n’étoient
point en état de porter lès armes; mais des
faits particuliers infpirés par le défefpoir j ne doivent
point imprimer une flétriffure à toute Une nation.
Tant que les Celtes menoient la vie nomade, errans
8c vagabonds, ils ne s’arrêtoient que dans les lieux
oîi ils trouvoient des fubfiftances : ainfi ils n’avoient
point de villes , ni d’édifices qui ne font utiles qu’à
ceux qui mènent une vie fédentaire ; 8c c’eft la véritable
caufe pour laquelle il n’avoient ni temples, ni
ftatués. Ce ne fut qu’après avoir reconnu les avantages
de l’agriculture; qu’ils firent le partage des terres
qui, jufqu’alors, n’avoient point eu de poffef-
feurs exclufifs. Ils bâtirent des granges pour y dépo-
fer leurs moiffons. Ces premiers édifices donnèrent
naiffance aux villes, que l’on ne fortifia que pour y
conferver le butin. Les Celtes auroient rougi de de-»
Voir leur falut à des murailles : ils cherchoierlt l’ennemi
, 8c le caraéfere de la lâcheté étoit de l’attendre;
Ils auroient cru fe déshonorer avec uri cafqueou uné
cuirâffe ; leur adreffe étoit leur plus ferme bouclier.
' Le premier des arts qu’ils cultivèrent, fut celui de
la guerre; c’étoit auffi le feul qui attiroit de la confi-
dération. Dans les premiers tems ils alloient to'ut
nuds, ils n’avoient d’autre parure que leurs armes;
Les vieillards, dans les froids rigoureux, fe cou-
vroient de la peau des bêtes dont ils avoient dévoré
la chair. La lime 8c le marteau furent les premiers
inftrumens connus dans la Celtique ; on s’en fervit
pour faire des lances 8c des épées , avant de les employer
à polir le foc 8c la beche deftinés à féconder
la terre. Le foin des manufactures fut abandonné à
des efclaves. Tout ce que nous appelions métier^
étoit regardé comme une occupation aviliffante, qui
dégradoit même la poftérité de ceux qui s’y étoient
livrés. Un Celte fe croyoit né pour la guerre, 8c il
ne vouloit devoir fa fubfiftance qu’à fon épée. Les
braves marchoient toujours armés, même en tems
de paix. Le pillage étoit permis en tout tems. La politique
avoit introduit cet abus , .pour entretenir les
inclinations belliqueufes de la nation. Toutes les v iolences
étoient autorifées , pourvu qu’on refpeétât la
cité dont on étoit membre. Ainfi la vie d’un Celte
étoit un état de guerre»
Les métaux, qui font le deftin de la guerre , furent
auffi employés à décorer la valeur. Les guerriers p.or-
toient des bracelets d’or ou d’argent, 8c c’étoit de ces
métaux qu’ils garniffoient le bord des crânes humains
8c les cornes des bêtes fauvages, qui leur fervoient
de coupes. Les colliers étoient la diftinétion la plus
honorable ; on ne pouvoit faire à un Celte lin préfent
qui flattât plus fa fierté. Leur front de bataille étoit
ordinairement compofé de ces hommes à colliers, 8c
comme c’étoient ordinairement les plus vigoureux 8c
les mieux faits, leurs armées offroient un coup d’oeil
également magnifique 8c terrible. On voyoit toujours
quelques-uns de ces braves qui fortoient de leur
rang, pour défier à un combat particulier, des foldats
ennemis. Lorfque les Celtes eurent fubi le jou g, 8c
qu’ils fe furent enrôlés dans les armées de leurs vainqueurs
, les Romains mirent les bracelets au nombre
des récompenfes militaires : on en voit encore des
veftiges dans les hauffes-cols, attribut diftinétif de
l’officier;
Leur poëfie remontoit au tems voifins de leur o r igine
; 8c leurs poëmes précédèrent de beaucoup leurs
ouvrages en profe. Leurs > poëtes* appellés bardes ;
excelloient fur-tout dans les odes* Leur, verve s’exer-
çoit principalement fur l’origine des peuples, les migrations
, les guerres. Ils fe coniplaifoierit à célébrer
la création des dieux 8c des hommes. Les prêtres
ayoient des poëmes propres à toutes les folemnités *