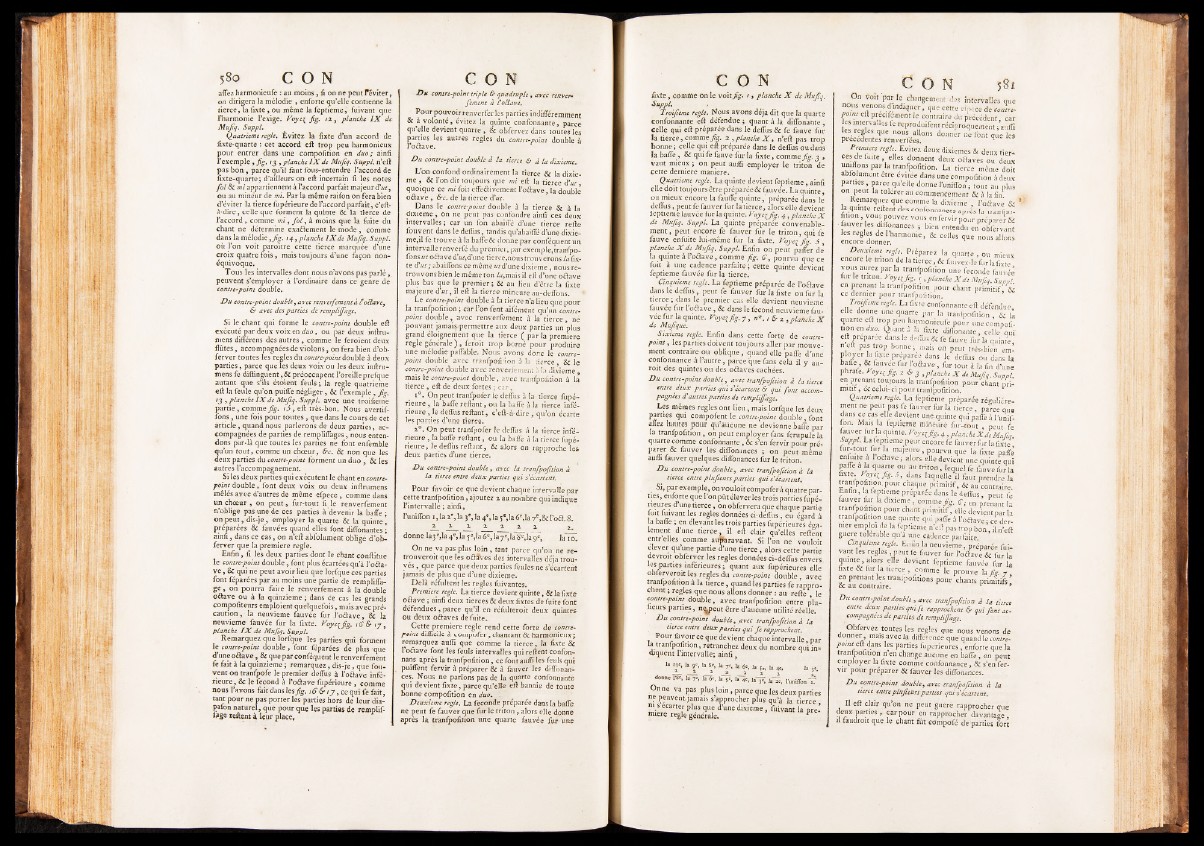
affez harmonieufe : au moins, fi on ne peutFéviter,
on dirigèra la mélodie , enforte qu’elle contienne la
tierce, la lixte, ou même la feptieme i fuivant que
l’harmonie l’exige. Voye%_ fig. 12. , planche IX de
Mujîq. Suppl.
Quatrième réglé. Évitez la fixte d’un accord de
fixte-quarte : cet accord eft trop peu harmonieux
pour entrer dans une compolition en duo; ainfi
l’exemple, fig. 13 , planche I X de Mujîq. Suppl, n’eft
pas bon , parce qu’il faut fous-entendre l’accord de
fixte-quarte; d’ailleurs on eft incertain fi les notes
fo l & mi appartiennent à l’accord parfait majeur d’ut,
ou au mineur de mi. Par la même raifon on fera bien
d’éviter la tierce fupérieure de l’accord parfait, c’eft-
à-dire, celle que forment la quinte 8c la tierce de
l’accord, comme mi, f o l , à moins que la fuite du
chant ne détermine exactement le mode, comme
dans la m élodie, fig. 14, planche IXde Mujîq. Suppl.
oh l’on voit paroître cette tierce marquée d’une
croix quatre fo is , mais toujours d’une façon non-
équivoque.
Tous les intervalles dont nous n’avons pas parlé,
peuvent s’employer à l’ordinaire dans ce genre de
contre-point double.
D u contre-point double, avec renverfement à Ûoctave,
& avec des parties de remplijfage.
Si le chant qui forme le contre-point double eft
exécuté par deux voix en duo, ou par deux inftru-
mens différens des autres , comme le feroient deux
flûtes, accompagnées de violons, on fera bien d’ob-
ferver toutes les réglés du contre-point double à deux
parties, parce que les deux voix ou les deux inftru-
jnens fe diftinguent, & préoccupent l ’oreille prefque
autant que s’ils étoient feuls ; la réglé quatrième
eft la feule qu’on puiffe négliger, & l’exemple, fig.
13 , planche IXde Mujîq. Suppl, avec une troifieme
partie, comme fig. /3 , eft très-bon. Nous avertirions
, une fois pour toutes, que dans le cours de cet
article, quand nous parlerons de deux parties, accompagnées
de parties de rempliffages, nous entendons
par-là que toutes les parties ne font enfemble
qu’un tout, comme un choeur, &c. & non que les
deux parties du contre-point forment un duo , & les
autres l’accompagnement.
Si les deux parties qui exécutent le chant en contrepoint
double, font deux voix ou deux inftrumens
mêlés avec d’autres de même efpece , comme dans
un choeur , on peut, fur-tout fi%le renverfement
n’oblige pas une de ces parties à ‘devenir la baffe ;
on p eut, dis-je, employer la quarte & la quinte ,
préparées & fauvées quand elles font diffonantes;
ainfi, dans ce cas, on n’eft abfolumènt obligé d’ob-
ferver que la première réglé.
Enfin, fi les deux parties dont le chant conftitue
le contre-point double, font plus écartées qu’à l’oôa-
v e , & qui ne peut avoir lieu que lorfque ces parties
font féparées par au moins une partie de rempliffa-
g e , on pourra faire le renverfement à la double
oftave ou à la quinzième ; dans de cas les grands
compofiteurs emploient quelquefois, mais avec précaution
, la neuvième fauvée fur ,l’o£lave, & la
neuvième fauvée fur la fixte. Voy't^fig. iS & ' 1 7 ,
planche I X de Mujîq. Suppl.
Remarquez que lorfque les parties qui forment
le contre-point double, font féparées de plus -que
d’une o&ave, & que par conféquent le renverfement
fe fait à la quinzième ; remarquez, dis-je, que fou-
vent on tranfpofe le premier deffus à l’oftave inférieure
, & le fécond à Poôave fupérieure, comme
nous l’avons fait dans les fig. 16 & r y , ce qui fe fait,
tant pour ne pas porter les parties hors de leur dia-
pafon naturel, que pour que les partit* de remplif-
w&e reftent à leur place.
D u contre-point triple & quadruple, avec renverfement
à F octave.
Pour pouvoirrenverfer les parties indifféremment
& à volonté, évitez la quinte confonnante, parce
qu’elle devient quarte , 8c obfervez dans toutes les
parties les autres réglés du contre-point double à
l’o&ave.
Du contrerpoint double à la tierce & à la dixième.
L’on confond ordinairement la tierce 8c la dixième
, & l’on dit toujours que' mi' eft la tierce d'u t,
quoique ce mi foit effectivement l’oftave, la double
oâa ve , &c. de la tierce d’ut.
Dans le poutre-point double à la tierce & à la
dixième, on ne peut pas confondre ainfi ces deux
intervalles; car un fon abaiffé d’une tierce refte
fouvent dans le deffus, tandis qu’abaiffé d’une dixième,
il fe trouve à la baffe & donne par conféquent un
intervalle renverfé du premier, par exemple,tranfpo-
fons ut o£la ve d’«/,d’une tierce,nous trouverons la fixte
d ut ,■ abaiffons ce meme ut d’une dixième, nous retrouvons
bien le même ton la,mais il eft d’une oétavé
plus bas que le premier; 8c au lieu d’être la fixte
majeure d’u t, il eft la tierce mineure au-deffous. *
Le contre-point double à la tierce n’a lieu que pour
la tranfpofition ; car l’on fent aifément qu’un contrepoint
double, avec renverfement à la tierce, né
pouvant jamai^permettre aux deux parties un plus
grand éloignement que la tierce ( par la première
réglé générale ) , feroit trop borné pour produire
une mélodie paffable. Nous avons donc le contrepoint
double avec tranfpofition à la tierce, & le
contre-point double avec renverfement à la dixième
mais le contre-point double, avec tranfpofition à la
tierce , eft de deux fortes ; c a r ,
. i ° . On peut tranfpofer le deffus à la tierce fupérieure,
la baffe reftant, ou la baffe à la tierce inférieure
, le deffus reftant, c’eft-à-dire , qu’on écarte
les parties d’une tierce.
i ° . On peut tranfpofer le deffus à la tierce inférieure
,. la baffe reftant, ou la baffe à la tierce fupérieure
, le defliis reftant, & alors on rapproche les
deux parties d’une tierce.
Du contre-point double , avec la tranfpojîtion à
la tierce entre deux parties qui s’écartent.
Pour favoir ce que devient chaque intervalle par
cette tranfpofition, ajoutez z au nombre qui indique
l’intervalle ; ainfi,
l’uniffon i , l a i e, l a 3%la4%Ia 5e,la6e,la7e,8c l’o ft .8.
JL 1 Jl 2 2 2 2 2.
donne la.3 e,Ia 4e, la 5 e,Ia 6% I a^ ia îF jI a ÿ ,
On ne va pas plus loin , tant parce qu’on ne re—
trouverait que les oûfves des intervalles déjà trouvés
, que parce que deux parties feules ne s’écartent
jamais de plus que d’une dixième.
Delà réfultent les réglés fuivantes.
Première réglé. La tierce devient quinte, & la fixte
oÔave ; ainfi deux tierces & deux fixtes de fuite font
défendues, parce qu’il en réfulteroit deux quintes
ou deux oftaves de fuite.
Cette première réglé rend cette forte de contrepoint
difficile à-compofer, chantant & harmonieux;
remarquez auffi que comme la tierce, la fixte 8c
l’oétave font les feuls intervalles qui reftent confon-
nans après la tranfpofition, ce font auffi les feuls qui
puiffent fervir à préparer & à fauver les diffonances*
Nous ne parlons pas de la quarte confonnante
qui devient fixte, parce qu’elle eft bannie de toute
bonne compolition en duo. .
Deuxieme réglé. La fécondé préparée dans la balle
ne peut fe fauver que fur le triton, alors elle donne
après la tranfpofition une quarte fauvée fur uns
fixte, comme On le voit fig. 1 , planche X de Mujîq.
Sup p u. • , ... .
Troijîeme réglé. Nous avons déjà dit que la quarte
confonnante eft défendue ; quant à la diffonante ,
celle qui eft préparée dans le deffus 8c fe fauve fur
la tierce, comme fig. x , planche X , n’eft pas trop
bonne ; celle qui eft préparée dans le deffus ou dans
la baffe, & qui fe fauve fur la fixte, comme fig. 3 ,
vaut mieux ; on peut auffi employer le triton de
cette derniere maniéré.
Quatrième réglé. La quinte devient feptieme, ainfi
elle doit toujours être préparée 8c fauvée. La quinte,
ou mieux encore la fauffe quinte, préparée dans le
deffus, peut fe fauver fur la tierce, alors elle devient
feptieme fauvée fur la quinte. Voye{jig. 4 , planche X
de Mujîq. Suppl. La quinte préparée convenablement
, peut encore fe fauver fur le triton, qui fe
fauve enfuite lui-même fur la fixte. Voye£ fig. 5 8
planche X d e Mujîq. Suppl. Enfin on peut paffer de
la quinte à l’o â a v e , comme fig. <S, pourvu que ce
foit à une cadence parfaite ; cette quinte devient
feptieme fauvée fur la tierce.
Cinquième réglé. La feptieme préparée de l’oftave
dans le deflus, peut fe fauver fur la fixte ou fur la
tierce ; dans le premier cas elle devient neuvième
fauvée fur l’o a a v e , 8c dans le fécond neuvième fau-
vée fur la quinte. Voye^fig.y, n* . , & z , planche X
de Mujique.
Sixième réglé. Enfin dans cette forte de contrepoint
, les parties doivent toujours aller par mouvement
contraire ou oblique, quand elle paffe d ’une
confonnance à l’autre, parce que fans cela il y au-
roit des quintes ou des o&aves cachées.
D u contre-point doubl^, avec tranfpojîtion à la tierce
entre deux parties qui s’écartent & qui font accompagnées
d’autres parties de remplijfage.
Les mêmes réglés ont lieu, mais lorfque les deux
parties qui compofent le contrepoint double, font
affez hautes pour qu aucune ne devienne baffe par
la tranfpofition , on peut employer fans fcrupule la
quarte comme confonnante, 8c s’en fervir pour préparer
8c fauver les diffonances ; on peut même
auffi fauver quelques diffonances fur le triton.
D u contre-point double, avec tranfpojîtion à la
tierce entre plujîeurs parties qui s’écartent.
Si, par exemple, on vouloit compofer à quatre parties,
enforte que l’on pût élever les trois parties fupé-
rieures d une tierce, on obfervera que chaque partie
foit fuivant les réglés données ci-deffus , eu égard à
la baffe ; en élevant les trois parties fupérieures également
d’une tierce, il eft clair qu’elles reftent
entr’elles comme auparavant. Si l’on ne vouloit
elever qu’une partie d’une tierce, alors cette partie
devrait obferver les réglés données ci-deffus envers,
les parties inférieures ; quant aux fupérieures elle
obferveroit les réglés du contre-point double , avec
tranfpofition à la tierce, quand les parties fe rapprochent
; réglés que nous allons donner : au refte , le
contre-pomt double, avec tranfpofition entre plu-
lieurs parties, n^peut être d’aucune utilité réelle.
D u contre-point double, avec tranfpofition à la
tierce entre deux parties qui fe rapprochent.
Pour favoir ce que devient chaque intervalle par
a tranfpofition, retranchez deux au nombre qui indiquent
l’intervalle; ainfi, la 10e, la 9e, la 8«, la 7«, fc 6e> la ^ la ^ la ^
donneB«, lïT«, iTéc, 1^, Ia~i, la~ 1Wiffon~: '
On ne va pas plus loin, parce que les deux parties
ne peuventjamais s’approcher plus qu’à la tierce H
ni s ecarter plus que d’une dixième, fuivant la pre-
nuere réglé générale. e
On tfoit par le changement des intervalles que
nous venons d indiquer, que cette eipece i e contre-
point eft précifunentde Contraire du précédent, car
es intervalles fe feproduifentréeiprdquemènt ; auffi
i i c ?! eS. qt,e B H f f precedentes renverfées. l donner ne font que les
Premier, nglc Évitez deux dixièmes & deux tieri
cm de fuite , elles donnent deux oïlavès ou deux
uniffons par la tranfpofition. La tierce même doit
abiolument être évitée dans une compofifion à deux
parties , parce qu'elle donne l’unilfon ; tout au plus
on peut la tolerer au commencement & à la fin.
Remarquezquecomméla dixième , l’o â a ve 8s’ ' '
la quinte reftent des confonnances après la tranfpo-
fition, vous pouvez vous en fervir pdnr prébarêr &
fauver les diflonances , bien entendu en obfervant
les réglés de 1 harmonie , & celles que nous allons
encore donner.
Bm à tm t rcgu. Préparez la quarte , ou mieux
encore le « to n de la tierce, & ftïvez-le (W la fixte
vous aurez par la tranfpofition une fécondé fatfvée
• le tnton- F°yelfig- I y planche X de Mu fia. Suppl
en prenant la tranfpofition pour chant primitif, 8c
ce dernier pour tranfpofition.
Troifieme réglé. La fixte confonnante eft défendue,
elle donne une quarte par la tranfpofition , 8c la
quarte eft trop peu harmonieufe pour une compofi-
n2 ne“ duo; Q»ant à la fixte diffonante, celle qui'
Ü H H H H l d-e f fu s& f t BS fur laqiiinte,
n eft pas trop bonne ; mais on peut très-bien em.-
ployer la fi^te preparée dans l e ‘ deffus ou dans la
baffe , & fauvee fur 1 oélave , fur-tout à la fin d’une
phrafe. b'oyei fig. 2 & 3 , planche X de Mafia. Suppl
en prenant toujours la tranfpofition pour chant pri*
mitit, 8c celui-ci pour tranfpofition.
Quatrième réglé. La feptieme préparée régulière-
ment ne peut pas fé f a u f * fur la tierce , parce que
dans ce cas elle devient unfc-quinte quipafl'e à l’unif-
lon. Mais la feptieme mineure fur-tout peut fe
fauver fur la quinte. H M M M M IW i
Suppl. La feptieme petit encore fe fauver fur la fixte
iur-tout fiir la majeure , pourvu que la fixte pafle
m m m m b b h h mmbh paffe à la quarte ou au triton , lequel fe fauve fur la HD SB dans laquelle il faut prend're'la
tranfpofition. pour chaque primitif, & au contraire
Enfin, la feptieme préparée dans: le deffus, peut fe
fauver fur la dixième, comme fig, <f, eu prenant la
tranfpofitlDtl p'duf chant primitif, elle dévient bar la
tranlpofition une quinte qui paffe à l ’o ô a v t- ce dernier
emploi de la feptieme .n’eft pas trop bon, il n’eft
guere tolerable qu’à une cadencé parfaite.
Cinquième régit. Enfin la neuvième, préparée fui-
vant les réglés , peut fe fauver fur I’oélave 8c fur la
quinte, alors dlle d'evient feptieme fauvée fur ia
fixte & fur la tierce , comme le prouve la f e 7
en prenant les tranfpofitions pour chants primffife!
oc au contraire. 1 9
Du contre-point double, avec tranfpofition à la ti-m
entre deun. parties qui fe rapprochent & qui font ac-
compagnees de parties de remplijfage.
Obfervez toutes les feg!&|que nous vérions dê
donner mais avec la. différence que quand le cofiü-
point ell: dans les parties fupérieures , enforte que la
tranlpofition n’en change aucune en baffe, on peut
employer la fixte comme confonnance, 8c s’en fervir
pour préparer 8c fauver les diffonances.
Du contre-point double, avec tranfpofition à la
tierce entre plafieiirs parties qui s’écartent.
Il eft clair qu’on né peut guerè rapprocher què
deux parties , car pôvlr en rapprocher davantage
il faudroit que.le chant fût eompqfé de'pafties fort