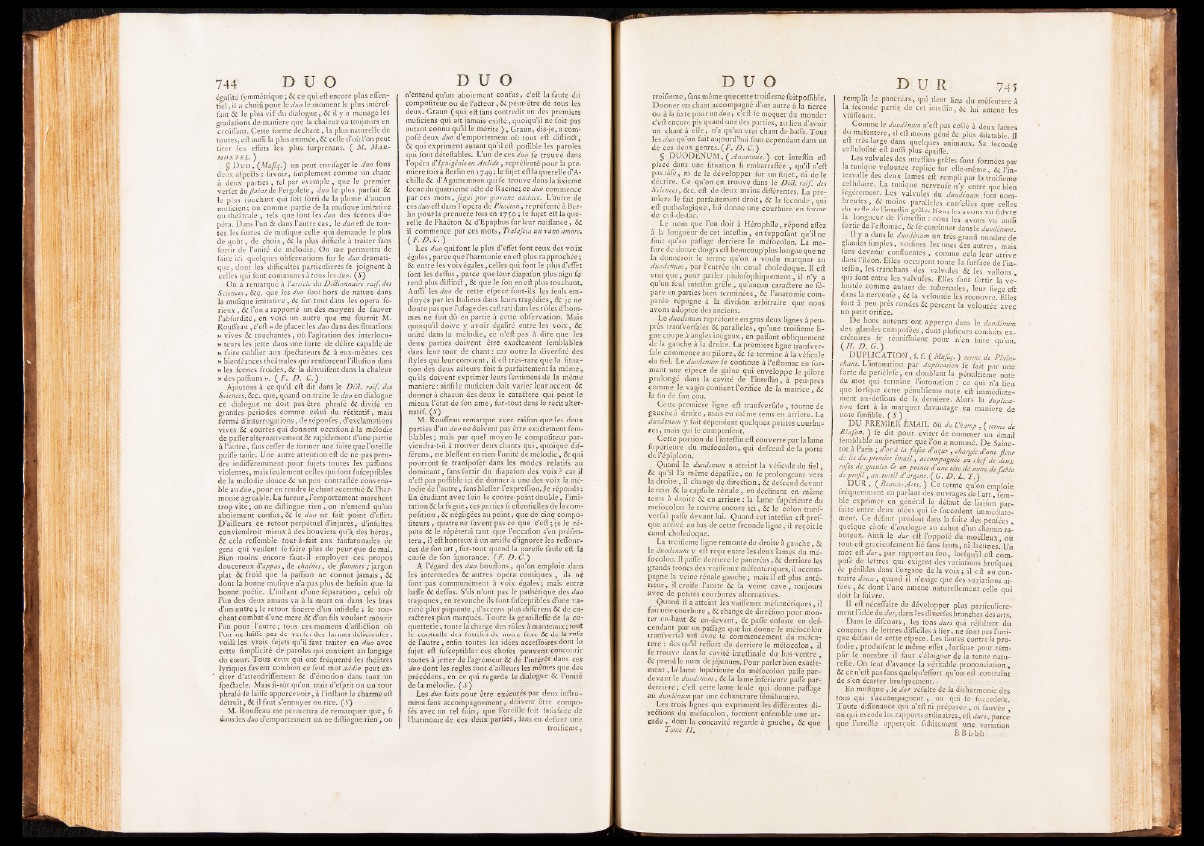
744 D U O
égalité fymmétrique ; 6c ce qui eft encore plus effen-
tiel, il a çhoifi pour le duo le moment le plus interef-
fant 6c le plus v i f du dialogue, & il y a ménagé les
gradations de maniéré que la chàleur va toujours en
croiffant. Cette forme dechant, la plus naturelle de
toutes, eft aufli la plus animée, & celle d’où l’on peut
tirer les effets les plus furprenans. ( M. Ma r -
m o n t e l . )
§ D u o , (Mufîq.) on peut envifager le duo fous
deux afpeâs : favoir, fimplement comme un chant
à deux parties , tel par exemple, que le premier
verfet ànftabat de Pergolefe, duo le plus parfait 6c
le plus, touchant qui foit forti de la plume d’aucun
muficien; ou comme partie de la mulîque imitative
ou théâtrale , tels que font les duo des fcenes d’opéra.
Dans l’un & dans l’autre cas, le duo~eû de toutes
les fortes de mulique celle qui demande le plus
de goût, de choix, 6c la plus difficile à traiter fans
fortir de l’unité de mélodie. On. me permettra de
faire ici quelques obfervations fur le duo dramatique,
dont les difficultés particulières fe joignent à
celles qui font communes à tous \es duo. {S)
On a remarqué à Y article du Dictionnaire raif. des
Sciences, &c. que les duo font hors de nature dans
la mufique imitative, 6c fur-tout dans les opéra fé-
rieux, 6c l’on a rapporté un des moyens de fauver
l ’abfurdité, en voici un autre que me fournit M.
Rouffeau, c’eft « de placer les duo dans des fituations
» vives 6c touchantes, oit l’agitation des interlocu-
» teurs les jette dans une forte de délire capable de
» faire oublier aux fpettateurs & à eux-mêmes ces
» bienféances théâtrales qui renforcentl’illufton dans
» les fcenes froides, 6c la détruifent dans la chaleur
» des paflions ». ( F. D . C. )
Ajoutons à ce qu’il eft dit dans le Dict. raif. des
Sciences, 6cc. que, quand on traite le duo en dialogue
ce dialogue ne doit pas être phrafé 6c divifé en
grandes périodes comme celui du récitatif, mais
formé d’interrogations, de réponfes, d’exclamations
vives 6c courtes qui donnent occafiôn à la mélodie
de paffer alternativement & rapidement d’une partie
à l’autre, fans ceffer de former une fuite que l’oreille
puifle faifir. Une autre attention eft de ne pas prendre
indifféremment pour fujets toutes les paflions
violentes, mais feulement celles qui font fufceptibles
de la mélodie douce 6c un peu contraftée convenable
au duo, pour en rendre le chant accentué 6c l’harmonie
agréable. La fureur, l’emportement marchent
trop vite; on ne diftingue rien , on n’entend qu’un
aboiement confus, & le duo ne fait point d’effet.
D ’ailleurs ce retour perpétuel d’injures, d’infultes
coiiviendroit mieux à des bouviers qu’à des héros,
6c cela reffemble tout-à-fait aux fanfaronades de
gens qui veulent fe faire plus de peur que de mal.
Bien moins encore faut-il employer ces propos
doucereux Üappas, de chaînes, de flammes ; jargon
plat 6c froid que la paffion ne connut jamais, 6c
dont la bonne mufique n’a pas plus de befoin que la
bonne poéfie. L’inftant d’une féparation, celui oit
l ’un des deux amans va à la mort ou dans les bras
d’un autre ; le retour fincere d’un infidèle ; le touchant
combat d’une mere & d’un fils voulant mourir
l’un pour l’autre ; tous ces momens d’affliétion oii
l’on ne laiffe pas de verfer des larmes délicieüfes :
voilà les vrais fujets qu’il faut traiter en duo avec
cette fimpliçité de paroles qui convient au langage
du coeur; Tous ceux qui ont fréquenté les théâtres
lyriques favent combien ce feu 1 mot addio peut exciter
d’attendriffement & d’émotion dans tout u n
fpeâacle. Mais fi-tôt qu’un trait d?efprit ou un tour
phrafé fe laiffe appercevoir, à l’inftant le charme eft
détruit, 6c il faut s’ennuyer ou rire. («5')
M. Rouffeau me permettra de remarquer que, fi
dansées duo d’emportement on ne diftingue rien, on
D U O
n’èntend qu’un aboiement confus, c’eft la faute du
compofiteur ou de l’afteur, 6c peut-être de tous les
deux. Graun (qui eft fans contredit un des premiers
muficiens qui ait. jamais exifté, quoiqu’il ne foit pas
autant connu qu’il le mérite ) , Graun, dis-je, a Com*
pofé deux duo d’emportement où tout eft diftinâ:,
& qui expriment autant qu’il eft poflible les paroles
qui font déteftables. L’un de ces duo te trouve dans
l’opéra à?Iphigénie en AuLide, repréfenté pour la première
fois à Berlin en 1749; le fujet eft la querelle d’Achille
& d’Agamemnon quife trouve dans la fixieme
fcene du quatrième a£le de Racine; ce duo commence
par ces mots, fegui pur giovane audace. L’autre de
ces duo eft dans l ’opéra de Phaêton, repréfenté à Berlin
pour la première fois en 1750 ; le fujet eft la querelle
de Phaéton 6c d’Epaphusfurleur naiflance, 6c
il commence par ces mots, Tralafeia un vano amore«
( F -O .C . )
Les duo qui font le plus d’effet font ceux des vo ix
égales, parce que l’harmonie en eft plus rapprochée;
6c entre les voix égales, celles qui font le plus d’effet
font les deffus, parce que leur diapafon plus aigu fé
rend plus diftinft, 6c que le fon en eft plus touchant.
Aufli les duo de cette efpece font-ils les feuls employés
par les Italiens dans leurs tragédies, 6c je ne
doute pas que l’ufage des caftrati dans les rôles d’hommes
ne foit dû en partie à cette obfervation. Mais
quoiqu’il doive y avoir égalité entre les vo ix , 6c
unité dans la mélodie, ce n’eft pas à dire que les
deux parties doivent être exactement femblables
dans leur tour de chant : car outre la diverfité de$
ftyles qui leur convient, il eft très-rare que la fitua-
tion des deux afteurs foit fi parfaitement la même ,
qu’ils doivent exprimer leurs fentimens de la même
maniéré: ainfile muficien doit varier leur accent 6c
donner à chacun des deux le caraétere qui peint le
mieux l’état de fon ame, fur-tout dans le récit alternatif.
(S')
M. Rouffeau remarque avec raifon que les deux
parties d’un duo ne doivent pas être exactement femblables;
mais par quel moyen le compofiteur parviendra
t-il à trouver deux chants qui, quoique dif-
férens, ne bleffent en rien l’unité de mélodie, 6c qui
pourront fe tranfpofer dans les modes relatifs au
dominant, fans fortir du diapafon des voix ? car il
n’ eft pas poflible ici de donner à une des voix la mélodie
de l’autre, fansbleffer l’expreflion. Je réponds:
En étudiant avec foin le contre-point double, l’imitation
6c la fugue, ces parties fi effentielles de la com-
pofition , & négligées au point, que de cinq compo-
fiteurs , quatre ne favent pas ce que 'c’eft ; je le répété
6c le répéterai tant que l’occafion s’en préfen*
tera, il eft honteux à un artifte d’ignorer les reffour-
ces de fon art, fur-tout quand la pareffe feule eft la
caufe de fon ignorance. (F . D .C .)
A l’égard des- duo bouffons,', qu’on emploie dans
les intermèdes 6c autres opéra comiques , ils né
font pas communément à voix égales; mais entre
baffe & deffus. S’ils n’ont pas le pathétique des duo
tragiques, en revanche ils font fufceptibles d’une variété
plus piquante.,- d’accens plus différens 6c de ca--
raCteres plus marqués. Toute la gentilleffe de la coquetterie
; toute la charge des rôles à manteaux; tout
le contrafte des fottifes de notre fe'xe 6c de la rufe
de l’autre, enfin toutes les idées» acceffoires dont le
fujet eft fufceptible: cés chofes 'peuvent-concourir
toutes à jetter de l’agrément 6c de l’intérêt dans ces
duo dont les réglés font d’ailleurs les mêmes que des
précédens, en ce qui regarde le dialogue 6c l'unité
de la mélodie. (*£)
Les duo faits pour être exécutés par deux inftrû-
mens fans accompagnement, doivent être compo-
fés avec un tel foin , que l’oreille foit fatisfaite de
l’harmonie de ces deux parties, fans en defirer une
troifieme,
D U O
troifieme', fans même que cette troifieme foit poflible.
Donner un chant,accompagné d’un autre à la tierce
ou à la fixte pour unduo, c’eft fe moquer du monde:
c’eft encore pis quand une des parties, au lieu d’avoir
un chant à elle , n’a qu’un vrai chant de baffe. Tous
les duo qu’on fait aujourd’hui font cependant dans un
de ces deux genres. {F. D . C.')
§ DUODENUM, {Anatomie. ) cet. inteftin eft
placé dans une fituation fi embarrafféè , qu’il n’eft
pasaifé, ni de le développer fur un fujet, ni de le
décrire. Ce qu’on en trouve dans le Dicl. raif. des
Sciences, 6cc. eft de deux mains différentes.. La première
le fait parfaitement droit, & :la fécondé, qui
eft pathologique, lui donne une courbure en forme
de cùl-de-fac.
Le nom que l’on doit à Hérophile, répond affez
à la longueur de cet inteftin, en fuppofant qu’il ne
finit qu’au paffage derrière le méfocolon. La me-
fure de douze doigts eft beaucoup'plus longue que ne
la donneroit le terme qu’on a voulu marquer au
duodénum, par l’entrée du canal cholédoque. Il eft
vrai que, pour parler philofophiquement, il n’y a
qu’un feul inteftin grêle, qu’aucun cara&ere ne fé*
pare en parties bien terminées, 6c l’anatomie comparée
répugne à la divifion arbitraire que nous
avons adoptée des anciens.
Le duodénum repréfente en gros deux lignes à peu-
près tranfverfales 6c paralleles, qu’une troifieme ligne
coupe à angles inégaux, en paffant obliquement
de la gauche à la droite. La première ligne tranfver-
fale commence au pilore, 6c fe termine à la véficule
du fiel. Le duodénum fe continue à l’eftomac en formant
une efpece de gaine qui enveloppe le pilore
prolonge. dans la cavité de l’inteftin, à peu-près
comme le vagin contient l’orifice de la matrice, 6c
la fin de fön cou.
Cette première ligne eft tranfverfale , tourne de
gauche à droite, mais en même tems en arriéré. Le
duodénum y fait cependant quelques petites courbures,
mais qui fe compenfent.
Cette portion de l’inteftin eft couverte par la lame
fupérieure du méfocolon, qui defcend de la porte
de l’épiploon.
. Quand le duodénum a atteint la véficule du fiel,
6c qu’il l’a meme depaffee, en fe prolongeant vers
la droite, il change de dire&ion, & defcend devant
le rein & la capfule rénale, en déclinant en même
tems à droite 6c en arriéré : la lame fupérieure du
méfocolon le couvre encore ic i, 6c le colon tranf-
verfal paffe devant lui. Quand cet inteftin eft pref-
que arrivé au bas de cette fécondé ligne,-il reçoit le
canal cholédoque.
La troifieme ligne remonte de droite à gauche, &
le duodénum y eft reçu entre les deux lames du mé-
foçolon. Il paffe derrière le pancréas, & derrière Les
grands troncs des vaiffeaux méfentériques,il accompagne
la veine rénale gauche ; mais il eft plus antérieur,
il croife l’aorte 6c la veine ca v e , toujours
avec de petites courbures alternatives.
Quand il a atteint les vaiffeaux méfentériques, il
fait une courbure , & change de direûion pour monter
en-haut 6c en-devant, 6c paffe enfuite en def-
cendant par un paffage que lui donne le méfocolon
tranfverfal uni avec le commencement du méfen-
tere : dès qu’il reffort de derrière le méfocolon, il
fe trouve dans la cavité inteftinale du bas-ventre $
6c prend le nom de jéjunum. Pour parler bien exactement
, la' lame fupérieure du méfocolon paffe par-
devant le duodénum, 6c la lame inférieure paffe par-
derriere ; c’eft cette lame feule qui donne paffage
au duodénum par une échancrure fémilunaire.
Les trois lignes qui exprimenitjes différentes di-
reôions du méfocolon, forment énfemble une arcade
, dont la concavité regarde à gauche, & que
Tome I I . , •• *: 5-î. j;VTi ■
D U R ,745
remplit le pancreas , qui tient lieu du méfentere à
la fécondé partie de cet inteftin, 6c lui amene les
vaiffeaux.
Comme le duodénum n’eft pas collé à deux lames
du méfentere, il eft moins gêné & plus dilatable. Il
e , Se £lans quelques animaux. Sa fécondé
cellulofite eft aufli plus épaiffe. -
Les valvules des inteftins grêles font formées par
la tunique veloutée repliée fur elle-même, & l ’in-
tervalle des deux lames eft rempli par la troifieme
cellulaire. La tunique nerveufe n’y entre que bien
legerement. Les valvules du duodénum font nom-
breufes, & moins parallèles entr’elles que celles
du refte de 1 inteftin grêle. Nous les avons vu fuivre
a longueur de 1 inteftin : nous les avons vu aufli
fortir de l’eftomac, 6c fe continuer dans le duodénum.
Il y a dans le duodénum un très-grand nombre de
glandes fimples, voifines les unes des autres, mais
fans devenir confluentes , comme cela leur arrive
dans l’iléon. Elles occupent toute la furfaee de l’in-
teftin, les tranchans des valvules & les vallons
qui font entre les valvules. Elles font fortir la v eloutée
comme autant de tubercules, leur fiege eft
dans la nerveufe , 6c la veloutée lés recouvre. Elles
font à peu-près rondes, 6c percent la veloutée avec
un petit orifice. '
De bons auteurs ont apperçu dans le duodénum
des glandes compofées , dont plufieurs conduits ex-
Cr# °Z ^ S(/ e reiln^°^en^ P0lIr n’en faire qu’un.
I DUPLICATION, f. f. ( Mafiq. ) I g J de P tain,
chant. L ’intonation par duplication fe fait par une
forte de periélefe, en doublant la pénultième note
du mot qui termine l’intonation : ce qui n’a lieu
que lorfque cette pénultième note eft immédiate*
ment au-deffous de la derniere. Alors la duplication
fert à la marquer davantage en maniéré de
note fenfible. ( S )
DU PREMIER ÉMAIL ou du Cha/np , ( terme de
Blafon. ) fe dit pour éviter de nommer un émail
femblable au premier que l’on a nommé. De Sainc-
tot a Paris ; d’or à La fafee da^ur, chargée d’une fleur
de lis du premier émail , accompagnée en .chef de deux
rofes de.gueules & en pointe dune tête de more de fable
de profil, au tortil d argent, f G. D . L. TA
D U R , {Beaux-Arts.) Ce terme qu’on emploie
fréquemment en parlant des ouvrages de l’art, fem-
ble exprimer en général le défaut de Liaifon parfaite
entre deux idées qui fe fuccedent immédiatement.
Ce défaut produit dans la fuite des penfées ,
quelque çhofe d’analogue au cahot d’un chemin ra-
bot£uX. Ainfi le dur eft l’oppofé du moëlLeux, ;où
tout eft gracieufement lié fans fauts , ni lacunes. Un
mot eft dur, par rapport au fon, iorfqiyl .eft com-
pofé .de lettres qui exigent- des variations brufques
6c pénibles dans l’organe de la voix ; il eft au contraire
doux, quand il n’exige que des variations ai-
fées , 6c dont l’une amene naturellement celle qui
doit la fuivre.
II eft néceffaire de développer plus particulièrement
J’idée du dur, dans les diverfes branches des arts.
Dans le difeours, les Ions durs qui réfultent du
concours de lettres difficiles:à lier, ne font pas.l’uni-
que.défaut de cette efpece. Les fautes-çontre la pro-
fodie, produifent le même effet, lorfque pour remplir
le nombre il faut s’éloigner d'e 1-a tenue naturelle.
On fent d’avance la véritable prononciation .,
& ce n’eft pas: fans quelqu’effort qu’on; eft contraint
de s’en écarter brufquement. ■
En mufique , le dur réfulte de la disharmonie des
tons qui s’accompagnent , ou qui fe fuccedent.
Toute diffonance ;qui n’eft ni préparée , ni fauvée
ou qui excede les rapports ordinaires, eft dure, parce
que l’oreille apperçoit fubitement une variation
BBJainb,