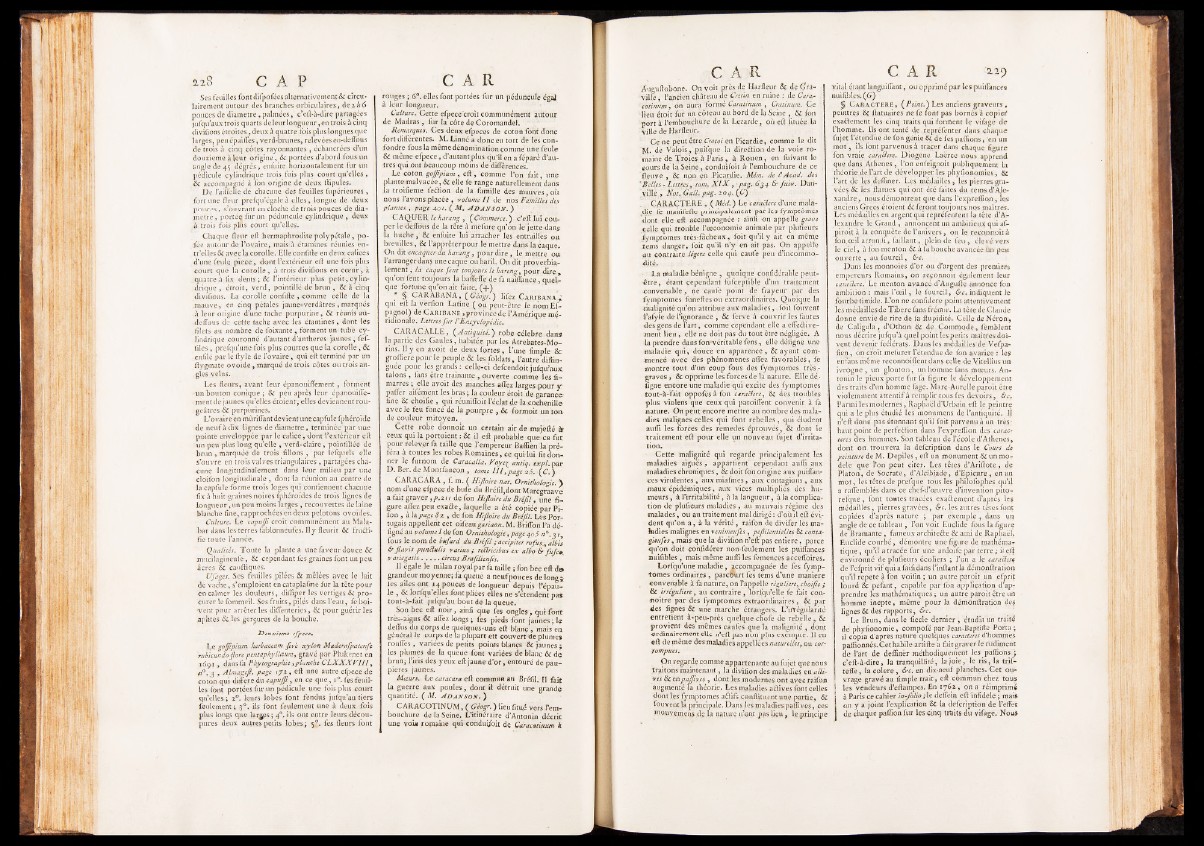
Ses feuilles fontdifpoféesalternativement& circu*
lairenient autour des branches orbiculaires, de z à 6
pouces de diamètre, palmées, c’eft-à-dire partagées
jufqu’aux trois quarts de leur longueur ,en trois à cinq
divifions étroites, deux à quatre fois plus longues que
larges, peu épaiffes, verd-brunes, relevées en-deflbus
de trois à cinq côtes rayonnantes , échancrées d’un
douzième è leur origine, & portées d’abord fous un
angle de 45 dégrés, enfuite horizontalement fur un
pédicule cylindrique trois fois plus court qu’elles,
& accompagné à fon origine de deux ftipules.
De raillelle de chacune des feuilles fupérieures ,
fort une fleur prefqu’égale à elles, longue de deux
pouces, s’ouvrant en cloche de trois pouces de diamètre
, portée fur un péduqcule cylindrique , deux
à trois fois p:ltis court qu’elles.
Chaque fleur eft hermaphrodite polypétale, po-
fée autour de l’ovaire, mais:«Yétamines réunies en-
tr’ellps & avec la corolle. Elle confifte en deux calices
d’une feule pièce, dont l’extérieur eft une fois plus
court que la corolle, à trois divifions en coeur, à
quatre à fix dents ; & l’intérieur plus petit, cylindrique
, étroit, verd, pointillé de brun , & à cinq
divjfion?. La corolle confifte, comme celle de la
mauve, en cinq pétales jaunes verdâtres , marqués
à leur origine d’une tache purpurine, & réunis au-
deflous de cette tache avec les étamines, dont les
filets au nombre de foixante , forment un tube cylindrique
couronné d’autant d’anthères jaunes , {effiles
, prefqu’unie fois plus courtes que la corolle, &
enfilé par le ftyle de l’ovaire, qui eft terminé par un
ftygmate ovoïde, marqué de trois côtes ou trois an-
. gles velus.
Les fleurs, avant leur épanouiflëment, forment
un bouton conique ; & peu après leur épanouiffe-
mentde jaunes qu’elles étoienf,- elles deviennent rougeâtres
& purpurines.
L’ovaire en mûrifiant devient une capfule fphéroïde
de neuf à dix lignes de diamètre, terminée'par une
pointé enveloppée par le calice, dont l’extérieur eft
un peu plus long qu’elle , verd-claire, pointillée de
brun , marquée de trois filions , par iefquels elle
s’ouvre en trois valves triangulaires , partagées chacune
longitudinalement dans leur milieu par une
cloifon longitudinale , dont la réunion au centre de
la capfule forme trois loges qui contiennent chacune
fix à huit graines noires fpheroïdes de trois lignes de
longueur, un peu moins larges , recouvertes de laine
blanche fine, rapprochéesen deux pelotons ovoïdes.
Culture. Le capufli croît communément au Mala-.
bar dans les terres fablonneufes. Il y fleurit & fruéli-
fie toute l’année.
Qualités. Toute la plante a une faveur douce &
mucilagineufe, & cependant fes graines font un peu
âcres & cauftiques.
UJ'ages. Ses feuilles pilées & mêlées avec le lait
de vache, s’emploient en cataplafme fur la tête pour
en calmer les douleurs, difliper les vertiges & procurer
lefommeil. Ses fruits, pilés dans l’eau, fe boivent
pour arrêter les diffenteries, & pour gu;érir les
aphtes &. les gerçures de la bouche.
Deux if me efpece.
Le gofflpium herbauum five xylon Maderafpatenfe
rubicunào flore pentaphyllaum, gravé par Phikepet en
1691 , dans fa Photographie, planche C L X X X V I ll,
ft°. a , Alniag&ft. page i j z , eft une autre efpece de
coton qui diffère du capufli, en ce que, 1 °. fes feuilles
font portées fur un pédicule une fois plus court
qu’elles ; i° . leurs lobés font fendus jufqu’au tiers
feulement; g°. ils font feulement une à deux fois
plus longs que larges ; 40, ils ont entre leurs découpures
deux autres petits lob.es ; 5°. fes fleurs font
rouges ; 6°. elles font portées fur un péduncule égal
à leur longueur.
Culture. Cette efpece croît communément autour
de Madras, fur la côte de Coromandel.
Remarques. Ces deux efpeces de coton fonf donc
fort différentes. M. Linné a dpnceu tort de les confondre
fous la meme dénomination comme une feule
& même efpece, d’autant plus qu’il en a féparé d’autres
qui ont beaucoup moins de différences.
Le coton gojjîpium, eft , comme l’on fait, une
plante malvacée, & elle fe range naturellement dans
la troifieme feâion de la famille des mauves, oit
nous l’avons placée , volume I I de nos Familles des
plantes , page 401. ( M. A d a n s o n . )
C AQUER le harang , ( Commerce. ) c’eft lui couper
le défions de la tête à méfure qu’on le jette dans
la huche, & enfuite lui arracher les entrailles pu
breuilles, & l’apprêter pour le mettre dans la caque.
On dit encàquer du harang. pour dire , le mettre ou
l’arranger dans une caque ou baril. On dit proverbialement
; la caque fent toujours le hareng, pour dire,
qu’on fent toujours la baffelfe de fa namance , quelque
fortune qu’on ait faire, (-}-)
* § CARABANA, ( Géo'gr, ) lifez Caribana ^
qui eft la verfion Latine ( ou peut-être le nom E f-
pagnol) de C arib a n e , province de l’Amérique méridionale.
Lettres fur TEncyclopédie.
C AR A CA LL E , ( Antiquité. ) robe célébré, dans
la partie des Gaules, habitée par les Atrebates-Mo-
rins. II y en avoit de deux fortes , l ’une fimple &c
grofliere pour le peuple & les foldats, l’autre diftin-
guée pour les grands : celle-ci defcendpit jufqu’aux:
talons , faqs g.tre traînante , ouverte comme les fi-
marres ; elle avoit des manches allez larges pour y
paffer aifément les bras ; la couleur étoit de garance-
fine & çhoifie , cjui réuniffoit l’éclat de la cochenille
avec le feii foncé de la pourpre , & formoit un tou
de couleur mitoyen.
Cette robe donnoit un certain air de majefté Y
ceux gm la portoient : & il eft probable que. ee fut
pour relever fa taille que l’empereur Baffien la préféra
à toutes les robes Romaines, ce qui-lui fit donner
le furnom de Caracalla. Foye,[ antiq. expi. par
D. Ber. de Montfaucon , tome III,page a i . (C . )
CARACARA , f. m. ( Hifloire nat. Ornithologie. \
nom d’une efpece de bufe du Bréfil,dont Marcgraave
a fait graver ,p .z i 1 de fon Hifloire du BréfiL, une figure
allez peu ex aâ e, laquelle a été copiée par Pilon
, à la page 82 , de fon Hifloire du Bréfll. Les Portugais
appellent cet oifeau gariaon. M. Briffon l?a défi
gné au volume I de fon Ornithologie, page 40$ n ° .j ty
fous le nom de bufard du Bréfll ; accipiter rufu$. albis
& flavis punclulis varius ; reflricibus ex albo & fufe*
variegatis. . . . . circus Brafilienfis.
11 égale le milan royal par fa taille ; fon bec eft do
grandeur moyenne; fa queue a neuf pouces de long*
les aîles ont 14 pouces de longueur depuis Pépau-
le , & lorfqu’elles font pliées elles ne s’étendent pas
tout-à-fait jufqu’au bout de la queue.
Son bec eft noir, ainfi que lès ongles, qui font
très-aigus & affez longs ; fes pieds font jaunes ; le
deffus du corps de quelques-uns eft blanc , mais en
general le corps de la plupart eft couvert de plumes
rouffes , variées de petits points blancs & jaunes ;
les plumes de la queue font variées de blanc & dç
brun; l’iris des yeux eft jaune d’o r , entouré de-paupières
jaunes.
Moeurs. Le caracara eft commun au Bréfil. Il fait
la guerre aux poules, dont il détruit une grande
quantité. ( M. A d a n s o n . )
C ARACOTINUM , ( Géogr. ) fieu fi tué vers l’embouchure
de la Seine. L’itihéraire d’Antonin décrit
uue voie romaine qui conduifoit de Cdracotinum k
C A R
ÆnguAobone. 0 ,n voit près de; Harfleiir & de CÏra-
v ille , l’apcien château de Crétin en ruine : de Cura,-
cotirium, ôn aura formé Caratinutn , Cratinum. Ce '
lieu étoit fut ôn èôteau au bord de la Seine , & fon
port à l’embouchure de la Lézardé x oii eft fituée la
ville de Harfleùr.
Ce ne peut être Çroioi en Picardie, comme le dit
M. de Valqis. pqifque la direction de la voie romaine
de Troues à Paris, à Rouen, en fuivant le
«ours de la Seiqe , conduifoit à l’embouchure de ce ,
fleuve , & non çn .Picardie. Mém. de C Acad, des
rB elles r Lettres 3 tonu XIX. ppg. Cg4 & fuiv. Dan-
y f l l é , Not. G ails pag. 204. (C)
C A R A C T E R E , ( Méd. ) Le caractère d’une maladie
fe manifefte principalement par les fymptômés
!dqnt elle eft accompagnée : ainfi on appelle grai>e
celle qui trouble l’oeconomie animale par plufieurs
./ymptomes très-fâcheux, foit qu’il y ait en mên^e
îems danger, foit qu’il n’y en ait pas. On appelle
au contraire Légère celle qui caufe peu d’incommo-
djté.
La maladie bénigne , quoique confidérable peut-
^tre, étant cependant fufceptible d’un traitement
convenable, ne caufe point de frayeur par des
fymptomes funeftes ou extraordinaires. Quoique la
malignité qu’on attribue aux maladies, . foit fouvent
l’afyle de l’ignorance , & ferve à couvrir les, fautes
des gens de l’art, comme cependant elle a effe&ive-
ment lieu , elle ne doit pas du tout être négligée, A
la prendre dans fon*véritable fens, elle déjigne une
maladie qui, douce en apparence , & ayant commencé
avec des phénomènes affez favorables, fe
•montre tout d’un coup fous des fymptomes très -
graves, & opprime les forces de la nature. Elle dé •
figne encore une maladie qui excite des fymptomes
tout-à-fait oppofés à fon caractère, & des troubles
plus violens que ceux qui paroiffent convenir à ('3
nature. On peut encore mettre au nombre des maladies
malignes celles qui font rebelles, qui éludent
aufli les forces des remedes éprouvés, & dont le
traitement eft pour elle un nouveau fujet d’irritation.
• Cette malignité qui regarde principalement les
maladies aiguës, appartient" cependant aufli aux
maladies chroniques, & doit fon origine aux puiflan-
ces virulentes , aux miafmes, aux contagions , aux
maux épidémiques, aux vices multipliés des hur
meurs, à l’irritabilité, à la langueur, à la complication
de plufieurs maladies , au mauvais régime des
malades, ou au traitement mal dirigé : d’où il eft évident
qu’on a , à la vérité , ràifon de diviler les ijna-
fedies malignes en venimeufes, peflilentielles & conta-
gieufes, mais que la divifion n’eft pas entière, parce
qu’on doit confidérer nori-fêulement les puiffances
nuifibles, mais même aufli les femences acceffoires.
Lorfqu’une maladie, accompagnée de fes fymptomes
ordinaires , parcourt fes tems d’une maniéré
eonvenable .à fa nature, on l’appelle régulière, choifle ;
& irrégulière, au contraire, lorsqu’elle fe fait con-
«oître par des fymptomes extraordinaifes, & par
des Agnes & une marche étrangers. L’iitégularité
entretient à-peu-près quelque chofe de rebelle, &
provient des mêmes caufes que la malignité , dont
Ordinairement elle n’eft pas non plus exe,n?pte. Il en
eft de même des maladies appeffées naturelles,.q u corrompues.
On regarde comme appartenante au fujet que nous
traitons maintenant, la divifion des maladies en actives
& onpajfîv.es , dont les mqdernes ont avec raifon
augmenté ta théorie. Les maladies avives font celles
dont les' fymptomes aélifs conftituent une partie, &
fouvent la principale. Dans jles maladiespafiives, ces
mouyemens ,dç la nature n’ont pas lieu, l.e .principe
C A R 119
vital étant languiffant, ou opprimé par les puiffances
nuifibles* (G)
§ C a r a c t è r e , (P e in t .) Les anciens graveurs,
peintres ftatuaires ne fe font pas bornés à copier
exaftement les cinq traits qui forment le vifage de
l’homme. Ils ont tenté de fepréfenter dans chaque
fujet l’étendue de fon génie & de fes pallions, en un
mot * ils font parvenus à trader dans chaque figure
fon vraie caractère. Diogene Laërce nous apprend
que dans Athènes , l’on enfeignoit publiquement la
théorie.de l’art de développer les phyfionomies, &
l’art ffc les d^fliner. Les médailles, les pierres gravée^
& Tps ftatues qui pnt été faites du tems d’Alexandre,
nQiisdémpntrent que dans l’exprefiion , les
anciens Grecs étoient & feront toujours nos maîtres.
Les médailles, en argent qui repréfenfent la tête d’Alexandre
le Grand , annoncent un ambitieux qui af-
piroit à la conquête de l’univers, on le reçonnoît à
fon. oeil arrondi, fai liant, plein de feu , élevé, vers
le ciel, à fon menton & à fa bouche avancée un peu
ouverte , au fourcil, &c.
Dans les monnoies d’or ou d’argent des premiers
empereurs Romains, on reçonnoît également leur
caractère. Le menton avance d’Augufte annonce fon
ambition : mais l’oe il, le fourcil, & g. indiquent le
fourbe timide. L’on ne confidere point attentivement
les médailles de Tibere fans frémir. La tête de Claude
donne envie de rire de la ftupidité. Celle de Néron,
de Caligula, d’Othon & de Commode, femblenr
nous décrire jufqu’à quel point les petits maîtres doivent
.devenir fcél.érats. Dans les rnédailles'de Vefpa-
fien, on croit melurer l’étendue de fon avarice : le?
eritans même reconnôïffent dans celle de Yitellius un
ivrogne , un glouton, un homme fans moeurs. An-
tonin le pieux porte fur fa figure le développement
des traits d’un homme fage. Marc-Aurelle paroît être
violemment attentif à remplir tous fes devoirs, &c.
Parmi les modernes, Raphaël d’Urbain eft le peintre
qui a le plus étudié les monumens de l’antiquité. Il
n’eft donc pas étonnant qu’il foit parvenu à un très-
haut point de perfection dans l’expreftïon des caractères
des hommes. Son tableau de l’école d’Athènes,
dont on trouvera la defeription dans le Cours de
peinture de M. Depiles, eft un monument & un modèle
que l’on peut citer. Les têtes d’Ariftote, de
Platon, de Socrate, d’Alcibi.àdç, d’Epicure, enuq
mot, les têtes de prefque tous les phijofophes qu’il
a raffemblés dans ce chef-d’oeuvre d’invention pito-
refque, font toutes tracées exactement d’après les
médailles, pierres gravées, &c. les autres têtes font
copiées d’après nature ; par exemple , dans uq
angle de ce tableau , l’oq voit Euçlide fous la figure
de Bfamante, fameux architeéte & ami de Raphaël.
Euclide courbé, démontre une figure de. mathématique
, qu’il a tracée fur une ardoïfe par terre; il eft
environné de plufieurs écoliers ; l’un a le caractère
de l’efprit v if qui a faifi dans l’inftant la dém.onftration.
qu’il répété à fon voifin ; un autre paroît un efprit
lourd &c pefant, capable par fon application d’apt*
prendre les mathématiques ; un autre patoît être un
homme inepte, même pour la démonftration de?
lignes & des rapports, &c.
Le Brun, dans le fiecle dernier, étudia un traité
de phyfionomie, compofé par Jean-Baptiffe Porta ;
il copia d’après nature quelques caractères d’hommeS
paflionnés. Cet habile artifte a fait graver le rudiment
de l’art de deflinër méthodiquement les paffions \
c’eft-à-dire, la tranquillité, la joie, le ris, la trif-
teffe, la colere, &c. en dix-neuf planches. Cet oiv*
y rage gravé au fimple trait, eft cômmun chez tous
les vendeurs d’eftampes. En 176 1 , on a réimprimé
à Paris ce cahier in-folio ; le fleffein eft infidèle ; mais
on y a joint l’explication & la defeription de Reflet
de chaque paflion fur les cinq traits du vifage. Nous