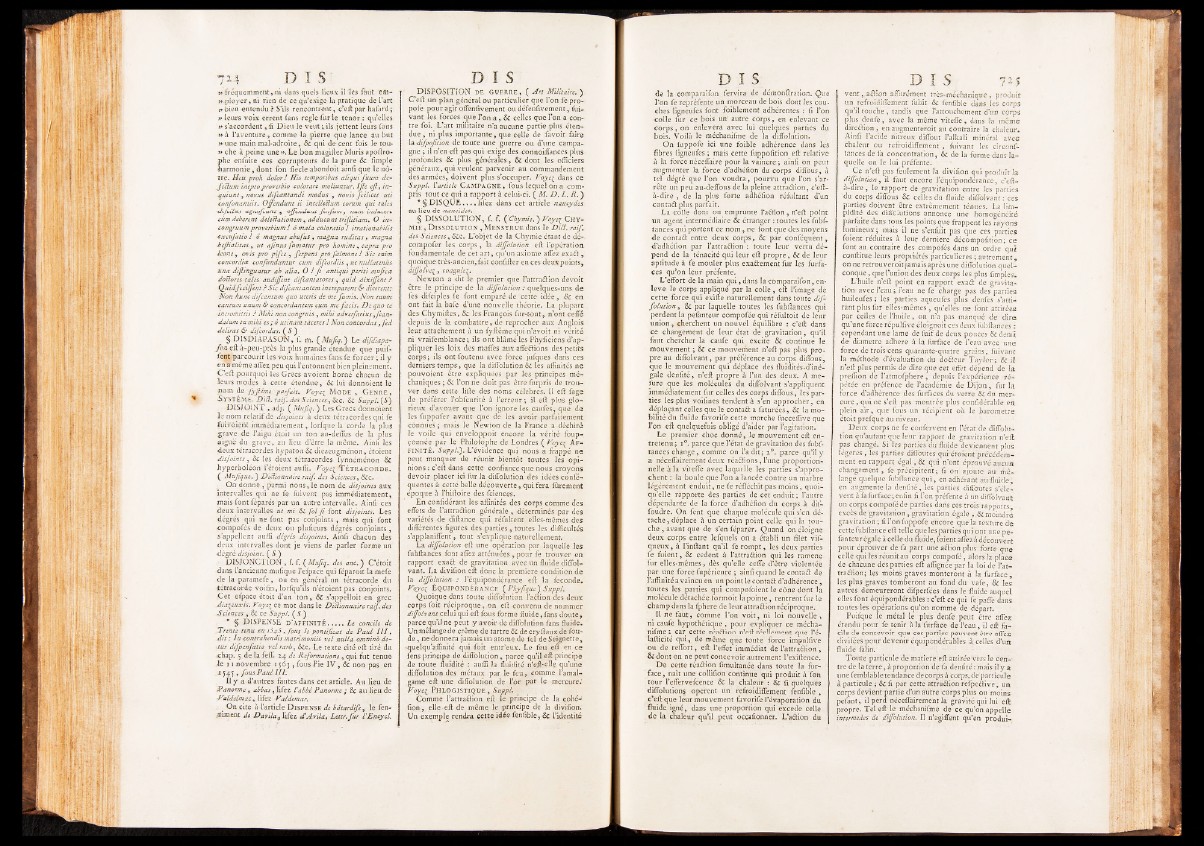
» fréquemment y ni dans quels lieux il 'les faut em-
».ployer, ni rien de ce qu’exige, la pratique de l’art
tf -bien entendu-? S’ils rencontrent, c’ eft par hafard ;
» leurs voix errent fans regle furie ténors qu’elles
» s’accordent, fi Dieu le veut ; ils jettent leurs fons
-» à l’aventure:, comme 4a pierre que lance au but
»■ une main mal-adroite, 8c qui de cent fois le tou-
» che à peine une ». Le bon magilter Mûris apoftro-
phe enfuite ces corrupteurs de la pure & fimple
harmonie, dont fon fiecle abondoit ainfi que le nôtre.
Heu proh dolot ! His temporibus aliqui fuiun de-
Julum inepto proverbio -colorare moltuntur. ljie ejl, in-
§quiunt -, no vus difcantandi modus , novis fcilicet uti
conjbnanti'is. Offendunt ii intellelîum eorum qui taies
-dejeclus agnofcunt 9 offendunt fenfum; nam inducere
cum deberent deleclationem, adducunt trifiitiam. O in-
congruum proverbium ! ô mala Colorado ! ïrrationabilis
excufatio ! ô magnus abufus , magna ruditas, magna
■ bçjlialitas , ut ajinits fumatur pro homine, capra pro
■ Icône y ovis pro p if ce , ferptns pro falmone ! Sic enim
concordiez confunduntur cum difeordiis , ut nullatenùs
una dijlinguatur ab alla. O ! J i antiqui perid mujiccc
doctores taies audiffent difeantatores , quid dixiffent ?
Quidfedjfent ? Sic difeantantem increparent & dicerent:
-Non hune difeantum quo uteris de me fumis. Non tuutn
cantum unum & concordantcm cum me facis. De quo te
intromittis ? Mihi non congruis , mihi adverfarius ,fcan-
dal uni tu mihi es; ô udnarn t acérés ! Non concordas, fed
■ déliras & difeordas. ( S )
§ DISDIAPASON, f. m. (Mufiq.) Le difdiapa-
Jonçft. à-peu-près la plus grande étendue que puif-
fent parcourir les voix humaines fans fe forcer ; il y
en a même affez peu qui l’entonnent bien pleinement.
C ’eft pourquoi les Grecs avoient borné chacun de
leurs modes à cette étendue, 8c lui donnoient le
nom dq fyjléme parfait. Foye{ Mode , Genre ,
-SYSTÈME. Dicl. raif. des Sciences, &c. Si Suppl. (S )
DISJOINT , adj. ( Mufiq. ) Les Grecs donnoient
le nom relatif de disjoints à deux tétracordes qui fe
fuivoient immédiatement, lorfque la corde la plus
grave de l’aigu étpit un ton au-deffus de la plus
•aiguë du grave, au lieu d’être la même. Ainfi les
<leux tétracordes hypaton Si diezeugménon, étoient
disjoints, 8c les deux tétracordes fynnéménon 8c
hyperboléon l’étoient aufii. V zj'eç ^Tétracord e.
( Mujîque. ) Dictionnaire raif. des Sciences, &c.
On donne , parmi nous, le nom de disjoints aux
intervalles qui ne fe fuivent pas immédiatement,
mais font féparés par un autre intervalle. Ainfi ces
deux intervalles ut mi & fol Ji font disjoints. Les
dégrés qui ne font pas conjoints , mais qui font
compofés de deux ou plufieurs dégrés conjoints,
s ’appellent auffi degrés disjoints. Ainfi chacun des
deux intervalles dont je viens de parler forme un
dégré disjoint. ( S. )
- DISJONCTION , f. f . ( Mujîq. desanc.j C’étoit
-dans l’ancienne mufique l’efpace qui féparoit la mefe
de la paramefe, ou en général un tétracorde du
tétracorde voifin, lorfqu’ils n’étoient pas conjoints.
Ce t efpace étoit d’un ton, 8c s’appelloit en grec
dia^euxis. Voye\ ce mot dans le Dictionnaire raij. des
Sciences., & ce Suppl. ( J" )
* § DISPENSE d’affinité........ Le concile de
Trente tenu en iSqS, fous le pontificat de Paul I I I ,
dit : In contrahendis matrimpniis vel nulla omninb de-
■ .tur difpenfatio vel rarb, &c, Le texte cité eft tiré du
•chap. % de la fefl. 14 de Refprmafionc, qui fut tenue
Je n novembre 1563 , fous Pie IV , 8c non pas en
J 545 , fous.Paul III.
Il y a d’autres fautes dans cet article. Au lieu de
JP anorme, abbas 9 lifez ! abbé Panorme ; 8c au lieu de
•Valdplmac, liiez Valdemar.
, £ On cite à l’article D ispense de bâtardife, le fen-
.aiment de Davila,a lifez d’Avila, Lettr.fur CEncycl.
DISPOSITION de g u e r r e , ( A n Militaire. )
C’eft un plan général ou particulier que l’on fe pro-
pofe pour agir offenfivement ou défenfivement, fui-
vant les forces que l’on a , & celles que l’on a contre
foi. L’art militaire n’a aucune partie plus étendue
, ni plus importante, que celle de favoir faire
la difpojition de toute une guerre ou d’une campagne
; il n’en eft pas qui exige des connoiffances plus
profondes & plus générales, & dont les officiers
généraux, qui veulent parvenir au commandement
des armées, doivent plus s’occuper. Voye^ dans ce
Suppl, l’article Campagne, fous lequel on a compris
tout ce qui a rapport à celui-ci. ( M. D . L. R. )
* § DISQUE. . . . lifez dans cet article naucydes.
au lieu de naneïdes.
§ DISSOLUTION, f. f, ÇCkymie. ) Voye{ C h y -
m ie , Dissolution , Menstrue dans le Dicl. raif.
des Sciences, &cc. L’objet de la Chymie étant de dé-,
compofer les corps j la dijfolution eft l’opération
fondamentale de cet art, qu’un axiome aflez exaél ,
quoique très-ancien, fait confifter en ces deux points,
dijjolve^ i coagule
Newton a dit le premier que l’attra&ion de voit
être le principe de la dijfolution : quelques-uns de
fes difciples fe font emparé de cette idée, & en
ont fait la bafe d’une nouvelle théorie. La plupart
des Chymiftes, & les François fur-tout, n’ont cefle
depuis de la combattre, de reprocher aux Anglois
leur attachement à un fyftême qui n’avoit ni vérité
ni vraifemblance ; ils ont blâmé les Phyficiens d’appliquer
les loix des mafles aux affeélions des petits
corps ; ils ont foutenu avec force jufques dans ces
derniers temps, que la diflolution & les affinités ne
pouvoient être expliquées par les principes mé-
chaniques ; & l’on ne doit pas être furpris de trouver
dans cette- lifte des noms célébrés. Il eft fage
de préférer Pobfcurité à l’erreur; il eft plus glorieux
dévouer que l’on ignore les eau fes, que de
les fuppofer avant que de les avoir parfaitement
connues niais le Newton de la France'a déchiré
le voile qui enveloppoir encore la vérité foup-,
çonnée par le Philofophe de Londres ( Voye%_ Aff
in it é . Suppl.). L’évidence qui nous a frappé ne
peut manquer de réunir bientôt toutes les opinions
: c’eft dans cette confiance que nous croyons
devoir placer ici fur la diflolution des idées confé-
quentes à cette belle découverte, qui fera fûrement
epoque à l’hiftoire des fciences.
En confidérant les affinités des corps comme des
effets de l’attratlion générale , déterminés par des
variétés de diftance qui réfultent elles-mêmes, des
différentes figures des parties, toutes les difficultés
s’applaniffent, tout s’explique naturellement.
La dijfolution eft une opération par laquelle les
fubftances font affez atténuées , pour fe trouver en
rapport exaâ de gravitation avec un fluide diffol-
vant. La divifion eft donc la première condition de
la dijfolution : l’équipondérance eft la fécondé.
Foyei Éq UIPONDÉRANCE (Phyfique) Suppl.
Quoique dans toute diflolution l’attion des deux
corps foit réciproque ,.on eft ,convenu de nommer
difjolvant celui qui eft fous forme fluide, fans doute,
parce qu’il ne peut y avoir de diflolution fans fluide.
Un mélange de crème de tartre & de cryftaux de fou-
d e , ne donnera jamais, un atome de fel de Seignetfe,
»quelqu’affinité qui foit entr’eux. Le feu e f t . en ce
fens principe de diflolution , parce qu’il eft principe
de toute fluidité : auffi la fluidité n’eft-elle qu’une
diflolution des métaux par le feu, comme l’amalgame
eft une diflolution de l’ôr par le mercure.'
Foye{ Ph lo g is t iq u e , Suppl.
Comme l’attraâion eft le principe de la cohé-
fion, elle eft de même le principe de la divifion.
Un exçmple rendra cette idée fenfible, 8c l’identité
de la comparaifon fervira de démonftration. Que
l’on fe repréfente un morceau de bois dont les couches
ligneufes font foiblement adhérenres : fi l’on
colle fur ce bois un' autre corps, en enlevant ce
corps, on enlevera avec lui quelques parties du
bois. Voilà le méchanifme de la diflolution.
On fuppofe ici une foible adhérence dans les
fibres ligneufes ; mais cette fuppofition eft relative
à la force néceffaire pour la vaincre ; ainfi on peut
augmenter la force d’adhéfion du corps diffous, à
tel dégré que l’on voudra, pourvu que l’on s’arrête
un peu au-deflous de la pleine attraélion, c’eft-
à-dire , de la pins forte adhéfion réfultant d’un
contaél plus parfait.
La colle dont on emprunte l’a â io n , n’eft point
un agent intermédiaire 8c étranger : toutes les fubftances
qui portent ce nom, ne font que des moyens
de contaft entre deux corps, 8c par conféquent,
d’adhéfion par l’attraélion : toute leur vertu dépend
de la ténacité qui leur eft propre, & de leur
aptitude à fe mouler plus exactement fur les furfa-
ces qu’on leur préfente.
L’effort de la main qui, dans la comparaifon, en-
leve le corps appliqué par la co lle, eft l’image de
cette force qui exifte naturellement dans toute dif-
folution, 8c par laquelle toutes les fubftances qui
perdent la pefanteur compofée qui réfultoit de leur
union, cherchent un nouvel équilibre : c’eft dans
ce changement de leur état de gravitation, qu’il
faut chercher la caufe qui excite & continue le
mouvement ; 8 c ce mouvement n’eft pas plus propre
au diffolvant, par préférence au corps diffous,
que le mouvement qui déplace des fluidités-d'iné-
gale denfité, n’eft propre à l’un des deux. A mesure
que les molécules du diffolvant s’appliquent
immédiatement fur. celles dès corps diffous, les parties
lès plus voifines tendent à s’en approcher, en
déplaçant celles que le contaft a faturées, 8c la mobilité
du fluide favorife cette marche fucceffive que
l’on eft quelquefois obligé d’aider par l’agitation.
Le premier choc donné, le mouvement eft entretenu;
i°. parce que l’état de gravitation des fubftances
change, comme on l’a dit'; z°. parce qu’il y
a néceffairement deux réaûiohs, l’une proportionnelle
à la vîteffe avec laquelle les parties s’approchent
; la boule que l’on a lancée contre un marbre
légèrement enduit, ne fe réfléchit pas moins, quoiqu’elle
rapporte des parties de cet enduit ; l’autre
dépendante de la force d’adhéfion du corps à dil-
foudre. On fent que chaque molécule qui s’en détache,
déplace à un certain point celle qui la touche
, avant que de s’en fépar,er. Quand on éloigne
deux corps entre lefquels on a établi un filet vif-
queux , à l’inftant qu’il fe rompt, les deux parties
fe fuient, 8c cedent à l’attraéfion qui les ramene
fur elles-mêmes, dès qu’elle ceffe d’être violentée
par une force fupérieure ; ainfi quand le contatt de
l’affinité a vaincu en un point le contaâ d’adhérence,
toutes les parties qui compofoient le cône dont la
molécule détachée formoit la pointe, rentrent fur le
champ dans la fphere de leur attraâion réciproque.
Il ne faut, comme l’on v o it, ni loi nouvelle ,
ni caufe hypothétique , pour expliquer ce méchanifme
; car cette réaftion n’eft réellement que l’é-
lafticité qui, de même que toute force impuîfive
ou de reffort, eft l’ effet immédiat de l’attrattion,
8c dont on ne peut concevoir autrement l’exiftence.
De cette réaftion fimultartée dans toute la fur-
face, naît une collifion continue qui produit à fon
tour l’effervefcence 8c la chaleur : & fi quelques
diflolution^ opèrent un refroidiffement fenfible ,
c’eft que leur mouvement favorife l’évaporation du
fluide igné, dans une proportion qui excede celle
de la chaleur qu’il peut ocçafiônner. L’a&ion du
vent ,.a&ion affurement très-méchanique, produit
un refroidiffement fubit & fenfible dans les corps
qu’il touche , tandis que l’attouchement d’un cçrps
plus denfe, avec la même vîteffe, dans la même
direétion , en augmenferoit au contraire la chaleur.
Ainfi l’acide nitreux diffout l’alkali minéral avec
chaleur ou refroidiffement , fuivant les circonf-
tances de fa concentration, & de la forme dans laquelle
on le lui préfente.
Ce n’eft pas feulement la divifion qui p r o d u it la
dijfolution, il faut encoreTéquipondérarice , c’eft-
à-dire, le rapport de •gravitation entre les parties
du corps diffous 8c celles du fluide diffolvant : ces
parties doivent être extrêmement ténues. La limpidité
des diffclutions annonce une homogénéité
parfaite dans tous les points que frappent les rayons
lumineux ; mais il ne s’enfuit pas que ces parties
foient réduites à leur derniere décompofition ; ce
font au. contraire des- compofés dans un ordre qui
conftitue leurs propriétés particulières ; autrement,
on ne retrouveroit jamais après une diflolution quelconque,
que l’union des deux corps les plus fimples.
L’huile n’eft point en rapport exaft de gravitation
avec l’eau ; l’eau ne fe charge pas des parties
huileufes; les parties aquèufes plus denfes s’attirant
plus, fur elles-mêmes, qu’elles ne font attirées
par celles de l’huile, on n’a pas manqué de dire
qu’une force répulfive éloignoit ces deux fubftances :
cependant une lame de fuif de deux pouces 8c demi
de diamètre adhéré à la furface de l’eaù avec une
force de-trois'cens quarante-quatre grains, fuivant
la méthode d’évaluation du doéleur Taylor ; 8c il
n’eft plus permis de dire que cet effet dépend de la
preflion de l’atmofphere, depuis l’expérience répétée
en préfence de l’académie de D ijon , fur la
force d’adhérence des furfaces du verre 8c du mercure,
qui ne s’eft pas montrée plus confidérable en
plein air, que fous un récipient où le baromètre
étoit prefque au niveau.
Deux corps ne fe corrfervent en l’étafde diffolu-
tion qu’autant que leur rapport de gravitation n’eft
pas changé. Si les partiés du fluide deviennent plus
Hgeres , les parties diflbutes quréroient précédemment
en rapport ég a l, & qui n’ont éprouvé aucun
changement, fe précipitent; fi on ajouté au "mê- 1
lange quelque fubftancë qui, en adhérant àü fluide,
en augmente la denfité,.les parties diffoutes s’élèvent
à,fa furface; enfin fi.l’on préfente à un diffolvant
un corps compofé de parties dans ces trois-rapports .
excès de gravitation, gravitation égale ;,& moindfè
gravitation ; fi l’on fuppbfè encore quela texture de
cette fubftancë eft telle que les parties qui ont une pefanteur
égale à celle du fluide, foient aflez à découvert
pour éproùver de fa part une aftion plus forte que
celle qui les réunit au corps compofé, alors la place
de chacune dés parties eft aflrgnée par la loi de l’at-
tra&ion; les moins graves monteront à la furface,
les plus graves tomberont au fond du vafe, 8c les
autres demeureront difperfées dans le fluide auquel
elles font équipondérables : c’eft ce qui fe paffe dans
toutes les opérations qu’on nomme de départ.
Puifque le métal le plus denfe peut être affez:
étendu pour fe tenir à laTurfàcè de l’eau, il eft facile
de concevoir que ces parties peuvent être affez
divifées pour devenir équipondérables à, celles d’un
fluide falin.
Toute particule dematierè eft àttirée'vers le centre
de la terre, à proportion de-fa denfité : mais il y a
une femblable tendance de corps, à corps, de particule
à particule ; 8c fi par cette àttrâéïion refpèéfive, un
corps devient partie d’un autre corps plus ou moins
pefant, il perd néceffairement la gravité qui lui eft
propre. Tel eft le méchanifme de ce qu’on appelle
intermèdes de dijfolution. II n’agiffent qu’en produi