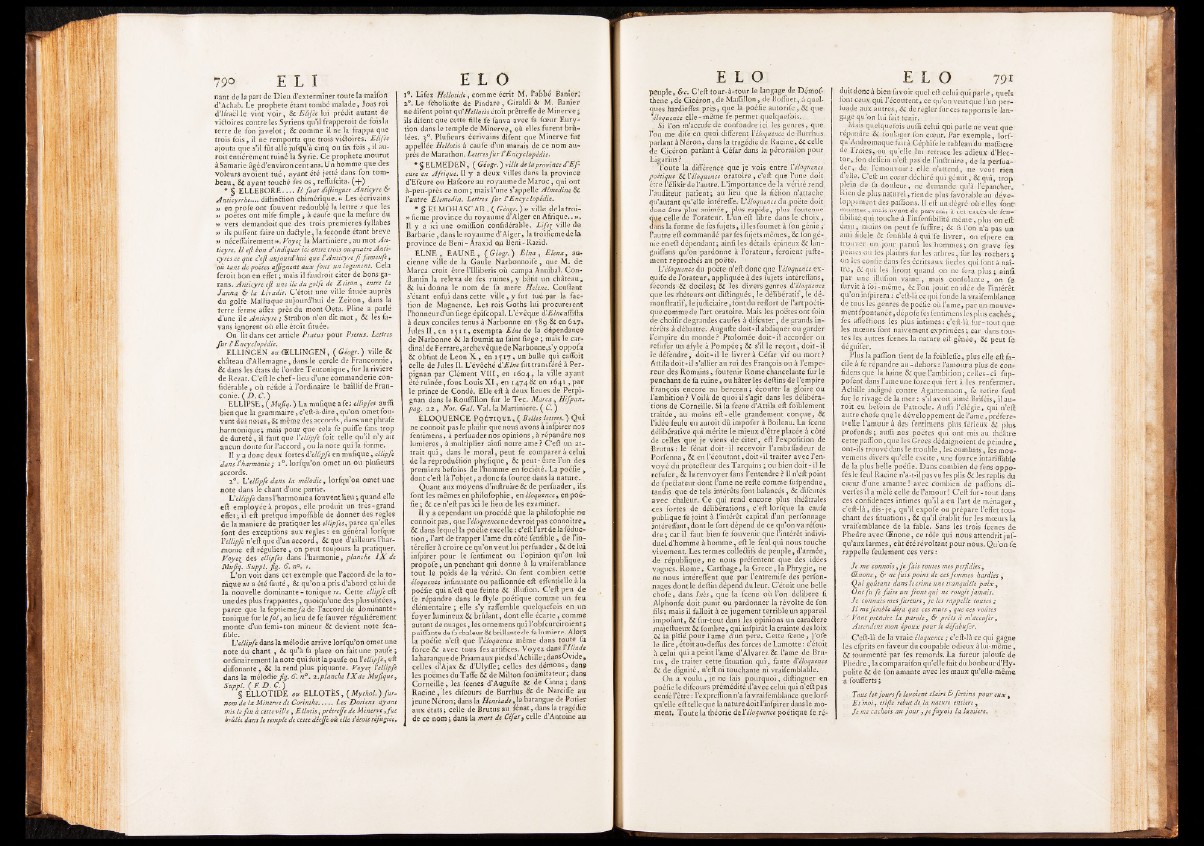
nant de la part de Dieu d’exterminer toute la mailbn
d’Achab. Le prophète étant tombé malade, Joas roi
d’Ifraël le vint v o ir , 6cElifée lui prédit autant de
victoires contre les Syriens qu’il frapperoit de fois la
terre de fon javelot; & comme il ne la frappa que
trois fois, il ne remporta que trois viftoires. Elifée
ajouta que s’il fut allé jufqu’à cinq ou fix fois , il au-
roit entièrement ruiné la Syrie. Ce prophète mourut
àSamarie âgé d’environ cent ans. Un homme que des
voleurs avoient tué, ayant été jetté dans fon tombeau,
& ayant touché fes o s , reffufcita. (+ )
* § ELLEBORE. . . . I l fautdiftinguer Anticyre &
Anticyrrhe.... diftin&ion chimérique.« Les écrivains
» en profe ont fouvent redoublé la lettre r que les
» poètes ont mife limple, à caufe que la mefure du
» vers demandoit que des trois premières fyllabes
» ils puffent faire un daélyle, la fécondé étant breve
» néceffairement ». Voye{ la Martiniere, au mot Anticyre.
Il ejl bon d'indiquer ici entre trois ou quatre Anti-
cyres ce que c'ejl aujourd'hui que t Anticyre Jîfameufe,
'ou tant de poètes alignent aux fous un logement. Cela
feroit bon en effet ; mais il faudroit citer de bons ga-
rans. Anticyre eft une île du golfe de Zeiton , entre la
Janna & la Livadie. C’étoit une ville fituée auprès
du golfe Malliaque aujourd’hui de .Zeiton, dans la
terre ferme affez près du mont Oeta. Pline a parlé
d’une île Anticyre ; Strabon n’en dit mot, 6c les fa-
vans ignorent oîi elle étoit fituée.
On lit dans cet article Pratus pour Prêtas. Lettres
fur VEncyclopédie.
ELLINGEN ok (ELLINGEN, ( Giogr. ) ville &
château d’Allemagne, dans le cercle de Franconnie,
& dans les états de l’ordre Teutonique, fur la riviere
de Rezat. C ’efl le chef-lieu d’une commanderie con-
lidérable, oh réfide à l’ordinaire le baillif de Fran-
conie. ( D .C . )
ELLIPSE, ( Mufiq. ) La mufique a fes ellipfes aufli
bien que la grammaire, c’eft-à-dire, qu’on omet fou-
vent des notes, 6c même désaccords, dans une phrafe
harmonique; mais pour que cela fe puiffe fans trop
de dureté , il faut que l'ellipfe foit telle qu’il n’y ait
aucun doute fur l’accord, ou la note qui la forme.
Il y a donc deux fortes d'ellipfe en mufique, ellipfe
'dans £ harmonie-, i° . lorfqu’on omet un ou plufieurs
accords.
i ° . L’ellipfe dans la mélodie, lorfqu’on omet une
note dans le chant d’une partie.
U ellipfe dans l’harmonie a fouvent lieu ; quand elle
eft employée» propos, elle produit un très-grand
effet ; il eft prefque impoffible de donner des réglés
de la maniéré de pratiquer les ellipfes, parce qu’elles
font des exceptions aux réglés : en général lorfque
P ellipfe n’eft que d’un accord, & que d’ailleurs l’har-
jnonie eft régulière , on peut toujours la pratiquer.
Voyei des ellipfes dans l’harmonie, planche I X de
Mujiq. Suppl, fig. 6, n°. i.
L ’on voit dans cet exemple que l’accord de la tonique
ut a été fauté , 6c qu’on a pris d’abord celui de
la nouvelle dominante - tonique re. Cette ellipfe eft
une des plus frappantes, quoiqu’une des plusufitées,
parce que la feptieme fa de l’accord de dominante-
tonique fur le fo l, au lieu de fe fauver régulièrement
monte d’un femi-ton mineur 6c devient noté fen-
fible.
L’ellipfe dans la mélodie arrive lorfqu’on omet une
note du chant , & qu’à fa place on fait une paufe ;
ordinairement la note qui fuit la paufe ou Vellipfe, eft
diffonante , & la rend plus piquante. Voye{ l’ellipfe
dans la mélodie fig. 6. n °. 2.planche IXde Mufique,
Suppl. (F . JD. C.)
§ ELLOTIDE o« ELLOTÈS, (Mythol.) fur-
nom de la Minerve de Corinthe. . . . . Les Doriens ayant
mis le feu à cette ville , Ellotis, prêtreffe de Minerve ,fut
bridée dans le temple de cette déeffe où elle £ étoit réfugiée•
i° . Lifez Hellotide, comme écrit M. l’abbé BanîéiC
2°. Le fcholiafte de Pindare, Giraldi & M. Banjer
ne difent point qu'Hellotis étoit prêtreffe de Minerve ;
ils difent que cette fille fe fauva avec fa foeur Eury-
tion dans le temple de Minerve, oh elles furent brûlées.
30. Plufieurs écrivains difent que Minerve fut
appellée Hellotis à caufe d’un marais de ce nom auprès
de Marathon. Lettresfur l'Encyclopédie*
* § ELMED EN', ( Géogr. ) ville de la province <£ Ëf-
cure en Afrique. 11 y a deux villes dans la province
d’Efcureou Hafcoreau royaume de Maroc, qui ont
à-peu-près ce nom ; mais l’une s’appelle Almedine 6c
l’autre Elemedin. Lettres fur P Encyclopédie.
* § ELMOHASCAR., ( Géogr.)» ville delatroi-
» fierne province du royaume d’Alger en Afrique.. ».
Il y a ici une omiflion confidérable. Lifeç ville de
Barbarie , dans le royaume d’Alger, lafroifiemedela
province de Berii-Araxid qp Beni-Ràzid.
ELNE , EAU NE , ( Géogr.) Èlna , Elena, ancienne
ville de la Gaule Narbonnoife, que M. de
Marca croit être l’liliberis oh campa Annibal. Con-
ftantin la releva de fes ruines, y bâtit un château *
6c lui donna le nom de fa mere Helene. Confiant
s’étant enfui dans cette ville, y fut tué par la faction
de Magnence. Les rois Goths lui procurèrent
l’honneur d’un fiege épifcopal. L’évêque fi-Elne aflifta
à deyx conciles tenus à Narbonne en 589' 6c en 627.
Juives I I , en 1 < i t , exempta Elne de la dépendance
de Narbonne oc la fournit au faint fiege ; mais le cardinal
de Ferrare, archevêque de Narbonne,s’y oppofa
& obtint de Leon X > en 15 1 7 , un bulle qui cafibit
celle de Jules II. L’évêché a Elne fut transféré à Perpignan
par Clément V III, en 1604, la ville ayant
été ruinée, fous Louis X I , en 1474 & en 1641 , par
le prince de Condé. Elle eft à deux lieues de Perpignan
dans leRouflillon fur le Tec . Marca, Hfparu
pag. 2 2 , Not. Gai. Val. la Martiniere. ( C. )
ÉLOQUENCE Po é t iq u e , ( Belles lettres.) Qui
ne connoît pas le plaifir que nous avons àinfpirer nos
fentimens, à perfuader nos opinions, à répandre nos
lumières, à multiplier ainfi notre ame ? C’eft Un attrait
q ui, dans le moral, peut fe comparer à celui
de la reprodu&io'n phyfique, & peut-être l’un des
premiers befoins de l’homme en foeiété. La poéfie ,
dont c’eft là l’objet , a donc fa fource dans la natute.
Quant aux moyens d’inftruire 6c de perfuader, ils
font les mêmes en philofophie, en éloquence, en poé-
fie ; 6c ce n’eft pas ici le lieu de les examiner.
Il y a cependant un procédé que la philofophie ne
connoît pas, que l'éloquence ne de vroit pas connoître,
& dans lequel la poéfie excelle : e’eft l’art de la féduc-
tion, l’art de frapper l’ame du côté fenfible, de l’m-
téreffer à croire ce qu’on veut lui perfuader, & de lui
infpirer pour le fentiment ou l’opinion qu’on lui
propofe, un penchant qui donne à la vraifemblance
tout le poids de la vérité. On fent combien cette
éloquence infinuante ou paflionnée eft effentielle à la
poéfie qui n’eft que feinte 6c illufion. C ’eft peu de
fe répandre dans le ftyle poétique comme un feu
élémentaire ; elle s’y raffemble quelquefois en un
foyer lumineux & brûlant, dont elle écarte, comme
autant de nuages, les ornemens qui l’obfcurciroient ;
puiffante de fa chaleur & brillante de fa lumière. Alors
la poéfie n’eft que l'éloquence même dans toute fa
force & avec tous fes artifices. Voyez dans £ Iliade
la harangue de Priam aux pieds d’Achille ; dansOvide,
celles d’Ajax & d’U lyffe; celles des démons, dans
les poèmes du Taffe 6c de Milton fon imitateur; dans
Corneille, les fcenes d’Augufte & de Cinna dans
Racine, les difcours de Burrhus 6c de Narciffe au
jeune Néron; dans la Henriade, la harangue de Potier
aux états; celle de Brutus au fénat, dans la tragédie
de ce nom j dans la mort de Cefar f celle d’Antoine au
peuple, &c. C ’eft tour-à-tour le langage de Démof-
thene , de Cicéron, de Mafîillpn, de Boffuet, à quelques
hardieffes près, que la poéfie autorife, & que:
’ éloquence elle-même fe permet quelquefois.,,
^ Si l’on m’accufe de confondre ici les genres, que.
l’on me dife en quoi different l'éloquence de Burrhus.
parlant à Néron,, dans la tragédie de Racine, 6c celle
de Cicéron parlant à Céfar dans la péroraifon pour
Ligarius ?
Toute la différence que je v.ois entre l'éloquence
poétique 6c l’éloquence oratoire, c’eft que l’une doit
être l’élixir de l’autre. L’importance de la vérité rend,
l’auditeur patient; au lieu que la fiâion. n’attache,
qu’autant qu’elle intéreffe. \d éloquence du,poète doiq
donc être plus animée, plus rapide, plus foutenue
que celle de l’Orateur. L’un eft libre dans le choix ,
dans la forme de fes fujets, il lesfoumet à fon génie ;
l’autre eft commandé par fes fujets mêmes, & fon gé-..
nie en eft dépendant; ainfi les détails épineux & lan-
guiffans qu’on pardonne à l’orateur, feroient jufte-.
ment reprochés au poète. ’
L'éloquence du poète n’eft donc que l'éloquence éx.-
quife de l’orateur, appliquée à des fujets intéreffans,
féconds 6c dociles ; & les divers genres d’éloquence.
que les rhéteurs ont diftingués, le délibératif, le dé-
monftratif, le judiciaire, font du reffort dé l’art poétique
comme de l’art oratoire. Mais les poètes ont foin
de choifir de grandes caufes à difcuter, de grands intérêts
à débattre. Augufte doit-il abdiquer ou garder
l’empire du monde? Ptolomée doit-il accorder ou
refufer un afyle à Pompée ; & s’il le reçoit, doit-il
le défendre, doit-il le livrer à Céfar v if ou mort?
Attila doit-il s’allier au roi des François ou à l’empereur
des Romains, foutenir Rome chancelante fur le
penchant de fa ruine, ou hâter les deftins de l’empire
François encore au berceau ; écouter la gloire ou
l’ambition ? Voilà de quoi il s’agit dans les délibérations
de Corneille. Si la fcene d’Attila eft foiblement
traitée, au moins eft-elle grandement conçue, &
l’idée feule en auroit dû impofer à Boileau. La fcene
délibérative qui mérite le mieux d?être placée à côté
de celles que je viens de citer, eft l’expofition de
Brutus : le fénat doit-il recevoir l’ambaffadeur de
Porfenna , & en l’écoutant, doit-il traiter avec l’envo
y é du protecteur des Tarquins ; ou bien doit-il le
refufer, & le renvoyer fans l’entendre ? Il n’eft point
de fpe&ateur dont l’ame ne refte comme fufpendue,
tandis que de tels intérêts font balancés, 6c difcutés
avec chaleur. Ce qui rend encore plus théâtrales
ces fortes de délibérations, c’eft lorfque la caufe
publique fe joint à l’intérêt capital d’un perfonnage
intéreffantjdont le fort dépend de ce qu’on va réfoudre
; car il faut bien fe fouvenir que l’intérêt individuel
d’homme à homme, eft le feul qui nous touche
vivement. Les termes colleûifs de peuple, d’armée,
de république, ne nous préfentent que des idées
yagues. Rome * Carthage, la Grece, la Phrygie, ne
ne nous intéreffent que par l’entremife des perfon-
jnages dont le deftin dépend du leur. C’étoit une belle
chofe, dans Inès, que la fcene oîi l’on délibéré fi
Alphonfe doit punir ou pardonner la révolte de fon
.fils; mais il falloit à ce jugement terrible un appareil
impofant, & fur-tout dans les opinions un caraftere
majeftueux & fombre, qui infpirât la crainte des loix
6 c la pitié pour l’ame d’un pere. Cette fcene , j’ofe
le dire,étoitau-deffus des forces de Lamotte : c’étoit
à celui qui a peint l’ame d’Alvarez & l’ame de Brutus,
de traiter cette fituation qui, faute d'éloquence
6 c de dignité, n’eft ni touchante ni vraifemblable.
On a voulu, je ne fais pourquoi, diftinguer en
poéfie le difcours prémédité d’avec celui qui n’eft pas
cenfé l’être: l’expreffion n’a fa vraifemblance quelorf-
.qu’elle eft telle que la nature doit l’infpirer dans le moment,
Toute la théorie de l'éloquence poétique fe réduitd.
onç à bien favoir quel eft celui qui parle, quels
font ceux qui l’ecoutent, ce qu’on veut que l’un per-
fuade aux autres, & dérégler furces rapports le langage
qu’on lui fait tenir.
IMaisquelquefois-auffi celui qui parle.né veut que
répandre .& foulager fon coeur. Par exemple, lorf-
qu And^omaquefait à Céphifele tableau du maffacre
deTroies,.ou qu’elle lui retrace les adieux d’Hec-
tpr , fon deffein n’eft pas de.l’inftruire, de la perfua-
der,; de. l’émouvoir: elle, n’attend, ne veut rien
d elle. C ’eft un coeur déchiré qui gémit, 6c qui, trop
plein de fa. douleur, ne demande qu’à l’épancher.
Rien de.plus naturel , rien de plus favorable au dé.ve-
Ipppcnient des pallions. Il eft un degré où elles lonr
miiettes , mais,.ayant de parvenir à cet excès de fen-
fibilite. qui touche a l'infenlihilité même, plus on eft
emy, moins on peut fe fuffire; & fi l’on n’a pas un
ami fidele & fenfible à qui'fe livrer , ôn efpere en
trouver un .jour parmi les‘hommes ; on grave fes
peines oit fes plaifirs fur les arbres, fur les -rochers ;
on les confie .dans fes. écrits aux fieeles qui font à naîr
t re ,.& q iii les liront quand on ne fera plus ; ainfi
par une illufion vaine., mais conlblante, on fe
furvit à foi-même, êc l’on jouit en idée de l’intérêt
qu’on infpirera : c’eft-là ce qui fonde la vraifemblance
de tous les genres de poéfie où l’ame, par un mouvement
fpontanée^ dépofe fes fentimens les plus cachés,'
fes affeûions les plus intimes: c’eft-là fur-tout que
les moeurs font naïvement exprimées ;.car dans toutes
les autres fcenes la nature eft gênée, 6c peut fe
déguifer.
Plus la paffion tient de la foiblefle, plus elle eft facile
à fe répandre au- dehors : l’amour a plus de con-
fidens que la haine 6c que l’ambition; celles-ci fup-
pofent dans l’ame une force qui fert à les renfermer.
Achille indigné contre Agamemnon, fe retire feul
fur le rivage de la mer : s’il avoit, aimé Briféis, il auroit
eu befoin de Patrocle. Aufli l’élégie, qui n’eft
autre chofe que le développement de l’ame, préfere-
t-elle l’amour à des fentimens plus_férieux 6c plus
profonds4 . aufli nos po.ëtes qui ont mis au théâtre
cette paflion, queies Grecs dédaignoient de peindre ,
ont-ils trouvé dans le trouble, les combats, les mou-
vemens divers qu’elle excite, une fource intariffable
de la plus belle poéfie. Dans combien de fens oppo-
fés le feul Racine n’a-t-il pas vu les plis 6c les replis du
coeur d’une amante 1-avec combien, dè paflions di-
verfes il a mêlé celle de l’amour ! C’eft fur- tout dans
ces confidences intimes qu’il a eu l’art de ménager ,
c’eft-là, dis-je, qu’il expofe ou prépare l’effet touchant
des fituations., & qu’il établit fur les moeurs la
vraifemblance de la fable. Sans les trois fcenes de
Phedre avec (Enone, ce rôle qui nous attendrit juf-
qu’aux larmes, eût été révoltant pour nous. Qu’on fe
rappelle feulement ces vers :
Je me comtois, je fais toutes nies perfidies,
(Enone, 6* ne fuis point de ces femmes hardies ,
Qui gçûtant dans le crime une tranquille paix ,
Ontfufe faire un front qui ne rougit jamais.
Je connais mes fureurs, je lès rappelle toutes ;
I l me femble déjà que ces murs , que ces voûtes
. ' Vont prendre la parole, & prêts à nPaccufêr,
Attendent mon époux pour le dèfabufer.
C’eft-là de la vraie éloquence ; c’eft-là ce qui gagne
les efprits en faveur du coupable odieux à lui-même ,
6c tourmenté par fes remords. La fureur jaloufe de
Phedre, la comparaifon qu’elle fait du bonheur d’Hy-
polite & de fon amante avec les maux qu’elle-même
■ a-foùfferts ;
Tous les jours fe levaient clairs fit fereins pour eux ,
Et moi, tri fie rebut de la nature entière ,
Je.me cachais au jour , je fuy ais la lumière. .•
__ ___________ ______ ____■ ______ _______ M M B li” '1*1111 .. —.--ti