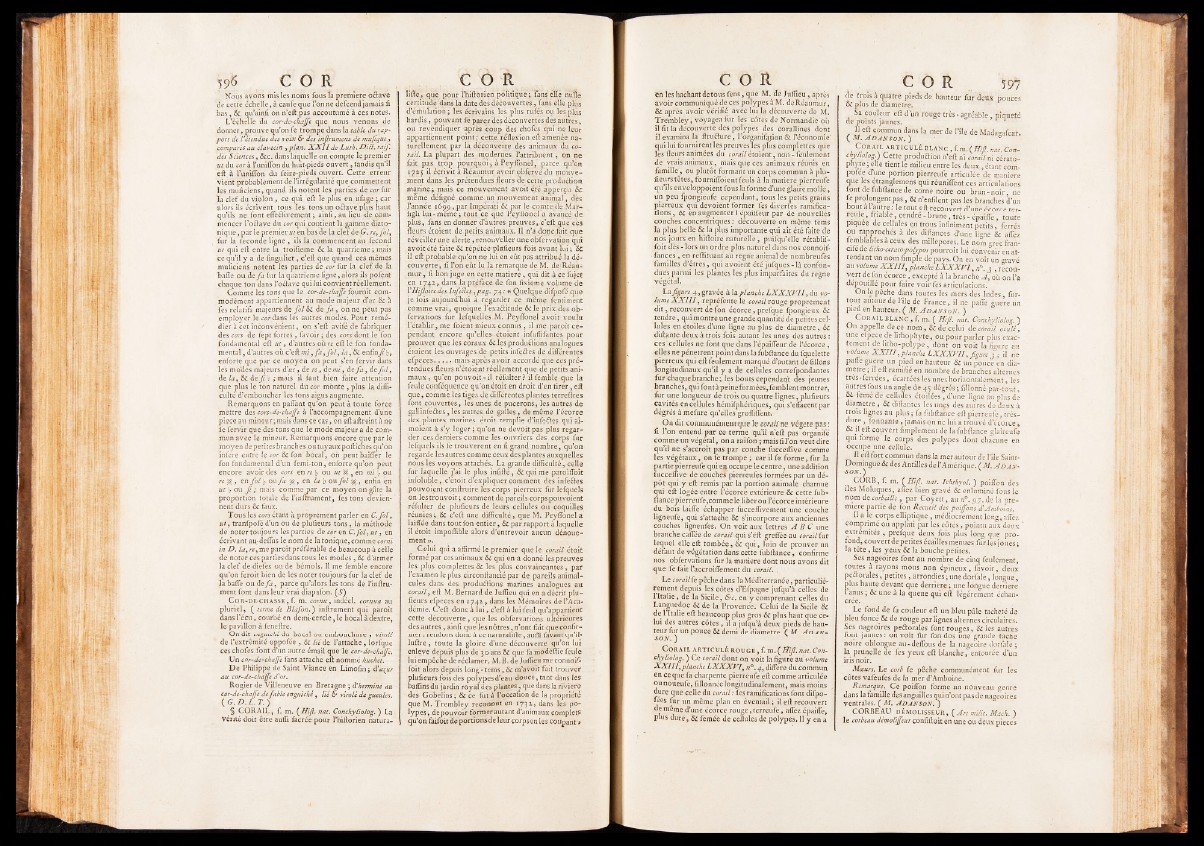
Nous avons mis les noms fous ta première oôâve
de eettè échelle, à caufe que Tonne defcend jamais fi
bas, & qu’ainfi on n’eft pas accoutumé à ces notés.
L’échelle du cor-de-chaffe que nous venons de
donner , prouve qu’on fe tro.mpe dans la table du rapport
de retendue des voix & des infirumens de miijique ,
.comparés au clavecin , plan. X X I I defuth.Dicl. raif.
des Sciences, & c. dans laquelle on compte le premier
■ ut. du.-cor à Tuniffon du huit-pieds ouvert, tandis qu’il
eft ^ Tuniffon du feize-pieds ouvert. Cette erreur
vient probablement de l’irrégularité que commettent
les muficiens, quand ils notent les parties .de cor fur
la clef du violon, ce qui eft le plus envufage ; car
■ alors ils écrivent tous les. tons un oûave plus haut
qu’ils ne font effectivement ; ainfi, au lieu de.com-
mencer ToCtave du cor qui contient la gamme diatonique,
par le premier ut en. bas de la <deî dz-G ,re, fol,
fur la fécondé ligne , ils la commencent au-fécond
ut qui eft entre la troifieme & la quatrième ; mais
ce qu’il y a de fingulier, c’éft que quand ces mêmes
muficiens notent les parties de,cor fur la clef de. la
baffe ou de fa fur la quatrième ligne, alors ils.pofent
chaque ton dans ToCtave qui lui convient réellement.
Comme les tons que le cor-de-chaffe fournit commodément
appartiennént au mode majeur d'ut & à
fes relatifs majeurs de fo l & de f a , oh ne. peut pas
employer le cor dans les autres modes. Pour remédier
à cet inconvénient, on s’eft avifé de fabriquer
des cors de fept fortes , favoir ; des cors dont le fon
fondamental eft u t, d’autres oit re eft le fon fondamental
, d’autres où c ’eft mi, fa , fo l, la, & enfinJ i
enforte que par ce moyen on peut s’en fervir dans
les modes majeurs d'u t, de re, demi, de f a , de fo l,
de la, & de f i \> ; mais il faut bien faire attention
que plus le ton naturel du cor monte , plus la difficulté
d’emboucher les tons aigus augmente.
Remarquons en paffant qu’on peut à toute force
mettre d es cors-de-ckaffe à l’accompagnement d’une
piece au mineur; mais dans ce cas, on eft aftreint à ne
fe fervir que des tons que le mode majeur a dé commun
avec le mineur. Remarquons encore que par le
moyen de petites branches ou tuyaux poftiches qu’ôn
inféré entre le cor & fon bocal, oh peut baiffer le
fon fondamental d’un femi-ton, enforte qu’on peut
encore avoir des cors en re (7 ou ut % en mi j; pu
r e% , en fo l\ ou fa % , en la 1? ou fo l enfin en
ut | ou f i ; mais comme par ce moyen on gâte la
proportion totale de l’inftrument, fes tons devièn- '
nent durs & faux. ■
Tous les cors étant à, proprement parler en C. fo l,
ut, tranfpofé d’un ou de plufieurs tons, là méthode
de noter toujours les parties de cor en C.fol, u t , en
écrivant aq-deffus le nom de la tonique, comme corni
in D. la, re, me paroît préférable de beaucoup à celle
de noter ces parties dans tous les modes , & d’armer
la clef de diefes ou de bémols. Il me fembîe encore
qu’on feroit bien de lés noter toujours fur la clef de
la baffe ou de f a , parce qu’alors les tons de l’inftru-
ment font dans leur vrai diapafon. ( i 1)
C or-de-CHASSE, f. m. cornu, indéd. cornua au
pluriel, ( terme de Blafon.') infiniment qui pàroît
dans l’écu, courbé en demi-cercle, le bocal àdextre,
le pavillon à feneftre.
On dit enguichè'du bocal ou embouchure , virole
de l’extrémité oppofée , lié de l’attache, lorfque
ces chofes font d’un autre émail que le cor-de-chaffe.
Un cor-de-chaffe fans attache eft nommé huchet.
De Philippe de Saint Viance en Limofin; d’azur
au cor-de-chaffe d'or.
Rogier de Villeneuve en Bretagne ; déherminé au
cor-derchaffe de fable enguichè, lié & virole de gueules.
( G. D .L . T. )
§ CORAIL, f. m. ( Hifl. nat. Conchyliolog. ) La-
vérité doit être auffi facrée pour l’hiftorien naturalifte,
que j>puy.l*ffifl:bnen,politique;• fans elle nulle
certitude'dans la date des découvertes, fans elle plus
d’émülation; les écrivains les plus rufés ou les plus
hardis, pouvant fe parer des découvertes des autres *
ou revendiquer après coup 'des chofes qui ne leur
appartiennent’ point t.çettq réflexion eft amenée naturellement
par lar découverte des animaux du corail.
La plupart desmodernes l’attribuent ; on ne
fait pas trop pourquoi^ à Peyffpnel, ,parce .qu’en
172,5 il écrivit àRéaumurayoir çbfervé du mouvement
dans les prétendues fleurs de cette production
marine ; mais ce mouvement avoit été apperçu &
meme défigné commevun mouvement animal, dès
. l’année 1699., par Impérati ÔL par le comte; de Mar-
figli lui-même; tout ce que Peyffonel a avancé de
plus, fans en donner d’autres preuves, c’eft,j^ue ces
fleurs étoient de petits animaux. 11 n’a doncTait que
réveiller une alerte, renouveller une obfervàtipn qui
avoit été faite & répétée plufieurs fois ayant-lui ; &
il eft probable qu’on ne lui en eût pas attribuera découverte,
fi Ton eût l,u là remarque de M, de Réau-
mur, fiibon juge en cette matière , qui dit à ce fujet
en 1742, dans, la prçface de fon fixieme volume de
YHifioire des.Infectes, pag. 74 : « Quelque difppfé que
je fois aujourd’hui à, regarder ce même fentiment
comme vrai, quoique Texa&itude & le prix des obfervations
fur lefquelles M. Peyflonel avoit voulu
l’établir , me foient mieux connus , il me paroît cependant
encore qu’elles- étoient infuffifantes pour
prouver que les coraux & les productions analogues
étoient les ouvrages.de petits infeCtes de différentes
efpeçes.. , . • mais.après avoir accordé que ces prétendues
fleurs n’étôient réellement que de petits animaux,
qu’en pouvoit-il réfulter? il femble que la
feule çônféquence qu’on étoit en droit d’en tirer, eft
que, comme les tiges de différentes plantes terreftres
font couvertes, les.unes de pucerons, les autres de
gallinfeCtes, les^autres de galles , de même l’écorce
des plantes marines étoit remplie d’infeCtes qui ai-
moient à s’y loger ; qu’on ne devoit pas plus regarder
ces derniers comme les ouvriers des corps fur
lefquels ils fe trouvèrent en fi grand nombre, qu’on
regarde lesautres comme ceux des plantes auxquelles
nous les voyons attachés. La grande difficulté, celle
fur laquelle j’ai le plus infifté, & qui me paroiffoit
infoluble, c’étoit d’expliquer comment des infeCtes
pou voient çonftruire les corps pierreux fur lefquels
on lestrouvoit; comment de pareils corps pouvoient
réfulter de plufieurs de leurs cellules ou coquilles
réunies; & c’eft une difficulté, que M. Peyffonel a
laiffée dans tout fon entier, & par rapport à laquelle
il étoit impoffible alors d’entrevoir aucun dénouement,
».
Celui qui a affirmé le premier que .le corail étoit
formé par ces animaux & qui en a donné les preuves
les plus complettes & les plus convaincantes, par
l’examen le plus circonftancié par de pareils animalcules
dans des productions marines analogues au
corail, eft M. Bernard de. Juffieu qui en a décrit plufieurs
efpeces en 174 1 , dans les Mémoires de l’Académie.
C’eft donc à lui, c’eft à lui feul qu’appartient
cette découverte, que les obfervations ultérieures
des autres, ainfi que-lesnôtres, n’ont fait que confirmer
: rendons donc à ce naturalifte, auflx favant qu’il-
luftre, toute la gloire d’une découverte qu’on lui
enleve depuis plus de 30 ans & que fa modéfiie feule
lui empêche de réclamer. M. B. de Juffieu me connoifi
foit alors depuis long -tems, & m’a^oit fait trouver
plufieurs fois des polypes d’eau douce, tant dans les
baffins du jardin royal des plantes, que dans la ri'vierè
des Gobelins ; & ce fut à l’occafion de la propriété
que M. Trembley reconnut en 1732, dans les polypes
, de pouvoir former autant d’animaux complets
qu’on fàifoit de portions de leur corps en les coupant >
en les hachant detoüs fens, que M. dé Juffieu, après
avoir communiqué de ces polypes à M. deRéaûmür,
& après avoir vérifié avec lui là découverte de M.
Trembley, voyagea fur les côtes de Normandie Où
il fit la découverte des polypes des c'orallines dont
il examina la ftruCture, l ’organifmion & l’économie-
qui lui fournirent les preuves les pmS complettes que
les fleurs animées du corail étoient, non - feulement
de vrais animaux, mais que cèS animaux réunis en
famille, ou plutôt formant un corps commun à plu.—
fieurstêtes, fourniffoientfeüls à la matière pierreufe
qu’ils enveloppoient fous là forme d’une glaire molle,
un peu fpongieufe cependant, tous les petits grains
pierreux qui dévoient former fes diverfes ramifications,
& en augmenter l ’épaiffeur par de nouvelles
couches concentriques : découverte en même téms
la plus belle & la plus importante qui ait été faite de
nos jours en hiftoire naturelle, puifqu’elle rétablif-
foit dès - lors un ordre plus naturel dans nos connoif-
■ fances , en reftituant ait régné animal de hombreufes
familles d’êtres, qui avoient été jufques-là confondues
parmi les plantes les plus imparfaites du régné
végétal,-
La figure 4 , gravée à la planche L X X X V I I , du volume
X X I I I , repréfente le corail rouge proprement
dit, recouvert de fon écorce, prefque fpongieux &
tendre, qui montre une grandequantité de petites cellules
en étoiles d’une ligne au plus de diamètre, &
diftante deux à trois fois autant les unes des autres :
ces cellules ne font que dans Tépaiffeur de l’écorce ,
elles ne pénètrent point dans la fubftance du fquelette
pierreux qui eft feulement marqué d’autant de filions
longitudinaux qu’il y a de cellules correfpondantes
fur chaque branche; les bouts cependant des jeunes
branches, qui fontàpeine formées,femblent montrer,
fur une longueur de trois ou quatre lignes » plufieurs
. cavités en cellules hémifphériques, qui s’effacent par
degrés à mefure qu’elles groffiffentv
On dit communément que le corail ne végété pas:
fi Ton entend par ce terme qu’il n’eft pas organifé
comme un végétal, on a raifon ; mais fi Ton veut dire
qu’il ne s’accroît pas par couche fucceffive comme
les végétaux, on fe trompe ; car il fe forme, fur la
partie pierreufe qui eji occupe le centre, une addition
fucceffive de couches pierreufes formées par un dépôt
qui y eft remis par la portion animale charnue
qui eft logée entre l’écorce extérieure & cette fubftance
pierreufe,comme le liber ou Técorce intérieure
du bois laiffe échapper fucceffivement une couché
ligneufe, qui s’attache & s’incorpore aux anciennes
couches ligneufes. On voit aux lettres A B C une
branche caffée de corail x^di s’eft greffée au corail fur
lequel elle eft tombée, & qui, loin de prouver un
défaut de végétation dans cette fubftance, confirme
nos obfervations fur la maniéré dont nous avons dit
que fe fait Taccroiffement du corail. .
Le corail le pêche dans la Méditerranée, particuliérement
depuis les côtes d’Efpagne jufqu’à celles de
l’Italie, de la Sicile, &c. en y comprenant celles du
Languedoc & de la Provence. Celui de la Sicile &
de l’Italie eft beaucoup plus gros & plus haut que celui
des autres côtes, il a jufqu’à deux pieds de hauteur
fur un pouce & demi de diamètre. ( M. A d an -
s o n . )
Corail articulé rouge, f. m.( lïijl.nat.Con-
thyliolog. ) Ce corail dont on voit la figure au volume
X X I I f planche LX X X V I , n°. 4, différé du commun
en ce que fa charpente pierreufe eft comme articulée
ounoueufe, fillonnée longitudinalement, mais moins
,^ire clue celle du corail: les ramifications font difpo-
fées fur un même plan en éventail ; il eft recouvert
de même d’une écorce rouge, terreufe, affez épaiffe,
plus dure, & Cernée de cellules de polypes, Il y en a
de trois à quàtre pieds de hauteur fur deux pouces
& plus de diamètre.
Sa couleur eft d ’un rouge très - agréable piqueté
de points jaunes.
Il eft commun dans la mer de l’oie de Madaeafcar.
( M. A D a n s o n . ) 5
Corail articulé blanc , f .m . ( ^ . Con-
chyholog.) Cette produàion n’eft ni corail ni cérato-
phyte ; elle tient le milieu entre les deux , étant com-
pofée d’une portion pierreufe articulée de maniéré
que les étranglemens qui réuniffent ces articulations
font de fubftance de corne noire ou brun-noir, ne
fe prolongent pas, & n’enfilent pas les branches d’un
bout a 1 autre : le tout eft recouvert d’une écorce ter-
reüfe, friable, cendré - brune, très - épaiffe, toute
piquée de cellules en trous infiniment petits, ferrés
Ou rapprochés à des diftarices d’une ligne & affez
femblàbles à ceux des millepores. Le nom grec fran-
cifédé litho-ceratôpolypos pourroit lui convenir en attendant
tin nom fimple de pays. On en voit un gravé
au volume X X I I I , planche L X X X V I , , recouvert
de fon écorce, excepté à la branche A , où on Ta
dépouillé pour faire voir fes articulations.
On le pêche dans foutes les mers des Indes, fur-
tout autour de l’île de France, il ne paffe guere un
pied en hauteur. ( M. A d a n s o n . )
Corail blanc , f. m. ( Hiß. nat. Conchyliolog. )
On appelle de ce nom , & de celui de corail oculè,
une efpece de lithophyte, ou pour parler plus exactement
de litho-polype, dont on voit la figure au
volume XXIII,planche LX X X V I I , figure j ; il ne
paffe guere un pied en hauteur & un pouce en diamètre
; il eft ramifie en nombre de branches alternes
tres-ferrées, écartées les unes horizontalement, les
autres fous un angle de 45 degrés ; fillonné par-tout,
ô i ferne de cellules étoilées, d’une ligne au plus de
diamètre , & diftantes les un^s des autres de deux à
trois lignes au plus ; fa fubftance eft pierreufe, très-
dure , fonnante, jamais on ne lui a trouvé d’écorce,
& il eft couvert Amplement de la fubftance glaîreufe
qui forme le corps des polypes dont chacune en
occupe une cellule.
Il eft fort commun dans la mer autour de l’île Saint-
Domingue & des Antilles de l’Amérique, ( M. A d a n -
■ SON.) "■
CORB, f. m. ( Hiß. nat. Ichthyol. ) poiffon des
îles Moluques, affez bien gravé & enluminé fous le
nom de corbeille, par Co ye tt, au n°. q j . de la première
partie de fon Recueil des poiffons 'dAmboine.
Il a le corps elliptique , médiocrement long, affez
comprime ou applati par les cotés, pointu aux deux
extrémités , prefque deux fois plus long que profond,
couvert de petites écailles menues fur les joues ;
la tê te , les yeux & la bouche petites.
Ses nageoires font au nombre de cinq feulement,
toutes à rayons mous non épineux, favoir, deux
peftorales, petites, arrondies ; une dorfale, longue,
plus haute devant que derrière ; une longue derrière
1 anus ; & une à la queue qui eft légèrement échan-
.crée.
Le fond de fa couleur eft un bleu pâle tacheté de
bleu foncé & de rouge par lignes alternes circulaires.
Ses nageoires peftorales font rouges, & les'autr.es
font jaunes : on voit fur fon dos une grande tache
noire oblongue au-deffous de la nageoire dorfale;
la prunelle de fes yeux eft blanche, entourée d’un
iris noir.
Moeurs. Le corb fe pêche communément fur les
côtes vafeufes .de la mer d’Amboine.
Remarque. Ce poiffon forme un nouveau genre
dans la famille des anguilles qui n’ont pas de nageoires
ventrales. ( M. A d an so n . )
CORBEAU DÉMOLISSEUR, ( Artmilit. Mach. )
le corbeau dèmoliffeur confiftoit en une ou deux pièces