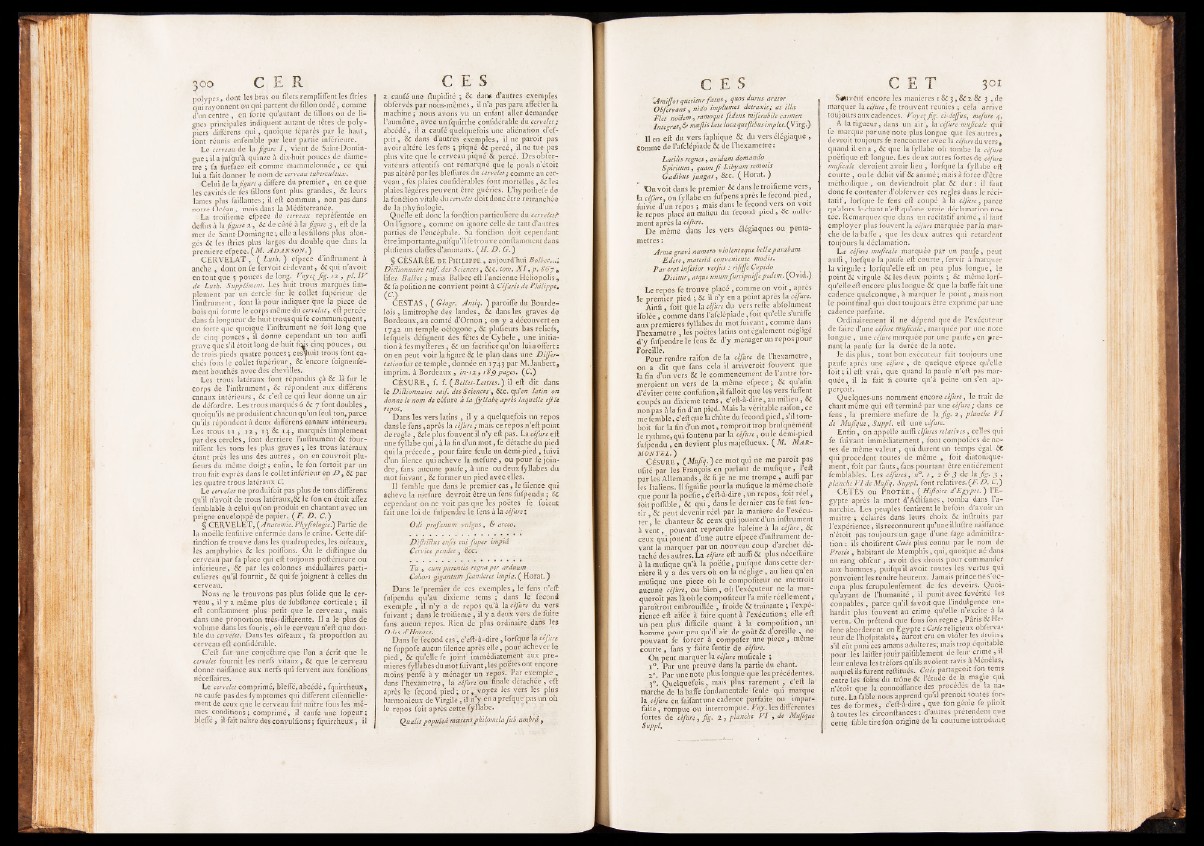
300 C E R
polypes, dont les bras ou filets rempliflent les fines
qui rayonnent ou qui partent du fillon ondé, comme
d’un centre , en forte qu’autant de filions ou de lignes
principales indiquent autant de têtes de polypiers
différens q u i, quoique féparés par le haut,
font réunis enfemble par leur partie inférieure.
Le cerveau de la figure I , vient de Saint-Domingue
; il a jufqu’à quinze à dix-huit pouces de diamètre
3 fa furface eft comme mammelonnee, ce qui
lui a fait donner le nom de cerveau tuberculeux.
Celui de la figure* différé du premier , en ce que
les cavités de fes filions font plus grandes, & leurs
lames plus faillantes ; il eft commun, non pas dans
notre Océan , mais dans la Méditerranée.
La troifieme efpece de cerveau repréfentée en
deffus à la figure z , & de côté à la figure 3 , eft de la
mer de Saint-Domingue ; elle a les filions plus alon-
gés & les ftries plus larges du double que dans la
première efpece. (M. A d a n s o n .)
C E R V E LA T , ( Luth. ) efpece d’inftrument à
anche , dont ôn fe l'ervoit ci-devant, & qui n’avoit
en tout que 5 pouces de long. Foye%_ fig. i z , pl. I F
de Luth. Supplément. Les huit trous marqués Amplement
par un cerclé fur le collet fupérieur de
rinftrument, font là pour indiquer que la piece de
bois qui forme le corps même du cervelat, eft percée
dans fa longueur de huit trous quife communiquent,
en forte que quoique l’inftrument ne foit long que
de cinq pouces , il donne cependant un ton aufli
grave que s’il étoit long de huit fqis cinq pouces, ou
de trois pieds quatre pouces ; cesviuit trousTont cachés
fous le collet fupérieur, & encore foigneufe-
ment bouchés avec dés chevilles.
Les trous latéraux font répandus çà & là fur le
corps de l’inftrument, & répondent aux différens
canaux intérieurs, & c’éft ce qui leur donne un air
de défordre. Les trous marqués 6 & 7 font doubles ,
quoiqu’ils ne produifent chacun qu’un feul ton, parce
qu’ils répondent à deux différens canaux intérieurs.
Les trous 11 , 1 2 , 13 & 14 , marqués Amplement
par des cercles, font derrière l’inftrument & four-
niffent les tons les plus graves ; les trous latéraux
étant près les uns des autres , on en couvroit plu-
fieurs du même doigt; enfin, le fon fortoit par un
trou fait exprès dans le collet inférieur en D , & par
les quatre trous latéraux C.
Le cervelat ne produifoit pas plus de tons différens
qu’il n’avoit de trous latéraux,& le fon en étoit affez
femblable à celui qu’on produit en chantant avec un
peigne enveloppé de papier. (F . D . C.)
§ CERVELET, (Anatomie. Phyfiologie.') Partie de
la moelle fenfitive enfermée dans le crâne. Cette dif-
tinôion fe trouve dans les quadrupèdes, les oifeaux,
les amphybies & les poiffons. On le diftingue du
cerveau par fa place qui eft toujours poftérieure ou
inférieure, & par les colonnes médullaires particulières
qu’il fournit, & quife joignent à celles du
cerveau.
Nous ne le trouvons pas plus folidç que le cerveau
, il y a même plus de lubftance corticale ; il
eft conftamment plus petit que le cerveau, mais
dans une proportion très-différente. Il a le plus de
volume dans les fouris, où le cerveau n’ eft que double
du cervelet. Dans les oifeaux, fa proportion au
cerveau eft confidérable.
C ’eft fur une conjecture que l’on a écrit que le
cervelet fournit les nerfs vitaux, & que le cerveau
donne naiffance aux nerfs qui fervent aux fondions
néceffaires.
Le cervelet comprimé, bleffé, abcédé, fquirrheux-,
ne caufe pas des fymptomes qui different effentielle-
ment de ceux que le cerveau fait naître fous les mêmes
conditions; comprimé, il caufe une fopeur;
bleffé, il fait naître des convulfions ; fquirrheux, il
C E S
a caufé une-ftupidité ; & dans d’autres exemples
obfervés par nous-mêmes, il n’a pas paru affeder la
machine ; nous avons vu un enfant aller demander
l’aumône, avec unfquirrhe confidérable du cervelet ;
abcédé, il a caufé quelquefois une aliénation d’ef-
prit, 6c dans d’autr'és exemples, il ne paroît pas
avoir altéré les fens ; piqué & percé, il ne tue pas
plus vite que le cerveau piqué & percé. Des observateurs
attentifs ont remarqué que le pouls n’étoit
pas altéré par les bleffures du cervelet; comme au cerveau
, fes plaies confidérables font mortelles, & les
plaies légères peuvent être guéries. L’hypothefe de
la fonction vitale du cervelet doit donc être retranchée
de la phyfiologie.
Quelle eft donc la fondion particulière du cervelet?
On l’ignore, comme on ignore celle de tant d’autres
parties de l’encéphale. Sa fondion doit cependant
être importante,puifqu’ilfe trouve conftamment dans
plufieurs claffesd’animaux. (H. D . G.')
§ CÉSARÉE de Philippe , aujourd’hui Bolbcc.,.i
Dictionnaire raif. des Sciences, &C. tom. X I , p. 86y „
lifez Balbec ; mais Balbec eft l’ancienne Héliopolis ,
& fa pofition ne convient point à Céfarée de Philippe,
(C.) . 8
C ESTAS , ( Géogr. Antiq. ) paroiffe du Bourde-
lois , limitrophe des landes, & dans les graves de
Bordeaux, au comté d’Ornon ; on y a découvert en
1742 un temple odogone, & plufieurs bas reliefs,
lefquels défignent des fêtes de Cybele , une initiation
à fes myfteres, & un facrifice qu’on lui a offert:
on en peut voir la figure & le plan dans une Dijfer-
tationiur ce temple, donnée en 1743 par M. Jaubert,
imprim. à Bordeaux , in-tZy 18gpages. (C.)
CÉSURE, f. f. (Belles-Lettres.} il eft dit dans
le Dictionnaire raif. des Sciences , &c. qu’e/z latin on
donne le nom de céfure a la fyllabç après laquelle eft le
repos.
Dans les vers latins , il y a quelquefois un repos
dans le fens, après la céfure ; mais ce repos n’eft point
de réglé , &le plus fouvent il n’y eft pas. La céfure eft
une fyllabe qui, à la fin d’un m ot, fe détache du pied
qui la précédé, pour faire feule un demi-pied , fuivi
d’un filence qui achevé la mefuré , ou pour fe joindre,
fans aucune paufe, à une ou deux fyllabes du
mot fuivant, & former un pied avec elles.
Il femble que dans le premier cas, le filence qui
achevé la mefure devroit être un fens fufpendu ; &
cependant on ne voit pas que les poètes fe foient
fait une loi de fufpendre le fens à la céfure :
Odi prpfanum vulgus, & arceo.
Difirictus enfis cui fuper impiâ
Çervice pendet, &cV
Tu , cum parentis régna per arduurn
Çohors gigantum fcanderet impia. ( Horat. )
Dans l e rpremier de ces exemples, le fens n’eft:
fufpendu qu’au dixième tems ; dans le fécond
exemple , il n’y a de repos qu’à la céfure du vers
fuivant ; dans le troifieme , il y a deux vers de fuite
fans aucun repos. Rien de plus ordinaire dans les
Odes d.'Horace.
Dans le fécond cas ', c’eft-à-dire, lorfque la cefure
ne fuppofe aucun filence après elle, pour achever le
pied, & qu’elle fe joint' immédiatement àux premières
fyllabes du mot fuivant, les poètes ont encore
moins penfé à y ménager un repos. Par exemple ,
dans l’hexametre, la céfure ou finale détachée , eft
après le fécond pied ; o r , voyez les vers lés plus
harmonieux de V irgile, il n’y enapréfque'pas un ou
le repos foit après cette fyllabe.
Qjialis populeâ mcerehs philomelafub umbrq ,
C E S
Umîijos qucriturfatus^uosiumsardior .
Obfervans, nido implumes detraxit; at ilia
Flet noctem, ramoque fedens miferabile carmen
Intégrât^& muftis latelocaquefiibusimplet.(Virg.')
Il en eft du vers faphique & du vers élégiaque ,
tomme de l’afclépiade & de l’hexametre :
Latius régnés, avidum domando
Spiritum, quant f i Libyam remotis
Gadibus jungas, &c. ( Horat. )
'On voit dans le premier & dans le troifieme vers,
la céfure, ou fyllabe en fufpens après le fécond pied ,
liiivie d’un repos ; mais dans le fécond vers on voit
le repos placé au milieu du fécond pied, & nullement
après la céfure. .
De même dans les vers elegiaques x>u pentamètres
:
Arma gravi numéro violentaque bellaparabam
Edere, materiâ convcniente modis.
Par erat inferior verfus : rifijfe Cupido
Dicitur, atque unum furripuiffe pedem. (Ovid.)
Le repos fe trouve placé, comme on v o it , après
le premier pied ; & il n’y en a point après la céfure.
Ainfi , foit que la céfure du vers refte abfolument
ifolée, comme dans l’afclépiade, foit qu’elle s uniffe
aux premières fyllabes du mot fuivant, comme dans
l’hexametre , les poètes latins ont également négligé
d’y fufpendre le fens & d’y ménager un repos pour
l’oreille.
Pour rendre raifon d e là céfure de lhexametre,
on a dit que fans cela il arriveroit fouvent que
la fin d’un vers & le commencement de l’autre for-
meroient un vers de la même efpece ; & qu’afin
d’éviter cette confufion, il falloit que les vers fuffent
coupés au dixième tems, c’eft-à-dire, au milieu, &
non pas à la fin d’un pied. Mais la véritable raifon, ce
me femble, c’eft que la chute du fécond p ied, s’il tom-
boit fur la fin d’un mot, romproittrop brufquement
le rythme, qui foutenu par la céfure, ouïe demi-pied
fufpendu, en devient plus majeftueux. ( M. Ma r -
MONTEL. )
CÉSURE, (Mufiq.)ce mot qui ne me paroît pas
lifité par les François en parlant de mufique, l’ eft
par les Allemands, & fi je ne me trompe aufli par
les Italiens. Ilfignifie pour la mufique la mêmechofe
que pour la poëfie, c’ eft-à-dire ,un repos, foit réel,
foit poflible, & q u i, dans le dernier cas fe fait fén-
tir , & peut devenir réel par la maniéré de l’exécuter
le chanteur & ceux qiii jouent d’un infiniment
à vent, pouvant reprendre haleine à la céfure, &
ceux qui jouent d’une autre efpece d’inftrument devant
la marquer par un nouveau coup d’archet détaché
des autres. La céfure eft aufli & plus néceffaire
à' la mufique qu’à la poëfie, puifque dans cette der-'
niere il y a des vers oü on la néglige, au lieu qu en
mufique une piece oîi le compofiteur ne mettrôit1
aucune céfure, ou bien, oii l’executeur ne la mar-
queroit pas là oîi le compofiteur l’a mife réellement,
paroîtroit embrouillée , froide & traînante ; l’expérience
eft aifée à faire quant à l’exécution; elle eft
lin peu plus difficile quant à la compofition, um
homme pour peu qu’il ait de goût & d’oreille , ne •
pouvant fe forcer à compofer une piece, même:
courte, fans y faire fentir de céfure.
On peut marquer la céfure muficale ;
i ° . Par une preuve dans la partie du chant.
a°. Par une note plus longue què les précédentes.
30. Quelquefois, mais plus rarement , c’eft la
marche de la baffe fondamentale feule qui marque
la céfure en faifant une cadence parfaite ou imparfaite
, rompue ou interrompue. Voy. les différentes
fortes de céfure, fig. Z , planche F I ,.de Mufique
Suppl.
C E T 301
Sauvent encore les manières i & 3 , & 2 & 3 ,de
marquer la. céfure, fe trouvent reunies ; cela arrive
toujours aux cadences. Foye^fig. ci-deffus, mefure 4.
A la rigueur, dans un air , la céfure muficale qui'
fe marque par une note plus longue que les autres ,
devroit toujours fe rencontrer avec la céfure du vers,
quand il en a , 6c que la fyllabe oii tombe la céfure
poétique eft longue. Les deux autres fortes de céfure
muficale dévoient avoir lieu , lorfque la fyllabe eft
courte , ou le débit v if & animé ; mais à force d’être
méthodique, on deviendroit plat & dur : il faut
donc fe contenter d’obferver ces réglés dans le récitatif,
lorfque le fens eft coupé à la céfure, parce
qu’alors le chant n’eft qu’une vraie déclamation notée.
Remarquez que dans un récitatif animé , il faut
employer plus fouvent la céfure marquée parla marche
de la baffe , que les deux autres qui retardent
toujours la déclamation.
La céfure muficale marquée par un paufe, peut
aufîi, lorfque la paufe eft courte, fervir à marquer
la virgule : lorfqu’elle eft un peu plus longue, le
point & virgule & les deux points ; & même lorfqu’elle
eft encore plus longue & que la baffe fait une
cadence quelconque, à marquer le point, mais non
le point final qui doit toujours être exprimé par une
cadence parfaite.
Ordinairement il ne dépend que de l’exécuteur
de faire d’une céfure niuficale, marquée par une note
longue , une céfure marquée par une paufe, en prenant
la paufe fur la durée de la note.
Je dis plus , tout bon exécuteur fait toujours une
paufe après une céfure , de quelque efpece qu’elle
foit ; il eft vrai, que quand la paufe n’ eft pas marquée,
il la fait fi courte qu’à peine on s’en ap-
perçoit. H H H
Quelques-uns nomment encore cefure, le trait de
chant même qui eft terminé par une céfure ; dans ce
fens, la première mefure de la fig. z , planche F I
de Mufique, Suppl, eft une céfure.
Enfin, on appelle aufli céfures relatives, celles qui
fe fuivant immédiatement, font compofées de notes
de même valeur , qui durent un temps égal ôC
qui procèdent toutes de même , foit diatoniquement,
foit par fauts, fans pourtant être entièrement
femblables. Les céfures , n°. / , z & J de la fig. j ,
planche F I de Mufiq. Suppl, font relatives. (F. D . C.)
C ÉTÉS ou Pr o tÉe , ( Hiftoire d’Egypte. ) l’Egypte
après la mort d’A&ifanes, tomba dans l’anarchie.
Les peuples fentirent le befoin d’avoir un
maître ; éclairés dans leurs choix ôt inftruits par
l ’expérience, ils reconnurent qu’une illuftre naiffance
n’étoit pas toujours un gage d’ une fege adminiftra-
tion : ils choifirent Cetés plus connu par le nom de
Protêt, habitant de Memphis, qui, quoique né dans
un rang obfcur , avoit des droits pour commander
aux1 hommes, puifqu'il avoit toutes les vertus qui
pouvoient les rendre heureux. Jamais prince ne s occupa
plus fcrupuleufement de fes devoirs. Quoi-
qu’ayant de l’humanité, il punit avec féverité les.
coupables:, parce qu’il favoit que l’indulgence enhardit
plus fouvent au crime qu’elle n’excite à la
vertu. On prétend que fous fon régné , Pâris &He-
lene abordèrent en Egypte : Cetés religieux obferva-
teur de l’hofpitalité, auroit cru en violer les droits,
s’il eût puni ces amans adultérés; mais trop équitable
pour les laiffer jouir paifiblement de leur crime , il
leur enleva lestréfors qu’ils avoient ravis à Menelas,
auquel ils furent reftitués. Cetés partageoit fon tems
entre les foins du trône & l’étude de la magie qui
n’étoit que la connoiffance des procédés de la natu
r e . La fable nous apprend qu’il prenoit toutes fortes
de formes, c’eft-à-dire , que fon génie fe plioit
à toutes les circonftances;:: d’autres prétendent que
cette fable tire fon origine de la coutume introduite