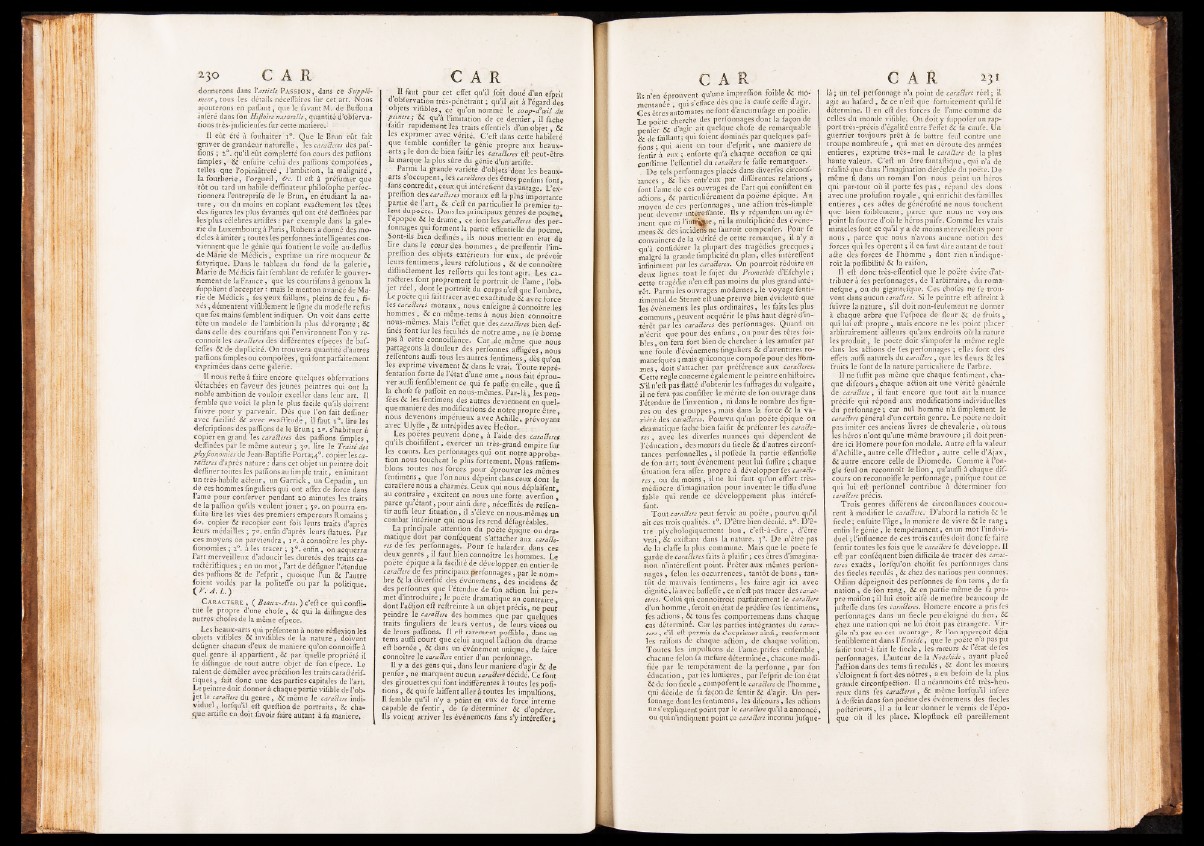
230 C A R
-donnerons dans l’article Pa s sio n , dans ce Supplément,
tous tes dérails néceffaires fur cet art. -Nous
ajouterons eii paffant, que le favant M. de Buffona
inféré dans fon Hifloire naturelle, quârttitéd’obferva-
rions très-judicieufes fur cette matière.;
Il eût été à fouhàiter i° . Que le Brun eût fait
■ graver de grandeur naturelle’, 1 zs caractères des paf-
fions ; 2°. qu’il eiit cômpletté fon cours des pallions
Amples, & enfuite celui des paffioriè cpiripofées,
telles que l’opiniâtreté , 1 ambition, la malignité ,
la fourberie, l’orgueil, ■ &c. Il eft à préfumer que
tôt ou tard un habile deffinateur philof6plie perfectionnera
l’entreprife de le Brun, en étudiant la nature
, ou du moins en copiant exaôement les têtes
des figures les plus favàntes. qui ont été deffinées par
les'plus célébrés artiftes: par exemple dans la galerie
du Luxembourg à Paris, Rubens a donné des modèles
à imiter ; toutes les perfonnes intelligentes conviennent
que le génie qui foutient le voile au-deffus
de Marie de Médicis, exprime lin rire moqueur 6c
fatyrique. Dans le tableau du fond de la galerie,
Marie de Médicis fait femblant de refufer le gouvernement
de Ja France, que les courtifans à genoux la
fupplient d’accepter : mais le menton avancé de Marie
de Médicis , fes yeux faillans, pleins de feu , fixés
, démentent vifiblëment le ligne du modeftérefus
que fes mains femblent indiquer. On voit dans cette
tête un modèle de l’ambition la plus dévorante ; 6c
dans celkrdes courtifans qui l’environnent l’on y re-
connoît les caractères des différentes efpeces de baf-
jfefles & de duplicité. On trouvera-quantité d’autres
pallions fimplesou compoféès , qui font parfaitement
exprimées dans cette galerie.1
Il nouS refte à faire encore quelques obfervations
détachées en faveur des jeunes peintres qui ont la
noble ambition de vouloir exceller dans leur art. Il
femble que voici le plan le plus facile qu’ils doivent
fuivre pour y parvenir. Dès que l’on fait deffiner
avec facilité 6c avec exaêritude, il faut i ° . lire les
deferiptions des pallions de le Brun ; 2<\ s’habituer à
topier en grand les caractères des pallions fimples ,
deffinées par le même auteur ; 3 p. lire le Traité des
phyfiônomies de Jean-Baptifte Porta;4°. copier les caractères
d’après nature : dans cet objet un peintre doit
deffiner toutes les pallions au limple trait, èn imitant
un très-habile adeur, unGarrick, unCepadin, un
de ces hommes linguliers qui ont allez de force dans
I’ame pour conferver pendant 20 minutes les traits
de la paillon qu’ils veulent jouer ; 5p. on pourra en-
fuite lire les vies des premiers empereurs Romains ;
<So. copier & recopier cent fois leurs traits d’après
leurs médailles ; 7p. enfin d’après leurs flatues. Par
ces moyens ôn parviendra, ip . à connoître les phy-
fionomies ; 20. à les tracer ; 30. enfin, on acquerra
l’art merveilleux d’adoucir les duretés des traits ca-
radériftiques ; en un mot , l’art de défigner l’étendue
des pallions & de l’efprit, quoique l’un 6c l’autre
foient voilés par la politeffe ou par la politiaue.
( y.-A. L. ) * 4
C aractère , ( Beaux-Arts. ) c’eft ce qui confti-
tue le propre d’une chofe , 6c qui la diflingue des
autres chofes de la même efpece.
Les beaux-arts qui préfentent à notre réflexion les
objets vifibles & invifibles de la nature, doivent
défigner chacun d’eux de maniéré qu’on connoilfe à I
quel genre il appartient, 6c par quelle propriété il
fe diftingup de.tout autre objet de fon efpece. Le
talent de démê.ler avec précifion les traits caradérif-
îiques, fait donc une des parties capitales de l’art.
Le peintre doit donner à chaque partie vifible de l’objet
le. caractère du genre, & même le caractère individuel
, lorfqu’il eft queftionde portraits, & chaque
artifte en doit favoir faire autant à fa maniéré.
C A R
5 ® faut pour cet effet qu’il fpit doué d’un efprit
d’oblervatiôn très-pénétrant ; qu’il ait . à l’égard des
objets vifibles, ce qu’on nommé le coup-d'oeil du
peintrei 6c qu’à l’imitation de ce dernier, il fâche
faifir rapidement les traits effentiéls d’un o b jet, 6c
les exprimer avec vérité. C ’eft dans cette habileté
que femble confifter le génie propre aux beaux-
arts ; le don de bien faifir les caractères eft peut-être-
la marque la plus sûre du génie d’uh artifte.
Parmi la grande variété d’objetsridont les beaux-
arts s occupent, les caractères des êtres penfans font,
-fans contredit, ceux qui intérefrerit davantage. L’etf-
preffion des caracîeresmoraux eft la pjùsïmpdrtanfe
partie de l’a rt, 6ç c’eft en particulier lé premier talent
du poète. Dans les principaux genres de poéfiê’,
1 épopée 6c le drame, c e font les /caractères des personnages
qui forment la partie effentielle du poème.
. Sont-ils bien deffinés, ils nous mettent en état dé
lire dans le coeur des hommes , dé preffentir l’im-
preffion des objets extérieurs fur eu x, de prévoir
leurs fentimens, leurs refolutions , & de connoîtrfc
diftinâement les refforts qui les font agir. Les caractères
font proprement le portrait de .l’ame, l’ob.
jet réel, dont le portrait du corps n’eft que l’ombre.
Le poete qui fait tracer avec exactitude 6c ayec force
les caractères moraux., nous enfeigne, à connoître les
hommes , & en mêmé-temsà nous bien connoître
nous-mêmes. Mais l’effet que.'des,caractères bien défîmes
font fur les facultés de notre ame, ne fe’ borne
pas à cette connoiffançe. Car^de. même que nous
partageons la douleur des perfonnes affligées, nous
reffentons auffi tous les autres fentimens, dès qu’on
les exprime vivement 6c dans le vrai. Toute repré-
fentation forte de l’état d’une ame, ..nous fait éprouver
auffifenfiblementce qui fe paffe en elle, que fi
la chofe fe paffoit en nous-mêmes. Parrlà, les pensées
& les fentimens des autres devié.rînent en quelque
maniéré des modifications de notre propre être
nous devenons impétueux avec Achille, prévoyant
avec Ulyffe , & intrépides avec HeClor.
Les poètes peuvent donc, à l’aide des caractère*
qu’ils choififfent, exercer un très-grand empire fur
les coeurs. Les perfonnages qui ont no,tre approba-,
tio.n nous touchent le plus fortement. Nous raffem-
blons toutes nos forces pour éprouver les mêmes
fentimens, que 1 on nous dépeint dans.ceux dont le
caraCtere nous a charmés. Ceux qui nous déplaifent
au contraire, excitent en nous une forte averfion \
parce qu’étant, pour ainfi dire, néceffités de reffen-
tir auffi leur fituation, il s’élève en nçus-mêmes un
combat inferieur qui nous les rend défagréables.
La principale attention du poète epique ou dramatique
doit par conféquent s’attacher aux caractères
de fes perfonnages. Pour fe hafarder. dans ces
deux genres , il faut bien connoître les hommes. Le
poète épique a la facilité de développer en entier le
caractère de fes principaux perfonnages ,.par le nombre
& la diverfité des événemens, des incidens &
des perfonnes que l’étendue de fon aCtion lui permet
d’introduire; le poète dramatique au contraire,
dont l’aftion eft reftreinte à un objet précis, ne peut
peindre le caractère des hommes que par quelques
traits finguliers de leurs vertus, de leurs vices ou
de leurs pallions. Il eft rarement poffible, dans un
tems auffi court que celui auquel l’aCtion du drame
eft bornée , 6c dans un événement unique, de faire
connoître le caraïïcre entier d’un perfonnage.
Il y a des gens qui, dans leur maniéré d’agir & de
penfer, ne 'marquent aucun caractère décidé. Ce font
des girouettes qui font indifférentes à toutes les polirions
, 6c qui fe laiffent aller à toutes les impulfions.
Il femble qu’il n’y a point en eux de force interne
capable de fentir, de fe déterminer 6c d’opérer.
Ils voient arriver les événemens fans s’y intéreffer;
C A R
ils n’en éprouvent qu’une impreffion foible & ihô-
mentanée , qui s’efface dès que la eaufe ceffe d’agir. .
Ces êtres automates ne font d’aucun ufage en poéfie.
L e poète cherche des perfonnages dont la façon de
penfer 6c d’agir ait quelque chofe de remarquable
& de Taillant; qui foient dominés par quelques paf-
fions ; qui aient un tour d’efprit, une maniéré de
fentir à eux ;-enforte qu’à chaque occafion ce qui
conftitue l’effentiel du caractère fe faffe remarquer.
De tels perfonnages placés dans diverfes cireonR *
tances, &.liés entr’eux par différentes relations*
font l’ame de ces ouvrages de l’art qui confîftent én
aérions , 6c particuliérement du poème épique. Au
moyen de ces perfonnages, une aérion tres-fimple
peut devenir intégeffante. Ils y répandent un agrément
que ni -, ni la multiplicité des événemens
& des incid * ne fauroit comperiferi. Pour fe
convaincre de la vérité de cette remarque , il n’y a
qu’à confidérer la plupart des tragédies grecques ;
malgré la grande fimplicité du plan, elles intéreffent
infiniment par les caractères. On pourroit réduire en
«leux lignes tout le fujet du Promethèe d’Efchyle;
cette tragédie n’en eft pas moins du plus grand intérêt.
Parmi les ouvrages modernes, le voyage fenti-
timental de Sterne eft une preuve bien évidentè que
les événemens les plus ordinaires, les faits les plus
communs, peuvent acquérir le plus haut dégré d’intérêt
par les caractères des perfonnages. Quand on
n’écrit que pour des enfans , ou pour des têtes foir
e s on fera fort bien de chercher à les artiufer par
une foule d’événemens finguliers 6c d’aventures ro-
manefques ; mais quiconque compofe pour des Hommes
doit s’attacher par préférence aux caractères.
Cette réglé concerne également le peintre enhiftoire.
S’il n’eft pas flatté d’obtenir les fufïrages du vulgaire,
il ne fera pas confifter le mérite de fon ouvrage dans
l’étendue de l’invention, ni dans le nombre des figures
ou des grouppes, mais dans la force 6c la variété
des caractères. Pourvu qu’un poète épique ou
dramatique fâche bien faifir 6c présenter les caractères
, avec lés diverfes nuances qui dépendent de
l ’éducation, des moeurs du fiecle 6c d’autres circonf-
tances perfonnelles , il poffede la partie effentielle
de fon art; tout événement peut lui fuffire ; chaque
fituation fera affez propre à développer fes caractères
y. ou du moins, il ne lui faut qu’un effort très-
médiocre d’imagination pour inventer le tiffu d’une
fable qui rende ce développement plus intéref-
fant.
Tout caractère peut fervir aù poète, pourvu qu’il
ait ces trois qualités. i° . D ’être bien décidé. 2°. D ’être
pfyehologiquement bon, c’ eft-à-dire , d’être
.vrai, 6c exiftant dans la nature. 30. De n’être pas
de la claffe la plus commune. Mais que le poète fe
garde de caractères faits à plaifir ; ces êtres d’imagination
n’intéreffent point. Prêter aux mçmes perfonnages
, félon les occurrences, tantôt de bons, tantôt
de mauvais fentimens , les faire agir ici avec
dignité, là avec baffeffe, cé n’eft pas tracer des caractères.
Celui qui connoîtroit parfaitement le caractère
d’un homme ÿferoit en état de prédire fes fentimens,
fes aftions, 6c tous fes comportemens dans chaque
cas déterminé. Car les parties intégrantes du caractère
, s’il eft permis de s’exprimer ainfi, renferment
les raifons de chaque aérion, de chaque volition.,
Toutes les impulfions de i’ame. prifes enfemble ,
chacune félon la mefure déterminée, chacune modifiée
par le tempérament de la perfonne, par fon
éducation, par fes lumières, par l’efprit de.fon état
ôède fon fiecle , compofentle caractère de l’homme,
qui décide de fa façon de fentir 6c d’agir. Un perfonnage
dont les fentimens, les difeours, les aérions
ne s’expliquent point par le caractère qu’il a annoncé,
ou qui n’indiquent point ce caractère inconnu jufque-
C A R
là ; un tel jpeffonnage n’a point de caractère réel ; il
agit au hafard , & ce n’eft qite fortuitement qu’il fe
détermine. Il en eft des forces de l’ame comme de
celles dit monde vifible. On doit y fuppofer un rapport
très-précis d’égalité entre l’effet 6c fa caufe. Un
guerrier toujours prêt à fe battre feu! contre une
troupe nombreufe , qui met en déroute des armées
entières, exprime très-mal le caractère de la plus
haute valeur. C ’eft un être fantâftiàue, qui n’a dé
réalité que dans l’imagination déréglée du poète. De
même fi dans un roman l’on nous peint un héros
qui par-tout oit il porte fes pas, répand dés dons ‘ •
avec une profufion royale, qui enrichit des familles !
entières , ces aétes de générofité rie nous touchent
que bien foiblement, parce que nous ne voyons
point la fource d’oii le héros puife. Comme les vrais
miracles font ce qu’il y a de moins Mer veilleux pour
nous -, parce que nous n’avons aucune notion des 1
forces qui les opèrent ; il en faut dire autant de tout
aéle des forces de l’hômme , dont rien n’indique-
roit la poffibiiité & la raifon.
Il eft donc très-efféntiel que le poète évite d’attribuer
à fes perfonnages, de l’arbitraire, du roma-.
nefque, ou du gigantefque. Ces chofes ne fe trouvent
daris aucun caractère. Si le peintre eft aftreint à
fuivre la nature, s’il doit non-feulemént né donner
à chaque arbre que l’efpece de fleur 6c de fruits,
qui lui eft propre ,. mais encore ne les 'pbint placer
arbitrairement ailleurs qu’aux endroits Ôii la nature
les produit, le poète doit s’impofer la même réglé
dans les aérions de fes perfonnages elles font des
effets auffi naturels du caractère, que les fleurs 6c le s:
fruits le font de la nature particulière de l’arbre.
Il nè fuffit pas même que chaque fentiment, chaque
difeours, chaque aériôn ait unè vérité générale
de caractère, il faut encore que tout ait la nuance
précife qui répond aux modifications individuelles;
du perfonnage ; car nul homme n’a Amplement le
caractère général d’un certain genre. Le poète ne doit
pas imiter ces anciens livres de chevalerie, oit tous
les héros n’ont qu’une triême bravoure ; il doit prendre
ici Homeré pour fon modèle. Autre eft la valeur
d’Achille, autre celle d’Heéior , autre celle d’Ajax,
6c autre encore celle de Diomede. Comme à l’ongle
feul on reconnoît le lion, qu’auffi à chaque difeours
on feconnoiffe le perfonnage, puifque tout ce
qui lui eft perfonnel contribue à déterminer fon
carattere précis.
Trois genres différens de circonftances concourent
à modifier le caractère: D ’abord la natio*n 6c lé
fiecle ; enfuite l’âge, la maniéré de vivre 6c le rang ;
enfin le génie, le tempérament, en un mot l’individuel
; l’influence de ces trois caufes doit donc fe faire
fentir toutes les fois que le caractère fe développe. II
eft par conféquent bien difficile de- tracer des caractères
exaéls, lorfqu’on choifit fes perfonnages dans
des fiecles reculés, & chez des nations peu connues;
Offian dépeignoit des perfonnes de fon tems , deTa
nation, de fon rang, 6c en partie même de là pro-^
pfe maifon ; il lui étoit aifé de mettre beaucoup de"
jufteffe dans fes caractères. Homere encore a pris fes
perfonnages dans un fiecle peu éloigné du fien, ôc
chez une nation qui ne lui étoit pas étrangère. Virgile
n’â pas eu cet avantage, 6c l’on apperçoit déjà
fenfiblement dans VEneïde, que le poète n’a pas pu
faifir tout-à-fait le fiecle, les moeurs & l’état de fes
perfonnages. L’auteur de la Nodchide, ayant placé
l’aétion dans des tems fi reculés , & dont les riioeurs
s’éloignent fi fort des nôtres, a eu befoin de la plus
grande circonfpeérion. Il a néanmoins été très-heu-
?eux dans fes caractères, & même lorfqu’il inféré
à deffein dans fon poème des événemens des fiecleS
poftérieurs, il a lu leur donner le vernis de l’époque
oii il les place. Klopftock eft pareillement