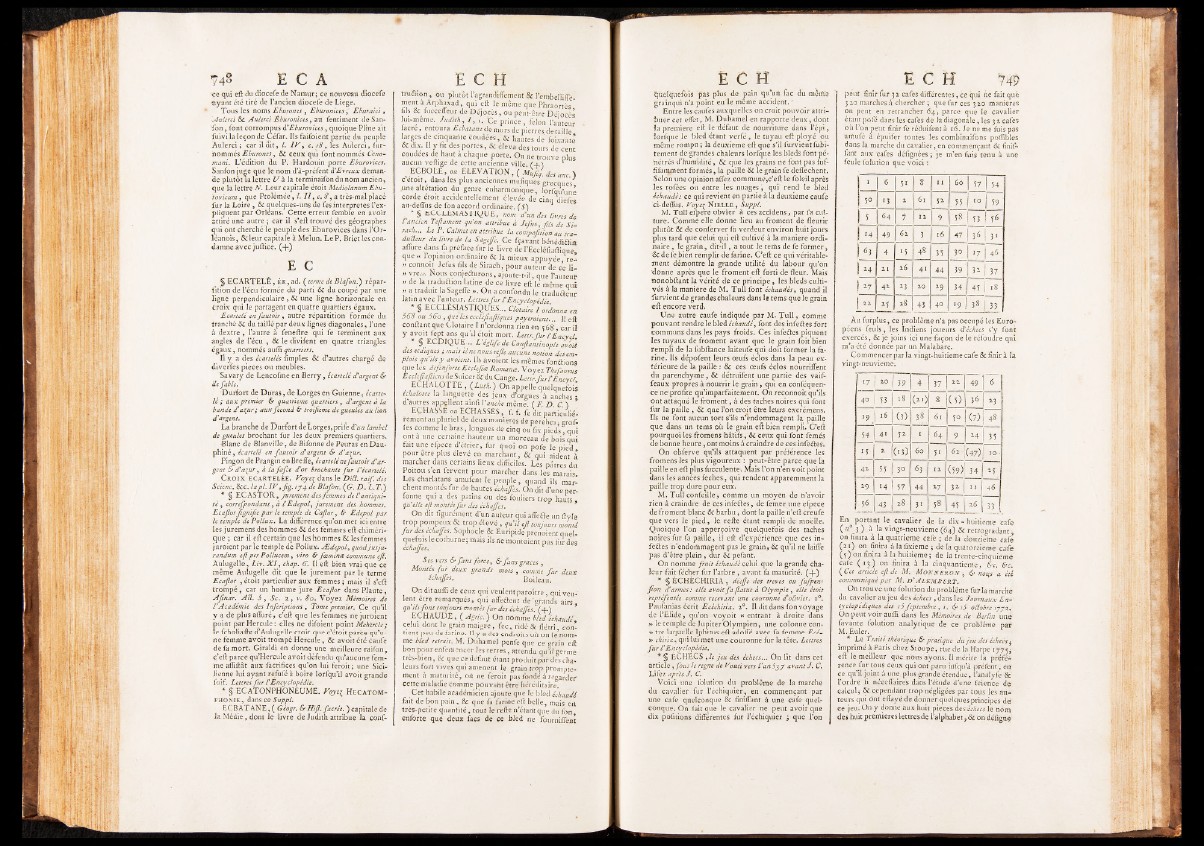
ce qui eft du diocefe de Namur; ce nouveau diocefe
■ ayant été tiré de l’ancien diocefe de Liege.
Tous les noms Eburones, Eburonicesf E b ural ci ,
-Aulerci & Aulerci Èbiironices, au fentiment deSan*
Ton, font corrompus àé Eburovices, quoique Pline ait
fuivi la leçon de Céfar. Ils faifoient partie du peuple
Âulerci ; car il dit, l. I V > c. 18, les Aulerci, fur-
nommés Eburones, & ceux qui font nommés C-eno-
mani. L’édition du P. Hardouin porte Eburovices.
Sanfon juge que le nom d’à-préfent d'Evreux demande
plutôt la lettre U à la terminaifondunomancien.^
que la lettre N. Leur capitale étoit Mediolanum Ebu-
irovicurn, que Ptolémée, / . / / , c. <?, a très-mal placé
fur la Loire, & quelqués-üns de fes interprètes l’expliquent
par Orléans. Cette erreur femble en avoir
attiré une autre ; car il s’eft trouvé des géographes
qui ont cherché le peuple des Eburovices dans l’Or-
léanois, & leur capitale à Melun, Le P. Briet les condamne
avec juftice. (-4-.)
E C
§ ECARTELÉ, ÉE, ad. ( terme de Blafon.) répartition
de l’écu formée du parti & du coupé par une
ligne perpendiculaire , & une ligne horizontale en
Croix qui le partagent en quatre quartiers égaux,
Ecartelé en fautoir, autre répartition formée du
tranché & du taillé par deux lignes diagonales, J’une
à dextre , l’autre à feneftre qui fe terminent aux
angles de l’écu , & le divifent en quatre triangles
égaux, nommés aulfi quartiers.
Il y a des écartelés (impies & d’autres chargé de
diverses pièces ou meubles.
Savary de Lencofme en Berry, écartelé d argent &
de fable.
' Durfort de Duras, de Lorges en Guienne, écartelé
; aux premier 6* quatrième quartiers , d'argent à la
bande dé a^ur; aux fécond & troijieme de gueules au lion
d argent.
La branche de Durfort de Lorges, prife d'un lambel
de gueules brochant fur les deux premiers quartiers.
-Blanc de Blanville, de Bifonne de Peuras en Dauphiné
, écartelé en fautoir dé argent & d'azur.
Pingon de Prangin en Brefle, écartelé nefautoir d'argent
& d'a^tir, à la fafee clor brochante fur l'écartelé.
C roix ecartelée. Voyeidansh Dict. raif. dés
Scienc. &c. lapl. IV , fig. tyq de Blafon. {G. D . Z,.T.)
* § EC A STOR, jurement des femmes de l'antiquité
, correfpondant, à l'Edepoly jurement des hommes.
Ecajlor Jignifie par le temple de Cajlor, & Edepol par
le temple de Pollux. La différence qu’on met ici entre
les .juremens des hommes & des femmes eft chimérique
; car il eft certain que les hommes & les femmes
juroient parle temple de Pollux. Ædepol, quodjusju-
randum efl per Pollucem, viro & foemina commune ejl.
Àulugelle, L iv .X l , chap. 6. Il eft bien vrai que ce
même Aulugelle dit que le jurement par le terme
Ecajlor , étoit particulier aux femmes; mais il s’eft
trompé, car un homme jure Ecajlor dans Plaute,
Afinar. A cl. 5 , Sc. '2., V. 8o. Voyez Mémoires de
VAcadémie des Infcriptions , Tome premier. Ce qu’il
y a de plus affuré, c’eft que les femmes ne juroient
point par Hercule; elles ne difbient point MehircW;
le feholiafte d’Aulugelle croit que c’étoit parce qu’une
femme avoit trompé Hercule, & avoit été caufe
de fa mort. Giraldi en donne une meilleure raifon,
c’eft parce qu’Hercüle avoit défendu qu’aucune femme
affiftât aux facrifïces qu’on lui feroit ; une Sicilienne
lui ayant refufé à boire lorfqu’il avoit grande
foif. Lettres fur T Encyclopédie.
* § ECATONPHONEUME. Voye% He c a t om -
phonie, dans ce Suppl.
ECB AT ANE, ( Géogr. & Hijl.facrée. ) capitale de
IaMédie,dont le livre de Judith attribue la conf-
I H -----rt , * 1 c,IJüeuuiement
à Arphaxad, qui eft le meme que Phraortès
fils & luccefleur de Déjocès, ou peut-être Déiocès
lui-meme../«&4 , I , t. fee prince, félon l’auteur
lacre » entoura Ecbatapede murs de pierres dé taillé
larges de cinquante «aidées W —
& dut. Il y fit des portes , Sc éleva des tours'de cent
coudees de haut à chaque porte. On ne trouve plus
aucun vettige de cette ancienne vilïeï r-i-'i
•• i EÇBOLÉ, e* ELEVATION, ( Ma/!/. iUs « * . )
c e to it , dans les plus antiennes mufiques gfeceues,
.unealtétation du genre;.enharmonique, lorfqu’une
corde étoit accidentellement 'élevée de cinq diefes
au-deffus de fon accord ordinaire. 1
s * § ECCLÉSIASTIQUE, nom d'un des livres de
l'ancien Teflament qu'on attribue à Jefus, fils de Si-
rach... Le P. Calmet en attribue la compôjitiori au traducteur
du livre de la Sageffe. Ce fçavant bénédiftin
affure dans fa préface, fur le livre de l’Eccléfiaftique,
que « l’opinion ordinaire & la mieux appuyée, re^
» connoît Jefus fils de Sirach, pour auteur de ce li-
» 7 er N<iUSo^0njiea.Ur0^S, aioute-t*ili que l’auteuf
» de la traduction latine de ce livre eft le même qui
» a traduit la Sageffe ». On a confondu le tradufteur
latin avec l’auteur. Lettres fur l'Encyclopédie
* § ECCLÉSIASTIQUES... Clotaire I ordonna en
568 ou 56o y que les eccléjiajliques payeroient... Il eft
Confiant que Clotaire I n’ordonna rien en 568 car il
y avoit fept ans qu’il étoit mort. Leur.fur l'Encycl.
§ ECDIQUE... L'églifi de Confiandnople avoit
des eediques ; mais ilne nous refie aucune notion des emplois
qu'ils y avoient. Ils âvoient les mêmes fondions
que les defenforesEcclefiæ Romance. Voyez Thefaurus
Eccltjîajliciis de Suicer&'du Cange. Leur. furl'EncvcL
, ECHA LO TTE, {Luth.) On appelle quelquefois
cchalotte la languette des jeux d’orgues à anches *
d’autres appellent ainfi Y anche même. ( F. D. C’A *
EÇHASSE ou ECHASSES, f. f. fe dit particuliérement
au pluriel de deux maniérés de perches , grof-
fes comme le bras, longues de cinq ou fix pieds, qui
ont à une certaine, hauteur un morceau de bois qui
fait une efpece d’étrier, fur quoi on pofe le pied
pour être plus élevé en marchant, & qui aident à
marcher dans certains lieux difficiles. Les pâtres du
Poitou s’en fervent peur marcher dans les marais.
Les charlatans anuifent le peuple, quand ils mar*
chent montés fur de hautes échajfes. On dit d’une per-
fonne qui a des patins ou des fouliers trop hauts ,
qu'elle ejl montée fur des échaffeS.
On dit figurément d’un auteur qui affeôe un ftyle
trop pompeux & trop élevé , qu'il ejl toujours monté
fur des echafes. Sophocle & Euripide prenoient quelquefois
le cothurne; mais ils ne móhtóient pas fur des
échajfes.
Ses vers & fans force, <j* fans grâces -,
Montés fur deux grands mots , comme fur deux
échaffes. BoileaUi
On dit auffi de ceux qui veulent paroitre, qui veulent
être remarqués, qui afferent de'gtands airs.
qu'ils font toujours montés fur des échaffes. (4-1
ÉCH AUDÉ, ( Agric. ) On homme bled échaudé,
celui dont le grain maigre, fec, ridé & flétri, contient
peu de farine. Il y a des endroits oit on le nomme
bled retrait. M. Duhamel penfe que ce grain eft
bon pour enfemencer les terres, attendu qu’il germé
tres-bien, & que ce défaut étant produit par des chaleurs
fort vives qui amènent le grain trop promptement
à maturité, oh ne féroit pas fondé à regarder
cette nialadie comme pôUvaht être héréditaire.
Cet habile académicien ajoute que le bled échaudé
fait de bon pain, & que fa farine eft belle, mais en
très-petite quantité, tout le refte n’étarit que du fon
enforte que deux facs de ce bled ne fournifTent
ïjüélq'uefbis pas plus de pâin qu’un fac du meirfe
grainqui n’a point eu1 lé même accident. '
Entre les caufes auxquelles on croit pouvoir attribuer
cet effet, M. Duhamel en rapporte deux, dont
la première eft le défaut de nourriture dans l’ép i,
îorfque le bled étant verfé , le tuyau eft ployé ôu
même rompu ; la deuxieme eft que s’il furvient fubi-
tement de grandes chaleurs Iorfque les bleds font pénétrés
d’humidité, & que les grains ne font pas fuf-
fifanjpient formés, là paille & le grain fe deflechent.
Selon une opinion allez commune,c’eft le foleil après
les rofées ou entre les nuages qui rend le bled
échaudé: ce qui revient en partie à la deuxieme caufe
ci-deffus. Voye{ Nie l le , Suppl.
M. Tull efpere obvier à ces accidens, par fa culture.
Cômmé elle donne lieu au froment de fleurir
plutôt & de conferver fa verdeur environ huit jours
plus tard que celui qui eft cultivé à la maniéré ordinaire
, le grain, dit-il, a tout le teifts de fe former-,
ôc de fe bien remplir de farine. C ’eft ce qui véritablement
démohtre la grande utilité du labour qu’on
■ donne après que le froment eft forti de fleur. Mais
nonobftant la vérité de ce principe, les bleds cultivés
à la maniéré de M. Tull font échaudés, quand il
furvient de grandes chaleurs dans lé tems que le grain
eft encore verd»
Une autre caufe indiquée par M. T u ll, comme
pouvant rendre le bled échaudé, font des infeâes fort
communs dans les pays froids. Ces infeétes piquent
les tuyaux de froment avant que le grain foit bien
rempli de la fubftance laiteufe qui doit former la farine.
Ils dépofent leurs oeufs éclos dans la peau extérieure
de la paille : & ces oeufs éclos nourriflent
du parenchyme, & détruifent une partie des vaif-
feaux propres à nourrir le grain, qui en conféquen-
ce ne'profite qu’imparfaitement. On reconnoît qu’ils
ont attaqué le froment, à des taches noires qui font
fur la paille, & .que Ton croit être leurs exeréirçens.
Ils ne font aucun tort s’ils n’endommagent la paille
que dans un tems où le grain eft bien rempli. C’eft
pourquoi les fromens hâtifs, & fceux qui font femés
de bonne heure, ont moins à craindre de ces infeâesi
On obferve qu’ils attaquent par préférence les
fromens les plus vigoureux : peut-être parce que la
paille en eft plus fuceulente. Mais l’on n’en voit point
dans les années feches, qui rendent apparemment la
paille trop dure pour eux;
M. Tull confeille -, comme un moyen de h’avoir
rien à craindre de èes infeéles, de femer une efpece
de froment blanc & barbu, dont la paille n’eft creufe
que vers le pied, le refte étant rempli de moelle;
Quoique l’on apperçoive quelquefois des taches
noires fur fa paille, il eft d’expérience que c es in-
feétes n’endbrtimagent pas le grain, & qu’il ne laifle
pas d’être plein , dur & pefant.
On nomme fruit échaudé celui que la grande chaleur
fait fécher fur l’arbre , avant fa maturité; (+ )
* § ÉCHÉCHIRIA , dèefje des treVes ou fufpen-
fion dé armes: elle avoit fa (latue d Olympie , elle étoit
Yepréfentée comme recevant une couronne dé olivier. i°.
Paufanias écrit Ecéchiria. 20. Il dit dans fon voyage
de l’Elide, qu’on voyoit « entraht à droite dans
» le temple de Jupiter Olympien, urie colonne con-
» tre laquelle Iphitus eft adofle avec fa femme Ecé-
» chiriay qui lui met une couronne fur la tête. Lettres
fur l 'Encyclopédie.
* § ÉCHECS , le jeu des èchecsi.. Ôn lit dans cet
article x fùus le régné de Vouti vers l'an5$ J avant J. C.
Lifez après J. C.
Voici une folution du problème de la marche :
du cavalief fur l’échiquier, en commençant par
une café quelconque & finiflant à une café quelconque.
On fait que le cavalier’ ne peut avoir que
dix pofxtions différentes fur l’échiquier ; que l’on
peut finir lur 31 cafés différentes, ce qui he fait què
3 20 marches à chercher ; que fur ces 3 20 maniérés
on peut en retràhçhèr 64 , parce que le cavalier
étant pofé dans les cafés de la diagonale, les 32 cafés
oii l’on peut finir fé reduifent à 16. Je ne me fuis pas
arftufé a épuifer toutes les combinaifôns pofîibles
dans la marche du cavalier, en commençant & finift-
fant aux cafés défignéés ; je m’en fuis tenu à une
feule folution que voici t
■ 6 ï 1 '8 1 1 60 $7 54
5'° *3 2 fit 5^ j 5 l. I ï ; 59:
■ 64 7 12 9 T . 5«
1 14 49 62 3 16 47 56 31
U 4 M H 3° 7 46
u 21 26 41 44 39 n 37
---- B — BBS
1 42 20 29 34 4 Ï 18
H M 18 43 40 ■ 3S
Àu furplus, ce problème n’â pas occupé les Européens
feuls, les Indiens joueurs d'échecs s’y font
exercés, & je joins ici une-façon de le réfoudre qui.
m’a été donnée par un Malabare.
Commencer par la vingt-huitieme cafe & finir à la
yingt-neuvieme; •
l7 1 « f 5 | 1 4 37 i l [ 49
• v
40 1 5f:-| 00 8 ( 5) j 36 2-3
>9 1 16 J (3)
i t
fii 5° j (7) 48
54 1 4 ' 1 51 t 64
1 NO I
-É
35
1 ; 1 » j'(iî) 60 5' 61 -|(47) 10 •
41 I 55 | î | | 63 12 C 5 9)] 34 M
J 'O
E
1 ^
44 27
, 3z 1 E 46
■ e 1 n 1 8 3* 58 45 j 2-6 33
En portant le cavalier de la dix - huitième café
( 3.) - à la virtgt-neuvieme (64) & rétrogradant ;
on finira à la quatrième café ; de la douzieiiie café
(2 t ) on finira à la fixieme ; de la quâtorziemè café
(5) on finira à la huitième; de la trente-cihquieme
cale ( 13 ) on finira à la cinquantième, &c. &C'.
{Cet article ejl de M. M o n n e r o x t , 6* nous a été
communiqué par M. d 'A l e m b e r t .
On trouve une folution du problème fut la marché
du cavalier au jeu des échecs, dans les 'Journaux Encyclopédiques
des 15 feptembre , 1. & i5 octobre ty jz.
On peut voir auffi dans les Mémoires de Berlin uné
favante folution analytique de ce problème par
M. Euler.. r V
* Le Traite théorique & pratique du jeu des échecs $
imprimé à Paris chez Stbupe, rue de la Harpe 1775*
eft le meilleur que nous ayons. Il mérite la préfé*
renee fur tous ceux qui ont paru jufqu’à préfënt, en
ee qu’il joint à une plus grande étendue, l’artalyfe &
l’oraré fi néceflaires dans l’étude d’une fcience de
calcul* ôt cependànr trop négligées par tous les auteurs
qui ont effayé de donner quelques principes dé
ee jeu. On y donné aux huit pièces des échecs le nôm
des huit premières lettres de l’alphabet, & on défigne
■ H