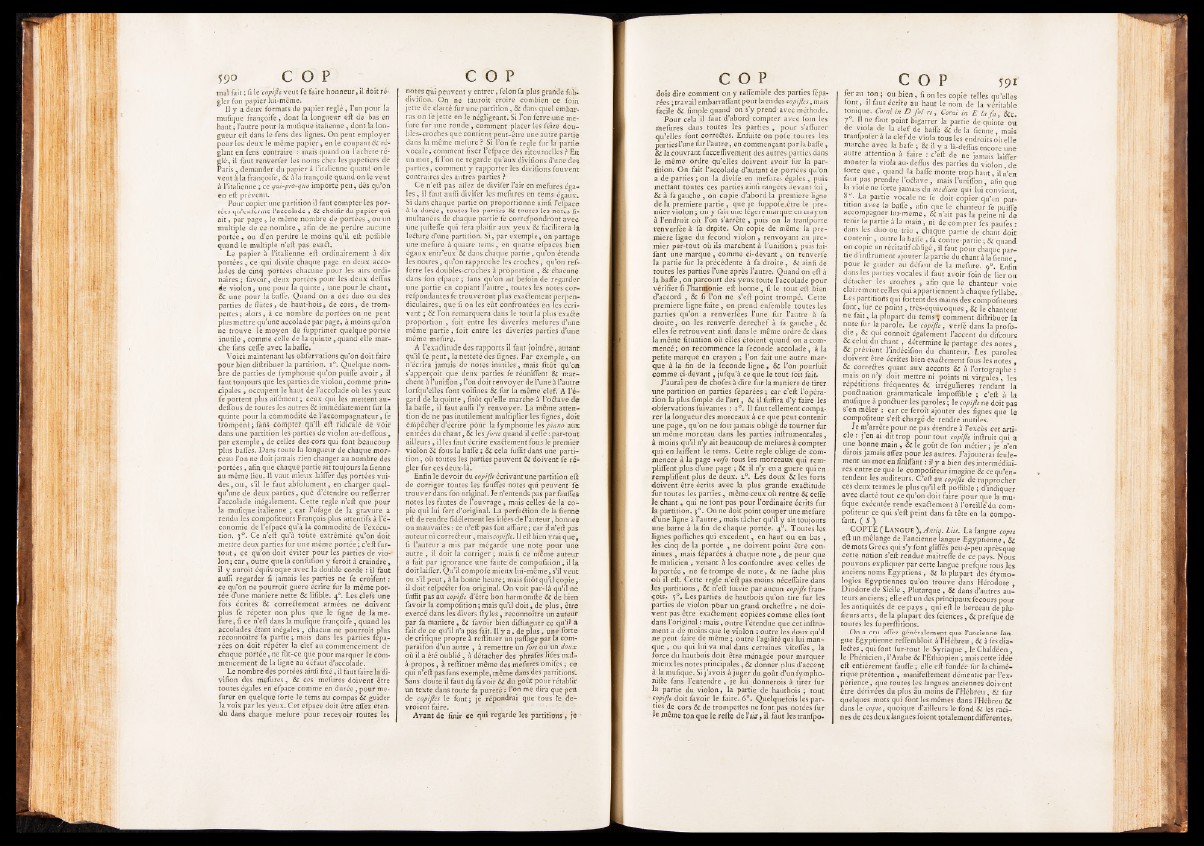
mal fait ; fi le copifie veut fe faire honneur, il doit régler
fon papier lui-même.
Il y a deux formats de papier réglé , l’un pour la
mufique françoife, dont la longueur eft de bas en
haut ; l’autre pour la mufique italienne , dont la longueur
eft dans le fens des lignes. On peut employer
pour les deux le même papier, en le coupant & réglant
en fens contraire : mais quand on l’achete réglé,
il faut renverl'er les noms chez les papetiers de
Paris, demander du papier à l’italienne quand on lè
veut à la françoife, & à la françoife quand on le veut
à l’italienne ; ce qui-pro-quo importe peu, dès qu’on
en eft prévenu.
Pour copier une partition il faut compter les portées
qu’enferme l’accolade, & choifir du papier qui
a it , par page , le même nombre de portées , ou un
multiple de ce nombre, afin de ne perdre aucune
portée j ou d’en perdre le moins qu’il eft poffible
quand le multiple n’eft pas exaft.
Le papier à l’italienne eft ordinairement à dix
portées, ce qui divife chaque page en deux accolades
de cinq portées chacune pour les airs ordinaires
; favoir, deux portées pour les deux deffus
de violon, une pour la quinte , une pour le chant,
6c une pour la baffe. Quand on a des duo ou des
parties de flûtes, de haut-hois, de cors, de trompettes;
alors, à ce nombre de portées on ne peut
plus mettre qu’une accolade par page, à moins qu’on
ne trouve le moyen de fupprimer quelque portée
inutile , comme celle de la quinte, quand elle marche
fans ceffe avec la baffe.
Voici maintenant les obfervations qu’on doit faire
pour bien diftribuer la partition. i°. Quelque nombre
de parties de fymphonie qu’on puifl'e avoir , il
faut toujours que lesparties de violon, comme principales
, .occupent le haut de l’accolade oit les yeux
fe portent plus aifément; ceux qui les mettent au-
delfous de toutes les autres 6c immédiatement fur la
quinte pour la commodité de l’accompagnateur, fe
trompent ; fans compter qu’il eft ridicule de voir
dans une partition les parties de violon au-deffous,
par exemple , de celles des cors qui font beaucoup
plus baffes. Dans toute la longueur de chaque morceau
l’on ne doit jamais rien changer au nombre des
portées, afin que chaque partie ait toujours la fienne
au même lieu. Il vaut mieux laiffer des portées vui-
d e s ,o u , s’il le faut abfolument, en charger quelqu’une
de deux parties, que d’étendre ou refferrer
l’accolade inégalement. Cette réglé n’eft que pour
la mufique italienne ; car l’ufage de la gravure a
rendu les compofiteurs François plus attentifs à l’économie
de l’efpace qu’à la commodité de l’exécution.
30. Ce n’eft qu’à toute extrémité qu’on doit
mettre deux parties fur une même portée ; c’eft fur-
tout , ce qu’on doit éviter pour les parties de vio-”
Ion ; ca r, outre que la confufiôn y feroit à craindre,
il y auroit équivoque avec la double corde : il faut
auflî regarder fi jamais les parties ne fe croifent :
ce qu’on ne polirroif guere écrire fur la même portée
d’une maniéré nette 6c lifible. 40. Les clefs une
fois écrites 6c correctement armées ne doivent
plus fe répéter non plus que le ligne de la me-
fure, fi ce n’eft dans la mufique françoife , quand les
accolades étant inégales , chacun ne pourroit plus
réconnoître fâ partie ; mais dans les parties féparées
on doit répéter la clef au commencement de
chaque portée, ne fût-ce que pour marquer le Commencement
de la ligne au défaut d’accolade.
Le nombre des portées ainfi fixé, il faut faire la di-
vifion des mefures, 6c ces mefures doivent être
toutes égales en efpace comme en durée, pour me-
furer en quelque forte le tems au compas 6c guider
la voix par les yeux. Cet efpace doit être affez étendu
dans chaque mefurê pour- recevoir toutes les
notes quipeuvent y entrer, félon fa plus grande fub-
divifion. On ne lauroit croire combien ce foin
jette de clarté fur une partition, & dans quel embarras
on fe jette en le négligeant. Si l’on ferre une me-
fure fur une ronde , comment placer les féize doubles
croches que contient peut-être une autre partie
dans la même mefure ? Si l’on fe réglé fur la5 partie
vocale, comment fixer l’efpace des ritournelles ? En
un m ot, fi l’on ne regarde qu’aux divifions d’une des
parties, comment y rapporter les divifions fouvent
contraires des autres parties ?
Ce n’eft pas affez de divifer l’air en mefures égales
, il faut auflî divifer les mefures en tems égaux;.
Si dans chaque partie on proportionne ainfi l’efpace
à la durée, toutes les parties 6ç toutes les notes fi-
multanées de chaque partie fe correspondront avec
une juftefl'e qui fera plaifir aux yeux 6c facilitera la
leCtere d’une partition. Si, par exemple, on partage
une mefure à quatre tems, en quatre efpaces bien
égaux entr’eux ‘& dans chaque partie , qu’on étende
les noires, qu’on rapproche les croches, qu’on ref-
ferre les doubles-croches à proportion , 6c chacune
dans fon efpace ; fans qu’on ait befoin de regarder
une partie en copiant l’autre , toutes les notes cor-
refpondantes fe trouveront plus exactement perpendiculaires,
que fi on les eût confrontées en les écrivant
; 6c l’on remarquera dans le tout la plus exaCte
proportion , ibit entre les diverfes mefures d’une
même partie, foit entre les diverfes parties d’une
même mefure.
A l’exaflitude des rapports il faut joindre, autant
qu’il fe peut, la netteté des lignes. Par exemple, on
n’écrira jamais de notes inutiles, mais fitôt qu’on
s’apperçoit que deux parties fe réunifient & marchent
à l’uniffon, l’on doit renvoyer de l’une à; l’autre
lorfqu’elles font voifines 6c fur la même clef. A l’égard
de la quinte , fitôt qu’elle marche à l’o&ave de
la baffe, il faut aufli l’y renvoyer. La même attention
de ne pas inutilement multiplier les lignes, doit
empêcher d’écrire pour la fymphonie les piano aux
entrées du chant, & les forte quand il cefl'e : par-tout
ailleurs, il les faut écrire exactement fous le premier
violon 6c fous la baffe ; 6c cela fuffit dans une partition,
oii toutes les parties peuvent & doivent fe régler
fur ces deux-là.
Enfin le devoir du copijle écrivant une partition eft
de corriger toutes Les fauffes notes qui peuvent fe
trouver dans fon original. Je n’entends pas par fauffes
notes les fautes de l’ouvrage , mais celles de la copie
qui lui fert d’original. La perfection de la fienne
eft de rendre fidèlement les idées de l’auteur, bonnes
ou mauvaifes : ce n’eft pas fon affaire ; car il n’eft pas
auteur ni correCteur, mais copijle. Il eft bien vrai que,
fi l’auteur a mis par mégarde une note pour une
autre , il doit la corriger ; mais fi cè meme auteur
a fait par ignorance une faute de compofition, il la
doit laiffer. Qu’il compofe mieux lui-même, s’il veut
ou s’il peut, à la bonne heure ; mais fitôt qu’il copie ,
il doit refpeCter fon original. On voit par-là qu’il ne
fuffit pas au copijle d’être bon harmonifte & de bien
favoir la compofition ; mais qu’il doit, de plus, être
exercé dans les divers ftylès, reeôrinoîtife un auteur
par fa maniéré, 6c favoir bien diftinguer ce qu’il a
fait de ce qu’il n’a pas fait. Il y a , de plus, une forte
de critique propre à reftituer iin paflage par la com-
paraifon d’un autre , à remettre un fort pu un doux
où il a été oublié, à détacher des phrafés liées malà
propos , à reftituer même des mefures omifes ; ce
qui n’eft pas fans exemple, même dans des partitions1.
Sans doute il faut du favôif &' du goût pour 'rétablir
un texte dans toute fa pürèté : l’on me dira que peu
de copijles le font; je répondrai que'toüs lè. de-
vroient fairé.
Avant de finir ce qui regarde les partitions, je |
dois dire comment on y raffemble des parties féparées
; travail embarraffant pour bien des copijles, mais
facile 6c fimple quand on s’y prend avec méthode.
Pour cela il faut d’abord compter avec foin les
mefures dans toutes les parties , pour s’affurer
qu’elles font correCtes. Enfuite on pofe toutes les
partiesl’une fur l’autre, en commençant par la baffe,
& la couvrant fucceffivement des autres parties dans
le même ordre qu’elles doivent avoir fur la partition.
On fait l’accolade d’autant de portées qu’on
a de parties ; on la divife en mefures égales , puis
mettant toutes ces parties ainfi rangées devant fo i ,
6c à fa gauche , on copie d’abord la première ligne
de la première partie , que je fuppofe#être le premier
violon ; on y fait une légère marque en crayon
à l’endroit où l’on s’arrête , puis on la tranfporte
renverfée à fa drpite. On copie de même la première
ligne du fécond violon, renvoyant au premier
par-tout où ils marchent à l’uniffon ; puis fai-
fant une marque , comme ci-devant, on renverfe
la partie fur la précédente à fa droite , 6c ainfi de
toutes les parties l’une après l’autre. Quand on eft à
la baffe , on parcourt des yeux toute l’accolade pour
vérifier fi l’harn®onie eft bonne, fi le tout eft bien
d’accord , & fi l’on ne s’eft point trompé. Cette
première ligne faite, on prend enfemble toutes les
parties qu’on a renverfees l’une fur l’autre à fa
droite, on les renverfe derechef à fa gauche, 6c
elles fe retrouvent ainfi dans le même ordre 6c dans
la même fituation où elles étoient quand on a commencé;
on recommence la fécondé accolade , à la
petite marque en crayon ; l’on fait une autre marque
à la fin de la fécondé ligne, & l’on pourfuit
comme ci-devant, jufqu’à ce que le tout foit fait.
J’aurai peu de chofes à dire lur la maniéré de tirer
une partition en parties féparées ; car c’eft l’opération
la plus fimple de l’a r t , 6c il fuffira d’y faire les
obfervations fuivantes : i° . Il faut tellement comparer
la longueur des morceaux à ce que peut contenir
une page, qu’on ne foit jamais obligé de tourner fur
un même morceau dans les parties inftrumentales,
à moins qu’il n’y ait beaucoup de mefures à compter
qui en laiffent le tems. Cette réglé oblige de commencer
à la page verfo tous les morceaux qui rem-
pliffent plus d’une page ; & il n’y en a guere qui en
rempliffent plus de deux. z°. Les doux & les forts
doivent être écrits avec la plus grande exaditude
fur toutes les parties, même ceux où rentre 6c ceffe
le chant, qui ne font pas pour l’ordinaire écrits fur
la partition. 30. On ne doit point couper une mefure
d’une ligne à l’autre , mais tâcher qu’il y ait toujours
une barre à la fin de chaque portée. 40. Toutes les
lignes poftiches qui excédent, en haut ou en bas ,
les cinq de la portée , ne doivent point être continues
, mais féparées à chaque note , de peur que
le muficien , venant à les confondre avec celles de
la portée, ne fe trompe de note, & ne fâche plus
où il eft. Cette réglé n’eft pas moins néceffaire dans
les partitions , 6c n’eft fuivie par aucun copijle fran-
çois. 50. Les parties de hautbois qu’on tire fur les
parties de violon pbur un grand orcheftre , nè doivent
pas être exactement copiées comme elles font
dans l’original : mais, outre l’étendue que cet inftru-
ment a de moins que le violon ; outre les doux qu’il
ne peut faire de même ; outre l’agilité qui lui manque
, ou qui lui va mal dans certaines vîteffes , la
force du hautbois doit être ménagée. pour marquer
mieux les notes principales, 6c donner plus d’accent
à la mufique. Si j ’avois à juger du goût d’unfympho-
nifte fans l’entendre , je lui donnerois à tirer fur
la partie du violon, la partie de hautbois ; tout
•copijle doit favoir le faire. 6°. Quelquefois les parties
de cors 6c de trompettes ne font pas notées fur
le même ton que le refte de l’air, il faut les tranfpoferait
ton ; ou bien, fi on les copie telles qu’elles
font , il faut écrite au haut le nom de la véritable
tonique. Corni in D f o i re, Corni in E la fa , 6cc.
7°. 11 ne faut point bigarrer la partie de quinte ou
de viola de la clef de baffe & de la fienne, mais
tranfpoler à la clef de viola tous les endroits où elle
marche avec la bafe ; & il y a là-deffus encore une
autre attention à faire : c’eft de ne jamais laiffer
monter la viola au-deffus des parties du violon de
forte que , quand la baffe monte trop haut, il n’en
faut pas prendre l’ociave , mais l’uniffon, afin que
la viole ne forte jamais du medium qui lui convient.
8^. La partie vocale ne fe doit-copier qu’en partition
avec la baffe, afin que le chanteur fe puiffe
accompagner lui-même, & n’ait pas la peine ni de
tenir fa partie à la main, ni de compter fes paufes ;
dans les duo ou trio , chaque partie de chant doit
contenir , outre la baffe , fa contre-partie ; & quand
on copie un récitatif obligé, il faut pour chaque partie
d’inftrument ajouter la partie du chant à la fienne ,
pour le guider au défaut de la mefure. 90. Enfin
dans les parties vocales il faut avoir foin de lier ou
détacher les croches , afin que le chanteur voie
clairement celles qui appartiennent à chaque fyllabe.
Les partitions qui fortent des mains des compofiteurs
font, fur ce point, très-équivoques, & le chanteur
ne fait, la plupart du tems'Ç comment diftribuer la
note fur'la parole; Le copijle, verfé dans la profo-
d ie, & qui connoit également l’accent du difcours
6c celui du chant , détermine le partage des notes ,
& prévient l’indécifion du chanteur. Les paroles
doivent être écrites bien exactement fous les notes ,
& correCtes quant aux accents 6c à l’ortographe :
.°.n n’y mettre ni points ni virgules , les
répétitions fréquentes 6c irrégulières rendant la
ponduation grammaticale impoflible ; c’eft à la
mufique à ponCluer les paroles ; le copijle ne doit pas
s’en mêler : car ce feroit ajouter des lignes que le
compofiteur s’eft chargé de rendre inutiles.
Je m’arrête pour ne pas étendre à l’excès cet article
: j’en ai dit trop pour tout copijle inftruit qui a
uïie ,^9nne ma^n > & le goût de fon métier ; je n’en
dirois jamais affez pour les autres. J’ajouterai feulement
un mot en finiffant : il y a bien des intermédiaires
entre ce que le compofiteur imagine & ce qu’entendent
les auditeurs. C ’eft au copijle de rapprocher
cés deux termes le plus qu’il eft poffible ; d’indiquer
avec clarté tout ce qu’on doit faire pour que la mufique
exécutée rende exactement à l’oreillé*du compofiteur
ce qui s’eft peint dans fa tête en la compo-
fant. ( S ) v
COPTE ( L angu e) , Antiq. Litt. La langue copte
eft un mélange de_Fancienne langue Egyptienne 6c
. de mots Grecs qui s’y font gliffés peu-à-peu après que
cette nation s’eft rendue maîtreffe de ce pays. Nous
pouvons expliquer par cette langue prefque tous fos
anciens noms_ Egyptiens , & la plupart des étymologies
Egyptiennes qu’on trouve dans Hérodote ,
Diodore de Sicile , Plutarque , & dans d’autres auteurs
anciens ; elle eft un des principaux-fecours pour
les antiquités de ce pays , qui eft le berceau de plu-
fieurs arts, de la plupart des fciences, 6c prefque dei
toutes les fuperftitibns.
On a cru affez généralement que l’ancienne langue
Egyptienne reffembloit à l ’Hébreu, & à fes dia-
leCtes, qui font fur-tout le Syriaque , le Chaldéen ,
le Phénicien, l’Arabe & PEthiopien ; mais cette idée
eft entièrement faufle ; elle eft fondée fur la chimérique
prétention , manifeftement démentie par l’expérience,
que toutes les langues anciennes doivent
être dérivées du plus au moins de l’Hébreu, & fur
quelques mots qui font les mêmes dans l’Hébreu 6c
dans le copte, quoique d’ailleurs le fond & les racines
de ces deux langues foient totalement différentes.