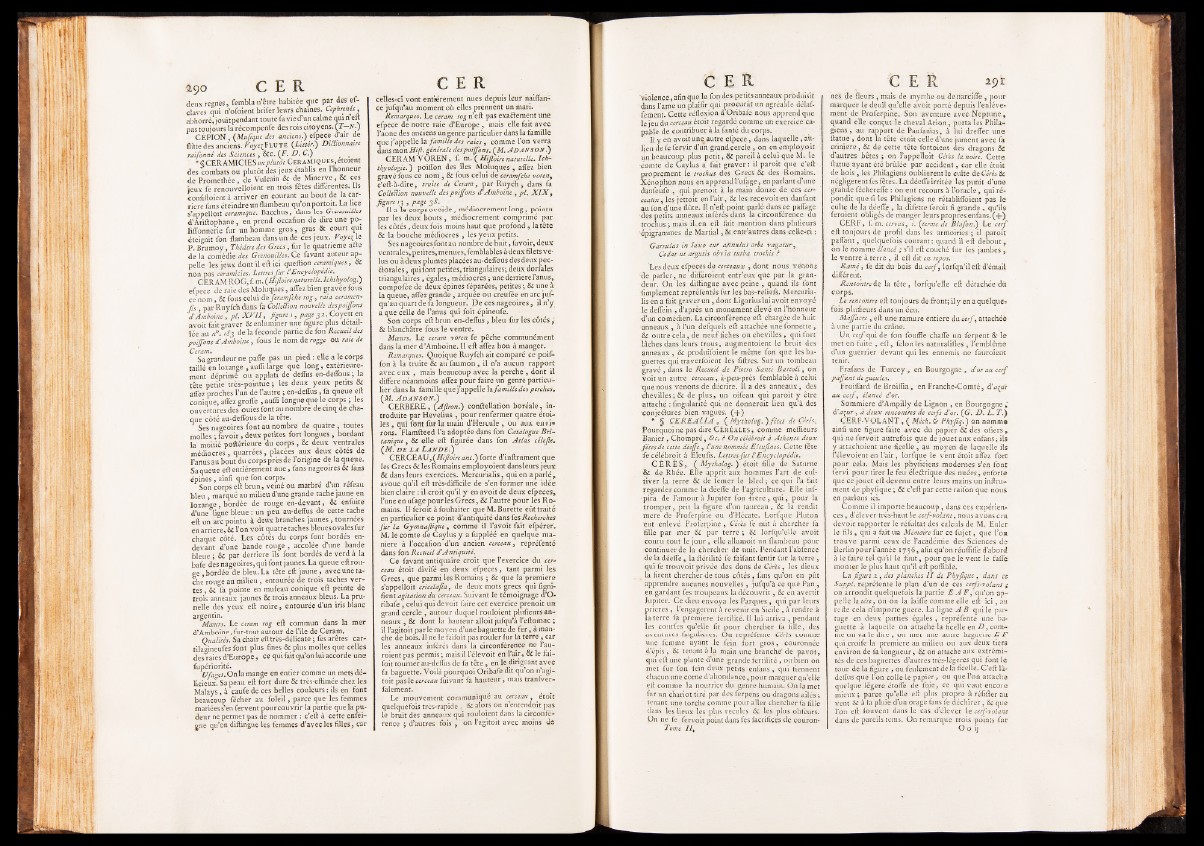
deux régnés, fembla n’être habitée que par des ef-
claves qui n’ofoient brifer leurs chaînes. Cephrenes,
abhorré, jouit pendant toute fa vie d’un calme quin’eft
pas toujours la récompenfe des rois citoyens, (T—N.)
CÉPION, (Mufique des anciens.) efpece d’air de
flûte des anciens. Flû te ( Littêr.) Dictionnaire
raifonnê des Sciences , & c . (F . D . C.) r .
* § CERAMICIES ou plutôt C éramiques, etoient
des combats ou plutôt des jeux établis en 1 honneur
de Promethée, de Vulcain & de Minerve, & ces
jeux fe renouvelaient en trois fêtes differentes. Ils
conliftoient à arriver en courant au bout de la carrière
fans éteindre un flambeau qu’on portoit. La lice
s’appelloit céramique. Bacchus, dans les Grenouilles
d’Ariftophane, en prend occafion de dire une po-
liffonnerie fur un homme gros, gras & court qui
éteignit fon flambeau dans un de ces jeux. Voye[le
P. Brumoy, Théâtre des Grecs, fur le quatrième atte
de la comédie des Grenouilles. Ce favant auteur appelle
les jeux dont il eftici queftion céramiques, &
non pas ceramicies. Lettres fur C Encyclopédie.
CER AM ROG, f. m. (Hifloire naturelle. Ichthyolog.)
efpece de raie des Moluques, affez bien gravée fous
ce nom, & fous celui deferamfche rog, raia ceramen-
(is par Ruyfch dans fa Collection nouvelle despoijfons
d'Amboine , pl. X V I I , figure i , page 32. Coyett en
avoit fait graver & enluminer une figure plus détaillée
au n°. iS3 de la fécondé partie de fon Recueil des
poifons d'Amboine, fous le nom de rogge ou raie de
Ceram. • , « .
‘ Sa grandeur ne paffe pas un pied : elle a le corps
taillé enlozange ,auflilarge que long, extérieurement
déprimé ou applati de deffus en-deffous ; la
tête petite très-pointue ; les deux yeux petits &
affez proches l’un de l’autre ; en-deffus, fa queue eft
conique, affez groffe , aufli longue que le corps ; les
ouvertures des ouies font au nombre de cinq de chaque
côté au-deffous de la tête.
Ses nageoires font au nombre de quatre , toutes
molles ; favoir, deux petites fort longues , bordant
la moitié poftérieure du corps, & deux ventrales
médiocres, quarrees, placées aux deux cotes de
l’anus au bout du corps près de l’origine de la queue.
Sa queue eft entièrement nue , fans nageoires & fans
épines, ainfi que fon corps. ^
Son corps eft brun, veiné ou marbré d’un refeau
bleu , marqué au milieu d’une grande tache jaune en
lozange, bordée de rouge en-devant, & enfuite
d’une ligne bleue : un peu au-deffus de cette tache
eft un arc pointu à deux branches jaunes, tournées
en arriéré, & l’on voit quatre taches bleues ovales fur
chaque côté. Les côtés du corps font bordés en-
devant d’une bande rouge , accolée d’une bande
bleue ; & par derrière ils font bordés de verd à la
bafe des nageoires, qui font jaunes. La queue eft rouge
, bordée de bleu. La tête eft jaune , avec une tache
rouge au milieu, entourée de trois taches vertes
, & fa pointe en mufeau conique eft peinte de
trois anneaux jaunes & trois anneaux bleus. La prunelle
des yeux eft noire, entourée d’un iris blanc
argentin.
Moeurs. Le ceram rog eft commun dans la mer
d’Amboine,fur-tout autour de File de Ceram.
Qualités. Sa chair eft très-délicate ; fes arêtes car-
tilagineufes font plus fines & plus molles que celles
des raies d’Europe, ce qui fait qu’on lui accorde une
fupériorité. . t
Clfâges. On la mange en entier comme un mets délicieux.
Sa peau eft fort dure & très-eftimée chez les
Malays, à caufe de ces belles couleurs : ils en font
beaucoup fécher au foleil, parce que les femmes
mariées s’en fervent pour couvrir la partie que la pudeur
ne permet pas de nommer : c’eft à cette enfei-
gne qu’on diftingue les femmes d’avec les filles, car
celies-ci vont entièrement nues depuis leur naiffan-
ce jufqu’au moment où elles prènnent un mari.
Remarques. Le ceram rog n’eft pas exactement une
efpece de notre raie d’Europe , mais elle fait avec
l’aone des anciens un genre particulier dans la famille
que j’appelle la famille des raies, comme l’on verra
dans mon Hifl. générale des poifons. (JW. ADAN SON.)
CERAM VOREN, f. m. ( Hifloire naturelle. Ich-
thyologie. ) poiffon des îles Moluques , affez bien
gravé fous ce nom , & fous celui de ceramfche voren,
c’eft-à-dire, truite de Ceram, par R u ych , dans fa
Collection nouvelle des poijfons (CAmboine , pl. X IX ,
figure 13 , page 38. ;
Il a le corps ovoïde, médiocrement long, pointu
par les deux bouts, médiocrement comprimé par
les côtés, deux fois moins haut que profond, la tête
& la bouche médiocres , les yeux petits.
Ses nageoires font au nombre de huit, favoir, deux
ventrales, petites, menues, femblables à deux filets velus
ou à deux plumes placées au-deffous des deux pectorales
, qui font petites, triangulaires; deux dorîales
triangulaires , égales, médiocres ; une derrière l’anus,
compofée de deux épines féparées, petites ; & une à
la queue, affez grande, arquée ou creufée en arc jufqu’au
quart de fa longueur. De ces nageoires, il n’y
a que celle de l’anus qui foit épineufe.
Son corps eft brun en-deffus, bleu fur les côtés ,
& blanchâtre fous le ventre.
Moeurs. Le ceram voren fe pêche communément
dans la mer d ’Amboine. Il eft affez bon à manger.
Remarques. Quoique Ruyfch ait comparé ce poiffon
à la truite & au faumon, il n’a aucun rapport
avec eux , mais beaucoup avec la perche , dont il
différé néanmoins affez pour faire un genre particulier
dans la famille que j’appelle la famille des perches,
(Af. A d a n s o n .)
CERBERE, (.Ajtron.) conftellation boréale, introduite
par Hevehus , pour renfermer quatre étoiles
, qui font fur la main d’Hercule , ou aux environs.
Flamfteed l’a adoptée dans fon Catalogue Bri-
ianique, & elle eft figurée dans fon Atlas célefie,
(Af. d e l a La n d e .)
CERCEAU, (Hifloire anc.) forte d’inftrument que
les Grecs & les Romains employoient dans leurs jeux
& dans leurs exercices. Mercurialis, qui en a parlé,
avoue qu’il eft très-difficile de s’en former une idée
bien claire : il croit qu’il y en avoit de deux efpeces,
l’une en ufage pour les Grecs, & l’autre pour les R omains.
Il feroit à fouhaiter que M. Burette eût traité
en particulier ce point d’antiquité dans fes Recherches
fur la Gymnajiique, comme il l’avoit fait efpérefi.
M. le comte de Caylus y a fuppléé en quelque maniéré
à l’occafion d’un ancien cerceau, repréfenté
dans fon Recueil (TAntiquité.
Ce favant antiquaire croit que l’exercice du cer-*
ceau étoit divifé en deux efpeces, tant parmi les
Grecs, que parmi les Romains ; & que la première
s’appelloit cricelafia, de deux mots grecs qui lignifient
agitation du cerceau. Suivant le témoignage d’O-
ribafe, celui qui devoit faire cet exercice prenoit un
grand cercle , autour duquel rouloient plufieurs anneaux
, & dont la hauteur alloit jufqu’à l’eftomac ;
il l’agitoit parle moyen d’une baguette de fé r , à manche
de bois. Il ne le faifoit pas rouler fur la terre, car
les anneaux inférés dans la circonférence ne l’ail—
roient pas permis ; mais il l’élevoit en l’air, & le faifoit
tourner au^deffus de fa tête, en le dirigeant avec
fa baguette. Voilà pourquoi Oribafe dit qu’on n’agi-,
toit pas le cerceau fuivant fa hauteur, maïs tranfver-
falement.
Le mouvement communique au cerceau, etoit
quelquefois très-rapide , & alors on n’entendoit pas
le bruit des anneaux qui rouloient dans la circonférence
; d’autres fois , on l’agitoit avec moins de
'violence, afin que, le fon des petits anneaux produisît
dans l’aine un plaifir qui procurât un agréable délaf-
fement. Cette réflexion d’Oribafe nous apprend que
le jeu du cerceau étoit regardé comme un exercice capable
de contribuer à la fanté du corps.
II y en avoit une autre efpece, dans, laquelle,'àU-
ïieu de fe ferylr d’un grand çercle , on en employo.it
un beaucoup plus petit, & pareil à celui que M. le
-comte de Caylus à fait graver : il paroît que c’eft
proprement le trochus des, ÇreçS &: des Romains.
Xénqphpn nous en apprend l'ufage , en pariant d’une
danfeufe , qui prenoit à la main douze de ces cer- \
çeaux, les. jettoit en l’air, &{. les reçevoit en danfant
au fon d’une flûte. Il n’eft point parlé dans ce paffage
des petits anneaux inférés dans la circonférence du
trochus ; mais il.en eft fait mention dans, plufieurs ~
'épigrammes dp Martial, &:entr’autres dans celle-ci :
Garrulus in ïd'xo cur ajinulus orbe vagatur-,
Cédât ut argutis obvia'tuf b a trochis?
Les deux efpeçes de cerceaux , dont nous Vëfiohs
•de parler-, ne différoient entr’eux que par la grandeur.
On les diftingue avec peine , quand ils font
Amplement repréfentés fur les bas-reliefs. Mercurialis
en a fait graver un , dont Ligorius lui avoit envoyé
le deffein , d’après un monument élevé en l’honneur
d’un comédien. La circonférence eft chargée de huit
Anneaux , à l’un defquels eft attachée une fonnette ,
& outre çe la ,d è neuf fiches ou chevilles, qui fort
'lâches dans leurs trous-, augmentaient le bruit des,
anneaux , & prpduifoient le même fon que les baguettes
qui traverfoient les filtres. Sur un tombeau
'gra vé, dans le Recueil de Pietro Santi B.artoli, on
voit un autre cerceau, à-peu-près femblable à celui
que nous venons de décrire, Il a des anneaux, des
- c h e v i l l e s d e plus, un oifieau qui paroît y être
attaché : fingularité qui ne donnproit lieu qu’à des
conjeétures bien vagufes. (+ )
* § CE R E A L I A , ( Mytholog. ) fêtes de Gérés.
Pourquoi ne pas dire C éréales , comme meilleurs
Banier, Cho'mpré, &c. ? On çèlebroit à Athènes deux
fêtes de cette déeffe , L'une noj;imêe Elcufines. Cette fête
fe célébroit à Eleufis. Lettres fur l’Encyclopédie.
C É R È S , ( Mytholog. ) étoit fille de Saturne
& de Rhée. Elle apprit aux hommes l’art de euh
tiver la terre .& de femer le bled ; ce qui l’a fait
regarder comme la déeffe de l’agriculture. Elle infi
-pira de l’amour à Jupiter fon fre re , qui, pour la
tromper, prit la figure d’un taureau, & la rendit
mere de Proferpine ou d’Hécate. Lorfque Piuton
put enlevé Proferpine , Çér'es fe mit à chercher fa
fille par mer & par terre ; & lorfqu’çllé avoit
couru tout le jou r, elle allumoit un flambeau pour
continuer de la chercher de nuit. Pendant l’abfence
de la déeffe, la ftérilité fe faifant fentir fur la terre,
qui fe trouvoit privée des dons de Cérès, les dieux
la firent chercher de tous côtés , fans qu’on en pût
apprendre aucunes nouvelles , jufqu’à ce que Pan ,
pn gardant fes troupeaux la découvrit, & en avertit
Jupiter. Ce dieu envoya les Parques , qui par leurs
prières , l’engagèrent à revenir en Sicile , à rendre à
la terre fa première fertilité. Il lui arriva , pendant
les courfes qu’elle fit pour chercher fa fille, des
aventures fingulieres. On repréfente Cérès comme
une femme ayant le fein fort gros, couronnée
d’épis, & tenant à la main une branche* de pavot,
qui eft une plante d’une grande, fertilité , ou bien on
met fur fon fein deux petits enfans , qui tiennent
chacun une corne d’abondance, pour marquer qu’elle
eft comme la nourrice du genre humain, On la met
fur un chariot tiré par des lerpens ou dragons ailés ;
tenant une torche comme pour aller- chercher fa fille
dans les lieux les plus reculés St les plus ohfcurs.
pn ne fe fervoit point dans lès. façrifices de couron-
Torne II,
nés de fleurs , mais de myrthe ou de narciffe , pour
marquer le deuil qu’elle avoit porté depuis l’-enléve-r
ment de Proferpine. Son aventure avec.Neptune,
quand elle conçut le cheval Àrian, porta les Phila-
gieos , au rapport de Paufariias, à lui dreffer une
llatue , dont la tête étoit celle d’une jument avec fa
crinière, & de cette tête fortoient des dragons &
d’autres bêtes ; on l’appelloit Cérès lunaire. Cette
ftatue ayant été brûlée par accident, car elle étoit
de bois , les Philagieris oublièrent le culte de Cérès &
négligèrent fes fêtes. La déeffe irritée les punit d’une
grande féchereffe : on eut recours à l’oracle, qui répondit
que fi les Philagiens ne rétabliffoient pas le
culte de la déeffe , la difette feroit fi grande , qu’ils
feraient obligés de manger leurs propres enfans. (+)[
CERF, f. m. cervus, i. (terme de Blafon.) Le cerf
eft toujours de profil dans les armoiries; il paroît
paffant, quelquefois courant : quand il eft debout,
on lé homme élancé ; s’il eft couché fur fes jambes ,
le ventre à terre , il eft dit en repos.
Ràmé, lé dit du bois du cerf, lorfqu’il eft d’émail
différent.
Rencontre de la tête, lôrfqu’elle eft détachée dit
corps.
Le rencontre eft toujours de front; il yen a quelquefois
plufieurs dans un écu.
I H âcre , eft une ramure entière du cerf, attachéè
à une partie du crâne.
Un cerf qui de fon fôuffle chàffe un ferpent & le
met en fuite , e ft , félon les nâturaliftes , l’emblème
d’un guerrier devant qui les ennemis ne fauroien't
tenir.
Frafans de T u rc e y , en Bourgogne, d’or au cerf
pafiunt de gueules,
Froiffard deBroiflia, en Franche-Comté, d'azur
au cerf, élancé d'or,
Sommiere d’Ampilly de Lignon , en Bourgogne >
d'uytr\ à deux rencontres de cerfs d'or. ( G. D. L. T.)
CERF-VOLANT, ( Méch. & Phyfiq.) on nomme
ainfi une figure faite avec du papier & des ofiers ,
qui ne fervoit autrefois que de jouet aux enfans; ils
y attachoient une ficelle , au moyen de laquelle ils
i’élevoient en l ’air, lorfque le vent étoit affez fort
pour cela. Mais les phyficiens modernes s’en font
lervi pour tirer le feu éleéhique des nuées, enforte
que ce jouet eft devenu entre leurs mains un infiniment
de phyfique ; & c’eft par cette raifon que nous
en parlons ici.
Comme il importe beaucoup, dans ces expériences
, d’élever très-haut le cerf-volant, nous avons cru
devoir rapporter le réfultat des calculs de M. Euler
le fils , qui a fait un Mémoire fur ce fuje t, que l’on
trouve parmi ceux de l’académie des Sciences de
Berlin pour l’année 1756, afin qu’on réuififfe d’abord
à le faire tel qu’il le faut, pour que le vent le faffe
monter le plus haut qu’il eft polîible.
La figure 2 , des planches I I de Phyfique , dans ce
Suppl, repréfente le plan d’un de ces cerfs-volans ;
on arrondit quelquefois la partie E A F , qu’on-appelle
la tête, ou on la laiffe comme elle eft i c i , au
relie cela n’importe guere. La ligne A B qui le partage
en deux parties égales , repréfente une baguette
à laquelle on attache la ficelle en D , comme
on va le dire ; on met une autre baguette E F
qui croife'la première au milieu ou aux deux tiers
environ de fa longueur, & on attache aux extrémités
de ces baguettes d’autres très-légeres qui font le
tour de la figure , ou feulement de la ficelle. C’eft là-
deffus que l’on colle le papier, ou que l’on attache
quelque légère étoffe de fqie, ce qui vaut encore
mieux ; parce qu’elle eft plus propre à rélifter au
vent & à la pluie d’un orage fans fe déchirer, & que
l’on eft fouvent dans le cas d’élever le cerf-volant
dans de pareils tems. On remarque trois points fur
O o ij