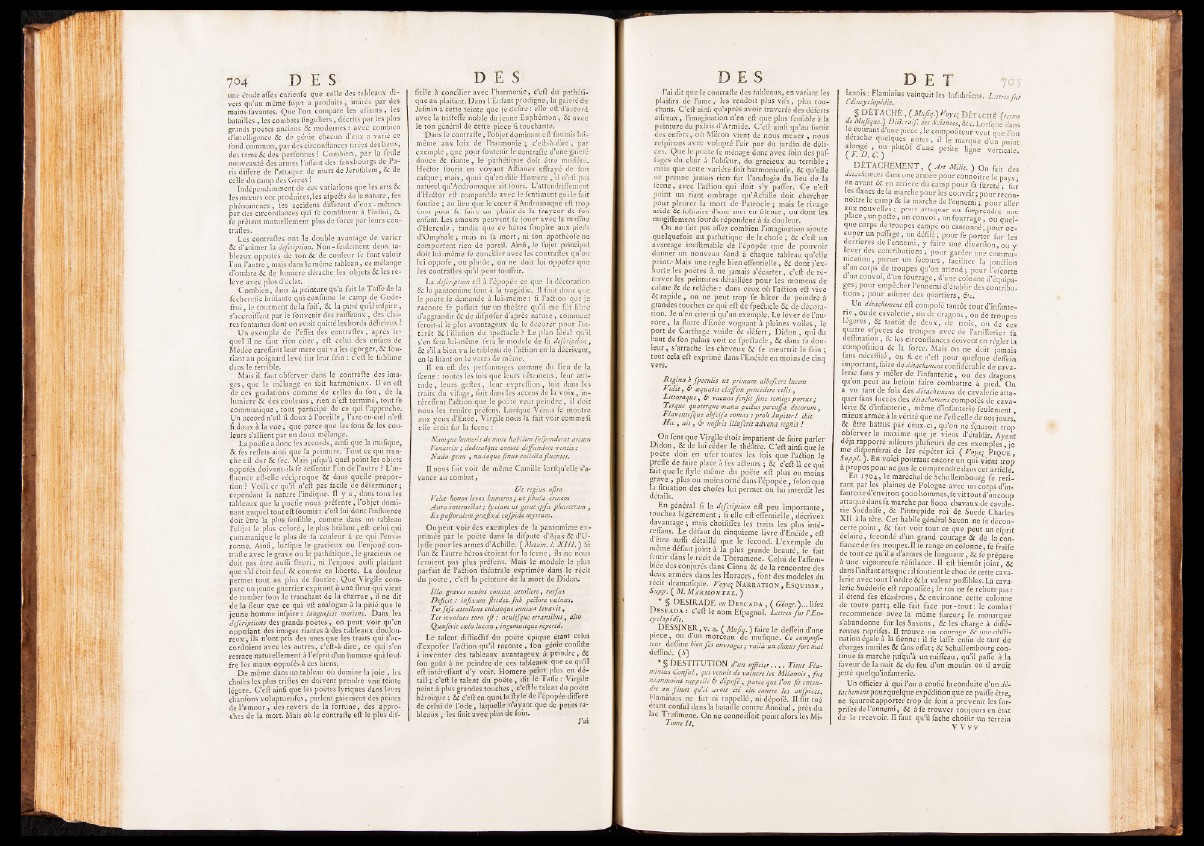
704 D E S
une étude affez curieufe que celle des tableaux divers
qu’un même fujet a produits, imités par des
mains favantes. Que l’on compare les alîauts , les
batailles , les combats finguliers, décrits par les plus
grands poètes anciens & modernes : avec combien
d’intelligence & de génie chacun d’eux a varie ce
tond commun, par des circonftances tirées des lieux,
des tems & des perfonnes ! Combien, par la feule
nouveauté des armes l’affaut des fauxbourgs de Paris
différé de l’attaque de murs de Jérufalem, & de
celle du camp des Grecs !
Indépendamment de ces variations que les arts &
les moeurs ont produites,les afpeéts de la nature, fes
phénomènes, fes accidens different d’eux-memes
par des circonftances qui fe combinent à l’infini, ÔC
fe prêtent mutuellement plus de force par leurs cori-
traftes. . , :
-Les contraftes ont le double avantage de varier
& d’animer la dtfcripùon. Non - feulement deux tableaux
opppfés de ton & de couleur fe font valoir
l’un l’autre ; mais-dans le même tableau, ce mélange
d’ombre & de lumière détache les objets & les re-
leve avec plus d’éclat.
Combien, dans la peinture qu’a fait le Taffe de la
féchereflè brûlante qui confume le camp de Gode-
froi, le tourment de la foif, & la pitié qu’il infpire,
s’accroiffent par le fouvenir des ruiffeaux, des claires
fontaines dont on avoit quitté lès bords délicieux!
Un exemple de i’effet des contraftes, après 1er
quel il ne faut rien citer, eft celui des enfans de
Médëe careffant leur mere qui va les égorger, & fou-
riant au poignard levé fur leur fein : c’eft le fublime
dans le terrible.
Mais il fautôbferver dans le contrafte des images
, que le mélange en foit harmonieux. Il en eft
de ces gradations comme de celles du fon , de la
lumieré & des couleurs ; rien n’eft terminé, tout fe
communique , tout participe de ce qui l’approche.
Un accord n’eft fi doux à l’oreille, l’arc-en ciel n’eft
fi doux à la vite/, que parce que les fons & les couleurs
s’allient par un doux mélange.
La poëfie a donc fes accords, ainfi que la mufique,
& fes reflets ainfi que la peinture. Tout ce qui tranche
eft dur & fec. Mais jufqu’à quel point les objets
oppofés doivent-ils fe reffentir l’un dé l’autre ? L’influence
eft-elle réciproque & dans quelle proportion?
Voilà ce qu’il n’eft pas facile de déterminer;
cependant la nature Pindique. Il y a , dans tous les
tableaux que la poëfie nous préfente, l’objet dominant
auquel tout eft fournis : c’eft lui dont l’influence
doit être la plus fenfible, comme dans un tableau
l’objet le plus coloré, le plus brillant, eft celui qui
communique le plus de fa couleur à ce qui l’environne.
Ainfi, lorfque le gracieux ou l’enjoué contrafte
avec le grave ou le pathétique, le gracieux ne
doit pas être auflî fleuri, ni l’enjoué auflî plaifant
que s’il étoit feul & comme en liberté. La douleur,
permet tout au plus, de fourire. Que Virgile compare
un jeune guerrier expirant à une fleur qui vient
de tomber fous le tranchant de la charrue , il ne dit
de la fleur qué ce qui eft analogue à la pitié que le
jeune homme infpire : langue/zit moriens. Dans les
defcriptionsdes grands poètes.,, on peut voir qu’en
oppofant des images riantes à, êtes tableaux douloureux,
ils n’ont pris des unes que les traits qui s’ac-
cordoient avec les autres, c’eft-à-dire, ce qui s’en
retrace naturellement à l’efprit d’un homme qui fouf-
fre les maux oppofés à ces biens.
De même dans un tableau où domine la joie , les
chofes les plus triftes en doivent prendre une teinte
légère. C’eft ainfi que les poètes lyriques dans leurs
chanfons voluptueufes, parlent gaiement des peines
de l’amour, des revers de la fortune, des approches
de la mort. Mais où le contrafte eft le plusdif-
D E S
ficile à concilier avec l’harmonie, c’ eft du pathétique
au plaifant. Dans l’Enfant prodigue, la gaieté de
Jafmin a cette teinte que je defire : elle eft d’accord
avec la trifteffe noble du jeune Euphémon, Se avec
le ton général de cette piece fi touchante.
Dans lè contrafte, l’objet dominant eft fournis lui-
même aux loix de l’harmonie ; c’eft-à-dire, par
exemple , que pour foutenir le Contrafte d’une gaieté
douce & riante, le pathétique doit être modéré.
Heétor fourit en voyant Aftianax effrayé de fon
cafque ; mais, quoi qu’en dife Homere , il n’eft pas
naturel qu’Andrômaque ait fouri. L’atténdriffement
d’Heftor eft compatible avec le fentiment qui le fait
fourire ; àu lieu que le coeur d’Andromaque eft trop
ému pour fe faire un plaifir de la frayeur de fon
enfant. Les amours peuvent fe jouer avec la maffue
d’Hercule , tandis que ce héros foupire aux pieds
d’Omphàle ; mais ni fa mort, ni fon apothéofe ne
comportent rien de pareil. Ainfi, le fujet principal
doit lui-même fé concilier avec les contraftes qu’on
lui oppofe , ou plutôt, on ne doit lui oppofer que
les contraftes qu’il peut fouffrir.
La de/cription eft à l’épopée ce que la décoration
& la pantomime font à là tragédie. Il faut, donc que
le poète fe demande à lui-même : fi l’aétion que jè
raconte fe paffoit fur un théâtre qu’il me fut libre
d’aggrandir & de difpofer d’après nature, comment
feroit-il le plus avantageux de le décorer pour l’intérêt
& l’illufion du lpeètacle ? Le plan idéal qu’il
s’en fera lui-même fera le modèle de fa de/cription,
& s’il a bien vu le tableau de Pa&ion en la décrivant,
en la lifant on le verra de même.
Il en eft des perfonnàges comme du Heu de la
feene : toutés les fois que leurs vêtemens, leur attitude
, leurs,, geftes, leur exprefîion, foit dans les
traits du vifage, foit dans les accens de la v o ix , in-
téreffent l’aètion que le poète veut peindre , il doit
nous les rendre préfens: Lorfque Vénus fe montre
aux yeux d’Enée, Virgile nous là fait voir comme fi
elle étoit fur la feene :
Nam que humeris de more habilem fufpenderat arcum
Venatrix ; dederatque cornas diffundere ventis :
Nuda genu , nudoque (inus colLecla fituntes.
Il nous fait voir de même Camille lorfqu’elle s’avance
au combat,
Ut regiu s ofiro
Velu honos levés humeros ; ut fibula -crinem
Aura interneciat ; lyciarn ut gérât ip/a phare tram ,
Et pajloralemprafixd cu/pide myrtum. ,
On peut voir des exemples de la pantomime exprimée
par le poète dans la difpute d’Ajax & d?U-
lyffe pour les armes d’Achille. ( Metam. I. X I I I . ) Si
l’un & l’autre héros étoient fur la feene ; ils ne nous
feroient pas plus préfens. Mais le modèle le plus
parfait de l’aftion théâtrale exprimée dans le récit
du poète , c’eft la peinturé de la mort de Didon.
Ilia graves oculos cqnata attollere, rur/us
Déficit : infixum flridep./ub pecloret vulnus.
Ter fie/e attollens cubitoque innixa levavit,
Ter revoluta toro ejl : oculi/que crraniibus Y alto
Qucefivit coelo lucem ÿ ingemuitque repertâ.
Le talent diftinélif du poète épique étant celui
d’expofer l’aétion qu’il raconte , ion génie confifte
à inventer des tableaux avantageux à peindre, &C
fôh goût à ne peindre de ces tableaux que ce qu’il
eft intéreffant d’y voiri Homere peint plus en détail
; c’eft le talent du poète, dit lefTaffe : Virgile
peint à plus grandes touches, c’eft le talent du poète
héroïque'; &c c’eft en quoi le ftyle de l’épopée différé
de celui de l’ode, laquelle n’ayant que de petits tableaux,
les finit avec plus de foin. ^ |
D E S
J’ai dit que le contrafte des tableaux, en variant les
plaifirs de l’ame,- les rendoit plus v ifs, plus tou-
chans. C ’eft ainfi qu’après avoir traverfé des déferts
affreux, l’imagination n’en eft que plus fenfible à la
peinture du palais d’Armide. C ’eft ainfi qu’au fortir
des enfers , où Milton vient de nous mener , nous
refpirons avec volupté l’air pur du jardin de délices.
Que le poète fe ménage donc avec foin des paf-
fages du clair à l’obfcur, du gracieux au terrible;
mais que cette variété foit harmonieufe, & qu’elle
ne prenne jamais rien fur l’analogie du lieu de la
feene, avec l’a&ion qui doit s’y paffer. Ce n’eft
point un riant ombrage qu’Achille doit chercher
pour pleurer la mort de Patrocle ; mais le rivage
aride & folitaire d’une mer en filehce, ou dont les
mugiffemens foiirds répondent à fa douleur.
On ne fait pas affez combien l’imagination ajoute
quelquefois au pathétique de la choie ; & c’eft un
avantage ineftimable de l’épopée que de pouvoir
donner un nouveau fond à chaque tableau qu’elle
peint:*-Mais une réglé bien effentiellé, & dont j ’exhorte
les poètes à ne jamais s’écarter, c’eft de ré-
ferver les peintures détaillées pour les momens de
calme & de relâche : dans ceux où l’aftion eft vive
& rapide, on ne peut trop fe hâter de peindre à
grandes touches ce qui eft de fpeftacle & de décoration.
Je n’en citerai qu’un exemple. Le lever de l’auro
re , la flotte d’Enée voguant à pleines voiles , le
port de Carthage vuide & défert, Didon , qui du
haut de fon palais voit ce fpe&acle, & dans fa douleur
, s’arrache les cheveux & fe meurtrit le fein ;
tout cela eft exprimé dans PEnéïde en moins de cinq
vers.
Regina è /peculis ut primum albe/cere lucem
Vidit, & æquatis cla/fem procédere velis,
Littoraque, & vacuos /en/it fine remige portus ;
Terque quaterque manu peclus percu/fa décorum y
Flavente/que ab/ci/a comas : proh Jupiter! ibit
•Hic , ait y & nofiris illuferit advena regnis !
On fent que Virgile étoit impatient de faire parler
Didon, & d e lui céder le théâtre. C ’eft ainfi que le
poète doit en nier toutes les fois que l’aélion le
preffe de faire place à fes aéieurs ; & c’eft-là ce qui
fait que le ftyle même du poète eft plus ou moins
grave, plus ou moins orné dans l’épopée, félon que
la fituation des chofes lui permet ou lui interdit les
détails.
En gençral fi la de/cription eft peu importante,
touchez légèrement ; fi elle eft effentielle, décrivez
davantage ; mais choififfez les traits les plus inté-
reffans. Le défaut du cinquième livre d’Enéïde, eft
d être auflî détaillé que le fécond. L’exemple du
même défaut joint à la plus grande beauté, fe fait
fentir dans le récit de Theramene. Celui de l’affem-
blee des conjures dans Cinna & de la rencontre des
deux armées dans les Horaces, font des modèles du
récit dramatique. Voye^ Najrration , E squisse ,
Supp. ( M. M a r m o n t e l . )
* § DESIRADE okD escada , ( Géogr.)... lifez
D eseada : c’eft le nom Efpagnol. Lettres fur VEncyclopédie.
DESSINER, v. a. ( Mufiq. ) faire le deffein d’une
piece, ou d’un morceau de mufique. Ce compofi-
teur deflïne bien /es ouvrages ; voilà un choeur fort mal
defliné. (S)
* § DESTITUTION eT-un officier. . . . Titus F la-
minius Con/ul y qui venoit de vaincre les Milanois , fu t
neanmoins rappelle & dépofè , parce que l'on fit entendre
au fenat quil avoit été élu contre les au/pices.
Flaminius ne fut ni rappellé, ni dépofé. Il fut tué
étant conful dans la bataille contre Annibal, près du
lac Trafimene. On ne connoiffoit point alors les Mi-
Torne I I%
DE T 705
lanois : Plaftinius vainquit lès Infubriens. Lettres fat
1'Encyclopédie. J
% p tT A C n t , (_ M u f iq r ) f rdyel D é t a c h é (terme
de Mufique.) Dict.raif. des Sciences, t ic . iorfque dans
te rn ir a it d’une piece, le compôfiteur veut que l’on
détache quelques notes, il le marque d’un point
( ° F % c f P1“ ““ ffune Pelit« «gué verticale.
DÉTACHEMENT ( Are M ilit.) o „ feit des
detathemens dans une armée pour connoître le pays *
en avant & en arriéré du camp pour fa fureté ; fur
les flancs de la marche pour les couvrir ; pour recon-
noitre le camp & la marche de l’ennemi ; pour aller
aux nouvelles ; pour attaquer ou furprendre une
place, un pofte, un convoi, un fourrage, ou quelque
corps de troupes campé ou cantonné; pour occuper
un paflâge, un défilé ; pour fe porter fur les
derrières de l’ennemi, y faire une diverfiqn, ou y
lever des contributions ; pour garder une communication
, porter un fecours , faciliter la jonftion
d un corps de troupes qu’on attend; pour l’efcorte
d’un convoi, d’un fourrage, d’une colonne d’équipages;
pour empêcher l’ennemi d’établir des contributions
; pour affurer des quartiers, &c.
Un détachement eft compofé tantôt tout d’infanterie
, onde cavalerie, ou de dragons, ou de troupes
legeres, & tantôt de deux, de trois, ou de ces
quatre efpeces de troupes avec de l’artillerie : fa
deftination , & les circonftances doivent en régler la
compofirion ^ & la force. Mais on ne doit jamais
fans néceflïté , ou fi ce n’eft pour quelque deffein
important, faire de détachement confidérable de cavalerie
fans y mêler de l’infanterie, ou des dragons
qu’on peut au befoin faire combattre à pied. On
a vu tant de fois des détachement de cavalerie attaquer
fans fuccès des détachemens compofés de cavalerie
& d’infanterie, même d’infanterie feulement
mieux armee a la vérité que ne l’eftcelle de nos jours,
& etre battus par ceux-ci, qu’on ne fçauroit trop
obferver la maxime que je viens d’établir. Ayant
déjà rapporté ailleurs plufieurs de ces exemples, je
me difpenferai de;les répéter ici ( Voye^ Piq u e ,
Suppl. ). En voici pourtant encore un qui vient trop
à propos pour ne pas le comprendre dans cet article.
En 1704, le maréchal de Schullembour* fe retirant
par les plaines de Pologne avec un corps d’infanterie
d’environ 5ooohommes,fevittoutd’uncoup
attaqué dans fa marche par 8000 chevaux de cavalerie
Suédoifé, & l’intrépide roi de Suede Charles
XII à la tête. Cet habile généraKSaxon ne fe déconcerté
point, & fait voir tout ce que peut un efprit
éclairé, fécondé d’un grand courage & de la confiance
de fes troupes.Il lè range en colonne, fe fraife
de tout ce qu’il a d’armes de longueur, & fe prépare
à une vigoureufe réfiftance. Il eft bientôt joint, &
dans l’inftant attaqué : il foutientle choc de cette cavalerie
avec tout l’ordre & la valeur poflibles. La cavalerie
Suédoifé eft repouffée ; le roi ne fe rebute pas:
il étend fes èfeadrons, & environne cette colonne
de toute part; elle fait face par-tout: le combaC
recommence avec la même fureur; le monarque
s’abandonne fur les Saxons, & les charge à différentes
reprifes. II trouve un courage & une obfti-
nation égale à la fienne: il fe laffe enfin de tant de
charges inutiles & fans effet; & Schullembourg continue
fa marche jufqu’à un ruiffeau, qu’il pafle à la
faveur de la nuit & du feu d’un moulin où il avoit
jetté quelqu’infanterie.
Un officier à qui l’on a confié la conduite d’un détachement
pour quelque expédition que ce puiffe être,
ne fçauroit apporter trop de foin à prévenir les fur-
prifes de l’ennemi, & à fe trouver toujours en état
de le recevoir. II faut qu’il fâche choifir un terrein
V V v v