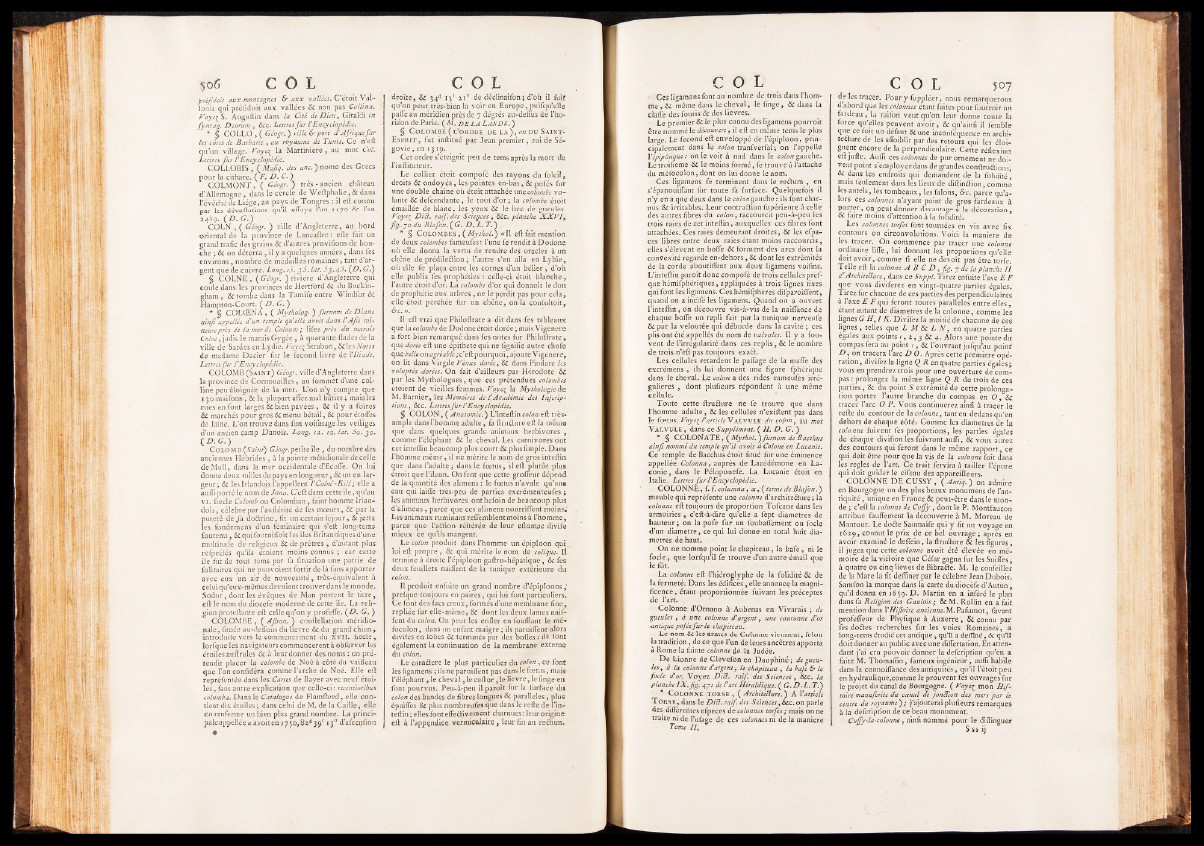
u f
IHl B i1l1®1
! • H i ln
I H l
M m n
préjidoit aux tnontàgnes & aux vallées. C ’etoit Val-
Jonia qui préfidoit aux vallées Sc non pas Collina.
Voye{ S. Auguftin dans la Cité de D im , Giraldi in
fyntag. Deorum , &c. Lettres fur L'Encyclopédie.
* § COLLO , ( Géogr.) ville & port d'Afrique fur
les côtes de Barbarie , au royaume de Tunis. Ce n’eft
qu’un village. Voye\ la Martiniere, au mot Col.
Lettres fur l 'Encyclopédie.
COLLOBIS , ( Mufiq. des anc.) nome des Grecs
pour la cithare. ( F . D . C.')
CO LM ON T , ( Géogr. ) très - ancien château
d’Allemagne , dans le cercle de Weftphalie, & dans
l’évêché de Liège, au pays de Tongres : il eft connu
par les dévastations qu’il efluya l’an 1 170 & l’an
34S9. ( D. G. )
COLN , ( Géogr. ) ville d ’Angleterre, au bord
oriental de la province de Lancaftre : elle fait un
grand trafic des grains Sc d’autres provifions de bouche
; Sc on déterra , il y a quelques années, dans fes
environs, nombre-de médailles romaines, tant d’argent
que de cuivre. Long. /5. jS . lat. ÔJ.4S. {D. G.)
§ CO LN E , (Géogr. ) riviere d’Angleterre qui
coule dans les provinces de Hertford &■ du Buckingham
, & tombe dans la Tamife entre '\Vindfor&
Hampton-Court. (D . G .)
* § CÔLCENA , ( Mytholog. ) furnom de Diane
ainji appellée (fun temple qu'elle avoit dans T Ajie mineure
prés de la mer de Coloum ; lifez prés du marais
Coloe, jadis le marais Gygée, à quarante Stades de la
ville de Sardes en Lydie. Voye^ Strabofl, Scies Notes
de madame Dacier fur le fécond livre de l'Iliade.
Lettres fur l'Encyclopédie.
COLOMB (Saint) Géogr. ville d’Angleterre dans
la province de Cornouailles , au fommet d’une colline
peu éloignée de la mer. L’on n’y compte que
ï 30 maifons , & la plupart allez mal bâties ; raaisles
Tues en font larges & bien pavées , & il y a foires
Sc marchés pour gros Sc menu bétail, Sc pour étoffes
de laine. L’on trouve dans fon voifinage les veftiges
d’un ancien camp Danois. Long. iz . iz.lat. J o .jo .
W jÊ M
Colomb {Saint) Géogr. petite île , du nombre des
anciennes Hébrides , à la pointe méridionale de celle,
de Mull, dans la mer occidentale d’EcoSfe. On lui
donne deux milles du pays en longueur, & un en largeur;
Sc leslrlandois l’appellent l ’Colm'-Kill; elie a
aufli porté le nom de Jona. C’eSt dans cette île, qu’au
v i . fiecle Colomb ou Colomban, faint homme Irlan-
dois, célébré par l’auStérité de fes moeurs, Sc par la
pureté de .fa doûrine, fit un certain féjour, & jetta
les fondemens d’un Séminaire qui s’eft long-tems
foutenu , &quifourniffoit les îles Britanniques d’une
multitude de religieux Sc de prêtres , d’autant plus
refpeétés qu’ils étoient moins connus ; car cette
île fut de tout tems par fa fituation une patrie de
folitaires qui ne pouvoient fortir de là fans apporter
avec eux un .air de nouveauté, très-équivalent .à
celui qu’eux-mêmes dévoient trouver dans le monde.
Sodor,dont les évêques de Man portent le titre,
eft le nom du diocefe moderne de cette île. La religion
proteftante eft celle qu’on y profeffe. (D . G. )
COLOMBE, ( AJlron. ) conftellation méridionale
, Située au-deffous du lievre Sc du grand chien,
introduite vers le commencement du x vii. fiecle ,
lorfque les navigateurs commencèrent à obferver les
étoiles auftrales Sc à leur donner des noms : on prétendit
placer la colombe de Noé à côté du vaiffeau
que l’on confidéra comme l’arche de Noé. Elle eft
repréfentée dans les Cartes de Bayer avec neuf étoiles
, fans autre explication que celle-ci : recentioribus
columba. Dans le Catalogue de Flamfteed, elle contient
dix étoiles ; dans celui de M. de la Caille, elle
en renferme un bien plus grand nombre. La principale
appellée « avoit en 17 50,8 id 3 9' 13" d’afcç.çfiôn
droite, Sc 34^ i f z i " de déclinaifon; d’oîi il fuit
qu’on peut très-bien la voir en Europe, puifqù’elle
palfe au méridien près de 7 dégrés au-deflus de l’horizon
de Paris. ( M. d e l a L a n d e . )
§ C o lom be ( l’ordre de l a ) , 0« du Saint-
Es p r it , fut inftitué par Jean premier, roi de Sé-
govie, en 1319.
Cet ordre s’éteignit peu de tems après la mort’de
l’inftituteur.
Le collier étoit compofé des rayons du foleil,
droits Sc ondoyés, les pointes en-bas, Sc pofés fur
une double chaîne oîi étoit attachée une colombe volante
Sc defeendante, le tout d’or ; la colombe étoit
émaillée de blanc, les yeux Sc le bec de gueules.
Voye^ Dicl. raif. des Sciences , &c. planche X X V I ,
fig. yo du Blafon. (G . D .L .T . ) _
* § Colombes , ( Mythol.) «Il eft fait mention
de deux colombes fameufes: l’une fe rendit à Dodone
oit elle donna la vertu de rendre des oracles à un
chêne de prédileôion ; l’autre s’en alla en Lybie,
oit elle fe plaça entre les cornes d’un bélier, d’oii
elle publia fes prophéties : celle-ci étoit blanche,
l’autre étoit d’or. La colombe d’or qui donnoit le don
de prophétie aux arbres , ne le perdit pas pour cela ,
elle étoit perchée fur un chêne, onia confultoit,
&c. ».
Il eft vrai que Philoftrate a dit dans fes tableaux
que la colombe de Dodone étoit dorée ; mais Vigenere
a fort bien remarqué dans fes notes fur Philoftrate ,
que dorée eft une épithetequi ne Signifie autre chofe
que belle ou agréable ; c’eft pourquoi, ajoute Vigenere,
on lit dans Virgile Vénus dorée, Sc dans Pindare les
voluptés dorées. On fait d’ailleurs par Hérodote Sc
par les Mythologues, que ces prétendues colombes
étoient de vieilles femmes. Voye£ là Mythologie de
M. Barnier, les Mémoires de VAcadémie des Injcaptions
, &c. Lettres fur l'Encyclopédie.
§ CO LON , ( Anatomie. ) L’inteftin colon eft très-
ample dans l’homme adulte ; fa ftru&ure eft la même
que dans quelques grands animaux herbivores ,
comme l’éléphant Sc le cheval. Les carnivores ont
cet inteftin beaucoup plus court Sc plus Simple. Dans
l’homme même, il ne mérite le nom de gros inteftin
que dans l’adulte ; dans le foetus, il eft plutôt plus
étroit que l’ileon. On fent que cette grolfeur dépend
de la quantité des alimens : le foetus n’avale qu’une
eau qui laiffe très-peu dé parties excrémenteufes ;
les animaux herbivores ontbefoin de beaucoup plus
d’alimens, parce que ces alimens nourriSTent moins»
Les animaux ruminans relfemblent moins à l’homme,
parce que l’aétion réitérée de leur eftomac divife
mieux ce qu’ils mangent.
Le colon produit dans l’homme un épiploon qui„
lui eft propre, Sc qui mérite le nom de colique. Il
termine à droite l’épiploon gaftro-hépatique, Sc fes
deux feuillets naiffent de la tunique extérieure du
colon.
Il produit enfuite un grand nombre d’épiploons,1
prefque toujours en paires, qui lui font particuliers.
Ce font des facs creux, formés d’une membrane fine,
repliée fur elle-même, Sc dont les deux lames naiffent
du colon. On peut les enfler en foufflant le mé-
focolon, dans un enfant maigre ; ils paroiflent alors
divifés en lobes Sc terminés par des bofles : ils font
également la continuation de la membrane externe
à\i colon.
Le cara&ere le plus particulier du colon, ce font
les ligamens ; ils ne paroiflent pas dans le foetus, mais
l’éléphant, le cheval, le caftor, le lievre, le finge en
font pourvus. Peu-à-peu il paroît fur la furface du
colon des bandes de fibres longues Sc parallèles, plus
épaifles & plus riombreufes que dans le refte. de l’inteftin
; elles font effeûivement charnues : leur origine
eft à l’appçndice vermicul^ire, leur fin ait rettum.
■ Ces ligamens font au nombre de trois dans l’homme
, Sc même dans le cheval, le finge, Sc dans la
clafle des fouris Sc des lièvres.
Le premier & le plus connu des ligamens pourroit
être nommé le découvert, il eft en même tems le plus
large. Le fécond eft enveloppé de l’épiploon, principalement
dans le colon tranfverfal; on l’appelle
Y épiploïque: on le voit à nud dans le colon gauche.
Le troifieme Sc le moins formé, fe trouve à l’attache
du mélocolon, dont on lui donne le nom.
Ces ligamens fe terminent dans le reâum , en
s’épanouiflant fur toute fa furface. Quelquefois il
n’y en a que deux dans le colon gauche : ils font charnus
Sc irritables. Leur contraction fupérieure à celle
des autres fibres du colon, raccourcit peu-à-peu les
trois raies de cet inteftin, auxquelles ces fibres font
attachées. Ces raies demeurant droites, & les efpa-
ces libres entre deux raies étant moins raccourcis,
elles s’élèvent en bofle Sc forment des arcs dont la
convexité regarde en-dehors, Sc dont les extrémités
de la corde aboutiflent aux deux ligamens voifins.
L’inteftin paroît donc compofé de trois cellules prefque
hémifphériques, appliquées à trois lignes fixes
qui font les ligamens. Ces hémifpheres difparoiflent,
quand on a incifé les ligamens. Quand on a ouvert
l ’inteftin, on découvre vis-à-vis de la naiflance de
chaque bofle un repli fait par la tunique nerveufe
Sc par la veloutée qui déborde dans la cavité ; ces
plis ont été appellés du nom de valvules. Il y a fou-
vent de l’irrégularité dans ces replis, Sc le nombre
de trois n’eft pas toujours exaéh
Les cellules retardent le paflage de la mafle des
excrémens , ils lui donnent une figure fphérique
dans le cheval. Le colom des rides rameufes irrégulières
, dont plufieurs répondent â une même
cellule.
Toute cette ftruûure ne fe trouve que dans
l’homme adulte, Sc les cellules n’exiftent pas dans
le foetus. Voyei l'article Valvule,<ƒ# colon, au mot
Valvule , dans ce Supplément. ( H. D . G. )
* § COLONATE, ( Mythol. ) furnom de Bacchus
ainji nommé du temple qu'il avoit à Colone en Lucanie.
Ce temple de Bacchus étoit fitué fur une éminence
appellée Colonna, auprès de Lacédémone en Laconie,
dans le Péloponefe. La Lucanie étoit en
Italie. Lettres fur ÜEncy elopedie.
COLONNE, f. f. columna, a , ( terme de Blafon. )
meuble qui repréfente une colonne d’architeâure ; la
colonne eft toujours de proportion Tofcane dans les
armoiries , c’eft-à-dire qu’elle a fept diamètres de
hauteur ; on la pofe fur un foubaflement ou focle
d’un diamètre, ce qui lui donne en total huit diamètres
de haut.
On ne nomme point le chapiteau, la bafe, ni le
foc le, que lorfqu’il fe trouve d’un autre émail que
le fut.
La colonne eft l’hiéroglyphe de la folidité & de
la fermeté. Dans les édifices, elle annonce la magnificence,
étant proportionnée fuivant les préceptes
de l’art.
Colonne d’Ornano à Aubenas en Vivarais ; de
gueules , à une colonne d'argent, une couronne d'or
■ antique pofée fur le chapiteau.
Le nom Sc les armes de Colonne viennent, félon
la tradition, de ce que l’un de leurs ancêtres apporta
à Rome la faint e colonne de la Judée.
De Lionne de Clevefon en Dauphiné; de gueules,
à la colonne d!argent , le chapiteau , la bafe & le
focle d'or. Voyez Dicl. raif. des Sciences, &c. la
planche IX . fig. qyi de l'art Héraldique. ( G. D. L. T .)
* Colonne torse , ( Architecture. ) A Y article
T orse, dans le Dicl. raif. des Sciences, &c.on parle
des différentes éfpeces de colonnes- torfes ; mais on ne
traite m de l’ufage de ces colonnes ni de la pianiere
Tome II.
de les tracer. Pour y fuppléer, nous remarquerons
d abord que \es colonnes étant faites pour foutenir un
fardeau, la raifon veut qu’on leur donne toute la
force qu’elles peuvent avoir, & qu’ainfi il femble
que ce foit un défaut & une inconféquence en architecture
de les affoiblir par des retours qui les éloignent
encore de la perpendiculaire. Cette réflexion
eft jufte. Aufli ces colonnes de pur ornement ne doivent
point s’employer dans de grandes conftru&ions
Sc dans les endroits qui demandent de la folidité \
mais feulement dans les lieux de diftinûion, comme
les autels, les tombeaux, les falons, &c. parce qu’a-
lors ces colonnes n’ayant point de gros fardeaux à
porter, on peut donner davantage à la décoration ,
& faire moins d’attention à la folidité.
Les colonnes torfes font tournées en vis avec fix
contours ou circonvolutions. Voici la maniéré de
les tracer. On commence par tracer une colonne
ordinaire lifle, lui donnant les proportions qu’elle
doit avoir, comme fi elle ne devoit pas être torfe.
Telle eft la colonne-A B C D , fig. y de la planche I I
d'Architecture, dans ce Suppl. Tirez enfuite l’axe E F
que vous diviferez en vingt-quatre parties égales.
Tirez fur chacune de ces parties des perpendiculaires
à l’axe E / ’ qui feront toutes parallèles entre elles,
étant autant de diamètres de la colonne, comme les
lignes G H , I K . Divifez la moitié de chacune de ces
lignes, telles que L M Sc L N , en quatre parties
égales aux points /, z , 3 Sc 4. Alors une pointe du
compas fera au point 1 , & l’ouvrant jufqu’au poin^
■ D, on tracera lare D O. Apres cette première opération,
divifez la ligne Q R en quatre parties égales;
vous en prendrez trois pour une ouverture de compas
: prolongez la même ligne Q R de trois de ces
parties, Sc du point S extrémité de cette prolongation
portez l’autre branche du compas en O , Sc
tracez l’arc O P. Vous continuerez ainfi à tracer le
refte du contour de la colonne, tant en dedans qu’en
dehors de chaque côté. Comme les diamètres de la
colonne fui vent fes proportions, les parties égales
de chaque divifion les fuivront aufli, Sc vous aurez
des contours qui feront dans le même rapport, ce
qui doit être pour que la vis de la colonne foit dans
les réglés de l’art. Ce trait fervira à tailler l ’épure
qui doit guider le cifeau des appareilleurs.
COLONNE DE CU SSY , ( Antiq, ) on admire
en Bourgogne un des plus beaux monumens de l’antiquité,
unique en France Sc peut-être dans le monde
; c’eft la colonne de Cuffy, dont le P. Montfaucon
attribue fauffement la découverte à M. Moreau de
Mautour. Le dofte Saumaife qui y fit un voyage en
1629, connut le prix de ce bel ouvrage; après en
avoir examiné le deffein, la ftruéfure Sc les figures,
il jugea que cette colonne avoit été élevée en mémoire
de la viéloire que Céfar gagna fur les Suifles,
à quatre ou cinq lieues de Bibraôe. M. le confeiller
de la Mare la fit defîiner par le célébré Jean Dubois.
Samfon la marque dans la carte du diocèfe d’Autun ,
qu’il donna en 1659. D . Martin en a inféré le plan
dans fa Religion des Gaulois ; Sc M. Roi lin en a fait
mention dans YHiJloire ancienne. M. Pafumot, favant
profeffeur de Pnyfique à Auxerre, & connu par
fes doâes recherches fur les voies Romaines, a
long-tems étudié cet antique, qu’il a deffiné, Sc qu’il
doit donner au public avec une differtation. En attendant
j’ai cru pouvoir donner la defeription qu’en a
faite M. Thomaflin, fameux ingénieur, aufli habile
dans la connoiflance des antiquités, qu’il Tétoitpeu
en hydraulique,comme le prouvent fes ouvrages fur
le projet du canal de Bourgogne. ( Voye{ mon Hif-
toire manuferite du canal de jonction des mers par le
centre du royaume ) ; j’ajouterai plufieurs remarques
à la defeription de ce beau monument.
Çufjy-la-colonne, ainfi nommé pour le diûinguer
S s s i j