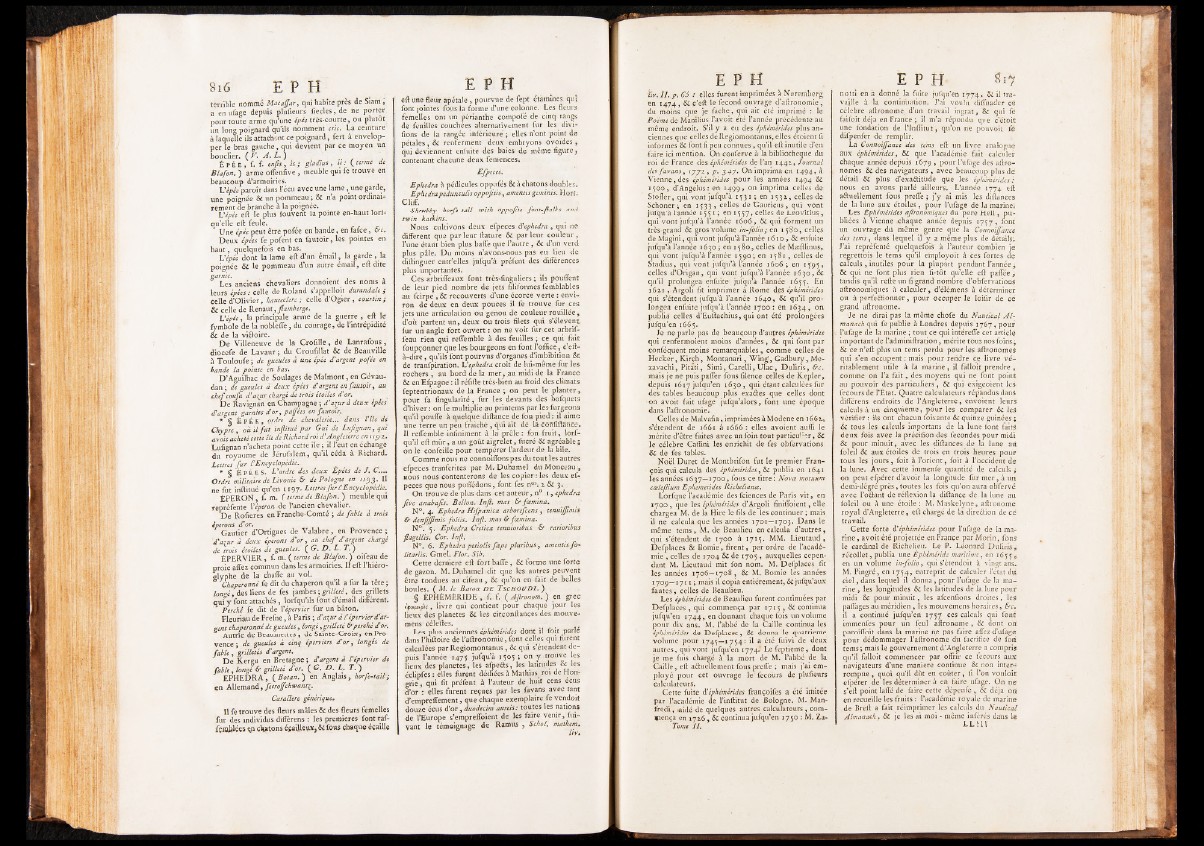
terrible nommé Macajfar, qui habite près ae Siam,
a en ufage depuis plufieurs fiecles, de ne porter,
pour toute arme qu’une épée très-courte, ou plutôt
un long poignard qu’ils nomment cric. La ceinture
à laquelle ils attachent ce poignard, fert à envelopper
le bras gauche, qui devient par ce moyen un
bouclier. {V . A . L. ) . \
ÉPÉE, f. f. enfis , is ; gladius, ij : ( termè dé
B la f on. ) arme offenfive, meuble qui fe trouve en
beaucoup d’armoiries.
L’épée paroît dans l’écu avec une lame, une garde,
une poignée & un pommeau ; & n’a point ordinairement
de branche à la poignée.
L’épée eft le plus Couvent la pointe en-haut lorf-
cu’elle eft feule.
Une épée peut être pofée en bande, en fafee, &c.
Deux épées Ce pôfent en fautöir, les pointes en
haut, quelquefois en bas!
L’épée dont la lame eft d’un émail, la garde, la
poignée & le pommeau d’un autre émail, eft dite
garnie. , ,
Les anciens chevaliers donnoienf des noms a
leurs épées : celle de Roland s’appelloit durandale }
celle d’Olivier, hautechre; celle d’Og ier, côuriin;
& celle de Renaut, flamberge.
L ’épée y la principale arme de la guerre, eft le
fymbole de la nobleffe, du courage, de l’intrépidité
& de la viftoire.
D e Villeneuve de la Crofille, de Lanrafous,
diocefe de Lavaur ; du Croufillat & de Beauville
à Touloufe ; de gueules a une épée d’argent pofée en
bande la pointe en bas.
D ’Aguilhac de Soulages de Malmont, en Gévâu-
dan; de gueules à deux épées <Targent en faiiioir, au
chef coufu d’azur chargé de trois étoiles d'or. ^ 4
De RavignaU en Champagne ; d’azur à deux épées
d?argent garnies tTor, papes en fautöir.
* § ÉPÉE, ordre de chevalerie... dans Pile de
Chypre , ou il fu t infiitué par Gui de Lufignan,qui
avoit acheté cette île de Richard roi d’Angleterre en 1192.
Lufignan n’acheta point cette île ; il l’eut en échange
du royaume de Jérufalem, qu’il céda à Richard.
Lettres fur l’Encyclopédie. .
* g É p é e s . L’ordre des deux Epées de J. C..'.'.
Ordre militaire de Livonie & de Pologne en 1193. Il
ne fut inftitué qu’en 1197. Lettres fur P Encyclopédie.
ÉPERON, f. m. ( terme de Blafon. ) meuble qui
repréfente l’éperon de l’ancien chevalier.
De Rofieres en Franche-Comté ; de fable a trois
éperons a or.
Gautier d’Ortigues de Valabre, en Provence;
d’azur à deux éperons d'or f ait chefet argent chargé
de trois étoiles de gueules. ( G. D . L. T. ) >
ÉPERVIER , f. m. ( terme de Blafon. ) oifeau de
proie affez commun dans les armoiries. Il eft l’hiéroglyphe
de la chaffe au völ.
Chaperonné fe dit du chaperon qu’il a fur la tête ;
longé, des liens de fes jambes ; grilleté, des grillets
qui y font attachés , lorfqu’ils font d’émail différent.
Perché fe dit de l’ épervier fur urt bâton.
Fleuriau de Frefne, à Paris ; d’a\ur à Vépefvietd’argent
chaperonné de gueules, longé y grilleté & perché etor.
Autric de Beaumettes , de Sainte-Croix, en Provence;
de gueules à cinq épirviers d'or y 'longes de
fable y grilletés d’argent.
De Kergu en Bretagne ; êPargent a Vépervier de
fftbUy longé & grilleté d’or. ( G. D . L. T. )
EPHEDRA, ( Botan. ) en Anglais, horfe-tail;
ien Allemand, feeroffehwantç.
Caractère générique.
Il fe trouve des fleurs mâles & des fleurs femelles
fur des individus différens : les premières font raf-
feittfelées çu chatons écailleux, & fous chaque écaille
eft une fleür apétale, pourvue de fept étamines qui
font jointes fous la forme d’une colonne. Les fleurs
femelles ont un périanthe compofé de cinq rangs
de feuillés couchées alternativement fur les divi-
fions de la rangée intérieure ; elles n’ont point de
pétales, & renferment deux embryons ovoïdes ,
qui deviennent enfuite des baies de même figure,
contenant chacune deux femences*
Efpeces;
Ephedra à pédicules oppofés & à chatons doubles;
Ephedra pedunculis oppojitis, amentis geminis. Hort;
Cliff.
Shrubby horfe-tail witk oppojite foot-Jialks and
iwin katkins.
Nous cultivons deux efpeces A’ephedra , qui ne
different que par leur ftature & par leur couleur ,
l’une étant bien plus baffe que l’autre , & d’un verd
plus pâle. Du moins n’avons-nous pas eu lieu de
diftinguer entr’elles jufqu’à prélent des différences
plus importantes.
Ces arbriffeaux font très-finguliers ; ils pouffent
de leur pied nombre de jets filiformes femblables
au feirpe , & recouverts d’une écorce verte : environ
de deux en deux pouces il fe trouve fur ces
jets une articulation ou genou de couleur rouillée,
d’oii partent un, deux ou trois filets qui s’élèvent
fur un angle fort ouvert : on ne voit fur cet arbrif-
I feau rien qui reffemble à des feuilles; ce qui fait
foupçonner que les bourgeons en font l’office, c’eft-
à-dire, qu’ils font pourvus d’organes d’imbibition &
de tranfpiration. L’ephedra croît de lui-même fur les
rochers, au bord de la mer,.au midi de la France
& en Efpagne : il réfifte très-bien au froid des climats
feptentrionaux de la France ; on peut le planter,
pour fa Angularité, fur les devants des bofquets
d’hiver: on le multiplie au printems par Iesfurgeons
qii’il pouffe à quelque diftance de fon pied : il aime
une terre un peu fraîche , qui ait de la confiflance.
Il reffemble infiniment à la prêle : fon fruit, lorf-
qu’il eft mur, a un goût aigrelet, fueré & agréable ;
on le confeille pour témpérer l’ardeur de la bile.
Comme nous ne connoiffons pas du tout les autres
efpeces transcrites par M. Duhamel du Monceau „
nous nous contenterons de les copier : les deux ef-,
peces que nous poffédons, font fes nos. 2 & 3*
On trouve de plus dans cet auteur, n° 1 , ephedra
Jive anabajis. Bellon. Injh mas & foemina.
N°. 4. Ephedra Hifpanica arborefeens , teiïuiffinùs
& denjiffimis folïis. Injl. mas & foemina.
N°. 5, Ephedra Cretica tenuioribus & rarioribus
flagellis. Cor. Injl, , " / ■ ■■
N°. 6. Ephedra petiolis fape pluribus, amentis fo -
litariis. Gmel. Flor. Sib.
Cette derniere eft fort baffe, & forme une forte
de gazon. M. Duhamel.dit que les autres peuvent
être tondues au cifeau, 6c qu’on en fait de belles
boules. ( M. le Baron d e T s c k o u D I . )
§ ÉPHÉMÉR1DE , f. f . ; (. AJironom. ) en grec
IptiptfU y livre qui contient pour chaque jour les
lieux des planètes 6c les circonftances des mouve-
mens céleftes.
Les plus anciennes éphémérides dont il foit parle
dans l’hiftoire de l’aftronomie, font celles qui furent
calculées par Regiomontanus, 6c qui s’étendent depuis
l’année 1475 jufqu’à 1505 ; on y trouve les
lieux des planètes, les afpeâs, les latitudes 6c les
éclipfes : elles furent dédiées à Mathias, roi de Hongrie
, qui fit préfent à l’auteur de huit cens ecus
d’or : elles furent reçues par les favans avec tant
d’empreffement, que chaque exemplaire fe vendoit
douze écus d’or , duodecim aureis: toutes les nations
de l’Europe s’empreffoient de les faire venir, fui—
vant le témoignage de Ramus , Schol. mathem.
1 lÎY.
iiv. II.. p. €6 : elles furent imprimées à Nuremberg
en 1474, & e’eft le fécond ouvrage d’aftronomie,
du moins que je fâche, qui ait été imprimé : le
Poème dé Manilius l’avoit été l’année précédente au
même endroit. S’il y a eu des éphémérides plus anciennes
que celles de Regiomontanus, elles étoient fi
informes & font fi peu connues , qu’il eft inutile d’en
faire ici mention. On conferve à la bibliothèque du
roi de France des éphémérides de l’an 144z , Journal
des favans y ijyo. , p. 347- On imprima en 1494, à
Vienne, des éphémérides t pour les années 1494 &
1500, d'Angelus: en 1499» on imprima celles de
Stofler, qui vont jufqu’à 1531 ; en 1532, celles de
Schoner ; en 1533, celles de Gauricus, qui vont
jufqu’à l’année 155»; en 1557, celles de LeovitiuS,,
qui vont jufqu’à l’année 1606, & qui forment un
très-grand & gros volume in-folio; en 1580, celles
de Magini, qui vont jufqu’à l’année 16 10 , & enfuite
jufqu’à l’année 1630 ; en 1580, celles de Mæftlinus,
qui vont jufqu’à l’année 1590; en 1581, celles de
Stadius, qui vont jufqu’à l’année 1606; en 1595,
celles d’Origan, qui vont jufqu’à l’année 1630, &
qu’il prolongea enfuite jufqu’à l’année 1655. En
1621 , Argoli fit imprimer à Rome des éphémérides
qui s’étendent jufqu’à l’année 1640, & qu’il prolongea
enfuite jufqu’à l’année 1700: en 1634, on
publia celles d’Euftachius , qui ont été prolongées
jufqu’en 1665.
Je ne parle pas de beauqoup d’autres éphémérides
qui renfermoient moins d’années., & qui font par
conféquent moins remarquables, comme celles de
Hecker, Kirch, Montanari, Wing-, Gadbury, Me-
zavachi, Pitati, Simi, Carelli, U la c, Duliris, & c .
mais je ne puis paffer fous filence celles de Kepler,
depuis 1617 jufqu’en 1630, qui étant calculées fur
des tables beaucoup plus exaéies que celles dont
on avoit fait ufage jufqu’alors, font une époque
dans l’aftronomie.
Celles de Malvafia ? imprimées à Modene en 1662,
s’étendent de 1661 à 1666 : elles avoient auffi le
mérite d’être faites avec un foin tout particuHer, 8>c
le célébré Caflïni les enrichit de fes obfervations
& de fes tables.
Noël Duret de Montbrifon fut le premier Fran-
■ çois qui calcula des éphémérides, & publia en 1641
les années 1637—1700, fous ce titre: Nova motuum
coelejlium Ephémérides Richeliana.
Lorfque l’académie des fciences de Paris v it , en
1700, que les éphémérides d’Argoli finiüoient, elle
chargea M. de la Hire le fils de les continuer ; mais
il ne calcula que les années 1701—1703. Dans le
même tems , M. de Beaulieu en calcula d’autres,
qui s’étendent de 1700 à 1715. MM. Lieutaud ,
Defplaces & Bomie, firent, par ordre de l’académie
, celles de 1704 & de 1705 , auxquelles cependant
M. Lieutaud mit fon nom. M. Defplaces fit
les années 1706—1708, & M. Bomie les années
1709—1711 ; mais il copia entièrement, & jufqu’aux
fautes, celles de Beaulieu.
Les éphémérides de Beaulieu furent continuées par
Defplaces , qui commença par 1715 , & continua
jufqu’en 1744, en donnant chaque fois un volume
pour dix ans. M. l’abbé de la Caille continua les
éphémérides de Defplaces, & donna le quatrième
volume pour 1745—1754 : il a été ftiivi de deux
autres, qui vont jufqu’en 1774«* Le feptieme, dont
je me fuis chargé à la mort de M. l’abbé de la
Caille, eft aûuellement fous preffe ; mais j’ai employé
pour cet ouvrage le' feco'urs de plufieurs
calculateurs.
Cette fuite d'éphémérides françoifes a été imitée
par l’académie de l’inftitut de Bologne. M. Man-
fredi, «aidé de quelques autres calculateurs, commença
en 1726, & continua jufqu’en 1750 : M. Za-
Tome IL
notti en à dohné la fuite jufqü’en 1 7 74 , & il travaille
à la continuation. J’ai voulu diffuader cé
célébré aftronome d’un travail ingrat, & qui fé
faifoit déjà en France ; il m’a répondu que c’étoit
une fondation de l’Inflitut, qu’on ne pouvoit fé
difpenfer de remplir:
La Connoijfance des tems ëft un livre analogue
âux éphémérides y & que l’académie fait calculer
chaque année depuis 1679 , pour l ’üfage des aftro-
nomes & des navigateurs , avec beaucoup plus dé
détail & plus d’exaftitùde qüe les éphémérides:
nous en avons parlé ailleurs; L’année 1774 eft
a&uellement fous preffe ; j’y ai mis les diftances
de la lune aux étoiles, pour l’ufage de la marinel
Les Éphémérides agronomiques du pere H e ll, publiées
à Vienne .chaque année depuis 1757, font
un ouvrage dit même genre qtie la Gonnoijfance
des tems, dans lequel il y a même plus de détails;
J’ai repréfenté quelquefois à l’auteur combien je
regrettôis le tems qu’il e'mployoit à ces fortes de
calculs , inutiles pour là plupart pendant l’année ;
& qui ne font plus rien fi-tôt qu’elle eft paffée >
tandis qu’il refte un fi grand nombre d’obfervations
aftronomiques à calculer, d’élémens à déterminer
ou à perfectionner, pour occuper le lôifir de cé
grand aftrônome.
Je ne dirai pas la même cÜofe du Nautical A l manach
qiii fe publie à Londres depuis 176 7 , pour
l’ufage de la marine ; tout ce qui intéreffe cet article
important de l’adminiftration, mérite tous nos foins;
& ce n’eft plus un tems perdu pour les aftronomeS
qui s’en occupent : mais pour rendre ce livre véritablement
utile à la marine, il falloit prendre ,
•Comme on l’a fa it , des moyens qui ne font point
au pouvoir des particuliers, & qui exigeoient les
fecours de l’État. Quatre calculateurs répandus dans
différens endroits de l’Angleterre, envoient leur*,
calculs à un cinquième, pour les comparer & les
vérifier : ils ont chacun foixante & quinze guinées ;
& tous les calculs importans de la lune font faitâ
deux fois avec la précifion des fécondés pour midi
& pour minuit, avec les diftances de la lune aii
foleil & aux étoiles de trois en trois heures pour
tous les jours, foit à l’orient, foit à l’Occident de
la lune. Avec cette immenfe quantité de calculs ;
on peut efpérer d’avoir la longitude fur mer, à un
demi-dégré près, toutes les fois qu’on aura obfervé
avec l’oftant de réflexion la diftance de. la lune au
foleil ou à une étoile: M. Maskelyne, aftronome
royal d’Angleterre, eft chargé de la'direôion de cé
travail;
Gette forte d’éphémérides pour l’ufage de la marine
, avoit été projettée en France par Morin, fous
le cardinal de Richelieu. Le P. Léonard Duliris,'
réeollet, publia une Éphéméride maritime y en 1655,
en un volume in-folio, qui s’étendoit à vingt ans.
M. Pingré, en 1754, entreprit de calculer l’état du
c ie l, dans lequel il donna, pour l’ufage de la marine
, les longitudes & les latitudes de la, lune pour
midi & pour minuit, les afeenfions droites, les
paffages au méridien , les mouvemens horaires, &c.
il a continué jufqu’eri 1757 ces calculs qui font
immenfes pour un feul aftronome, & dont ori
paroiffoit dans la marine iie pas faire affez d’ufage
pour dédommager l’aftronome du facrifice de font
tems; mais'le gouvernement d’Angleterre a compris
qu’il falloit commencer par offrir ce fecours aux
navigateurs d’une maniéré continue & non interrompue
, quoi qu’il dût en coûter, fi l’on vouloit
efpérer de les déterminer à en faire ufage. On ne
s’eft point laffé de faire cette dépenfe , 6c déjà oh
en recueille les fruits : l’académie royale de mariné
de Breft a fait réimprimer les calculs du Nautical
Almanach, 6c je les ai moi - même inférés dans 1*
L L H 1 ,