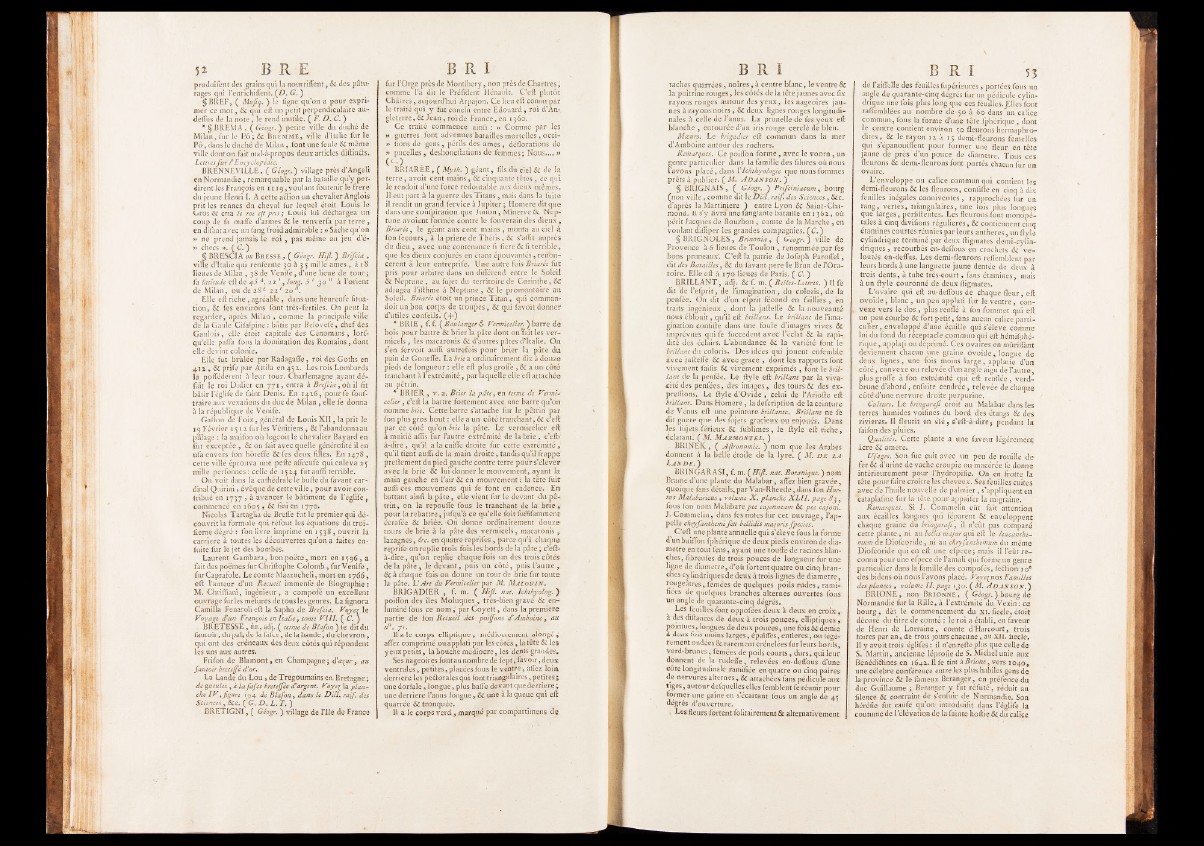
produisent des grains qui la nourriffent, 8i des pâturages
qui l’enrichiffent. (D . G. )
§BREF, ( Mußq, ) le Signe qu’on a pour exprimer
ce mot, &c qui eft un petit perpendiculaire au-
deflus de la note , le rend inutile. ( F. D. C. )
* § BREMA, ( Géos>r. ) petite ville du duché de
Milan, Sur le Pô; & Brem me, ville d’Italie Sur le
P ô , dans le duché de Milan , Sont une Seule & même
ville dont on fait mal-à-propos deux articles diftin&s.
Lettres fur V Encyclopédie.
BRENNE VILLE, ( Géogr.) village prèsd’Angeli
en Normandie, remarquable par la bataille qu’y perdirent
les François en 1 1 19 , voulant Soutenir le frere
du jeune Henri I. A cette aftion un chevalier Anglois
prit les rennes du cheval Sur lequel étoit Louis le
Gros & cria le roi efi pris ; Louis lui déchargea un
coup de Sa malTe d’armes & le renverSa par terre ,
en dISantavec un Sang froid admirable : » Sache qu’on
» ne prend jamais le roi , pas même au jeu d’e-
» checs ». ( C. )
§ BRESCIA ou Bresse , ( Géogr. Hiß. ) Brifcia ,
ville d’Italie qqi renferme 30 à 3 5 mille âmes , à 18
lieues de Milan, 38 de Venife, d’une lieue de tour;
Sa latitude eft de 46 d. 22. 1, long. 5 1 30 " à l’orient
de Milan, ou de 28 d 2 2 '2 0
Elle eft riche , agréable, dans une heureuSe fitua-
tion, & Ses environs font très-fertiles. On peut la
regarder, après Milan , comme la principale ville
de la Gaule Cifalpine : bâtie par Belovefe, chef des
Gaulois , elle étoit capitale des Cénomans, lorsqu’elle
paffa fous la domination des Romains, dont
elle devint colonie.
Elle fut brûlée par Radagaffe, roi des Goths en
412 , & prife par Attila en 451. Les rois Lombards
la pofféderent à leur tour. Charlemagne ayant défait
le roi Didier en 7 7 1 , entra à Brefcia, où il fît
bâtir Péglife de Saint Denis. En 1416, pour Se fouf-
traire aux vexations du duc de Milan, elle Se donna
à la république de Venife.
Gafton de Foix, général de Louis X I I , la prit le
19 Février 1512 Sur les Vénitiens, & l’abandonna au
pillage : la maifon oh logeoit le chevalier Bayard en
fut exceptée , & on fait avec quelle générofité il en
ufa envers Son hôreffe & Ses deux filles. En 1478 ,
cette ville éprouva une pefte affreufe qui enleva 25
mille perfonnes : celle de 1524 fut auflî terrible.
On voit dans la'cathédrale le bufte du Savant cardinal
Quirini, évêque de cette ville, pour avoir contribué
en 1737 9 à avancer le bâtiment de l’églife,
commencé en 1605 , & fini en 1770.
Nicolas Tartaglia de Breflè fut le premier qui découvrit
la formule qui réfout les équations du troi-
fieme dégré : Son livre imprimé en 1 538, ouvrit la
carrière à toutes les découvertes qu’on a faites en-
fuite fur le jet des bombes.
Laurent Gambara, bon p oète, mort en 1596, a
fait des poèmes fur Chriftophe Colomb, fur Venife,
fur Caprafole. Le comte Mazzucheli, mort en 1766,
eft l’auteur d’un Recueil immenfe de Biographie :
M. Chriftiani, ingénieur, a compofé un excellent
ouvrage furies mefures de tous les genres. La fignora
Camilla Fenarolieft la Sapho de Brefcia.. Voye£ le
Voyage cCun François en Italie, tome VIII. ( C. )
BRETESSÉ , ÉE, adj. ( terme de Blafon ) Se dit du
Sautoir, du pal, de la fafce, de la bande, du chevron,
qui ont des créneaux des deux côtés qui répondent
les uns aux autres.
Frifon de Blamont, en Champagne ; d'a^ur, au
fautoir breteffè d'or.
La Lande du L o u , de Tregoumains eu Bretagne ;
de gueules , d la fafce breteffée <£ argent. Voye^ la planche
I V , figure ic)4 de Blafon, dans le Dicl. raif des
Sciences, &c. ( G. D . L. T. )
BRETIGNI, ( Géogr. ). village de Plie de France
fur l’Orge près de Montlhery, non près de Chartres à
comme l’a dit le Prélïdent Hénault. C ’eft plutôt
Châtres, aujourd’hui Arpajon. Ce lieu eft connu par
le traité qui y fut conclu entre Edouard, roi d’Angleterre,
& Jean., roi de France, en 1360.
Ce traité commence ainfi : <* Comme par les
» guerres ,lont advenues batailles mortelles, occi-
» fions de gens, périls des âmes, déflorations de
» pucelles, deshoneftationsde femmes; Nous.... »
(C. )
BRIARÉE, ( Myth. ) géant, fils du ciel & de la
terre, avoit cent mains, & cinquante têtes , ce qui
le rendoit d’une force redoutable aux dieux mêmes.
Il eut part à la guerre des Titans, mais dans la fuite
il rendit un grand fervice à Jupiter ; Homere dit que
dans une conspiration que Junon, Minerve & Neptune
avoient formée contre le Souverain des dieux,
Briarée, le géant aux cent mains , monta au ciel à
Son Secours, à la priere de Thétis, & s’aflit auprès
du dieu , avec une contenance fi fiere & fi terrible,
que les dieux conjurés en étant épouvantés, renoncèrent
à leur entreprise. Une autre fois Briarée fut
pris pour arbitre dans un différend entre le Soleil
&c Neptune , au Sujet du territoire de Corinthe, &
adjugea l’ifthme à Neptune, & le promontoire au
Soleil. Briarée étoit un prince Titan, qui èomman-
doit un bon corps de troupes, & qui Savoir donner
d’utiles confeils. (+ )
* BRIE , f. f. ( Boulanger & Vermicelier. ) barre de
bois pour battre & brier la pâte dont on Tait les ver-
micels , les macaronis & d’autres pâtes d’Italie. On
s’en fervoit auffi autrefois pour brier la pâte du
pain de Goneffe. La brie a ordinairement dix à douze
pieds de longueur : elle eft plus groffe , & a un côté
tranchant à l’extrémité, par laquelle elle eft attachée
au pétrin.
* BRIER , v. a. Brier la pâte, en terme de Vermicelier
, c’eft la battre fortement avec une barre qu’on
nomme brie. Cette barre s’attache fur le pétrin par
Son plus gros bout : elle a un côté tranchant, & c’eft:
par ce côté qu’on brie la pâte. Le vermicelier eft
à moitié aflis fur l’autre extrémité de la brie , c’eft-
à-dire , qu’il a la cuiffe droite fur cette extrémité ,
qu’il tient aufli de la main droite, tandis qu’il frappe
preftement du pied gauche contre terre pour s’élever
avec la brie & lui donner le mouvement, ayant la
main gauche en l’air & en mouvement : la tête Suit
aufli ces mouvemens qui Se font en cadence. En
battant ainfi la pâte, elle vient fur le devant du pê-
trin, on la repouffe fous le tranchant de la b r ie ,
pour la rebattre, jufqu’à ce qu’elle Soit Suffisamment
écrafée & briée. -On donne ordinairement douze
tours de brie à la pâte des vermicels, macaronis ,
lazagnes, &c. en quatre reprifes, parce qu’à chaque
reprife on replie trois fois les bords de la pâte ; c’eft-
à-dire, qu’on replie chaque fois un des trois côtés
de la pâ te, le devant, puis un côté, puis l’autre ,
& à chaque fois on donne un tour de brie Sur toute
la pâte. L'Art du Vermicelier par M. Ma lo u in .
BRIGADIER , f. m. ( Hift. nat. Ichtkyolog. >
poiflbn des îles Moluques , très-bien gravé &c enluminé
fous ce n o m p a r C o y e tt , dans la première
partie de Son Recueil des poijfons d'Amboine, au
7 '- ' ‘ . * . * * 1 1 , ’
Il a le corps elliptique, médiocrement alonge ,’
aflez comprimé ouapplati par les côtés , la tête & les
yeux petits, la bouche médiocre, les dents grandes.
Ses nageoires font au nombre de Sept, Savoir, deux
ventrales, petites, placées fous le ventre, aflez loin
derrière les pédlorales qui font triangulaires, petites;
une dorfale, longue, plus baffe devant que derrière ;
une derrière l’anus longue , &c une à la queue qui eft
quarrée &c tronquée.
Il a le corps verd,, marqué par compartimens de
taches quarrées , noires, à centre blanc, le ventre &
la poitrine rouges, les côtés delà tête jaunes avec fix
rayons rouges autour des y e u x , les nageoires jaunes
à rayons noirs, & deux lignés rouges longitudinales
à celle de l’anus. La prunelle de Ses yeux eft
blanche , entourée d’un iris rouge cerclé de bleu. .
Moeurs. Le brigadier eft commun dans la mer
d’Amboine autour des rochers.
Remarques. Ce poiflbn forme, avec le voorn , un
genre particulier dans la famille des filures oh nous
l’avons placé, dans 1' Ichthyologie que nous Sommes
prêts à publier. ( M. A danson. )
§ BRIGNAIS, ( Géogr. ) Prifciniacum, bourg
(non ville , comme dit 1 e Dicl. raif. des Sciences, &c.
d’après la Martiniere ) entre Lyon & Saint-Cha-
mond. Il s’y livra une fanglante bataille en 1362, oh
périt Jacques de Bourbon, comte de la Marche, en
' voulant diflîper les grandes compagnies.(C.)
§ BRIGNOLES, Brinonia, .( Géogr. ) ville de
Provence à 6 lieues de Toulon , renommée par Ses
bons pruneaux*. C’eft la patrie de Jofeph Paroffel,
dit des Batailles, & du Savant pere le Brun de l’Oratoire.
Elle eft à 170, lieues de Paris. ( C. )
BRILLANT, adj. & f. m. ( Belles-Lettres. ) Il fe
dit de l’efprit, de l’imagination , du coloris, de la
penfée. On dit d’un efprit fécond en Saillies , en
traits ingénieux , dont la juftefle & la nouveauté
nous éblouit, qu’il eft brillant. Le brillant de l’imagination
confifte dans une foule d’images vives &c
imprévues qui Se Succèdent avec l’éclat & la rapi-,
dité des éclairs. L’abondance & la variété font le
Brillant du coloris.. Des idées qui jouent enfemble-
âvec juftefle & avec grâce , dont les rapports font
vivement faifis & vivement exprimés , font le brillant
de la penfée. Le ftyle eft brillant par la vivacité
des penfées, des images , des tours & des ex-
preflions. Le ftyle d’Ovide , celui de l’Ariofte eft-
brillant. Dans Homere, la description de la ceinture
de Vénus eft une .peinture brillante. Brillant ne fe
dit guere que des Sujets gracieux ou enjoués. Dans
les Sujets Sérieux & Sublimes, le -ftyle eft riche,
éclatant.- ( M. Marmontel. )
BR INEK, ( Ajtronomie. ) nom que les Arabes
donnent à la belle étoile de la lyre. ( M. d e l a
La n d e .')
BRINGARASI, f. m. ( Hifl. nat. Botanique. ) nom
Brame d’une plante du Malabar, aflez bien gravée,
quoique fans détails, par Van-Rheede, dans Son Hor-
tus Malabaricus , volume X . planche X L IL page 8 3,
fous Son nom Malabare pee cajenneam & pee cajoni.
J. Commelin, dans Ses notes fur cet ouvrage, l’appelle
chryfanthemi feu bellidis majoris fpecies.
C ’eft une plante annuelle qui s’élève fous la forme
d’un buiflon Sphérique: de deux pieds environ de diamètre
en tout Sens, ayant une touffe de racines blanches,
fibreufes de trois pouces de longueur Sur une
ligne de diamètre, d’oh Sortent quatre ou cinq branches
cylindriques de deux à trois lignes de diamètre,
rougeâtres, Semées de quelques poils rudes, ramifiées
de quelques branches alternes ouvertes fous
un angle de quarante-cinq dégrés.
Les feuilles font oppofees deux à deux en cro ix,
à des diftances de deux à trois pouces, elliptiques ,
pointues longues de deux pouces, une fois &c demie
à deux fois moins larges, épaifles, entières, ou légèrement
ondées ôc rarement crénelées Sur leurs bords,,
verd-brunes, Semées de poils courts, durs, qui leur
donnent de la rudefle, relevées en-deffous: d’une
cote longitudinale Ramifiée en quatre ou cinq paires
de nervures alternes, & attachées fans pédicule aux
tiges, autour defquelles elles Semblent fe réunir pour
former une gaîne en s’écartant Sous un angle de 45
dégrés d’ouverture.
. Les fleurs Sortent Solitairement & alternativement.
de l’aiflelle des feuilles Supérieures, portées Sous un
angle de quarante-cinq dégrés fur un pédicule cylindrique
une fois plus long que ces feuilles. Elles Sont
raflemblées au, nombre de 50 à 60 dans*un calice
commun, fous la forme d’une tête Sphérique , dont
le centre contient environ 50 fleurons hermaphrodites,
& le rayon 12 et 15 demi-fleurons femelles
qui s’épanouiflent pour former une fleur en tête
jaune de près d’un pouce de diamètre. Tous ces
fleurons &: demi-fleurons font portés , chacun fur un
" ovaire.
L’enveloppe ou calice commun qui contient les
demi-fleurons & les fleurons, confifte en cinq à dix
feuilles inégales conniventes, rapprochées fur un
rang, vertes, triangulaires, une fois plus longues
que larges, perfiftentes. Les fleurons font monopétales
à cinq divifions régulières, & contiennent cinq
étamines courtes réunies par leurs anthères, un ftyle
cylindrique terminé par deux ftigmates demi-cylindriques
, recourbés en-deffous en crochets & ve-?
loutés en-deffus. Les demi-fleurons reffemblent par
leurs bords à une languette jaune dentée de deux à
trois dents, à tube très-court, fans étamines, mais
à un ftyle couronné de deux ftigmates.
L’ovaire qui eft au-deffous de chaque fleur, eft
o voïde, blanc , un peu applati fur le ventre, con-
. vexe vers le dos , plus renflé à Son Sommet qui eft
un peu courbe & fort petit, fans aucun calice particulier,
enveloppé d’une écaille qui s’élève comme
lui du fond du réceptacle commun qui eft hémisphérique
, applap ou déprimé. Ces ovaires en mûriffant
deviennent chacun une graine ovoïde, longue de
deux lignes, une fois moins large, applatie d’un
cô té, convexe ou relevée d’un angle aigu de l’autre,
plus groffe à Son extrémité qui eft renflée, verd-
brune d’abord, enfuite cendrée, relevée de chaque
côté d’une nervure droite purpurine.
Culture. Le bringarafi croît au Malabar dans les
terres. humides voifines du bord des étangs & des
rivières. 11 fleurit en é té , c’eft-à-dire, pendant la
faifon des pluies.
Qualités. Cette plante a une faveur légèrement
âcrë & amere.
Ufages. Son Suc cuit avec un peu de rouille de
fer & d’urine de vache croupie ou macérée Se donne
intérieurement pour l’hydropifie. On en frotte la
tête pour faire croître les cheveux. Ses feuilles cuites
avec de l’huile nouvelle de palmier, s’appliquent en
cataplafme fur la tète pour appaifer la migraine.
Remarques. Sx J. .Commelin eut fait attention
aux écailles longues qui Séparent & enveloppent
chaque graine du bringarafi, il n’eût pas comparé
cette plante, ni au bellis major qui eft le- leucanthe-
mum de Diofcoride, ni au chryfanthemum du même
Diofcoride qui en eft une efpece; mais- il l’eût reconnu
pour une efpece de l’amali qui forme un genre
particulier dans la famille des compofés, feftion 10e
des. bidens oh nous l’avons placé. Voye1 nos Familles
des plantes , volume II. page 130. ( M. A d a n s o n .)
BRIONE , non Br io n n e , ( Géogr. ) bourg de
Normandie fur la Rille, à l’extrémité du Vexin: ce
bourg, dès le commencement du x i . fiecle, étoit
décoré du titre de comté : le roi a établi, en. faveur
de Henri de Lorraine, comte d’Harcourt, trois
foires:par an, de trois jours chaçune, au x ii. fiecle.
Il y avoit trois églifes : il n’en refte plus que celle de
S. Martin, ancienne léprofie de S. Michel unie aux
Bénédi&ines en 16,42. Il fe tint à Brione, vers 1040,
une célébré conférence entre les plus habiles gens de
la province & le fameux Beranger, en préfence du
duc Guillaume ; Beranger y fut réfuté, réduit au
Silence & contraint de s’enfuir de Normandie. Son
héréfie fut caufe qu’on introduifit dans l’églife la
coutume de l ’élévation de la Sainte hoftie & du calice