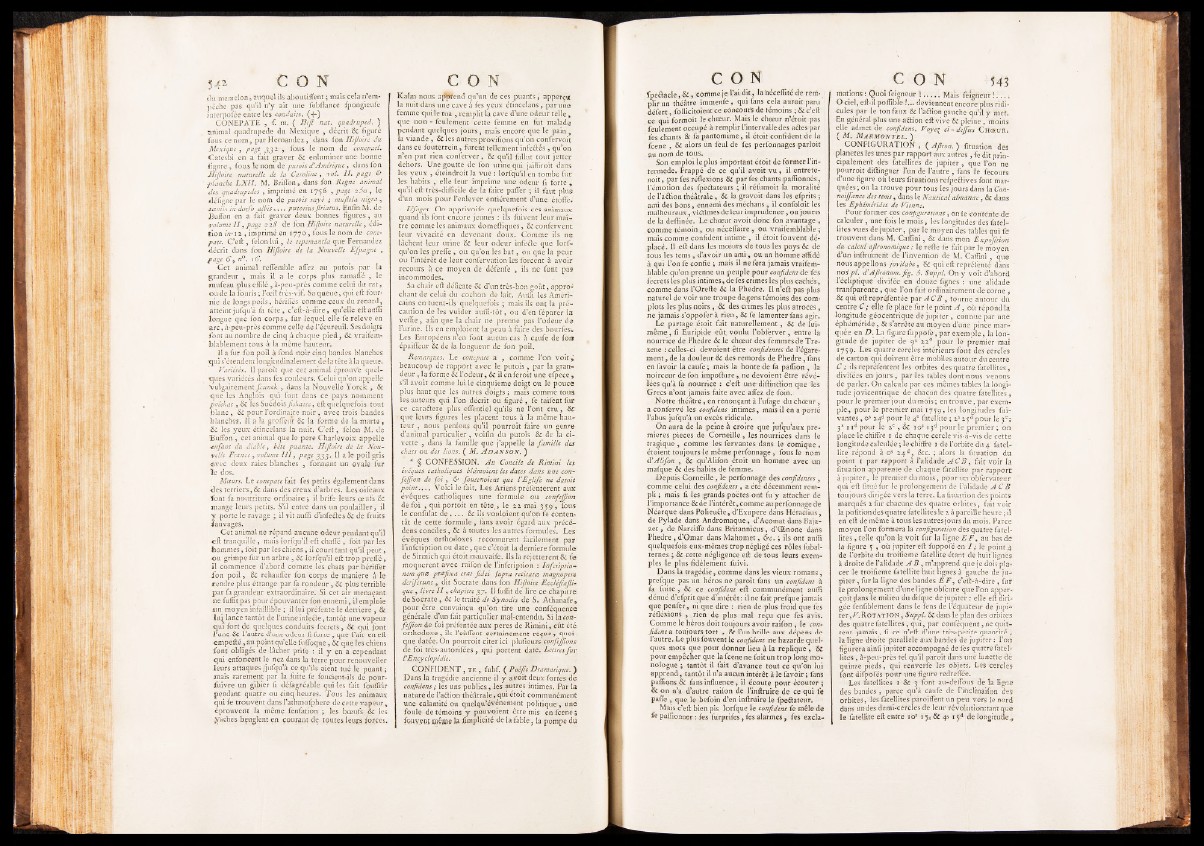
I
5 4 2 C O N
du mamelon, auquel ils aboutiflent ; mais cela n’empêche
pas qu’il n’y ait uiie fubftance fpongieule
interpolée entre les conduits. (+ )
CONEPATE , f. m. ( Hijl nat. quadruped. )
unimal quadrupède du Mexique , décrit & figuré
fous ce nom, par Hernandez, dans fon Hijloire da
Mexique , page 332."-, fous le nom de conepatl.
Catesbi en a fait graver & enluminer une bonne
figure, fous le nom de putois tfAmérique , dans fon
Hijloire naturelle de la Caroline , vol. II. page &
planche LXH. M. Briflbn, dans fon Régné animal
des quadrupèdes , imprimé en 17-56 , page 2S0, le
défigne par le nom de putois raye ; mufiela nigra,
toenîis in dorfo a Ibis,. . . putoriusfiriatus. Enfin M. de
JBuffon en a fait graver deux bonnes figures, au
volume I I , page 2.2.8 de fon Hijloire naturelle, édition
in-12 , imprimé en 1770 , lous le nom de cone-
pate. C’eft , félon lu i, le tepemantla que Fernandez
décrit dans fon Hijloire de la Nouvelle Efpagne ,
page 6', n°. iC.
Cet animal reffemble affez au putois par la
grandeur , mais il a le corps plus ramaffé , le
rnufeau plus effilé , à-peu-près comme celui du rat,
ou de la fouris; l’oeil très-vif. Sa queue, qui eft fournie
de longs poils, hériflès comme ceux du renard,
atteint jufqu’à fa tête, c’eft-à-dire, qu’elle eft auffi
longue que fpn corps , fur lequel elle fe releve en
■ arc, à-peu-près comme celle de l’écureuil. Ses doigts
font au nombre de cinq à chaque pied, ôt vraifem-
blablement tous à la même hauteur*
Il a fur fon poil à fond noir cinq bandes blanches
tjui s’étendent longitudinalement de la tête à la queue*
Variétés. Il paroît que cet animal éprouvé quelques
variétés dans fes couleurs. Celui qu’on appelle
vulgairement fcunck , dans la Nouvelle Yorck , &
que les Anglois qui font dans ce pays nomment
polekat, & les Suédois fiskatte, eft quelquefois tout
blanc, & pour l’ordinaire noir , avec trois bandes
blanches. Il a la grofTeur & la forme de la m arte,
& les yeux étincelans la nuit. C ’e f t , félon M. de
TufFon , cet animal que le pere Charlevoix appelle
•enfant du diable, bête puante. Hijloire de la Nouvelle
France , volume I I I , page 333. Il a le poil gris
-avec deux raies blanches , formant un ovale fur
l e dos.
Moeurs. Le conepate fait fes petits également dans
des terriers, & dans des creux d’arbres. Les oifeaux
font fa nourriture ordinaire ; il brife leurs oeufs &
mange leurs petits. S’il entre dans un poulailler, il
y porte le rayage ; il vit suffi d’infecles & de fruits
iauvages.
Cet animal ne répand aucune odeur pendant qu’il
eft tranquille, mais lorfqu’il eft chafte , foit par les
hommes, foit par les chiens, il court tant qu’il p eut,
ou grimpe fur un arbre , & lorfqu’il eft trop prefle,
il commence d’abord comme les chats par hérifîer
fon p o il, & rehauffer fon corps de maniéré à le
rendre plus étrange par fa rondeur, & plus terrible
par fa grandeur extraordinaire. Si cet air menaçant
ne fuffit pas pour épouvanter fon ennemi, il emploie
jun moyen infaillible ; il lui préfente le derrière , &
lui lance tantôt de l’urine infeéle, tantôt une vapeur
qui fort de quelques conduits fecrets , & qui font
l’une & l ’autre d’une odeur fi forte , que l’air en eft
empefté, au point qu’elle fuffoque , & que les chiens
font obligés de lâcher prife : il y en a cependant
qui enfoncent le nez dans la terre pour renouveller
leurs attaques jjufqu’à ce qu’ils aient tué le puant ;
mais rarement par la fuite fe foucient-ils de pour-
fuivre un gibier fi défagréable qui les fait fouffrir
pendant quatre ou cinq heures. Tous les animaux
qui fe trouvent dans l’athmofphere de cette vapeur,
éprouvent la même fenfation ; les boeufs & les
{vaches beuglent en çourant de tenues leurs forces.
C O N
Kalm nous a t te n d qu’un de ces puants \ apperçu
la nuit dans une cave à fes yeux étincelans, par une
femme qui le tua , remplit la cave d’une odeur telle ,
que non - feulement cette femme en fut malade
pendant quelques jours, mais encore que le pain ,
la viande , & les autres provifions qu’on confervoit
dans ce fouterrein, furent tellement infe&és , qu’on
n’en put rien conferver, & qu’il fallut tout jetter
dehors. Une goutte de fon urine qui jailliroit dans
les yeux , éteindroit la vue : lorfqu’il en tombe fur,
les habits , elle leur imprime une odeur fi forte ,
qu’il eft très-difficile de la faire pafl'er ; il faut plus
d’un mois pour l’enlever entièrement d’une étoffe*
Ufages. On apprivoife quelquefois ces animaux
quand ils font encore jeunes : ils fuivent leur maître
comme les animaux domeftiques, &: confervent
leur vivacité en devenant doux. Comme ils ne
lâchent leur urine & leur odeur infefre que lorf-
qu’on les prefle, ou qu’on les b a t , ou que la peur
ou l’intérêt de leur confervation les forcent à avoir
recours à ce moyen de défenfe > ils ne font pas
incommodes..
Sa chair eft délicate & d’un très-bon goût, appro^
chant de celui du cochon de lait. Auffi les Américains
en tuent-ils quelquefois ; mais ils ont la précaution
de les vuider àuffi-tôt, ou d’en féparer la
veffie, afin que la chair ne prenne pas l’odeur dé
l’iirine. Ils en emploient la peau à faire des bourfesv
Les Européens n’en font aucun cas à caufe de fou
épaifleur & de la longueur de fon poil.
Remarques. Le conepate a , comme l’on voit*
beaucoup de rapport avec le putois, par la grandeur
, la forme & l’odeur, & il enferoit une efpece,
s’il avoir comme lui le cinquième doigt ou le pouce
plus haut que les autres doigts ; mais comme tous
les auteurs qui l ’on décrit ou figuré , fe taifent fur
ce caraftere plus eflëntiel qu’ils ne l’ont c ru , 8t
• que leurs figures les placent tous à la même hauteur
, nous penfons qu’il pourroit faire un genre
d’animal particulier, voifin du putois & de la civette
, dans la famille que j’appelle la famille des
chats ou des lionSi ( M. A d AN SON. )
* § CONFESSION. Au Concile de Ritnini les
évêques catholiques blâmoieht les dates dans une con-
fejfion de foi , & foutenoient que VEglife ne datoit
point.... Voici le fait. Les Ariens préfentêrent aux
évêques catholiques une formule ou confejjîon
de foi , qui portoit en tête,, le 22 mai 359 , fous
le confulat de . . . . & ils vouloient qu’on fe contentât
de cette formule, fans avoir égard aux précé-
dens conciles, & à toutes les autres formules. Les
évêques orthodoxes reconnurent facilement par
l'infeription ou date, que c’étoit la derniere formule
de Sirmich qui étoit mauvaife. Ils la rejetterent& fe
moquèrent avec raifon de l’infeription : Infcriptio-
nem quee proefixa crat fidei fupra recitatoe magnopere
deriferunt, dit Socrate dans fon Hijloire Eccléjîajli-
que , livre I I , chapitre^y. Il fuffit de lire ce chapitre
de Socrate , & le traité de Synodis de S. Athanafe»
pour être convaincu qu’on tire une conféquence
générale d’un fait particulier mal-entendu. Si la confejjîon
de foi préfentée aux peres de Rimini, eût été
i orthodoxe , ils l’eûflent certainement reçue, quoique
datée. On pourroit citer ici plufieurs confejjîons
de foi très-autorifées, qui portent date. Lettres fur
P Encyclopédie.
CONFIDENT , te , fubf. ( Foéjie Dramatique. )
Dans la tragédie ancienne il y avoit deux fortes de
confidens ; les uns publics, les autres intimes. Par la
nature de l’aôion théâtrale, qui étoit communément
une calamité ou quelqu’évenement politique , une
foule de témoins, y pouvoient être mis en feene;
fouvenî iflêjne la fimpücité de la fable, la pompe du
C O N
îpe&acle, & , comme je l’ai dit , la néceffite de reni- ■
plir un théâtre immenfe, qui fans cela auroit paru’
défert, follicitoient ce concours de témoins ; & c’eft
ce qui formoit le choeur. Mais le choeur n’étoit pas
feulement occupé à remplir l’intervalle des a&es par
fes chants & fa pantomime, il étoit confident de la
feene , & alors un feul de fes perfonnages partait
. au nom de tous.
Son emploi le plus important étoit de former l’iri-
termede. Frappé de ce qu’il avoit v u , il entrete-
noit, par fes réflexions & par fes chants paffionnés,
l’émotion des fpèdlateurs ; il réfumoit la moralité
de l’aftion théâtrale, & la gravoit dans les efprits ;
ami des bons , ennemi des médians , il confoloit les
malheureux , viâimes de leur imprudence, ou jouets
de la deftinée. Le choeur avoit donc fon avantage ,
comme témoin, ou néceflaire, ou vraifemblable ;
mais comme confident intime , il étoit fouvent déplacé.
Il eft dans les mcéurs de tous les pays & de
tous les tems , d’avoir un ami, ou un homme affidé
à qui l’on fe confie ; mais il ne fera jamais vraifemblable
qu’on prenne un peuple pour confident de fes
fecrets les plus intimes, de fes crimes les plus cachés,
comme dans l’Orefte & la Phedre. Il n’eft pas plus
naturel de voir une troupe de,genstémoins des complots
les plus noirs , & des crimes les plus atroces,
ne jamais s ’oppofer à rien , & fe lamenter fans agir.
Le partage étoit fait naturellement, & de lui-
même , fi Euripide eût. voulu l’obferver, entre la
nourrice de. Phedre & le choeur des femmesde Tre-
zene : celles-ci dévoient être conjidentes de l’égarement
, de la douleur & des remords de Phedre, fans
en favoir la caufe ; mais la honte de fa paffion , la
noirceur de fon. impofture,. ne dévoient être révélées
qu’à fa nourrice : c’eft une diftinttion que lés
Grecs n’ont jamais faite avec aflez de foin.-
Notre théâtre, en renonçant à l’ufage du choeur ,
a conlervé les confidens intimes , mais il en a porté
l’abus jufqu’à un excès ridicule.
On aura de la peine à croire que jufqu’aux premières
pièces de Corneille, les nourrices dans le
tragique , comme les fervântes dans le comique ,
étoient toujours le même perfonnage, fous le nom
d'Alifon , & qu’Alifon étoit un homme avec un
mafque & des habits de femme.
Depuis Corneille, le perfonnage des confidentes ,
comme celui des confidents , a été décemment rempli
; mais fi les grands poètes ont fu y attacher de
l’importance & d e l’intérêt, comme au perfonnage de
Néarque dans Polieuâe, d’Exupere dans Héraêlius,
de Pylade dans Andromaque, d’Acomat dans Baja-
z e t , de Narciflè dans Britannicus, d’CEnone dans
Phedre , d’Omar dans Mahomet , 6 *c. ; ils ont auffi
quelquefois eux-mêmes trop négligé ces rôles fubal-
ternes ; & cette négligence eft de tous leurs exemples
le plus fidèlement fuivi.
Dans la tragédie, comme dans les vieux romans,
prefque pas un héros ne paroît fans un confident à
fa fu ite, & ce confident eft communément auffi
dénué d’efprit que d’intérêt: il ne fait prefque jamais
que penfer, ni que dire : rien de plus froid que fes
réfléxions , rien de plus mal reçu que fes avis*
Comme le héros doit toujours avoir raifoh , le confidents
toujours tort , & l’un brille aux dépens de
l’autre. Le plus fouvent le confident ne hazarde quelques
mots que pour donner lieu à la répliqué , &
pour empêcher que la feene ne foit un trop long monologue
; tantôt il fait d’avance tout ce qu’on lui
apprend, tantôt il n’a aucun intérêt à le favoir ; fans
pallions & fans influence, il écoute pour écouter ;
& on n’a d’autre railon de l’inftruire de ce qui fé
pafîe , que le befoin d’en inftrüire le fpeétateur.
Mais c’eft bien pis lorfque le confident fe mêle de
fe paffionner : fes furprifes, fes alarmes, fes excla-
C O N 543
mations : Quoi feignèur ! , . . . . Mais feigneiir ! . . . *
O ciel, eft-il poffible !... deviennent encore plus ridicules
par le ton faux & l’aftion gauche qu’il y met.
En général plus une aâion eft vive & pleine, moins
elle admet de confidens. Vcye{ ci - deffus CHOEUR;
( M. M a Am o n t e l . )
CONFIGURATION , ( Afiron. ) fituation des
planètes les unes par rapport aux autres , fe dit principalement
des fatellités de jupiter, que l’on ne
pourroit diftinguer l’un de l’autre , fans le fecours
d’une figure oii leurs fituations refpeélives font marquées;
on la trouve pour tous les jours dans la Con-
noijfance des terris, dans le NaUtical almanac, & dans
les Ephémérides de Vienne»
Pour former ces configurations, on fe contente dé
calculer , une fois le mois , les longitudes des f a i l lites
vues de jupiter, par le moyen des tables qui fë
trouvent dans M. Caffini, & dans mon Expofitiori
du calcul afironomique : le refte fe fait par le moyen .
d’un infiniment de l’invention de M. Caffini , que
nous appelions jovilabe, & qui eft représenté dans
nos1/»/, d'Afironom. fig. 5. Suppl. On y voit d’abord
l’écliptique divifée en douze fignes : une alidadé
tranfparente , que l’on fait ordinairement de corne ,
& qui eft représentée par A C B , tourné autour du
centre C ; elle fe place fur le point A , oh répond la
longitude géocentrique de jupiter , connue par une
éphéméride, & s’arrête au moyen d’une pince marquée
en D . La figure fuppofë, par exemple, la longitude
de jupiter de 9* 22° pour le premier mai
1759. Lés quatre cercles intérieurs font des cercles
de carton qui doivent être mobiles autour du centre
C ; ils repréfentent les orbites des quatre fatellites,
divifées en jours , par les tables, dont nous venons
de parler. On calcule par ces mêmes tables la longitude
jovicentrique de chacun des quatre fatellites,
pour le premier jour du mois ; en trouve, par exemple,
pour le premier mai 1759, les longitudes fui-
vantes, os 24d pour le 4e fatellite ; 2S 25d pour le 3e;
3S 1 i d pour le 2e , & io s 1 }d pour le premier ; on
place le chiffre 1 de chaque cercle vis-à-vis de cette
longitude calculée ; le chiffre 1 de l’orbite du 4 fatellite
répond à os 24d, &c. ; alors la fituation da
point 1 par rapport à l’alidade A C B , fait voir la
fituation apparente de chaque fatellite par rapport
à jupiter, le premier du mois, pour un obfervateur
qui eft fituéfur le prolongement de l’alidade A C B
toujours dirigée vers la terre. La fituation des points
marqués 2 fur chacune des quatre orbites, fait voir
. la pofition des quatre fatellites le 2 à pareille heure ; il
en eft de même à tous les autres jours du mois. Parce
moyen l’on formera la configuration fe s quatre fatellites
, telle qu’on la voit fur la ligne E F , au bas de
la figure 5 , où jupiter eft fuppofé en I ; le point 4
de l’orbite du troifieme fatellite étant de huit lignés
à droite de l’alidade A B , m’apprend que je dois placer
le troifieme fatellite huit lignes à gauche de jupiter
, fur la ligne des bandes E F , c’éft-à-dire , fiif
le prolongement d’uneltgne obfcure que l’on apperçoit
dans lé milieu dudifque de jupiter : elle eft diri gée
fenfiblement dans le fens de l’équateur de jupiter,
V. Rotation , Suppl. & dans le plan des orbites
des quatre fatellites , qui, par conféquent, rie quittent
jamais, fi ce n’eft d’une très-petite qnantité ,
la ligne droite parallèle aux bandes de jupiter : l’oiï
figurera âinfi jupiter accompagné de fes qua tre fâtël-
lite s, à-peu-près tel qu’il paroît dans unè lunette dé
quinze pieds, qui renvdrfe les Objets. Les cercles
font difpofés pour une figure redfeflee.
Les fatellites 1 & 3 font au-deffous de la ligné
des bandes , parce qu’à caufe de l’inclinaifon des
orbites, les fatellites paroiflent un peu x^ers le nord
dans un dès demi-cèrCles de leur révolutionnant que
lé fatéllite eft entre io s i )s & 4s 15d f e longitude