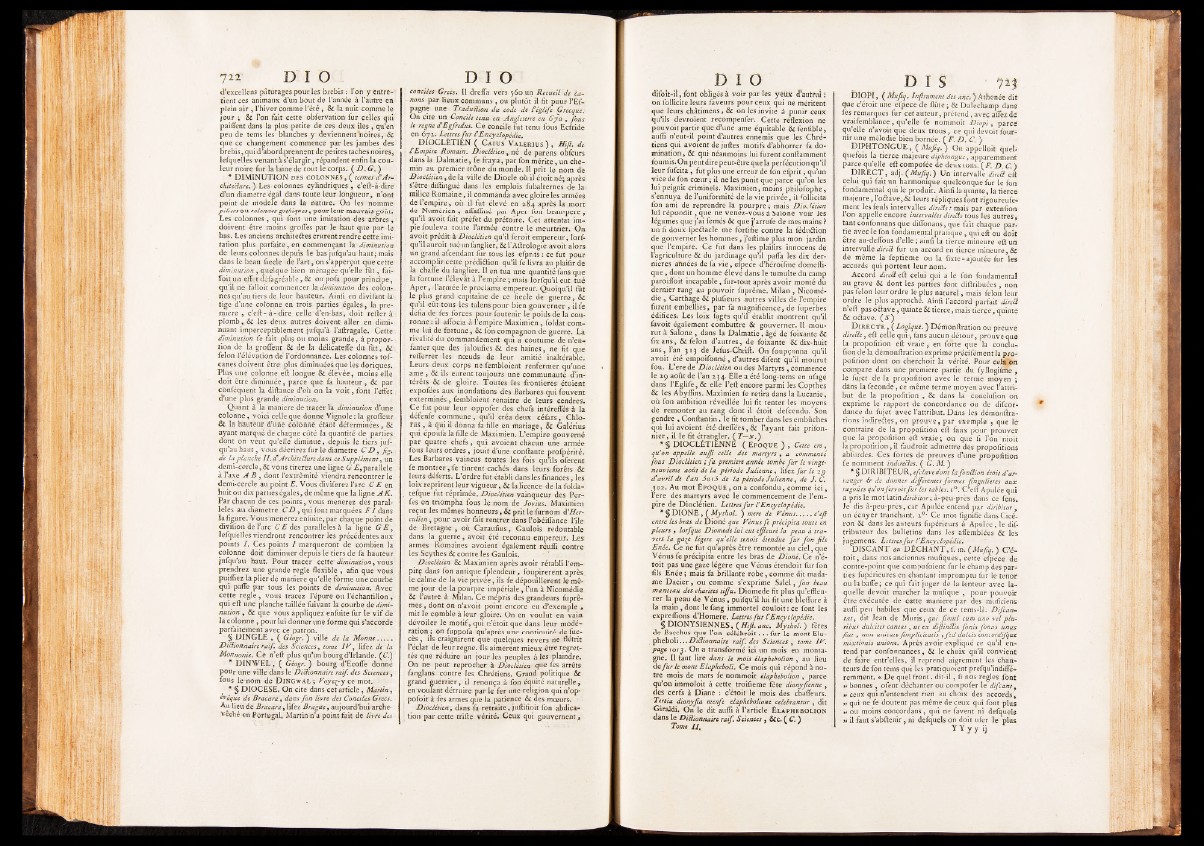
î î f ï r f
d’excellens pâturages pour les'brebis : l’on y entretient
ces animaux d’un bout de l’année à l’autre en
plein air , l’hiver comme l’été , &C la nuit co/nme le
jour ; & l’on fait cette obfervation fur celles qui
paiffent dans la plus petite de ces deux île s , qu’en
peu de tems les blanches y de viennent 1hoires,&
que ce changement commence par les jambes des-
brebis,qui d’abordiprennent de petites taches noires,
lefquelles;venant à s’élargir, répandent enfin la couleur
noire fur la laine de tout le corps. ( D . G . )
* DIMINUTION des colonnes, ( termes d'Architecture,
f Les-colonnes cylindriques, c’ eft-à-dire
d’un diamètre-égal dans toute leur longueur, n’ont
point de modèle dans la nature; On les nomme
piliers ou colonnes gothiques, pour leur mauvais go'ût.
Les colonnes, qui font une imitation des arbres,
doivent être moins groffes par le-haut que par le
bas. Les anciens archite&es crurent rendre cette,imitation
plus parfaite, en commençant la' diminution
de leurs.colonneS depuis le bas jufqu’au haut; mais
dans le beau liec-le de l’art, on s’apperçut que cette
diminution, quelque bien ménagée qu’elle fu t , fai-
ïoit un effet défagréable, & on'pofa pour principe,
qu’il ne falloit commencer la diminution des colon-.
nés qu’au, tjers de leur hauteur. Ainfi en divifant lâ\
tige d’une colonne en trois parties égales, la première
, c’eft- à - dire celle d’en-bas, doit refter à :
plomb , & les deux autres doivent; aller en d im inuant
imperceptiblement jufqu’à l’aftragale. Cette
diminution fe fait plus ou moins grande, à proportion
de la groffeur & de la déliçateffe du fût, &
félon l’élévation dé l’ordonnance. Les colonnes tof-
canes doivent être plus diminuée^ que les doriques.
Plus une colomie eft longue & élevée, moins elle
doit être diminuée, parce que fa hauteur, & par
conféquent la diftance d’où on la v o i t , font l’effet
d’une plus grande diminution.
Quant à la maniéré de tracer la diminution d’une
colonne, voici celle que donne Vignole : la groffeur
Sc la hauteur d’une colonne étant déterminées, &
ayant marqué de chaque côté la quantité de parties
dont on veut qu’elle diminue, depuis le tiers jufqu’au
haut, vous décrirez fur le diamètre C D , fig. ,
de la planche II. ^Architecture dans ce Supplément, un
demi-cercle,& vous tirerez une ligne G E ,parallèle
à l’axe A B , dont l’extrémité viendra rencontrer le
demi-cercle au point E. Vous diviferez l’arc C E en
huit ou dix parties égales, de même que la ligne A K .
Par chacun de ces points, vous mènerez des parallèles
au diamètre C D , qui font marquées F I dans
la figure. Vousmenerez enfuite,par chaque point de
divifion de l’arc C E des parallèles à la ligne G E ,
lefquelles viendront rencontrer les précédentes aux
points I . Ces points 1 marqueront de combien la
colonne doit diminuer depuis le tiers de fa hauteur
jufqu’au haut. Pour tracer cette- diminution, vous
prendrez une grande réglé flexible , afin que vous
puifliez la plier de maniéré qu’elle forme une courbe
qui paffe par tous les points de diminution. Avec
cette réglé , vous tracez l’épure ou l’échantillon ,
qui eft une planche taillée fuivant la courbe de diminution
, &c que vous appliquez enfuite fur le v i f de
la colonne , pour lui donner une forme qui s’accorde
parfaitement avec ce patron.
' § DINGLE , ( Géogr. ) ville de la Monne. . . . .
Dictionnaire raif . des Sciences, tome II' , lifez de ' la
Monnonie. Ce n’eft plus qu’ün bourg d’Irlande. (C.)
* D INW E L , ( Géogr. ) bourg d’Ecoffe donné
pour une-ville dans le Dictionnaire raif. des Sciences,
fous le-nom de D ingwal ; Voyeç- y ce mot.
* § DIOCESE. On cite dans cet article, Martin ,
tvêque de Bracara, dans fon livre des Conciles Grecs.
Au lieu de Brdçàra, lifez Brague, aujourd’hui archevêché
en Portugal. Martin n’a- point fait de livre des
conciles Grecs. Il dreffa vers 560 un Recueil de ca-
- nous par lieux communs , ou plutôt il fit pour l’Ef-
pagne une Traduction du code de Céglife Grecque.
On cite un Concile tenu en Angleterre en 6yo , fous
le régné d'Egfredus. Ce concile fut tenu fous Ecfride
en 672. Lettres fur C Encyclopédie.
DIOCLÉTIEN ( Caius Valerius ) , Hift. de
IEmpire Romain. Dioclétien, né de parens obfcurs
dans la Dalmatie, fe fraya, par fon mérite, un chemin
au premier trône du monde. Il prit le nom de
Dioclétien, de la ville de Diod e oîi il étoit né; après
s’têtre diftingué dans les emplois fubalternes de la-
milice Romaine, il commanda avec gloire les armées
de l’empire, où il fut élevé en 284 après la mort
de Numérien , affafliné par Aper fon beau-pere,
qu’il avoit fait préfet du prétoire. Cet attentat impie
fouleva toute l’armée contre le meurtrier. On
avoit prédit.à Dioclétien qu’il feroit empereur, lorsqu'il
auroit tuéunfanglier, & l ’Aftrologie avoit alors
un grand âfeendant fur tous les efprits : ce fut pour
accomplir>cette prédidion qu’il fe livra au plaifir de
la chaffe du Sanglier. Il en tua une quantité fans que
la fqrtune l’élevât à-l’empire ; mais lorfqu’il eut tué
A p e r ,.l’armée le proclama empereur. Quoiqu’il fût
le. plus grand capitaine de ce fiecle de guerre, &
qu’il eurtous les talenspour bien gouverner , ilfe
défia de fes forces pour Soutenir le poids dé la couronne.:
il affociaà l’empire Maximien, Soldat comme
lui de fortune, & Son compagnon de guerre. La
rivalité du-commandement qui a coutume de n’enfanter
qùe des jaloufies & des haines, ne fit que
refferrer les- noeuds de leur amitié inaltérable.
Leurs deux corps ne fembloient renfermer qu’une
ame, & ils eurent toujours, une communauté d’intérêts
& de gloire. Toutes les frontières étoient
expofées aux inondations des Barbares qui fouvent
exterminés, fembloient renaître de leurs cendres.
Ce fut pour leur oppofer des chefs intéreffés à la
défenfe commune, qu’il créa deux céfars, Chlo-
rus , à qui il donna fa fille en mariage, & Galérius
qui epoufa la fille de Maximien. L’empire gouverné
par quatre chefs, qui a voient chacun une armée
fous leurs ordres, jouit d’une confiante profpérité.
Les Barbares vaincus toutes les fois qu’ils oferent
fe montrer , f e tinrent cachés-dans leurs forêts &
leurs déferts. L’ordre fut. établi dans les finances, les
loix reprirent leur vigueur, & la licence de la folda-
tefque fut réprimée. Dioclétien vainqueur des Per-
fes en triompha fous le nom de Jovius. Maximien
reçut les mêmes honneurs, ôc prit le furnom d'Her-
culien -, pour avoir fait rentrer dans Pobéiffance Pile
de Bretagne , où Caraufius, Gaulois redoutable
dans la guerre, avoit été reconnu empereur. Les
armes Romaines avoient également réufli contre
les Scythes & contre les Gaulois.
Dioclétien & Maximien après avoir rétabli l’em-
pirp dans fon antique fplendeur, foupirerent après
le calme de la vie privée, ils fe dépouillèrent le même
jour de la pourpre impériale, l’un à Nicomédie
& l’autre à Milan. Ce mépris des grandeurs fuprê-
mes, dont on n’avoit point encore eu d’exemple ,
mit le comble à leur gloire. On en voulut en vain
dévoiler le motif, qui n’étoit que dans leur modération
; on fuppofa qu’après une continuité de fuc-
cès, ils craignirent que quelques revers, ne flétrit
l’éclat de leur régné. Ils aimèrent mieux être regrettés
que réduire iin jour les peuples à les plaindre.
On ne peut reprocher à Dioclétien que les arrêts
fanglans- contre les Chrétiens. Grand politique &
grand guerrier, il renonça à fon équité naturelle ,
en voulant détruire par le fer une-religion qui n’op-
pofoirà fes armes que la patience & des moeurs.
Dioclétien’, dans fa retraite, juftifioit fon abdication
par cette trifte vérité. Ceux qui gouvernent,
dîfolt-il, font obligés à voir par les ÿéüx cPautruî î
On follicite leurs faveurs pour ceux qui ne méritent
que leurs châtimens, & on les invité à punir ceux
qu’ils devroient recompenfer* Cette réflexion rte
pouvoit partir que d’une ame équitable & feniible *
auflï n’eut-il point d’autres ennemis que les Chrétiens
qui avoient de juftes motifs d’abhorrer fa domination
, & qui néanmoins lui furent conftamment
fournis. On peut dire peut-être que la perfécution qu’il
leur fufeita, fut plus une erreur de fon efprit $ qu’un
vice de fon coeur ; il ne les punit que parce qu’on les
lui peignit criminels. Maxiniien, moins pùilofophe ,
s ennuya de l’uniformité de la vie privée, ilSollicita
fon ami de reprendre la pourpre ; mais Dioclétien
lui répondit, que ne venez-vous à Salone voir les
légumes que j’ai femés & que j’arrofe de mes mains ?
un fi doux fpeâacle me fortifie contre la féduftion
de gouverner les hommes, j’eftime plus mon jardin
que l’empire* Ce fut dans les plaifirs innoeens de
l’agriculture & du jardinage qu’il paffa les dix dernières
années de fa v ie , elpece d’héroïfme domefti-
que, dont un homme élevé dans le tumulte du camp
paroiffoit incapable, fur-tout après avoir monté du
dernier rang au pouvoir fuprême. Milan , Nicomédie
, Carthage & plufieurs autres villes de l’empire
furent embellies, par fa magnificence, de luperbes
édifices; Les loix fages qu’il établit montrent qu’il
lavoit également combattre & gouverner. Il mourut
à Salorté , dans la Dalmatie, âgé de foixante &
fix ans, & félon d’autres, de foixante & dix-huit
ans, l’an 313 de Jefus-Chrift. On foupçonha qu’il
avoit été empoifonné, d’autres difent qu’il mourut
fou. L’erede Dioclétien ou des Martyrs »commence
le 29 août de l’an 234. Elle a été long-tems en ufage
dans l’Eglife, & elle l’eft encore parmi les Copthes
& les Abyflins. Maximien fe retira dans la Lucanie,
où fon ambition réveillée lui fit tenter les moyens
de remonter au rang dont il étoit defeendu. Son
gendre , Conftantin, le fit tomber dans les embûches
qui lui avoient été dreffées, & l’ayant fait prifon-
nier, il le fit étrangler. ( T—tr.')
* § DIOCLÉTIENNE ( Epoque ) , Cette ere,
qu'on appelle aufji celle des martyrs , a commencé
fous Diàclétien ,• fa première année tombe fur le vingt-
neuvieme août de la période Julienne, lifez fur le 2$
d!avril de Üan Soi S de la période Julienne, de J. C.
302. Au mot Épo q u e , on a confondu, comme ic i,
l’ere des martyrs avec le commencement de l’empire
de Dioclétien* Lettres fur C Encyclopédie.
*§DIONÉ,(iWyrAo/. ) mere de Vénus. . . . . c'ejt
entre les bras de Dioné que Vénus fe précipita toute en
pleurs , lorfque Diomede lui eut effleuré la peau à travers
la gaçe légère qu'elle tenoit étendue fur fon fils
Enée. Ce ne fut qu’après être remontée au ciel, que
Vénus fe précipita entre les bras de Dioné. Ce n’étoit
pas une gaze légère que Vénus étendoit fur fon
fils Enée ; mais fa brillante robe, comme dit madame
Dacier, ou comme s’exprime Salel, fon beau
manteau des charités tiffu. Diomede fit plus qu’effleurer
la peau de Vénus, puifqu’il lui fit une bleffure à
la main, dont le fang immortel couloit : ce font les
expreflions d’Homere. Lettres fur C Encyclopédie.
§ DIONYSIENNES, ( Hift. une. Mythol. ) fêtes
de Bacchus que l’on célébroit. . . fur le mont E la-
pheboli... Dictionnaire raif. des Sciences , tome IV
page /0/3. On a transformé ici un mois en montagne.
Il faut lire dans le mois élaphebolion , au lieu
t e fur le mont Elapheboli. Ce mois qui répond à notre
mois de mars fe nommoit élaphebolion , parce
qu’on immoloit à cette troifieme fête dionyfienne ,
des cerfs à Diane : c’étoit le mois des chaffeurs.
Ténia dionyfia menfe elaphebolione celebrantur, dit
Giraldi. On le dit aufli à l’article Élaphebolion
dans le Dictionnaire raif Sciences, &c* ( C. )
Tome ƒƒ,
D IOPI, ( Mujîq. Infirument dès ànci ) Athenéè dit
que c’étoit une efpece de flûte ; & Dalechamp dans
fes remarques fur cet auteur, prétend, avec affez dé
vraifemblance, qu’elle fe nommôit Diopi, parce*
qu’elle n’avoit que deux trous, ce qui devoit fournir
une mélodie bien bornée. ( F. D . C. )
DIPHTONGUE, ( Muftqf) On appellfcjit tjiiei-
quefois la tierce majeure diphtongue, apparemment
parce qu’elle eft compofée de deux ions. ( F. D . C. )
D IR E C T , adj. ( Mujîq.) Un intervalle direct eft
Celui qui fait un harmonique quelconque fur le fon
fondamental qui le produit. Ainfi la quinte, la tierce
majeure, l’oftave, & leurs répliques font rigoureufe*
ment les feuls intervalles directs : mais par extenfion
l’on appelle encore intervalles directs tous les autres j
tant confonnans que diffonans,que fait chaque partie
avec le fon fondamental pratique, qui eft ou doit
etre au-deffous d’ellë ; ainfi la tierce mineure eft urt
intervalle direct fur un accord en tierce mineure, &
de même la feptieme ou la fixte - ajoutée fur les
accords qui portent leur nom*
Accord direct eft celui qui a lé fôn fondamental
au grave & dont les parties font diftribuées , non
pas félon leur ordre le plus naturel, mais félon leur
ordre le plus approché. Ainfi l’accord parfait direct
h’eft pas ô&ave, quinte & tierce, mais tierce > quinte
& ottave. ( S )
D irecte , ( Làgique. ) Démonftrâtiort ou preuve
directe, eft celle qui-, fans aucun détour, prouve que
la propofitiqn eft vraie * en forte que la conclu-
fion de la dériionftration exprime précifément la pro-
pofirion dont on cherchoit la vérité. Pour celtüSbn
compare dans une première partie -du fyllogifme *
le fujet de là propôfitiort avec le terme moyen ;
dans la fécondé, ce même terme moyen avec l’attribut
de la propofition , 6c dans la coriclüfion on
exprime le rapport de concordance ou de difeor*-
dance du fujet avec l’attribut. Dans les démonftra-
tions indire&es, on prouve, par exemple', que le
contraire de lâ propofition eft faux pour prouver
que la propofition eft vraie ; ou que fi l’on nioit
la propofition, il faudrait admettre des propofitions
abfurdes. Ces fortes dé preuves d’une propofition
fe nomment indirectes. ( G. M. )
* § DIRIBITEUR, efçlavedont la fonction étoit d'arranger
& de donner différentes formes finguliefes aux
ragoûts tju’ônfervoitfur les tables. i° . Ç ’eft Apulée qui
a pris le mot latin diribitor', à-peü-près dans ce fens.
Je dis à-peu-près, car Apulée entend par diribitor ,
un ééuyer tranchant. 2°* Ge mot fignifie dans Cicéron
& dans les auteurs fupérieurs à Apulée , le dif-
tributeur des bulletins dans les'affemblées & les
jugemens. Lettres fur l'Encyclopédie*
DISCANT ou DÊCHANT, f. m. ( Mufià. ) C'était,
dans nos anciennes mufiques, cette elpece de
contre-point que compofoient fur le champ des parties
fupérieures en chantant impromptu fur le ténor
ou la baffe ; ce qui fait juger de la lenteur avec laquelle
devoir marcher la mufique , pour pouvoir
être exécutée de cette maniéré par des muficiens
aufli peu habiles que ceux de ce tems-là. Difcan-
tat, dit Jean de Mûris, qui ftmiil cum uno vel plu-
ribus dulciter cantat, ut ex diftinélis fonis fônus iinus
fia t, non unitate fimplicitatis ,fed dulcis concordifque
mixtionis unione. Après avoir expliqué ce qu’il entend
par éonfonnances, & le choix qü’il convient
de faire entr’elles, il reprend aigrement les chanteurs
de fon tems qui les pratiquoient prefqu’indiffé-
remment. <« De quel front, dit-il, fi nôs réglés font
» bonnes , ofent déchanter ou compofer le difeant,
» ceux qui n’entendent rien au choix des accords ,
» qui ne fe doutent pas même de ceux qui font plus
• » ou moins concordarts , qui rie favent rii defquels
» il faut s’abftenir, ni defquels on doit ufer le plus
Y Y y y i j