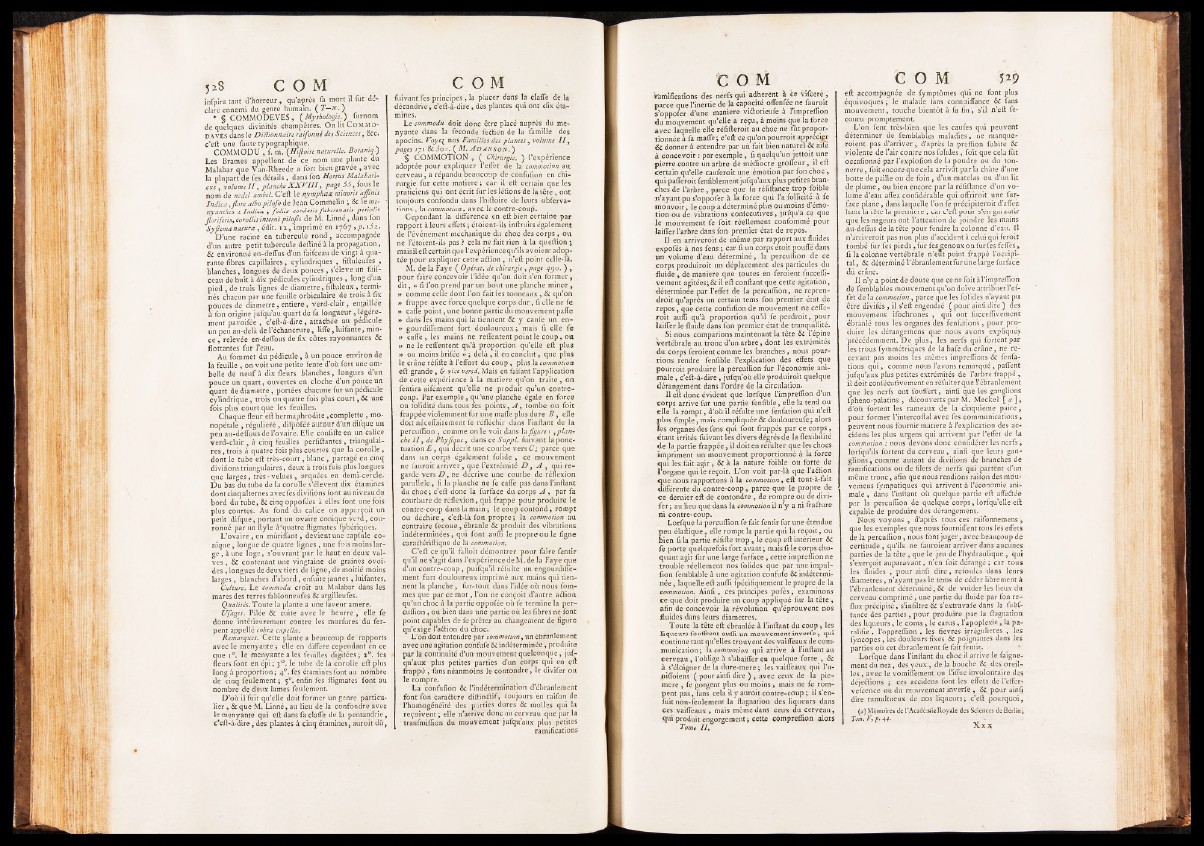
» P
e Jp [■
I ;
528 C OM
infpira tant d’horreur, qu’après fa mort il fut déclaré
ennemi du genre humain. ( T— N . )
* § COMMODEVES, ( Mythologie. ) furnom
de quelques divinités champêtres. OnlitCoMMO-
DAVES dans le Dictionnaire raifonnè des Sciences, &c.
c’eft une faute typographique.
COMMODU , f. m. (Hiftoire naturelle. Botaniq.)
Les Brames appellent de ce nom une plante du
Malabar que Van-Rheede a fort bien gravée , avec
la plupart de fes détails , dans fon Hortus Malaban-
cus , volume I I , planche X X V I I I , page S S , fous le
nom de nedel ambel. C ’eft le nymphatce minoris affinis
Indien, flore albo pilofo de Jean Commelin ; 6c le me- '
nyanthes 2 Indien , foliis cordatis fuberenatis petiotis
floriferis, coroltisinternépilofls de M. Linné, dans fon
Syftemanatura , édit, i l , imprimé en 1767 >p.iSz.
D ’une racine en tubercule rónd, accompagnée
d’un autre petit tubercule deftiné à la propagation,
& environné en-deffus d’un faifeeau de vingt à quarante
fibres capillaires, cylindriques , fiftuleufes ,
blanches, longues de deux pouces, s’élève un faifeeau
de huit à dix pédicules cylindriques , long d un
pied , de trois lignes de diamètre, fiftuleux , terminés
chacun par une feuille orbiculaire de trois à fix
pouces de diamètre, entière, verd-clair, entaillée
à fon origine jufqu’au quart de fa longueur, légèrement
pavoifée , c’eft-à-dire, attachée au pédicule
un peu au-delà de l’échancrure, liffe, luifante, mince
, relevée en-deffous de fix côtes rayonnantes 6c
flottantes fur l’eau.
Au fommet du pédicule, à un pouce environ de
la feuille , on voit une petite fente d’où fort une ombelle
de neuf à dix fleurs blanches, longues d’un
pouce un quart, ouvertes en cloche d’un pouce un
quart de diamètre, portées chacune fur un pédicule
cylindrique, trois ou quatre fois plus cou rt, 6c une
fois plus court que les feuilles.
Chaque fleur eft hermaphrodite ,complette , monopétale
, réguliere , difpofée autour d’un difque un
peu au-deffous de l’ovaire. Elle confifte en un calice
verd-clair , à cinq feuilles perfiftantes , triangulaires
, trois à quatre fois plus courtes que la corolle,
dont le tube eft très-court, blanc , partagé en cinq
divifions triangulaires, deux à trois fois plus longues
que larges, très-velues, arquées en demi-cercle.
Du bas du tube de la corolle s’élèvent dix étamines
dontcinqalternes avec fes divifions font au niveau du
bord du tube, & cinq oppofées à elles font une fois
plus courtes. Au fond du calice on apperçoit un
petit difque, portant un ovaire conique verd, couronné
parunftyle à'quatre ftigmates fphériqùes.
L’ovaire , en mûriffant, devient une capfule conique,
longue de quatre lignes , une fois moins large
, à une loge, s’ouvrant par le haut en deux valves
, 6c contenant une vingtaine de graines ovoïdes
, longues de deux tiers de ligne, de moitié moins
larges , blanches d’abord, enfuite jaunes ,*luifantes.
Culture. Le commodu croît au Malabar dans les
mares des terres fablonneufes & argilleufes.
Qualités. Toute la plante a une faveur amere.
Ufages. Pilée 6c cuite avec le beurre , elle fe
donne intérieurement contre les morfures du fer-
pent appelle cobra capella.
Remarques. Cette plante a beaucoup de rapports
avec le menyante ; elle en différé cependant en ce
que i°. le menyante a les feuilles digitées ; z°. fes
fleurs font en épi; 30. le tube de la corolle eft plus
long à proportion ; 40. fes étamines font au nofnbre
de cinq feulement ; 50. enfin fes ftigmates font au
nombre de deux lames feulement.
D ’où il fuit qu’elle doit former un genre particulier
, &qu eM . Linné, au lieu de la confondre avec
le menyante qui eft dans fa claffe de la pentandrie,
c’eft-à-dire, des plantes à cinq étamines, auroit dû,
C O M
fuivant fes principes , la placer dans la claffe de la
décandrie, c’eft-à-dire, des plantes qui ont dix étamines.
Le commodu doit donc être placé auprès du menyante
dans la fécondé fetlion de la famille des
apocins. Voye^ nos Familles des plantes, volume I I ,
pages iyi 6c Soi. ( M. A d a n s o n . )
§ COMMOTION , ( Chirurgie. ) l’expérience
adoptée pour expliquer l’effet de la commotion au
cerveau, a répandu beaucoup de confufion en chirurgie
fur cette matière ; car il eft ceriain que les
praticiens qui ont écrit fur les lélions de la tête , ont
toujours confondu dans l’hiftoire de leurs obferva-
tions , la commotion, avec le contre-coup.
Cependant la différence en eft bien certaine par
rapport à leurs effets ; étoient-ils inftruits également
de l’événement méchanique du choc des corps , ou
ne l’étoient-ils pas ? cela ne fait rien à la queftion j
maisil eft certain que l’expérience qu’ils a voient adoptée
pour expliquer cette aftion, n’eft point celle-là.
M. de la Faye ( Opérât. de chirurgie, page 490. ) ,
pour faire concevoir l’idée qu’on doit s’en former,
dit, « fi l’on prend par un bout une planche mince ,
» comme celle dont l’on fait les tonneaux, & qu’on
» frappe avec force quelque corps dur, fi elle ne fe
» cafte point, une bonne partie du mouvement paffe
» dans les mains qui la tiennent 6c y caufe un en-
*> gourdiffement fort douloureux; mais fi elle fe
» caffe, les mains ne reffentent point le coup, ou
» ne le reffentent qu’à proportion qu’elle eft plus
» ou moins brifée » ; delà , il en conclut, que plus
le crâne réfifte à l’effort du coup, plus la commotion
eft grande, & vice versa. Mais en faifant l’application
de cette expérience à la matière qu’on traite, on
fentira aifément qu’elle ne produit qu’un contrecoup.
Par exemple, qu’une planche égale en force
ou lolidité dans tous les points, A , tombe ou foit
frappée violemment fur une mafle plus dure B , elle
doit néceffairement fe réfléchir dans l’inftant de la
pereuflion , comme on le voit dans la figure 1 , planche
II f de Phyflque, dans ce Suppl, fuivant la ponctuation
E , qui décrit une courbe vers C; parce que
dans un corps également folide , ce mouvement
ne fauroit arriver, que l’extrémité D , A , qiii regarde
vers D , ne décrive une courbe de réflexion
parallèle, fi la planche ne fe caffe pas dans l’inftant
du choc; c’eft donc la furface du corps A , par fa
courbure de réflexion, qui frappe pour produire le
contre-coup dans la main ; le coup contond, rompt
ou déchire, c’eft-là fon propre ; la commotion au
contraire fecoue, ébranle 6c produit des vibrations
indéterminées, qui font aufîi le propre ou le figne
caraftériftique de la commotion.
C ’eft ce qu’il falloit démontrer pour faire fentir
qu’il ne s’agit dans l ’expérience de M. de la Faye que
d’un contre-coup, puifqu’il réfulte un engourdiffe-
ment fort douloureux imprimé aux mains qui tiennent
la planche , fur-tout dans l’idée oit nous fom-
mes que par ce mot, l’on ne conçoit d’autre attion
qu’un choc à la partie oppofée oïi fe termine la pereuflion
, ou bien dans une partie oit les fibres ne font
point capables de fe prêter au changement de figure
qu’exige l’aftion du choc.
L’on doit entendre par commotion, un ébranlement
avec une agitation cqhfufe 6c indéterminée, produite
par la continuité d’un mouvement quelconque, jusqu’aux
plus petites parties d’un corps qui en eft
frappé , fans néanmoins le contondre, le divifer ou
le rompre.
La confufion 6c l’indétermination d’ébranlement
font fon caraâere diftinélif, toujours en raifon de
l’homogénéité des parties dures & molles qui la
reçoivent ; elle n’arrive donc au cerveau que par la
tranfmiflion du mouvement jufqu’aux plus petites
ramifications
C O M
Vaittifications des nerfs qui adhèrent à ce vifeerè,
.parce que l’inertie de la capacité offenfee ne fauroit
s ’oppofer d’une maniéré vi&orieufe à l’impreflion
du mouvement qu’elle a reçu, à moins que la force
avec laquelle elle réfifteroit au choc ne fut proportionnée
à fa maffe; c ’eft ce qu’on pourroit apprécjgr
& donner à entendre par un fait bien naturel 6c âifé
à concevoir : par exemple, fi quelqu’un jettoit une
pierre contre un arbre de médiocre grôffeùr, il eft
certain qu’elle cauferoit une émotion par fon choc',
qui pafféroit fenfiblement jufqu’aux plus petites branches
de l’arbre, parce que fa réfiftance trop foible
n’àyant pu s’oppofer à la force qui l’afollicite à fe
mouvoir, le coup a déterminé plus ou moins d’emô-
tion ou de vibrations conféeutives, jufqu’à ce que
le mouvement fe foit réellement confommé pour
laiffer l’arbre dans fon premier état de repos..
Il en arriveroit de même par rapport aux fluides ;
expofés à nos fens ; car fi un corps étoit pouffé dans
un volume d’eau déterminé, la pereuflion de ce
corps produiroit un déplacement des particules du
fluide , de maniéré que toutes en feroient fuccefîî-
vement agitées; & il eft confiant que cette agitation,
déterminée par l’effet de la pereuflion, ne repren-
droit qu’après un certain tems fon premier état de
repos, que cette confufion de mouvement ne ceffe-
roit aufli qu’à proportion qu’il fe perdroit, pour
laiffer le fluide dans fon premier état de tranquillité.
. Si nous comparions maintenant la tête 6c l’épine
vertébrale au tronc d’un arbre, dont les extrémités
du corps feroient comme les branches, nous pourrions
rendre fenfible l’explication des effets que
pourroit produire la pereuflion fur l’économie animale
, c’eft-à-dire, jufqu’oîi elle produiroit quelque
dérangement dans l’ordre de la circulation.
Il eft donc évident que lorfque l’impreflion d’un
corps arrive fur une partie fenfible, elle la tend ou
elle la rompt, d’o à il réfulte une fenfation qui n’ eft
.plus fimple, mais compliquée & douloureufe ; alors
les organes des fens qui font frappés par ce corps *
étant irrités fuivant les divers dégrés de la flexibilité
de la partie frappée, il doit en réfulter que les chocs
impriment un mouvement proportionné à la force
qui les fait agir, & à la nature foible ou forte de
l ’organe qui le reçoit. L’on voit par-là que l’aûion
que nous rapportons à la commotion, eft tout-à-fait
différente du contre-coup, parce que le propre de
ce dernier eft de contondre , de rompre ou de divifer;
au lieu que dans la commotion il n’y a ni fraéture
ni contre-coup.
Lorfque la pereuflion fe fait fentir fur une étendue
peu élaftique, elle rompt la partie qui la reçoit, ou
bien fi la partie réfifte trop , le coup eft intérieur 6c
fe porte quelquefois fort avant ; mais fi le corps choquant
agit fur une large furfaCe, cette impreflion ne
trouble réellement nos folides que par une impul-
fion femblable à une agitation confufe 6c indéterminée
, laquelle eft aufli lpécifiquement le propre de la
commotion. Ainfi , ,ces principes pofés, examinons
ce que doit produire un coup appliqué fur la tête ,
afin de concevoir la révolution qu’éprouvent nos
fluides dans leurs diamètres.
Toute la tête eft ébranlée à l’inftant du coup * les
liqueurs fouffrent aufli un mouvement inverfe, qui
continue tant qu’elles trouvent des vaiffeaux de communication
; la commotion qui arrive à l’inftant au
cerveau, l’oblige à s’abaiffer ea quelque forte , 6c
à s’éloigner de la dure-mere ; les vaiffeaux qui l’u-
jfiffoient ( pour ainfi dire ) , avec ceux de la pie-
mere , fe gorgent plus ou moins > mais ne fe rompent
pas, fans cela il y auroit contre-coup ; il s’enfuit
non-feulement la ftagnation des liqueurs dans
ces vaiffeaux > mais même dans ceux du cerveau,
qui produit engorgement ; cette compreflion alors
Tome II.
G O M î29
éft accompagnée de fymptômes qlti ne font plus
équivoques ; le malade fans connoiffance 6c fans
mouvement, touche bientôt à fà fin', s’il n’eft fe-
couru promptement.
. L’on fent trèà-bien que les caufes qui peuvent
déterminer de femblables maladies, ne manque.-
rOient pas d’arriver , d’après la preflion fubite 6c
violente de l’air contre nos folides, foit que cela fut
occafionné par l’explofion de la poudre ou du tonnerre,
foit encore que cela arrivât parla chute d’une
botte de paille ou de foin, d’un matelas ou d’un lit
de plume, ou bien encore par la réfiftance d’un volume
d’eâu affez confidérable qui offriroit une fur-
face plané, dans laquelle l’on fe précipiteroit d’affez
haiit la tête la première ; car c’eft pour s’en garantir
que les nageurs ont l’attention de joindre les mains
àu-deffus de la tête pour fendre la colonne d’eau. Il
n’arriveroit pas non plus d’accident à celui qui feroit
tombé fur fés pieds , fur fes eenoux ou fur fes feffes,
fi la colonne vertébrale n’eut point frappé l’occipital,
& déterminé l’ébranlement fur une large furface
dû crâne.
Il n’y a point de doute que çe ne foit à l’impreflion
de femblables mouvemens qu’on doive attribuer l’effet
de la commotion, parce que les folides n’ayant pu
être divifés, il s’eft engendré ( pour ainfi dire ) des
mouvemens ifochrones , qui ont fucceflivement
ébranlé tous lés organes dés fenfations , pour produire
les dérangemens que nous avons expliqués
précédemment. De plus, les nerfs qui fortent par
les trous fymmétriques de la Bafe du crâne, ne recevant
pas moins les mêmes ïmprefîions 6c fenfa-
• fions, qui, comme nous l’avons remarqué, paffent
jufqu’aux plus petites extrémités de l’arbre frappé ,
il doit confécutivement en réfulter que l’ébranlement
que les nerfs ont fouffert, ainfi que les ganglions
fpheno-palatins , découverts par M. Meckel [ a ] ;
d’oïi fortent les rameaux de la cinquième paire ,
pour former l’intercoftal avec fes communications ;
peuvent nous fournir matière à l’explication des ac-
cidens les plus urgens qui arrivent par l’effet de la
commotion : nous devons donc confidérer les nerfs ;
lorfqu’ils fortent du cerveau, ainfi que leurs ganglions
, comme autant de divifi.ons de branches de
ramifications ou de filets de nerfs qui partènt d’un
même tronc, afin que nous rendions raifon des môu-
vemens fympatiques qui arrivent à l’économie animale
, dans l’inftant oii quelque partie eft affeâé'è
par la pereuflion dè quelque corps > lorfqu’elle eft
capable de produire des dérangemens.
Nous voyons , d’après tous ces raifonnemens \
que les exemples que nous fourniffent tous les effets
de la pereuflion, nous font juger, avec beaucoup de
certitude, qu’ils ne fauroient arriver dans aucunes
parties de la tête, que le jeu de l’hydraulique , qui
s’exerçoit auparavant, n’en foit dérangé ; car tous
les fluides , pour ainfi dire, refoulés dans leurs
diamètres, n’ayant pas le tems de céder librement à
l’ébranlement déterminé, 6c de vuider les lieux du
cerveau comprimé, une partie du fluide par fon reflux
précipité, s’infiltre 6c s’extravafe dans la fubf-
tance des parties, pour produire par, la ftagnation
des liqueurs, le coma, le carus, l’apoplexie, la pa-
ralifie, l’oppreflion , les fievres irrégulières , les
fyncopes, les douleurs fixes 6c poignantes dans les
parties oii cet ébranlement fe fait fentir.
Lorfque dans l’inftant du choc il arrive le faigne-
ment du nez, des yeu x, de la bouche 6c des oreili
le s , avec le vomiflement ou l’iffue involontaire des
déje&ions ; ces accidens font les effets de l’effer-
vefcence ou du mouvement inverfe , 6c pour ainfi
dire tumultueux de nos liqueurs; c’eft pourquoi,
(d) Mémoires de l’Académie Royale des Sciences de Berlin;
Tom, ü P. 44*
X x x