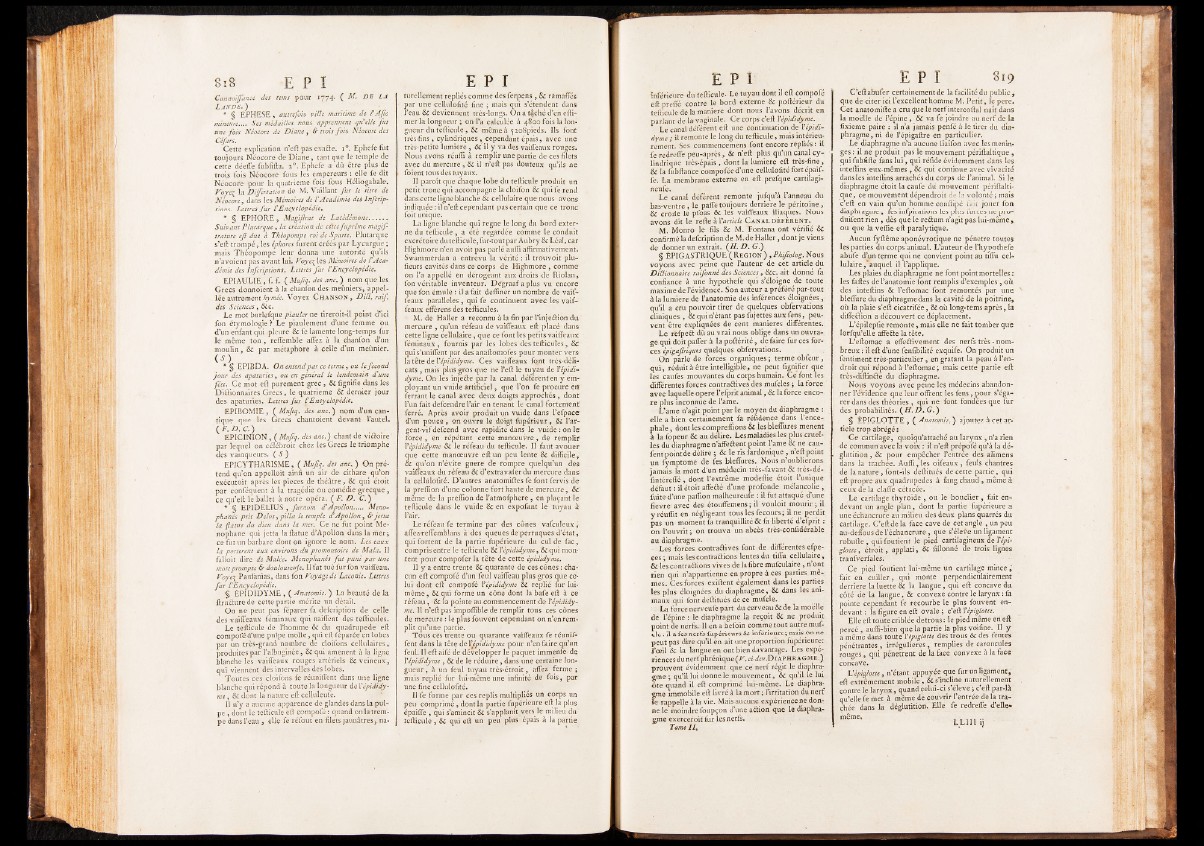
Connoitfance des teins p o u r 1774. ( NI. D E LA
L a n d e . )
* § EPHESE, autrefois ville maritime de l'Afie
mineure.... Ses médailles nous apprennent qu'elle fut
une fois Néocore de Diane , & trois fois Néocore des
Céfars.
Cette explication n’eft pas exafte. i°. Ephefe fut
toujours Néocore de Diane, tant que le temple de
cette déeffe fubfifta. z°. Ephefe a du être plus de
tro\s fois Néocore fous les empereurs : elle fe dit
Néocore pour la quatrième fois fous Héliogabale.
Voye.1 la Differtation de M. Vaillant fur le titre de
Néocore, dans les Mémoires de l'Académie des Infcrip-
lions. Lettres fur ÛEncyclopédie.
* § EPHORE , Mâgijlrat de Lacédémone.........
Suivant Plutarque , la création de cette fuprême magif-
trature ejl due à Théopompe roi de Sparte. Plutarque
s’eft trompé, les éphores furent créés par Lycurgue ;
mais Théopompe leur donna une autorité qu’ils
n’avoient pas avant lui. Voye[ les Mémoires de ÜAcadémie
des Infcriptions. Lettres fur C Encyclopédie.
EPIAULIE , f. f. ( Mujiqj des anc. ) nom que les
Grecs donnoierit à la chanfon des meuniers, appe||
lée autrement hymèe. Voyez Chanson , Dicl. raif.
des Sciences, &c.
Le mot burlefque piauler ne tireroit-il point d’ici
fon étymologie ? Le piaulement d’une femme ou
d’un enfant qui pleure & fe lamente long-temps fur
le même to n , reffemble affez à la chanfon d’un-
moulin , & par métaphore à celle d’un meunier.
m i w m m „ ,
* § EPIBDA. On entend par ce terme, ou le fécond
jour des apaturies, ou en général le lendemain d une
fête. Ce mot eft purement grec, & lignifie dans les
Diûionnaires Grecs, le quatrième & dernier jour
des apaturies. Lettres fur C Encyclopédie.
EPIBOMIE , ( Mufiq. des anc.) nom d’un cantique
que les Grecs chantoient devant l’autel.
( F .D .C .)
EPICINION, ( Mufiq. des anc.) chant de vi&oire'
par lequel on célébroit chez les Grecs le triomphe
des vainqueurs. ( S )
EPICYTHARISME, ( Mufiq. des anc.. ) On prétend
qu’on appelloit ainfi un air de cithare qu’on
exécutoit après les pièces de théâtre, & qui étdit
par conféquent à la tragédie ou comédie grecque,
ce qu’eft le ballet à notre opéra. ( F. D . C. )
* § EPIDELIUS , furnom d'Apollon..... Menophanés
prit Delos, pilla le temple £ Apollon, & jetta
la flatue du dieu dans la mer. Ce ne fut point Me-
nophane qui jetta la ftâtue d’Apollon dans la nier ;
ce fut un barbare dont on ignore le nom. Les eaux
la portèrent aux environs du promontoire de Mala. Il
falloit dire de Malce. Menophanés fut puni par une
mort prompte & douloureuje. Il fut tué fur fon vaiffeau.
Voyei Paufanias, dans fon Voyage de Laconie. Lettres
fur £ Encyclopédie.
§ ÉPIDIDYME , ( Anatomie. ) La beauté de la
ftru&ure de cette partie mérite un détail.
On ne peut pas féparer fa defcriptiôn de celle
des vaiffeaux féminaux qui naiffent des tefticules.
Le teflicule de l’homme & du quadrupède eft
compofé d’une pulpe molle, qui eft féparée en lobes
par un très-grand nombre de cloifons cellulaires,
produites par l’albuginée, & qui amènent à la ligne
blanche les vaiffeaux rouges artériels & veineux,
qui viennent des intervalles dés lobes.
Toutes ces cloifons fe réuniffent dans une ligne
blanche qui répond à toute la longueur de l'éptdidy-
mt, & dont la nature eft celluleulè.
11 n’y a aucune apparence de glandes dans la pulpe
, dont le tefticule eft compofé : quand on la trempe
dans l’eau, elle fe réfout en filets jaunâtres, naturelîement
repliés comme des ferpens , & ramàffés
par une cellulofité fine ; mais qui s’étendent dans
l’eau & deviennent très-longs. On a tâché d’en efti*
mer la longueur ; on l’a calculée à 4800 fois la longueur
du tefticule, & même à ^zoSpieds'. Ils font
très-fins , cylindriques 9/ cependant épais, avec une
très-petite lumière, & il y va des vaiffeaux rouges.
Nous avons réuffi à remplir une partie de ces filets
avec du mercure, & il n’eft'pas douteux qu’ils ne
foient tous des tuyaux.
II paroît que chaque lobe du tefticule produit un
petit tronc qui accompagne la cloifon & qui fe rend
dans cette ligne blanche & cellulaire que nous avons
indiquée : il n’eft cependant pas certain que ce tronc
foit unique.
La ligne blanche qui régné le long du bord externe
du tefticule, a été regardée comme le conduit
excrétoire du tefticule, fur-tout par Aubry & Léal, car
Highmore n’en avoit pas parlé auffi affirmativement.
Swammerdan a entrevu la vérité : il trouvoit plu-
fieurs cavités dans ce corps de Highmore , comme
on l’a appellé en dérogeant aux droits de Riolan,
fon véritable inventeur. Dègraaf a plus vu encore
que fon émule : il a fait deffiner un nombre de vaiffeaux
parallèles , qui fe continuent avec les vaiffeaux
efférens des tefticules.
M. de Haller a reconnu à la fin par l’injeélion du
mercure , qu’un réfeau de vaiffeaux eft placé dans
cette ligne cellulaire, que ce font les petits vaiffeaux
féminaux, fournis par les lobes des tefticules, 6c
qui s’uniffent par des anaftoittofes pour monter vers
la tête de l'épididyme. Ces vaiffeaux fo.nt très-délicats
, mais plus gros que ne l’eft le tuyau de Vépidi-
dyme. On les injefte par la canal déférent en y employant
un vuide artificiel, que l’on fe procure ért
ferrant le canal avec deux doigts approchés , dont
l’un fait defeendre l’air en tenant le canal fortement
ferré. Après avoir produit un vuide dans l’efpace
d’un pouce , on ouvre le doigt fupérieur, & l’ar-
gent-vif defeend avec rapidité dans le vuide : on le
force , en répétant cette manoeuvre, de remplir
l'épididyme & le réfeau du tefticule. Il faut avouer
que cette manoeuvre eft un peu lente & difficile,
& qu’on n’évite guere de rompre quelqu’un des
vaiffeaux du réfeau & d’extravaler du mercure dans
la cellulofité. D ’autres anatomiftes fe font fervis de
la preffion d’une colonne fort haute de mercure, &
même de la preffion de l’atmofphere , en plaçant le
tefticule dans le vuide & en expofant le tuyau à
l’air.
Le réfeau fe termine par des cônes vafculeux j-
affez-reffemblans à des queues de perruques d’état,
qui fortent de la partie ftipérieure du cul de fac,
compris entre le tefticule & l'épididyme, & qui mon--
tent pour compofer la tête de cette épididyme.
Il y a entre trente & quarante de ces, cônes : chacun
eft compofé d’un feul vaiffeau plus gros que cé-
lui dont eft compofé Vépididyme & replié lur lui-
même , & qui forme un cône dont la bafe eft à ce
réfeau, & la pointe au commencement de ¥ épididyme.
Il n’eft pas impoffible de remplir tous ces cônes
de mercure : le plus fouvent cependant on n’ en remplit
qu’une partie.
Tous cés trente ou quarante vaiffeaux fe réuniffent
dans la tête de l'épididyme pour n’en faire qu’un
feul. Il eft aifé de développer le paquet immenfe- de
¥ épididyme , & de le réduire, dans une certaine longueur
, à un feul tuyau très-étroit, affez ferme ;
mais replié fur lui-même une infinité de fois, par
une fine cellulofité.
Il fe forme par ces replis multipliés un corps un
peu comprimé, dont la partie fupérieure eft la plus
épaiffe , qui s’amincit & s’applanit vers le milieu du
tefticule , & qui eft un peu plus épais à la partie
ïfiférieure du tefticule. Le tuyau dont il eft compofé
eft preffé contre le bord externe & poftérieur du
tefticule de la maniéré dont nous l’avons décrit en
parlant de là vaginale. Ce corps c’eft Vépididyme.
Le canal déférent eft une continuation de Vépididyme
; il remonte le long du tefticule, mais intérieurement.
Ses commencemens font encore repliés : il
fe redrefte peu-après., Sc n’eft plus qu’un canal cy lindrique
très-épais , dont la. lumière eft très-fine,
& la fubftance compofée d’une cellulofité fort épaiffe.
La mêmbrane externe en eft prefque cartilagi-
neufe. . •
Le canal déférent remonte jufqu?à l’anneau du
bas-ventre , le paffe toujours derrière le péritoine,
& croife le pfoas & les vaiffeaux iliaques. Nous
avons dit le refte à ¥article Canal déférent.
M. Monro le fils & M. Fontana ont vérifié &
confirmé la defcriptiôn de M. de Haller, dont je viens
de donner un extrait. (H. D . G.)
§ ÉPIGASTRIQUE (R égion ) ,PhiJiolog. Nous
voyons avec peine que l’auteur de cet article du
Dictionnaire raifonné des Sciences, &c. ait donné fa
confiance à une hypothefe qui s’éloigne de toute
maxime de l’évidence. Son auteur a préféré par-tout
à la lumière de l’anatomie des inférences éloignées,
qu’il a cru pouvoir tirer de quelques obfervations
cliniques , & qui n’étant pasfujettes auxfens, peuvent
être expliquées de cent maniérés différentes.
Le rfefpeft dû au vrai nous oblige dans un ouvrage
qui doit paffer à la poftérité, défaire fur ees forces
épigajlriques quelques obfervations.
On parle de forces organiques ; terme obfcur ,
qui, réduit à être intelligible, ne peut fignifier que
les caufes mouvantes du corps humain. Ce font les.
différentes forces contra&ives des mufcles ; la force
avec laquelle opéré l’efprit animal, & la force encore
plus inconnue de l’ame.
L’ame n’agit point pàr le moyen du diaphragme :
elle a bien certainement fa réfidence dans l’ence-
phale, dont les comprenions & les bleffures mènent
à la fopeur & au délire. Les maladies les plus cruelles
du diaphragme n’àffettent point l’ame & ne cau-
fent point de délire ; & le ris lardonique , n’eft point
un fymptome de fes bleffures. Nous n’oublierons
jamais la mort d’un médecin très-favant & très-dé-
fintéreffé , dont l’extrême modeftie étoit l’unique
défaut : il étoit affe&é d’une profonde mélancolie ,
fuite d’une paffion malheureufe : il fut attaqué d’une
fievre avec des étouffemens; il vouloit mourir ; il
vréuffit en négligeant tous les fecours; il ne perdit
pas un moment fa tranquillité & fa liberté d efprit :
on l’ouvrit ; on trouva un abcès très-confidérable
au diaphragme.
Les forces contra&ives font de différentes efpe-
ces; mais les contrarions lentes du tiffu cellulaire,
& les contrarions vives de la fibre mufculaire , n’ont
rien qui n’appartienne en propre à ces parties mêmes.
Ces forces exiftent également dans les parties
les plus éloignées, du diaphragme, & dans les animaux
qui font deftitués de ce mufcle.
La force nerveùfe part du cerveau & de la moelle
de l?épine : le diaphragmera reçpit & ne produit
point de nerfs. Il en a befoin comme tout autre mufcle
: il a fes nerfs fupérieurs & inférieurs ; mais <>n ne
peut pas dire qu’il en. ait une proportion fupérieure:
l’oeil & la langue en ont bien davantage. Les expériences
du nerf phrénique (V. ci-t/«v.DiAPHRAGME.)
prouvent évidemment que ce nerf régit le diaphragme
; qu’il lui donne.le mouvement, & qu’il le lui
ôte quand il eft comprimé lui-même. Le diaphragme
immobile eft livré à la mort ; l’irritation du nerf
le rappelle à la vie. Mais aucune expérience ne donne
le moindre foupçon d’une a&ion que le diaphragme
exerceroit fur lesnerfs.
Tome II,
C ’eft abufer certainement de la facilité du public,
que de citer ici l’excellent homme M. Petit, le pere.
Cet anatomifte a cru que le nerf intercoftal naît dans
la moelle dé l’épine, & va fe joindre au nerf de la
fixieme paire : il n’a jamais penfé à le tirer du dia*
phragme, ni de l’épigaftre en particulier.
Le diaphragme n’a aucune liaifon avec lesmenin«'
ges î il ne produit pas le mouvement périftaltique ,
qui fubfifte fans lu i, qui réfide évidemment dans les
inteftins eux-mêmes , & qui continue avec vivacité
dans les inteftins arrachés au corps de l’animal. Si le
diaphragme étoit la caufe dii mouvement périftaltique,
ce mouvement dépendroit de la volonté ; mais
c’eft en vain qu’un homme conftipé fait jouer fon
diaphragme ; les infpirations les plus fortes ne pro-
duifent rien , dès que le reélum n’agit pas lui-même,
ou que la veffie eft paralytique»
Aucun fyftême aponévrotique ne pénétré toutes
les parties du corps animal. L’auteur de l’hypothefe
abufe d’un terme qui ne convient point au tiffu cellulaire
, auquel il l’applique.
Les plaies du diaphragme ne font point mortelles :
les faites de l’anatomie font remplis d’exemples', oit
des inteftins & l’eftomac font remontés par une
bleffure du diaphragme dans la cavité de la poitrine,
oh la plaie s’eft cicatrifée, & oîi long-tems après, la
diffedion a découvert ce déplacement.
L’épilepfie remonte, mais elle ne fait tomber que
lorfqu’elle affe&e la tête.
L’eftomac a effe&ivement des nerfs très - nombreux
: il eft d’une fenfibilité exquife. On produit un
fentiment très-particulier, en gratant la peau à l’eri-
droit qui répond à l’eftomac ; mais cette partie eft
très-diftinde du diaphragme.
Nous voyons avec peine les médecins abandonner
l’éVidence que leur offrent les fens, pour s’égarer
dans des théories , qui ne font fondées que fur
des probabilités. ( H .D .G .)
§ ÉPIGLOTTE, ( Anatomie. ) ajoutez à cet article
trop abrégé î
Ce cartilage, quoiqu’attaché au larynx , n’a rien
de commun avec la voix : il n’eft prépofé qu’à la déglutition
, & pour empêcher l’entree des alimens
dans la trachée. Auffi, les oifeaux , feuls chantres
de la nature, font-ils deftitués de cette partie, qui
eft propre aux quadrupèdes à lang chaud, même à
ceux de la çlaffe cétacée.
Le cartilage thyroïde , ou le bouclier , fait en-
devant un angle plan, dont la partie fupérieure a
une échancrure au milieu des deux plans quarrés du
cartilage. C ’eft de la face cave de cet angle , un peu
au-deffous de l’échancrure , que s’élève un ligament
robufte , qui foutient le pied cartilagineux de ¥ épiglotte
, étroit, applati, & fillonné de trois lignes
tranfvèrfales.
Ce pied foutient lui-même un cartilage mince >
fait en cuiller, qui monte perpendiculairement
derrière la luette & la langue, qui eft concave du
côté de la langue, & convexe contre le larynx : fa
pointe cependant fe recourbe le plus fouvent en-,
devant: la figure en eft ovale; c’eft ¥ épiglotte.
Elle eft toute criblée de trous : le pied même en eft
percé , auffi-bien que la partie la plus voifine. Il y
a même dans toute ¥ épiglotte des trous & des fentes
pénétrantes , irrégülieres, remplies de caroncules
rouges, qui pénètrent de la face convexe à la face
concave.
Vépiglotte, n’étant appuyée que fur un ligament,
eft extrêmement mobile , & s’incline naturellement
contre le larynx, quand cèlui-ci s’éleve ; c’eft par-là
qu’elle fe met à même dé couvrir l’entrée de la trachée
dans la déglutition. Elle fe redreffe d’ellemême.
* v JRH L L 111 îj
1 iJN