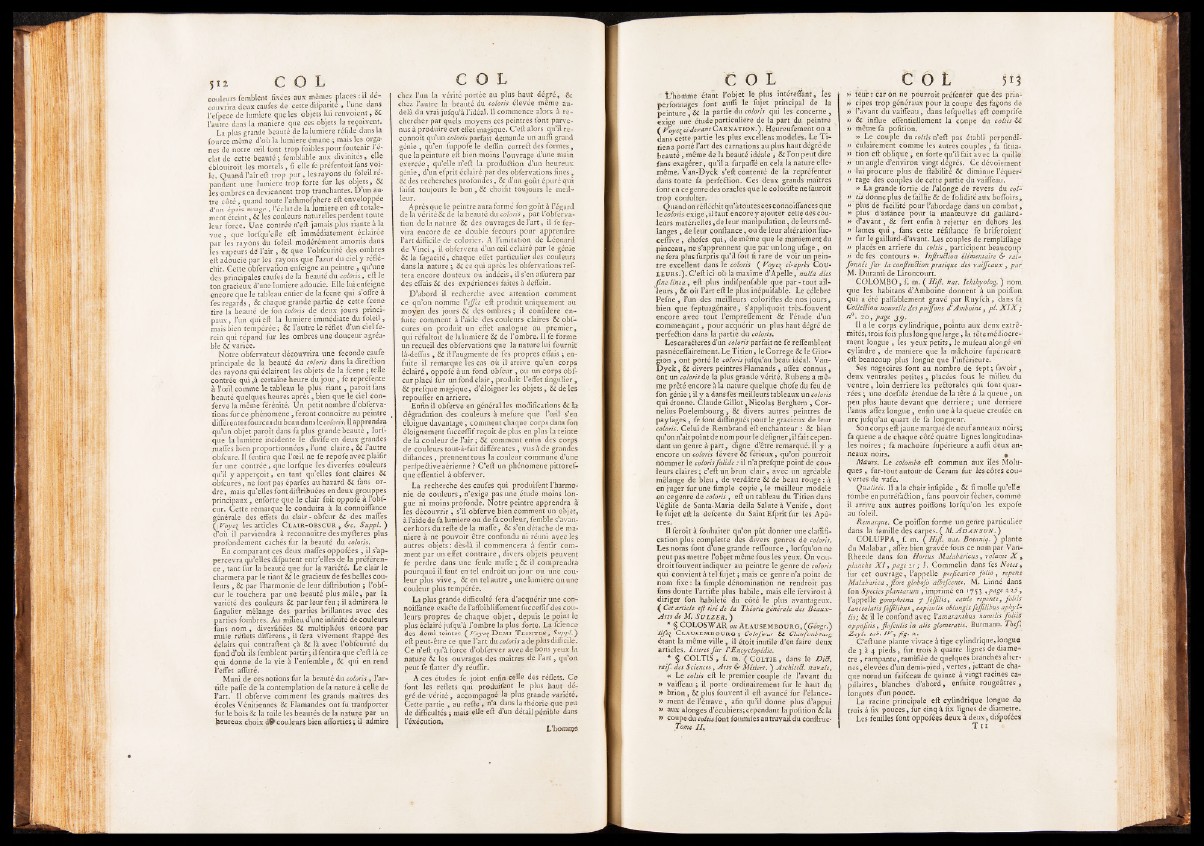
couleurs femblent fixées aux mêmes places : il découvrira
deux caufes de cette clifparite , l’une dans
l’efpece de lumière que les objets lui renvoient, 6c
l’autre dans la maniéré que ces objets la reçoivent.
La plus grande beauté de la lumière réfide dans la
fource même d’où la lumière émane ; mais les orga-
nés de notre oeil font trop foibles pour foutenir 1 e-
clat de cette beauté ; femblable aux divinités, elle
éblouiroit les mortels, fi elle fe préfentoit fans voile.
Quand l’air eft trop pu r, les rayons du foleil répandent
une lumière trop forte fur les objets, 6C
les ombres en deviennent trop tranchantes. D un autre
cô té, quand toute l’athmofphere eft enveloppée
d’un épais nuage , l’éclat de la lumière en eft totalement
éteint, 6c les couleurs naturelles perdent toute
leur force. Une contrée n’eft jamais plus riante à la
v u e , que lorfqu’elle eft immédiatement éclairée
par les rayons du foleil modérément amortis dans
les vapeurs dé l’air , 6c que l’obfcurité des ombres
eft adoucie par les rayons que l’azur du ciel y réfléchit.
Cette obfervation enfeigne au peintre , qu’une
des principales caufes de la beauté du coloris, eft le
ton gracieux d’une lumière adoucie. Elle lui enfeigne
encore que le tableau entier de la fcene qui s’offre à
fes regards, & chaque grande partie de cette fcene
tire la beauté de fon coloris de deux jours principaux
, l’un qui eft la lumière immédiate du foleil,
mais bien tempérée ; 6c l’autre le réflet d’un ciel fe-
rein qui répand fur les ombres une douceur agréable
6c variée.
Notre obfervateur découvrira une fécondé caufe
principale de la beauté du coloris dans la dire&ion
des rayons qui éclairent les objets de la fcene ; telle,
contrée qui ,à certaine heure du jou r , fe jæpréfente
à l’oeil comme le tableau le plus riant, paroît fans
beauté quelques heures après, bien que le ciel con-
ferve la même férénité. Un petit nombre d’obferva-
tions fur ce phénomène, feront connoître au peintre
différentes fources du beau dans le coloris. Il apprendra
qu’un objet paroît dans fa plus grande beauté , lorf-
que la lumière incidente le divife en deux grandes
maffes bien proportionnées, l’une claire, 6c l’autre
obfcure. Il fentira que l’oeil ne fe repofe avec plaifir
fur une contrée, que lorfque les diverfes couleurs
qu’il y apperçoit, en tant qu’elles font claires 6c
obfcures, ne font pas éparfes au hazard &c fans ordre
, mais qu’elles font diftribuées en deux grouppes
principaux, enforte que le clair foit oppofé à l’obf-
cur. Cette remarque le conduira à la connoiffance
générale des effets du clair-obfcur 6c des maffes
QVoye^ les articles Clair-obscur , &c. Suppl. )
d’où il parviendra à reconnoître des myfteres plus
profondément cachés fur la beauté du coloris.
En comparant ces deux maffes oppofées , il s’ap-
percevra qu’elles difputent entr’elles de la préférence
, tant fur la beauté que fur la variété. Le clair le
charmera par le riant 6c le gracieux de fes belles couleurs
, 6c par l’harmonie de leur diftribution ; l’obf-
cur le touchera par une beauté plus mâle, par la
variété des couleurs 6c par leur feu ; il admirera le
fingulier mélange des parties brillantes avec des
parties fombres. Au milieu d’une infinité de couleurs
fans nom , diverfifiées 6c multipliées encore par
mille réflets différens, il fera vivement frappé des
éclairs qui contraftent çà 6c là avec l’obfcurité du
fond d’où ils femblent partir ; il fentira que c’ eft là ce
qui donne de la vie à l’enfemble, 6c qui en rend
l ’effet affuré.
Muni de ces notions fur la beauté du coloris, l’ar-
tifte paffe de la contemplation de la nature à celle de
l’art. Il obferve comment les grands maîtres des
écoles Vénitiennes 6c Flamandes ont fu tranfporter
fur le bois 6c la toile les beautés de la nature par un
heureux choix d®1 couleurs bien afforties; il admire
chez l’un la vérité portée au plus haut degré, 6c
chez l’autre la beauté du coloris élevée même au-
delà du vrai jufqu’à l’idéal. Il commence alors à rechercher
par quels moyens ces peintres font parvenus
à produire cet effet magique. C ’eft alors qu’il re-
connoît qu’un coloris parfait demande un auffi grand
génie , qu’en fuppofe le deflin correft des formes,
que la peinture eft bien moins l’ouvrage d’une main
exercée, qu’elle n’eft la production d’un heureux
génie, d’un efprit éclairé par des obfervations fines,
6c des recherches profondes, 6c d’un goût épuré qui
faifit toujours le bon, 6c choifit toujours le meilleur.
Après que le peintre aura formé fon goût à l’égard
de la vérité 6c de la beauté du coloris, par l’obferva-
tion de la nature 6c des ouvrages de l’art, il fe fer-
vira encore de ce double fecours pour apprendre
l’art difficile de colorier. A l’imitation de Léonard
de Vinci, il obfervera d’un oeil éclairé par le génie
6c la fagacité, chaque effet particulier des couleurs
dans la nature ; 6c ce qui après les obfervations ref-
tera encore douteux ou indécis, il s’en affurera par
des effais 6c des expériences faites à deffein.
D ’abord il recherche avec attention comment
ce qu’on nomme l’effet eft produit uniquement au
moyen des jours 6c des ombres ; il confidere en-
fuite comment à l’aide • des couleurs claires 6c obfcures
on produit un effet analogue au premier,
qui réfultoit de la lumière 6ç de l’ombre. Il fe forme
un recueil des obfervations que la nature lui fournit
là-deffus , 6c il l’augmente de fes propres effais ; en-
fuite il remarque les cas où il arrive qu’un corps
éclairé, oppofé à un fond obfcur , ou un corps obfcur
placé fur un fond clair, produit l’effet fingulier ,
6c prefque magique, d’éloigner les objets, 6c de les
repouffer en arriéré.
Enfin il obferve en général les modifications & la
dégradation des couleurs à mefure que l’oeil s’en
éloigne davantage ; comment chaque corps dans fon
éloignement fucceffif reçoit de plus en plus la teinte
de la couleur de l’air ; 6c comment enfin des corps
de couleurs tout-à-fait différentes , vus à de grandes
diftances, prennent tous la couleur commune d’une
perfpeétive aérienne ? C’eft un phénomène pittoref-
que effentiel à obferver.
La recherche des caufes qui produifent l’harmonie
de couleurs, n’exige pas une étude moins longue
ni moins profonde. Notre peintre apprendra à
les découvrir , s’il obferve bien comment un objet,
à l’aide de fa lumière ou de fa couleur, femblé s’avancer
hors du refte de la maffe, 6c s’en détache de maniéré
à ne pouvoir être confondu ni réuni avec les
autres objets : dès-là il commencera à fentir comment
par un effet contraire, divers objets peuvent
fe perdre dans une feule maffe ; 6c il comprendra
pourquoi il faut en tel endroit un jour ou une couleur
plus v iv e , 6c en tel autre, une lumière q u une
couleur plus tempérée.
La plus grande difficulté fera d’acquérir une connoiffance
exaCte de l’affoibliffement fucceffif des couleurs
propres de chaque o b jet, depuis le point le
plus éclairé jufqu’à l’ombre la plus forte. La fcience
des demi-teintes ( Voye{ D emi-T eintes , Suppl. )
eft peut-être ce que l ’art du coloris a de pins difficile.
Ce n’eft qu’à force d’obferver avec de bons yeux la
nature 6c les ouvrages des maîtres de l’art, qu’on
peut fe flatter d’y réuffir.
A ces études fe joint enfin celle des réflets. Ce
font les reflets qui produifent le plus haut degré
de vérité , accompagné la plus grande variété.
Cette partie , au refte , n’a dans la théorie que peu
de difficultés ; mais elle eft d’un detail pénible dans
l’exécution.
L’homme
' t ’hoalme étant l'objet le plus intéreflant, les
berfonnàges font auffi le îiijet principal de la
peinture , & la partie dii colons qui les concerne ,
exige une étude particulière de lâ part du peintre
( Voyt^ci-devant C a r n a t i o n . ) . Heureufement on a
dans cette partie les plus excellens modelés. Le T itien
a porté l’art des carnations au plus haut dégré de
beauté, même de la beauté idéale j 6c l’on peut dire
fans exagérer, qu’il a furpaffé en cela la nature elle-
même. Van-Dyck s’eft contenté de la repréfenter
dans toute fa perfection. Ces deux grands maîtres
font en ce genre des oracles que le eolorifte ne fauroit
trop confultèn
Quand on réfléchît qu’à toutes ces côririoiffances que
le coloris exige, il faut encore y ajouter celle des couleurs
matérielles, de leur manipulation, de leurs mélanges
, de leur confiance, ou de leur altératiôn fuc-
ceffive, chôfes qui, de même que le maniement du
pinceau, ne s’apprennent que par un long ufage , on
ne fera plus furpris qu’il foit fi rare de voir un peintre
excellent dans le coloris ( Voye^ ci-après COULEURS.).
G’eft ici OÙ là maxime d’Apelle, nullâ dus
fine lima , éft plus indifpenfablé que par - tout ailleurs
, 6c où l’art eft le plus iriépuifable. Le célébré
Pefne , l’un des meilleurs coloriftes de nos jours y
bien que feptuagénàire, s’appliquoit très-fouvent
encore avec tout l’empreffement 6c l’étude d’uct
commençant, pour acquérir un plus haut dégré de
perfeélion dans la partie du coloris.
Lescarafteres d’un coloris parfait rie fe reffemblerit
pas néceffairefnent. Le T itien, le Correge 6c le G ior-
gion , ont porté le coloris jufqü’àu beau idéal. Van-
D y ck , & divers peintres Flamands , affez connus ,
ônt un coloris de la plus grande vérité. Rubens a même
prêté encore à la nature quelque chofe du féu de
fon génie ; il y a dans fes' meilleurs tableaux un coloris
qui étonne. Claude G illot, Nicolas Berghem , Cornélius
Poelembourg, 6c divers autres peintres de
payfages , fe font diftingués pour le gracieux de leur
coloris. Celui de Rembrand eft enchanteur : 6c bien
qu’on n’ait point de nom pour le défigner, il fait cependant
un genre à part, digne d’être remarqué. Il y a
encore un coloris févere 6c férieux, qu’on pOurroit
nommer le coloris folide : il n’a prefque point de couleurs
claires ; c’eft un brun clair, avec un agréable
mélange de bleu , de verdâtre & de beau rouge : à
en juger fur une fimple copie , le meilleur modèle
en ce genre de coloris, eft un tableau du Titien dans
l’églife de Santa-Maria délia Salute à Venife, dont
le fujet eft la defcente du Saint Efprit fur les Apôtres.
Il feroît à fouhaiter qu’on pût donner une claflîfi-
cation plus complette des divers genres de coloris.
Les noms font d’une grande reffource, lorfqu’on ne
peut pas mettre l’objet même fous les yeux. On vou-
droit fouvent indiquer au peintre le genre de coloris
qui convient à tel fujet ; mais ce genre n’a point de
nom fixe : la fimple dénomination ne rendroit pas
fans doute l’artifte plus habile, mais elle ferviroit à
diriger fon habileté du côté le plus avantageux.
( Cet article eft tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts de M. SüLZER. )
* § COLOSWAR ou A l a u s e m b o ü r g , (Gèogr.)
life£ CLAUSEMBOURG ; Coloflvar 6c Claufembourg
étant la même ville , il étoit inutile- d’en faire deux
articles. Lettres fur VEncyclopédie.
* § COLTIS , f . m. ( C o l t i e , d an s le Di&.
raift des Sciences, Arts & Métiers. ) Archit'ecl. navale.
« Le coltis eft le premier couple de l’avant du
» vaiffeau ; il porte ordinairement fur le haut du
» brion, 6c plus fouvent il eft avancé fur l’élance-
» ment de l’étrave, afin qu’il donne plus d’appui
» aux alonges d’écubiers; cependant la pofition & la
» coupe du coltis font foumifes au travail du conftruc-
Tome I L
» téur : car on ne poürroit préfenter que des prin-
>> cipes trop généraux pour la coupe des façons dë
>5 l’avant du vaiffeau , dans lefquellefc eft comprife
>> 6c influe effentielleriient la coupe du coltis 6c
» thème fa pofition.
p Le couple du coltis n’ eft pas établi perpendî-
» cülairement comme les autres couples , fa fitua-
» tion eft obliqtte ; en forte qu’il fait a vet la quille
» un angle d’environ vingt degrés. Ce dévoiement
» lui procure plus dé Habilité & diminue l’équer-
» rage des couples de cette partie du vaiffeau.
» La grande fortie de.l’alonge de rëvers du col-
» tis donne plus de faillie 6c de fôlidité aux boffoirs,
» plus dë facilité pour l’abordage dans uri combat,
» plus d’aifânce pour la manoeuvre du gaillard-
» d’avant, 6c fert enfin à rejetter en dehors les
» lames q u i, fans cette réfiftance fe briieroient
» fur le gaillard-d’avant. Les couples de rempliffage
» placés en arriéré du coltis, participent beaucoup
>> de fes contours »: Inflruclion élémentaire & rai-
fonnée fur la conftruclion pratique des vaijfeaux , par
M. Duranti de Lironcourt.
COLOMBO, f. m. ( Hiß. haï. ichthyolog. ) nom
que les habitans d’Amboine donnent à un poiffori-
qui a été paffablement gravé par Ruÿfch, dans fa
Collection nouvelle des poiflbns d’Amboine, pl. X I X ;
i o , page 3$. , ■ a
Il a le corps cylindrique, pointu aux deux extrê-
riiités, irois fois plus long que large, la tête médiocre-:
ment longue * les yeux petits, le mufeau alongé eri
cylindre , de manière que la mâchoire fupérieure
eft beaucoup plus longue que. l’inférieure.
Ses nageoires font au noinbre de fept ; fâvoir ,
deux ventrales petites j placées fous le milieu du
ventre, loin derrière les peCtoralés qui font quar-
réës ; une dorfale étendue de la têtè à la qUéue, un
peu plus hàute devant que derrière ; une derrière
l’anus affez longue, enfin une à la queue creufée en
arc jufqu’au quart de fa longueur.
Son corps eft jaune marqué de neuf anneaux noirs;
fa queUe a de chaque côté quatre lignes longitudinales
noires ; fa mâchoire fupérieure a auffi deux anneaux
noirs. •
Moeurs. Le Colombo, eft commun aux îles Molu-
ques , fur-tOut autour de Ceram fur les côtes couvertes
de vafe.
Qualités. Il a la chair infipide , 6c fi tnolle qu’elle
tombe enputréfaftion, fans pouvoir fécher, comme
il arrive aux autres poiffons lorfqu’on les expofë
au foleil.
Remarque. Ce poiffon forme un gèrire particulier
dans la famille des carpes. ( M. A d a n s o n . )
COLUPPA, f. m. ( Hißi nat. Botaniq. ) plante
du Malabar, affez bien gravée fous ce nom par Vari-
Rheede dans fon Hortus Malabaricus, volume X $
planche X I , page z i ; J. Commelin dans fes Notes,
fur cet ouvrage, l’appelle perficarico fo lio , repens
Malabarica, flore glnbofo albefcentt. M. Linné danà
fon Speciesplantarum , imprimé en 1753 1 PaSe ^25,
l’appelle gomphrena y fejfllis, caule repente, fohis
lanceolatis feffllibus , capitulis oblongis fejjilibus aphyl-
lis; 6c il le confond avec 1’amarantkits humilis foliist
oppofitis, flofculis in ails glornerdtis. Burmanri. Thef
Zeyl. tab. II^, fig. 2.
C ’eft une plante vivace à tige cylindrique, longue
de 3 à 4 pieds, fur trois à quatre lignes de diamètre
, rampante,ramifiée de quelques branchés alternes,
élevées d’un demi-pied, vertes, jetrant de chaque
noeud un faifceau de quinze à vingt racines capillaires,
blanches d’abord, enfuite rougéâtres *
longues d’uri pouce. ( .
La racine principale eft cyliridtique longue de
trois à fix pouces, fur cinq à fix lignes de diamètre.
Les feuilles fönt oppofées deux à deux, difpofées
T t t