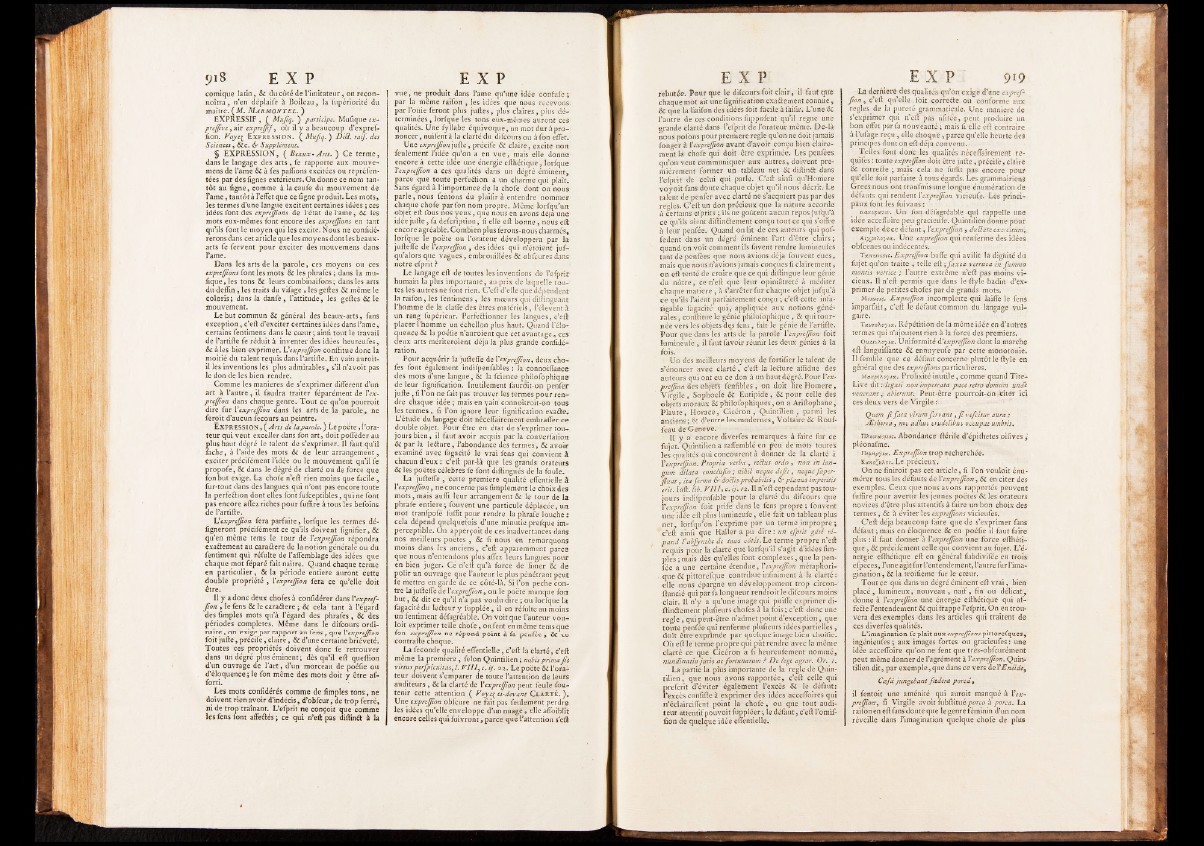
comique latin, & du côté de l’imitateur, on recon-
noîtra, n’en dëplaife à Boileau, la fupériorité du
maître. (AL Ma r m o n t e l . )
EXPRESSIF , ( Mujiq. ) participe. Mufique ex-
prejjive, air txprejjif, oit il y a beaucoup d’expref-
fion. Voyt{ Expression. ( Mujiq. ) Dicl. raif. des
Sciences, &c. 6* Supplément.
§ EXPRESSION, ( Beaux-Arts. ) Ce terme,
dans le langage des arts, fe rapporte aux mouve-
mens de l’ame 6c à Tes pallions excitées ou repréfen-
tées par des (ignés extérieurs. On donne ce nom tantôt
au (igné, comme à la caufe du mouvement de
l’ame, tantôt à l’effet que ce (igné produit. Les mots,
les termes d’une langue excitent certaines idées ; ces
idées font des exprejjions de l’état de l’ame, 6c les
mots eux-mêmes font encore des exprejjions en tant
qu’ils font le moyen qui les excite. Nous ne confidé-
rerons dans cet article que les moyens dont les beaux-
arts fe fervent pour exciter des mouvemens dans
l’ame.
Dans les arts de la parole, ces moyens ou ces
exprejjions font les mots 6c lesphrafes ; dans la mu-
iique, les tons 6c leurs combinaifons ; dans les arts
du deflin , les traits du v ifage, les geftes 6c même le
coloris ; dans la danfe , l’attitude, les geftes 6c le
mouvement.
Le but commun 6c général des beaux-arts, fans
exception, c’eft d’exciter certaines idées dans l’ame,
certains fentimens dans le coeur; ainfi tout le travail
de l’artifte fe réduit à inventer des idées heureufes,
& à les bien exprimer. Vexprejjion conftitue donc la
moitié du talent requis dans l’artifte. En vain auroit-
il les inventions les plus admirables, s’il n’avoit pas
le don de les bien rendre.
Comme les maniérés de s’exprimer different d’un
art à l’autre, il faudra traiter féparément de YexpreJJion
dans chaque genre. Tout ce qu’on pourroit
dire fur YexpreJJion dans les arts de la parole, ne
feroit d’aucun fecours au peintre.
Expression , ( Arts de la parole. ) Le poëte, l’orateur
qui veut exceller dans fon art, doit pofféder au
plus haut degré le talent de s’exprimer. Il faut qu’il
lâche, à l’aide des mots 6c de leur arrangement,
exciter précifément l’idée ou le mouvement qu’il fe
propofe, 6c dans le dégré dé clarté ou de force que
fon but exige. La chofe n’eft rien moins que facile ,
fur-tout dans des langues qui n’ont pas encore toute
la perfeâion dont elles font fufceptibles, qui ne font
pas encore affez riches pour fuffire à tous les befoins
de l’artifte.
L'exprejjion fera parfaite, lorfque les termes dé-
figneront précifément ce qu’ils doivent lignifier, &
qu’en même tems le tour de YexpreJJion répondra
exactement au caraâere de la notion générale ou du
fentiment qui réfulte de l’affemblage des idées que
chaque mot féparé fait naître. Quand chaque terme
en particulier, & la période entière auront cette
double propriété , YexpreJJion fera ce qu’elle doit
être.
Il y a donc deux chofes à confidérer dans Yexpref-
Jion , le fens & le caraâere ; & cela tant à l’égard
des Amples mots qu’à l’égard des phrafes, 6c des
périodes complétés. Même dans le difcours ordinaire
, on exige par rapport au fens, que YexpreJJion
foit jufte, précife, claire, 6c d’une certaine brièveté.
Toutes ces propriétés doivent donc fe retrouver
dans un dégré plus éminent ; dès qu’il eft queftion
d’un ouvrage de l’a r t , d’un morceau de poéfie ou
d’éloquence ; le fon même des mots doit y être af-
forti.
Les mots confidérés comme de (impies tons, ne
doivent rien avoir d’indécis, d’obfcur, de trop ferré,
ni de trop traînant. L’efprit ne conçoit que comme
les fens font affeôés ; ce qui n’eft pas diftinft à la
v u e , ne produit dans l’ame qu’une idée confufe ;
par la même raifon , les idées que nous recevons,
par l’oùie feront plus juftes, plus claires, plus déterminées
, lorfque les tons eux-mêmes auront ceS'
qualités. Une fyllabe équivoque, un mot dur à prononcer
, nuifent à la clarté du difcours ou à fon effet.
Une expreJJion)wft.Q, précife 6c claire, excite non
feulement l’idée qu’on a en vu e , mais elle donne
encore à cette idée une énergie efthétique, lorfque
YexpreJJion a ces qualités dans un dégré éminent,
parce que toute perfeâion a un charme qui plaît.
Sans égard à l’importance de la chofe dont on nous
parle, nous fentons du plaifir à entendre nommer
chaque chofe par fon nom proprè. Même lorfqu’un
objet eft fous nos yeux, que nous en avons déjà une
idée jufte, fa defcription, fi elle eft bonne , nous eft:
encore agréable. Combien plus ferons-nous charmés,
lorfque le poëte ou l’orateur développera par la
juftefle de YexpreJJion , des idées qui n’étoient juf-
qu’alors que vagues, embrouillées & obfcures dans
notre efprit ?
Le langage eft de toutes les inventions de l’efprit
humain la plus importante, au prix de laquelle toutes
les autres ne font rien. C ’eft d’elle que dépendent
la raifon, les fentimens , les moeurs qui dirtinguant
l’homme de la clalfe des êtres matériels, l’élevent à
un rang fupérieur. Perfectionner les langues, c’efl:
placer l ’homme un échellon plus haut. Quand l’éloquence
6c la poéfie n’auroient que cet avantage., ces
deux arts mériteroient déjà la plus grande confédération.
Pour acquérir la juftefle de YexpreJJion, deux chofes
font également indifpenfables : la connoiffance
des mots d’une langue, 6c la fcience philofophique
de leur lignification. Inutilement fauroit-on penlèr
jufte , fi l’on ne fait pas trouver les termes pour rendre
chaque idée; mais en yain connoîtroit-on tous
les termes, fi l’on ignore leur lignification exaCie*
L’étude du langage doit néceflairement embraffer ce
double objet. Pour être en état de s’exprimer toujours
bien, il faut avoir acquis par la converfation
6c par la leCture, l’abondance des termes, 6c avoir
examiné avec fagacité le vrai fens qui convient à
chacun d’eux: c’eft par-là que les grands orateurs
& les poëtes célébrés fe font diftingués de la foule.
La juftefle , cette première qualité effentielle à
YexpreJJion, ne concerne pas Amplement le choix des
mots, mais aufli leur arrangement & le tour de la
phrafe entière*fouvent une particule déplacée, un
mot tranfpofé fuffit pour rendre la phrafe louche :
cela dépend quelquefois d’une minutie prefque imperceptible.
On apperçoit de ces inadvertances dans
nos meilleurs poëtes , 6c fi nous en remarquons
moins dans les anciens, c’eft apparemment parce
que nous n’entendons plus affez leurs langues pour
en bien juger. Ce rï’eft qu’à force de limer 6c de
polir un ouvrage que l’auteur le plus pénétrant peut
fe mettre en garde de ce' côté-là. SiTon peche contre
la juftefle de Y exprejjion, ou le poëte manque forr
but, 6c dit ce qu’il n’a pas voulu dire ; ou lorfque la
fagacité du leCteur y fupplée, il en réfulte au moins
un fentiment défagréable. On voit que l’auteur vouloir
exprimer telle chofe, on fent en même’ tems que
fon exprejjion ne répond pôint à fa penfée, 6c ce
contrafte choque.
La fécondé qualité effentielle, c’eft la clarté, c’efl:
même la première, félon Quintilien ; nabis prima Jit
virtusperfpicuitasy l. V I I J c. ij. 22. Le poëte & l’orateur
doivent s’emparer de toute l’attention de leurs
auditeurs , & la clarté de l’exprejjion peut feule fbu-
tenir cette attention ( Voye^ ci-devant C larté. ) .
Une exprejjion obfcure ne fait pas feulement perdre
les idées qu’elle enveloppe d’un nuage, elle affoiblit
encore celles qui fuivront, parce que l’attention s'eft
rebutée. Pour que le difcours; foit clair, il faut que
chaque mot ait une fignification exactement connue,
&c que la liaifon des idées foit facile à faifir. L’une 6c
l’autre de ces conditions fuppofent qu’il régné une
grande clarté dans l’efprit de l’orateur même. De-là
nous pofons pour première réglé qu’on ne doit jamais
fonger à YexpreJJion avant d’avoir conçu bien clairement
là chofe qui doit être exprimée. Les penfées
qti’on veut communiquer aux autres; doivent premièrement
former un tableau net 6c diftinCt dans
l’efprit dé celui qui parle. C’eft ainfi qu’Homere
voyoit fans doute chaque objet qu’il nous décrit. Le
talent de pènfer avec clarté ne s’acquiert pas par des
réglés. Ç ’eft un don précieux que la nature accorde
à certains efprits ; ils ne goûtent aucun repos jufqu’à
ce qu’ils aient diftinCtement conçu tout ce qui s’offre
à leur penfée. Quand on lit de ces auteurs qui pof-
fedent dans un dégré éminent l’art d’être clairs;
quand on voit comment ils favent rendre lumineufes
tant de penfées que nous avions déjà fouvent eues,
mais que nous n’avions jamais conçues fi clairement,
on eft tenté de croire que ce qui diftingue leur génie
du nôtre, ce n’eft que leur opiniâtreté à méditer
chaque matière , à s’arrêter fur chaque objet jufqu’à
ce qu’ils l’aient parfaitement conçu ; c’eft cette infatigable
fagacité qui,- appliquée aux notions générales,
conftitue le génie philofophique, & qui tournée
vers les objets de(s fens * fait le génie de l’artifte.
Pour que dans les arts de 1a- parole Y exprejjion foit
lumineufe , il faut favoir réunir les deux génies à la
fois.
Un des meilleurs moyens de fortifier le talent de
s’énoncer avec clarté, c’eft la leâure aflidue des
auteurs qui ont eu ce don à un haut dégré. Pour YexpreJJion
des objSfs fenfibîes, on doit lire Homere,
Virgile, Sophocle 6c Euripide, 6c pour celle des
objets moraux & philofophiqués, on a Ariftophane,
Plaute, Horace, Cicéron , Quintilien , parmi les
anciens; & d’entre les modernes, Voltaire & Rouf-
feaii de Geneve.
Il y a‘ encore diverfes remarques à faire fur ce
fujet. Quintilien a raffemblé en peu de mots toutes
tes qualités qui concourent à donner de la clarté à
YexpreJJion. Propria ver b a , reclus ordo , non in lon-
gum dilata conclujio ; nïhil neqüe défit, neque fuper-
jlu a t, ita ferma & doclis prohabilis , & planus imperitis
erit. Inft. lib. V I I I , c. ij. 12. Il n’eft cependant pas toujours
indifpenfable pour la clarté du difcours que
YexpreJJion foit prife dans le fens propre ; fouvent
line idée eft plus lumineufe, elle fait un tableau plus
net, lorfqu?on l’exprime par un terme impropre ;
"c ’eft ainfi que Haller a pu dire: un efprit gâté répand
Vabfynthe de tous côtés. Le terme propre n’eft
requis pour la clarté que lorfqu’il s’agit d’idées Amples
; mais dès qu’elles font complexes, que la1 penfée
a une certaine étendue, Yexprejfoh métaphori-
. que 6c pittorefque contribue infiniment à la clarté:
elle nous'épargne un développement trop circon-'
ftancié qui par fa longueur rendroit le difcours moins
clair. Il n’y a qu’une image qui puiflè exprimer di-
llinâement plufieurs chofes à la fois ; c’eft donc une
réglé, qui peut-être n’admet point d’exception, que
toute penfée qui renferme plufieurs idées partielles,
doit être exprimée par quelque image bien choifie.
Oîi eft le terme propre qui pût rendre avec la même
clarté ce que Cicéron a fi heureufement nommé,
nundinatio juris ac fortunarum ? D e lege agrar. Or. /.
La partie la plus importante de la réglé de Quintilien
, que nous avons rapportée, c’efl: celle qui
preferit d’éviter également l’excès 6c le défaut:
l’excès confifte à exprimer des idées acceffoires qui
n’édairciffent point la chofe , ou que tout auditeur
attentif pouvoit fuppléer ; le défaut, c’eft l’omif-
fion de quelque idée effentielle.
•La derniere des qualités qu’on exige d’une exprep
Jion, c’eft qu’elle . foit eorreâe ou cohforme aux
réglés de la pureté grammaticale. Une maniéré de
s’exprimer qui ri’eft' pas ïifitée , peut produire un
bon effet par fa nouveauté ; mais fi elle eft contraire
à l’ufage reçu, elle choqué -, parce qu’elle heurte des
principes dont.on eft déjà convenu. •
Telles font don'c les qualités néceflairement re-
quifes : toute exprejjion doit être jufte -, précife, claire
6c correde ; mais cela-ne fuffit pas encore pour
qu’elle foit parfaite à tou? égards. Les grammairiens
Grecà nous ont tranfmis une longue énumération de
défauts qui rendent YexpreJJion vicieule^-Lès principaux
font lés fuivans : •
Ka.y.oçctTov. Un fon défagréable-qui rappelle une
idée acceffoire peu gracieiife. Quintilien donne pour
exemple dé ce défaut, YexpreJJion, duclâre exercitüm.
Aixfo^o-y/a. Une exprejjion qui renferme des idées
obfcenes ou indécentés.
TctTnivoiTiç. Exprejjion baffe qui avilit la dignité dii
fujët qu’on traite , telle eft ; faxea verruca in fummo
montis vertice ; l’autre extrême n’eft pas moins vicieux.
Il n’eft permis que dans le ftyle badin d’exprimer
de petites chofes par de grands mots.
Muutrfç. Exprejjion incomplette qui laiffe le fens
imparfait, c’eft le défaut commun du langage vul-
gaire.
. TctuToXoyia. Répétition de la même idée en d’autres
termes qui n’ajoutent rien à la force des premiers.
OuoioXoyict. Uniformité à.'exprejjion dont la marche
eft languiffante 6c ennujreufe par cette monotonie.
Il femble que ce défaut concerne'plutôt le ftyle en
général que des exprejjions particulières.
mcMpoXoyicL. Prolixité inutile', comme quand Tite-
Live dit :>legati non impetrata pacè rétro donïutn undé
vénérant r abierunt. Peut-être pourroit-on êitér ici
ces deux vers de Virgile M
Qjuem J i fata virürnfervant , f i vefeitur aura :
Ætherea , nec adhuc crudelibus occupât umbris.
uxiovd<Tfxaç. Abondance ftérile d’épithetes oifives
pléonafm;e.
ritpnpfia. Exprejjion trop recherchée.
Kcwot'nXov. Le précieux.
On ne finiroit pas cet article, fi l’on vouloit énumérer
tous les défauts de YexpreJJion, 6c en citer des
• exemples. Ceux que nous avons rapportés peuvent
fuffire pour avertir les jeunes poëtes 6c les orateurs
novices d’être plus attentifs à faire un bon choix des
termes, 6c à éviter les exprejjions viciéufes.
C ’eft déjà beaucoup faire que dé s’exprimer fans
défaut ; mais en éloquence & en poéfie il faut faire
plus : il faut donner à YexpreJJion une force efthétique,
6c précifément celle qui convient au fujet. L’énergie
efthétique eft en général fubdivifée en trois
efpeces , l’une agit fur l’entendement, l’autre fur l’imagination,
6c la troifieme fur le coeur.
Tout ce qui dans un dégré éminent eft v rai, bien
placé, lumineux, nouveau , naïf, fin ou délicat,
donne à YexpreJJion une énergie efthétique qui af-
feâe l’entendement & qui frappe l’efprit. On ën trouvera
des exemples dans les articles qui traitent de
ces diverfes qualités.
L’imagination fe plaît aux exprejjions pittorefques ,
ingénieufes ; aux images fortes ou gracieufes: une
idée acceffoire qu’on ne fent que très-obfcurément
peut même donner de l’agrément à Y exprejjion. Quintilien
dit, par exemple,que dans ce vers deYEnéide,
Cafd jungebant fotdera porca ,
il fentoit une aménité qui auroit manqué à YexpreJJion,
fi Virgile avoit fubftitué porco à porca. La
raifon en eft fans doute que le genre féminin d’un nom
réveille dans l’imagination quelque chofe de plus